Ce sera 64 ans. Le 10 janvier dernier sitôt le recul de l’âge légal de départ à la retraite officialisé par la première ministre française, Olivier Blanchard se demandait : « Pourquoi le gouvernement risquerait-il les grèves et une perte de capital politique, pour pousser une réforme dont la France n’a pas besoin ? » Les réponses au tweet de l’économiste insistèrent alors sur le besoin de complaire aux marchés financiers – pour attirer des capitaux – et à l’Union européenne – pour bénéficier du fonds de relance. Mais dès le 17 octobre 2022 Bruxelles s’était défendu de conditionner le déblocage des aides à une refonte du système de pension (1). Ni pur assujettissement, ni simple dialogue technique, en quoi consistent exactement les rapports des gouvernements aux bureaucraties – publiques ou privées, nationales ou européennes – qui suivent, influencent ou coproduisent leurs politiques publiques ? Revenir à la séquence dans laquelle s’insère l’annonce de Mme Élisabeth Borne permet de mieux le saisir ; pour constater le règne de la connivence experte, de l’argument d’autorité, au détriment du débat public comme de la délibération parlementaire.
À la suite du krach financier de 2008, alors que débutait la crise des dettes souveraines, le Conseil européen a instauré en 2010 un espace de discussion entre les gouvernements de l’Union, appelé « semestre européen », afin de mieux coordonner leurs politiques budgétaires, économiques et sociales. Chaque année, il s’ouvre avec la publication du « paquet d’automne », qui comprend un diagnostic pays par pays. Au printemps suivant, la Commission adresse des orientations aux exécutifs nationaux, en vue de l’élaboration de leurs programmes dits de stabilité (sur les trajectoires budgétaires) et de réformes (sur la compétitivité), tous deux présentés en avril. Le collège des commissaires fait alors paraître en mai des rapports sur chaque situation nationale et peut formuler des recommandations, à adopter lors du Conseil de l’Union européenne de juillet. Ce calendrier instaure une forme de circularité technocratique : les gouvernements s’obligent à respecter les préconisations qu’ils contribuent à rédiger. Nulle contrainte de la Commission. En mai 2022, elle s’en est tenue à suggérer que la France réforme son « système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite afin de renforcer l’équité du système tout en soutenant sa durabilité ». Puis le Conseil de l’Union européenne – composé des ministres des États membres – a adopté cette recommandation, déjà formulée en 2019 (2). Du reste, ce ne sont pas « la France », ni même « le gouvernement français », ni « la Commission » qui interviennent et négocient. Au détriment de ceux chargés de l’écologie ou du social, des secteurs bureaucratiques particuliers dominent le jeu bruxellois. Les recommandations adoptées au Conseil de l’Union par les ministres du travail (à la majorité qualifiée) respectent par exemple les « lignes directrices intégrées » (LDI), arrêtées par des instances où ne siègent que des représentants des ministères des finances, de la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission (DG Ecfin), des banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE). Tous instruits par une même doxa macroéconomique et budgétaire.
Pantouflages
Au cours du conflit sur les retraites, sans surprise, ce pôle économique et financier a ardemment appuyé le gouvernement français. Ainsi, selon M. Maarten Verwey, directeur de la DG Ecfin, ancien du Trésor néerlandais, le projet de loi se justifiait par le «vieillissement de la population qui pèsera de plus en plus sur le budget des États » (Le Monde, 14 mars 2023). Sa prise de position faisait écho à celles de M. Pierre Moscovici : le 25 janvier, devant l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie de M. François Hollande (2012-2014), commissaire aux affaires économiques sous M. Jean-Claude Juncker (2014-2019), avait encore soutenu que, « s’il n’y avait pas de réforme des retraites, alors à ce moment-là la dette [augmenterait] de manière significative d’ici à 2027 ». Devant la commission des finances, M. Moscovici ne défendait pas les menées du gouvernement français en sa qualité de premier président de la Cour des comptes – légation parisienne de l’orthodoxie bruxelloise – mais de président du Haut Conseil des finances publiques (HCFP). Créée en 2012 pour conformer le droit français au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), cette « institution budgétaire indépendante » veille au respect des engagements européens. Dans ses avis, elle doit dénoncer le moindre écart dans la trajectoire de « retour à l’équilibre des comptes publics », un objectif inscrit en 2008 à l’article 34 de la Constitution. Son collège réunit des magistrats de la Cour des comptes et des personnalités extérieures, notamment Mme Sandrine Duchêne – une ancienne cadre du Trésor qui pantoufle au Crédit mutuel –, Mme Michala Marcussen – dirigeante de la Société générale –, Philippe Martin – économiste gouvernemental, membre du cabinet de M. Emmanuel Macron à Bercy – et, figure du camp minoritaire, le chercheur Michaël Zemmour (3).
Davantage de procédures, des règles plus strictes, de nouvelles institutions. Depuis une vingtaine d’années, en France comme en Europe, tout renforce la technocratie financière; tout conforte ses représentants, qui tirent avantage de jouer la même partition, dans le même tempo. Le 5 juillet dernier, M. Moscovici présentait un rapport sur la situation des finances publiques au Sénat. Alors que la bataille des retraites tirait à sa fin, en préconisant « un effort substantiel », le premier président de la Cour des comptes validait l’austérité générale annoncée par Bercy quelques semaines auparavant – diminution des dépenses de l’État de 0,8 %, de celles des collectivités de 0,5 % – et anticipait le durcissement du « pacte budgétaire » annoncé fin avril par son successeur à Bruxelles, M. Paolo Gentiloni. Désormais, un État membre dont le déficit public dépassera les 3 % devra procéder à un ajustement budgétaire minimal correspondant à 0,5 % de son produit intérieur brut (PIB) (4). Autant de coupes nationales dans les prestations, mais aussi dans les investissements, les recrutements et les services publics. De quoi relativiser le pacte vert pour l’Europe ou la « soutenabilité » socio-environnementale chère à l’Union. Ce conclave technocratique et financier peut en outre contourner la démocratie – parlementaire ou sociale, nationale ou européenne – grâce à l’appui d’acteurs internationaux, non moins bureaucratiques. Après avoir consacré en décembre 2022 une étude à l’« amélioration des régimes par capitalisation (5) », l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a elle aussi défendu la réforme hexagonale de 2023. Son secrétaire général, ancien ministre du budget australien, M. Mathias Cormann, a repris le 17 mars dernier lors d’une conférence de presse les éléments de langage de Mme Borne et de ses ministres : « Nous vivons plus vieux et vivons plus vieux en meilleure santé », c’est pourquoi « il nous faut accepter de travailler un peu plus longtemps ». Alors même que dans plusieurs pays membres de son organisation l’espérance de vie en bonne santé régresse ou stagne, et sans tenir compte des gains de productivité entre générations, M. Cormann appelait le gouvernement français à « rester sur sa ligne et aller jusqu’au bout ». Mais les instances internationales exercent également des pressions plus directes : sur proposition de la Commission, la formation « affaires économiques et financières » du Conseil de l’Union européenne (ou Conseil Ecofin) peut adresser à des pays qui sortiraient des clous des recommandations don le publicité, expliquent les politistes Guillaume Sacriste et Antoine Vauchez, suffit à « déclencher le jugement des marchés financiers et des agences de notation (6) ». Pour faire adopter sa réforme, le président Macron a cru bon d'agiter cette menace : le 16 mars dernier en conseil des ministres, il justifiait le recours aux dispositions du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution en soutenant que «les risques financiers, économiques [étaient] trop grands »
Les retraites en ligne de mire
La modicité de l’économie annoncée (13,5 milliards d’euros en 2030) rapportée au montant de la dette française (3 000 milliards d’euros) n’a échappé à personne. En l’espèce, même les opérateurs de marché ont donc trouvé la ficelle un peu grosse. Mais, comme l’explique le politiste Benjamin Lemoine, « puisque le système est désormais financé partiellement par l’impôt et l’emprunt [et non plus seulement par les cotisations sociales], les retraites deviennent vulnérables aux conditions de financement sur les marchés, dont le pouvoir exécutif se fait le porte-parole. La base matérielle de l’ascendant du ministère des finances, la “main droite” de l’État, sur le reste de l’appareil d’État, la “main gauche”, est renforcée. (…) Et l’État se fait providence pour le capital (7) ». Fin avril 2023, l’agence Fitch a abaissé la note française en déplorant « l’impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) », qui « constituent un risque pour le programme de réformes de Macron et pourraient créer des pressions en faveur d’une politique fiscale plus expansionniste ou d’une remise en cause des réformes précédentes » (8). Ce jeu de célébration et de dénigrement croisés confirme le poids des marchés, qui trouvent dans les bons du Trésor un actif sans risque, tandis que les bureaucrates des finances les voient comme un outil de domestication de la démocratie. Au sein des technostructures, nationales ou européennes, les secteurs « sociaux » et « environnementaux » n’ont aucune prise sur les choix macroéconomiques. Ils jouent, au mieux, un rôle de gestionnaires de leurs conséquences négatives. Quand ils ne se muent pas à leur tour en sentinelles des opérateurs financiers, mettant en avant dans leurs publications le coût des engagements « sociaux » des États – les pensions à servir aux retraités, les prestations de diverses natures, les traitements des fonctionnaires –, dans la continuité des classements qu’établissait la Banque mondiale avec sa série « Doing Business » – sur les législations les plus propices à l’investissement, et les moins avantageuses pour les salariés – ou des « indicateurs de législation protectrice de l’emploi » de l’OCDE. Emploi, carrière, influence : la haute technocratie financière protège, elle, très bien ses positions, politiques ou personnelles. Et les renforce grâce aux passages par le privé et l’international. Lorsque le conseil de l’OCDE a publié en février 2022 une recommandation favorable à la capitalisation, Mme Laurence Boone exerçait les fonctions de secrétaire générale adjointe de l’organisation (9). Après avoir été pendant deux ans, de 2016 à 2018, cheffe économiste de l’assureur AXA, leader du marché français de l’épargne-retraite. En juillet 2022, M. Macron l’a nommée secrétaire d’État chargée de l’Europe. À la suite des annonces de M. Gentiloni, c’est à elle entre autres, au sein du gouvernement, qu’il incombera de suivre la mise en place des nouvelles règles communautaires en matière de déficit public et d’endettement.
Article du Monde diplomatique du mois d'octobre : https://www.monde-diplomatique.fr/2023/10/GAYON/66178
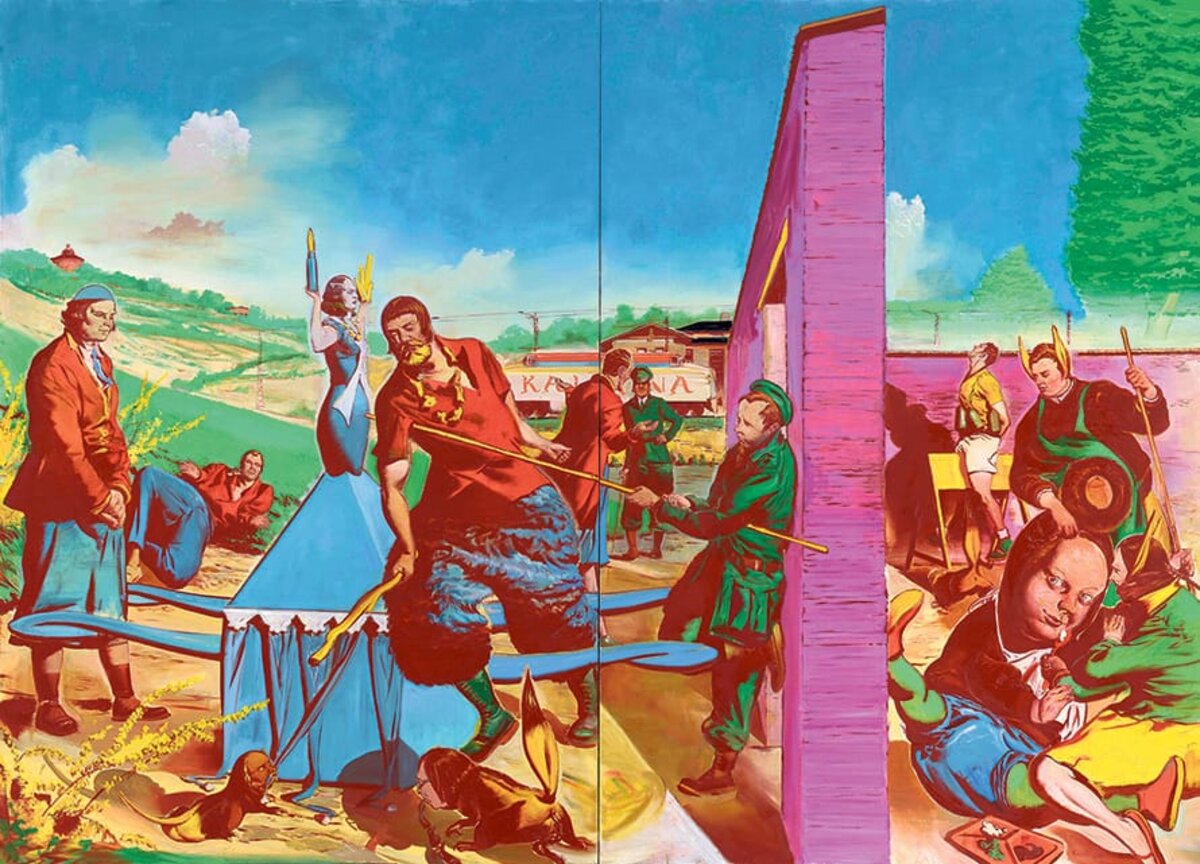
Agrandissement : Illustration 1




