
Docteur en Géographie, Consultant International dans les filières agro-alimentaires, Roland Poupon était à Ottawa pour le Colloque du Conseil Canadien des Etudes sur l'Asie du Sud-Est. Il nous livre ici son compte-rendu des débats.
Tous les deux ans, les chercheurs canadiens en sciences humaine et sociale organisent un colloque pour faire le point de leurs travaux, une occasion d’échanger entre les universités du pays et aussi avec les étudiants d’Asie venus poursuivre leurs études dans les universités du Canada. Après Vancouver en 2011, Montréal en 2013, et bientôt Toronto en 2017, c’était cette année au tour de l’université d’Ottawa d’accueillir l’évènement qui a réuni sur trois journées une centaine d’intervenants en deux sessions plénières et près d’une vingtaine de panels de discussion; autant d’occasions pour les professeurs de présenter leur recherche et pour les étudiants de s’aguerrir à la mise en forme de leurs travaux.
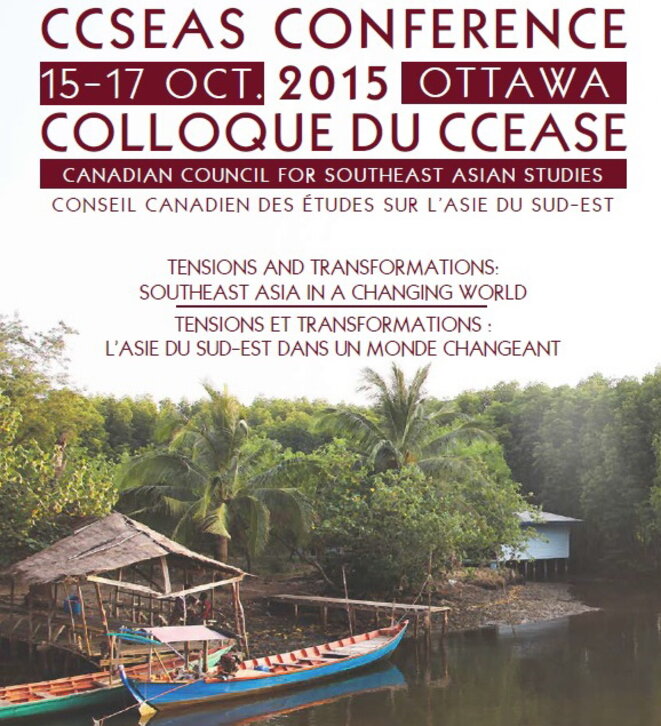
L’essentiel des débats portaient sur des questions de fond tant sur les modes de recherche que sur les évolutions sociétales. Il en ressort que la recherche a de plus en plus d’interactions avec la société qu’elle étudie. Les chercheurs sont impliqués dans les sujets de leur recherche, utilisent des outils modernes comme des drônes pour enquêter sur des plantations ou observer l’évolution de l’habitat. Ils ont recours à internet pour mettre à contribution un maximum de cerveaux sur une thématique.
Les intervenants relèvent que les prévisions alarmistes des décennies passées, annonçant des lendemains cauchemardesques de famine et de guerre, ne se sont pas avérées. Si l’Asie du Sud-Est n’est sans doute pas un paradis, la malnutrition a fortement régressé, la famine été évitée et les conflits armés largement désamorcés. Alors ?! Perplexité du monde de la recherche sur ce qu’il peut apporter, il constate à présent, sans l’expliquer, le nouveau paradoxe d’une déconcentration relative de la population, qui contrairement à ce que l’on clame souvent, est de moins en moins concentrée dans les grandes capitales, conjuguée néanmoins à une urbanisation galopante. Il y a ainsi de moins en moins de paysans, contradiction objective entre concentration et déconcentration[1]. Cette constatation conforte l’idée d’une transition plus douce qu’envisagée d’un exode rural vers des pôles urbains secondaires comme Surabaya, Medan, Pattaya, Chiang Mai, Davao, Ho Chin Minh city … plus pléthore de petites villes. Autre sujet d’étude vu d’Ottawa, la part plus importante que prennent la Chine et l’Inde dans les enjeux locaux que sont l’immigration, l’économie ou les tensions politiques.
La modernisation tranquille de l’Asie du Sud-Est pourrait ne pas durer; les États postcoloniaux, jadis dénoncés comme trop interventionnistes, voire autoritaires, et qui furent importants dans cette évolution, voient à présent leur rôle s’effriter année après année, laissant libre court aux intérêts privés locaux ou étrangers. Ainsi les inégalités croissent et la dégradation de l’environnement prend une ampleur inquiétante. Hier vilipendés pour leurs interventions aux relents nationalistes, ces États se voient désormais dénoncés pour leur laisser-faire. Le trouble des chercheurs est renforcé par les critiques des autochtones, non pas les Premières nations du Canada, mais les sujets étudiés, les asiatiques invités, qui ironisaient et se demandaient comment les Canadiens peuvent produire tant de littérature, au demeurant de grande qualité, sur l’Asie du Sud-Est alors que les chercheurs locaux restent inaudibles sinon improductifs, autre paradoxe qui enlise les échanges comme dans une impasse…

Ceci dit, les universitaires canadiens avaient surtout les esprits braqués sur les élections du lendemain qui devaient voir, à la satisfaction quasi générale des participants, les Conservateurs perdre le contrôle du pays après dix années de pouvoir et de réductions de poste (le recul de l’Etat à nouveau), au profit des Libéraux, qui en Amérique du nord font souvent figure d’infâmes gauchistes (pas certains qu’ils recréent des postes)[2]. Ceci n’affecta pas la qualité des échanges où le doute et la rigueur conduisent les chercheurs de l’Asie du Sud-Est à élargir l’objet de leur recherche dans leur discipline vers le reste du monde, et à envisager la globalité pour mieux cerner le local. Cette perspective ne saurait mieux témoigner de l’ouverture d’esprit des participants ainsi que de leur chaleureuse capacité d’accueil.
[1] A ce sujet, voir l’article de Rodolphe de Koninck de l’université de Montréal Filling in the Marginal Lands. Population Deconcentration in Southeast Asia (with Pham Thanh Hai) Asia Research Institute. Working Paper Series, 2015, No 237
[2] Ironie du calendrier : Le Canada rejoint ainsi quelques pays d’Asie du Sud-Est, Singapour, les Philippines et Singapour en élisant Justin fils de Pierre à la tête de l’état; il n’est pas isolé en Amérique du nord dans cette tendance où la démocratie enfante des dynasties, comme le montre la saga Bush …



