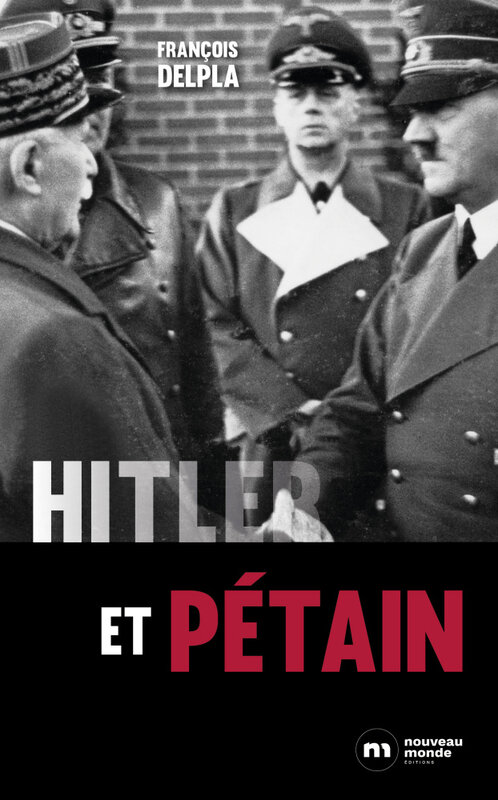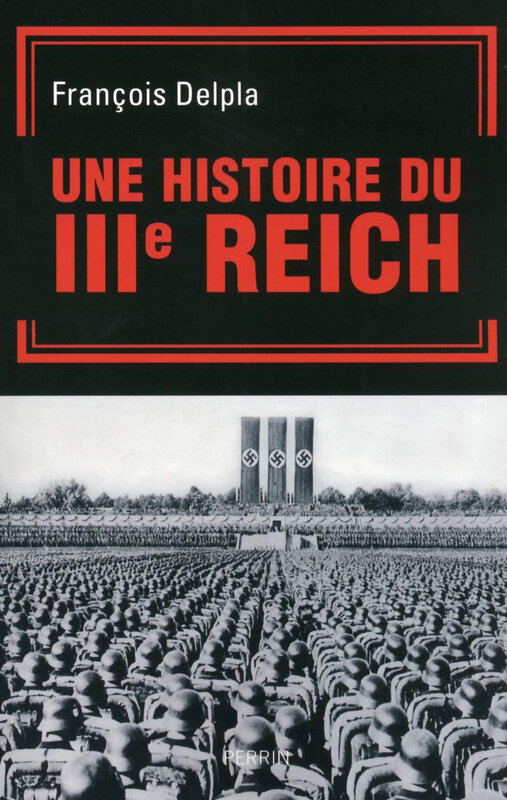
Une histoire du IIIe Reich, Perrin, 2014.
« Le nazisme, sujet vierge... ou presque ! »
Pour soutenir ce titre paradoxal, je commencerai par parcourir les cinquante dernières années, posthumes, de ce mouvement lancé il y a près de cent ans, avant de revenir sur son premier demi-siècle.
Un débat et des hommes
Il est généralement admis qu’un duel entre deux écoles historiographiques s’est engagé dans les années 1960, l’une qui s’intitulait « fonctionnaliste » et l’autre dite « intentionnaliste » (ce mot étant lui-même forgé et propagé par les fonctionnalistes).
Dans le camp fonctionnaliste, on trouvait deux fondateurs allemands, Martin Broszat (1926-1989) et Hans Mommsen (1930-2015), et, outre leurs disciples, de nombreux épigones anglo-saxons (Ian Kershaw, Tim Mason, Christopher Browning…).
Dans la mouvance « intentionnaliste » voisinaient des personnalités diverses, depuis les Allemands Andreas Hillgruber, Klaus Hildebrand et Eberhardt Jäckel jusqu’à l’Américaine Lucy Dawidovicz.
Le duel est censé avoir culminé dans les années 60 et 70, au net avantage du fonctionnalisme. Puis l’heure aurait été à la synthèse.
Conjoncture ou planification ?
Pour les fonctionnalistes, l’idéologie nazie, en raison de son manque de réalisme, a dû, dès le départ, composer avec une réalité qui échappait à ses adeptes, en sorte que toute décision résultait non d’une intention mais d’un compromis entre des idées délirantes et un réel résistant. En conséquence, cette école présente très rarement la politique mise en œuvre sous la direction de Hitler comme le résultat d’une planification. Elle privilégie tantôt les racines sociales et les processus de longue durée, tantôt la conjoncture la plus immédiate, et toujours multiplie les facteurs.
Les « intentionnalistes » sont ceux qui résistent à ce vent dominant en introduisant dans leurs analyses un minimum de continuité. Hélas, seulement un minimum.
Preuves et documents
Les fonctionnalistes sombrent, à chaque pas, dans un défaut de méthode : une déformation de la démarche que deux théoriciens de l’histoire encore très révérés, les Français Langlois et Seignobos, ont prônée à la fin du XIXème siècle sous le nom de « positivisme ». L’histoire, enseignent-ils, s’appuie sur des documents et ne peut rien affirmer sans un répondant documentaire. Les historiens du nazisme ont fort souvent, à propos des questions les plus centrales, imprudemment outrepassé ce conseil de prudence, le transformant en : « pas de document, pas d’événement ». Dans certains cas, cela revient à prêter main-forte aux effaceurs de traces. Tout particulièrement quand on traite du national-socialisme, un régime où le secret, le trompe-l’oeil et le cloisonnement étaient élevés à la hauteur d’un art.
La manœuvre initiale
L’incendie du Reichstag, le 27 février 1933, est l’un des faits les plus saillants de l’histoire du nazisme et l’acte de naissance de cette dictature. Mais il ne saurait, selon l’école fonctionnaliste, être attribué aux nationaux-socialistes puisqu’on ne dispose pas d’un ordre signé par eux à cet effet. Et comme on n’a découvert et châtié qu’un coupable, celui-ci a nécessairement agi seul et de sa propre initiative. Telle est la thèse de « l’acteur unique » Marinus van der Lubbe, popularisée en 1964 par Hans Mommsen dans un article fondateur du courant fonctionnaliste. L’erreur de méthode est patente car les ordres peuvent être donnés oralement, et les indices peuvent être effacés. Le raisonnement doit alors envisager les moyens dont disposaient des commanditaires, ou des complices, pour passer inaperçus.
Dans le cas de cet incendie, ces moyens sont aussi nombreux que faciles à appréhender.
Hitler se place lui-même dans un étau pour accéder au pouvoir
Lors de son accession à la chancellerie, le 30 janvier 1933, Hitler est coincé entre un président, Paul von Hindenburg, qui peut à tout moment le destituer, et un vice-chancelier, Franz von Papen, qui avait recruté et commandé, dans un cabinet précédent, presque tous les autres ministres, à l’exception de celui de l’Intérieur, le nazi Wilhelm Frick, et de Göring, ministre sans portefeuille. Ce dernier est nommé en même temps ministre de l’Intérieur en Prusse, sans abandonner pour autant la présidence du Reichstag, qu’il assurait depuis août 1932.
Hitler commence à desserrer l’étau au bout de 48 heures, en obtenant de Hindenburg le 1er février une dissolution du Reichstag qui n’était pas constitutionnellement nécessaire et n’avait pas été convenue avant sa nomination. L’ouverture d’une campagne électorale augmente considérablement l’importance des ministères de l’Intérieur, au plan national comme à celui de la Prusse. Comme le gouvernement était présenté comme celui de la dernière chance avant une guerre civile, la police était fondée à réprimer quiconque le critiquait, et la campagne en offrait de multiples occasions.
Hitler arrache dans ce sens à Hindenburg, dès le 4 février, un décret que Göring met à profit pour saisir les journaux et interrompre les meetings des partis non gouvernementaux, pas toujours mais souvent. Il décrète même, sans que personne y mette obstacle, que les milices SA et SS peuvent assister la police dans ce « maintien de l’ordre », munies d’un simple brassard.
Puis Göring fait perquisitionner le siège du KPD (le parti communiste allemand), abandonné depuis quelques jours par ses personnels, ce qui ne l’empêche pas d’y trouver des plans de conquête violente du pouvoir, passant par des attaques contre des bâtiments publics.
Pendant ce temps, le jeune Hollandais Marinus van der Lubbe, ancien communiste, est venu à pied de Leyde à Berlin, où il commence à faire de l’agitation antinazie dans les files de chômeurs tout en tentant maladroitement d’incendier des bâtiments publics. Si aucun document ne montre Hitler ou Göring ordonnant de brûler le Reichstag, aucun non plus ne nous renseigne sur le comportement de la police vis-à-vis de cet agitateur, qui devait bien avoir été repéré.
La triple fonction de Göring aurait-elle pu ne jouer aucun rôle ?
Les pouvoirs dévolus au président du Reichstag, notamment en matière de recrutement du personnel, offrent maintes possibilités pour introduire Marinus van der Lubbe dans le parlement à la nuit tombée et lui mettre en main de quoi incendier la salle des séances, ou confier cette mission à quelqu’un d’autre en s’arrangeant pour que Lubbe porte le chapeau. Göring, qui peut, en tant que ministre, disposer d’indicateurs qui repèrent l’incendiaire et l’apprivoisent en se présentant comme des antinazis, peut aussi, en tant que président, embaucher et piloter des agents nazis, membres du SD ou de quelque officine spécialement formée.
Deux dirigeants très organisés, qui agissent de concert
Trois autres indices peuvent être invoqués, relatifs au comportement du couple Hitler-Göring juste après l’incendie.
Tout d’abord, ils se précipitent sur les lieux alors que, lorsqu’un pouvoir est surpris par une soudaine révolte, le bon sens commande que ses dirigeants restent à l’abri en attendant de plus amples nouvelles.
Ensuite, ils font arrêter dans leur lit au petit matin des dizaines de responsables communistes, ce qui ne s’improvise pas en une nuit.
Enfin, Göring donne une conférence de presse pendant laquelle il fait état des documents subversifs saisis au siège du KPD en annonçant leur publication prochaine… qui n’aura jamais lieu.
Or, s’il avait eu vent de projets d’attaque contre des bâtiments publics, il lui incombait de protéger le Reichstag, à la fois comme président et comme ministre, et nul n’aurait dû pouvoir y pénétrer sans être fouillé et enregistré.
En revanche, un tel incendie, provoqué par lui à ce moment-là, s’inscrivait parfaitement dans la progression de la confiscation du pouvoir par le parti nazi, achevée pour l’essentiel dès le lendemain lorsque Hitler arrache, à un Hindenburg et à un Papen médusés, un décret suspendant toutes les libertés, qui sera reconduit sous diverses formes jusqu’en 1945.
Le coup d’État est là. Hitler n’a accepté de se placer dans un étau que pour desserrer et contrôler la vis au plus vite.
Quand une profession s’engouffre derrière une thèse mal assurée
Que Hans Mommsen, dans son article de 1964, écrive que Hitler, surpris par l’événement, « met tous ses pions sur la même case comme un mauvais joueur de roulette et gagne », c’est là une fantaisie individuelle. Qu’on en sourie est une chose, qu’on la prenne au sérieux en est une autre mais que toute une profession souscrive à un tel jugement est un symptôme fort éloquent. Il suggère que la démarche fonctionnaliste, loin d’être révolutionnaire, plonge de profondes racines dans la période antérieure, celle du nazisme puis de la guerre froide.
La théorie de « l’acteur unique » succède en effet à une autre vision dominante : celle d’un commando de SA venu par le souterrain du chauffage… un simple retournement de la version nazie primitive d’une escouade communiste arrivée par le même chemin, qui aurait fait le travail tout en laissant van der Lubbe se faire prendre. Propagée en 1934 dans un « Livre brun », la thèse d’un commando de SA, actionné par Göring ou Goebbels, résista quelque temps dans des sphères militantes après la publication de l’article de Mommsen, par exemple en RDA.
Le public avait alors le choix entre une grossière invraisemblance (un acteur unique venu de l’étranger, pyromane maladroit qui se serait mis par hasard à faire les bons gestes au bon endroit) et la non moins grossière action d’un commando porteur de gros bidons de matière inflammable, qui n’aurait pas dû passer inaperçu.
Les nazis auraient eu, dans les deux cas, beaucoup de chance. On leur dénie par là toute capacité d’intrigue et de planification (ils auraient attendu passivement le miracle d’un « acteur unique »), ou au moins toute subtilité dans leurs manœuvres.
Quant à ceux qui, sans adhérer à l’une ou à l’autre théorie, persistent à soupçonner les nazis d’avoir fait brûler leur parlement, ils sont volontiers accusés de « conspirationnisme ».
Un crime de masse engendré par la conjoncture ou un génocide planifié et mis en œuvre sur ordre ?
La difficulté vient précisément du rôle écrasant de Hitler. On veut bien l’admettre, s’agissant des crimes… encore que, dans les années 1980, le courant fonctionnaliste ait accouché d’une théorie suivant laquelle Himmler et Heydrich avaient été à l’origine de la Shoah, non point en vertu d’une idéologie mais de la difficulté de garder et de nourrir les Juifs des régions envahies ; Hitler se serait contenté de les approuver, « peut-être d’un signe de tête », comme quoi le positivisme le plus raide peut s’accommoder d’une imagination débridée. Dans les années 1990 cependant, un consensus s’est établi sur l’idée que Hitler avait donné un ordre de meurtre, et non une simple approbation.
Un Führer faible et maladroit, porté au pouvoir par un déterminisme historique
Si on a fini par consentir à voir en lui le chef de bande d’un régime responsable de millions de morts, on n’accorde pas pour autant à Hitler beaucoup de maestria. Et ce, dès son entrée en politique.
Lorsqu’il commence à se faire connaître en Bavière au début de la décennie 1920, la presse de gauche, ou certains journaux catholiques, remarquant qu’il n’exerçait aucun métier avant celui de politicien, se mettent à le taxer de paresse. Les mêmes, en raison de son talent le plus voyant, l’éloquence, le traitent de bavard, de beau parleur, de démagogue. Une sociologie marxiste sommaire s’en mêle : le courant stalinien le réduit à être « l’homme des trusts » tandis que Trotsky, qui écrit beaucoup sur le nazisme au début de son exil commencé en 1929, professe que Hitler tire ses idées de son auditoire « petit-bourgeois ».
Toutes les hypothèses se donnent libre cours à l’exception d’une seule : on évite soigneusement d’examiner si on n’aurait pas affaire à un politicien certes très particulier, mais travailleur et talentueux.
Or le régime qu’il a créé et dirigé jusqu’au bout a été d’une efficacité certaine. Son exclusion de tout rôle dans l’incendie du Reichstag, pratiquée par les fonctionnalistes, se retrouve à tous les stades de sa carrière, et du traitement de celle-ci par les observateurs, avant comme après 1945.
Comme il faut bien combler ce vide explicatif, on met en scène, côté allemand, les subordonnés, la chance, le hasard ou les calculs soit myopes, soit cyniques, des élites, et à l’étranger les erreurs, les lâchetés ou les divisions de ceux qui auraient pu et dû, sous toutes les latitudes, s’opposer. En d’autres termes, le régime nazi, parvenu au pouvoir par un mélange de fatalité historique et de légèreté des classes dominantes, était dirigé par un nul : c’est le déterminisme qui l’a porté au pouvoir… mais ce sont ses erreurs qui expliquent ses échecs.
Telle est l’équation fondamentale, enveloppée d’une phraséologie souvent très pompeuse, qui domine l’étude du nazisme depuis des dizaines d’années. Mon travail et mes recherches me conduisent, que je le veuille ou non, à des conclusions différentes : Hitler menait sa barque, du début à la fin.
Les panneaux tendus par le nazisme fonctionnent toujours
L’antinazisme, quand il engendre la peur de rendre Hitler sympathique ou admirable en lui prêtant des qualités, rejoint… le nazisme lui-même, et se montre docile à son chef. Car celui-ci planifiait ses coups d’autant plus efficacement qu’il dissimulait cette activité sous des dehors brouillons, impulsifs et indécis.
Le régime lui-même était présenté par divers artifices comme divisé, et son chef comme tiraillé entre des clans divers, par exemple des « durs » et des « mous ». Il n’est d’ailleurs pas faux que des courants aient existé, ainsi que des rivalités individuelles. Mais ce que l’histoire n’aurait jamais dû perdre de vue, c’est qu’un chef dominait tout cela. Il mettait à profit l’apparent désordre de son appareil d’État pour masquer son jeu, et le fait même qu’il avait un jeu.
Quant aux erreurs qu’on lui prête, elles appellent deux remarques :
1) il en fait quelques-unes dans les années 1920 et montre alors une grande aptitude, rare chez les politiciens, à en tirer de fécondes leçons ;
2) il n’en commet strictement aucune dans les années 1930.
Toutes ses fautes, réelles ou supposées, sont donc, dans la période où il est au pouvoir, postérieures au moment où, pour la première fois, il croise le fer avec Winston Churchill. Car à la mi-mai 1940, la toute récente accession de ce vieil adversaire à la barre de l’Angleterre, et le fait qu’il s’y maintienne contre vents et marées, privent Hitler d’un traité de paix qui aurait durablement installé la domination allemande et nazie en Europe.
L’accession et le maintien de Churchill au pouvoir dérangent ses plans d’une manière qui va s’avérer irrémédiable.
Pour échapper à ces évidences, l’historiographie du nazisme, succédant après 1945 aux observations contemporaines de diverses obédiences, a pris (ou prolongé) quelques très mauvais plis, transcendant bien souvent les écoles. Avec essentiellement une circonstance atténuante - ou accablante, comme on voudra : que l’on soit, avant 1945, un politicien ou un journaliste formé aux meilleurs écoles, marxistes comprises, ou bien, après 1945, un diplômé des départements d’histoire des universités les plus prestigieuses, il n’est pas facile d’admettre qu’un quidam sorti du collège à seize ans sans le moindre parchemin ait pu se hisser à la tête d’une grande puissance et faire au moins jeu égal, pendant des années, avec tous ses collègues étrangers. C’est ainsi qu’aux États-Unis et en Russie, mais ailleurs également, on entend souvent dire que même si Churchill n’avait pas existé, Roosevelt et Staline, qui « gagnaient du temps » en fourbissant leurs armes, s’en seraient servis de toute façon : ce sont là des assertions plus partisanes que scientifiques.
L’intelligence de Hitler et son dérangement mental, tous deux extrêmes, doivent être au centre du propos si on veut vraiment comprendre le Troisième Reich dans sa spécificité, et non dans ce qu’il peut avoir de commun avec tel ou tel autre régime. Le travail commence à peine. Quant à l’auteur de ces lignes, il continue d’aller de découverte en découverte.
François Delpla
21 juin 2019
Principaux ouvrages :
- Hitler, Grasset, 1999
- La face cachée de 1940 / Comment Churchill réussit à prolonger la partie, De Guibert, 2003
- L’individu dans l’histoire du nazisme / Variations sur l’arbre et la forêt, mémoire d’habilitation, 2012
- Une histoire du Troisième Reich, Perrin, 2014
- Hitler, propos intimes et politiques, 2 volumes, Nouveau Monde, 2015 et 2016
- Hitler et Pétain, Nouveau Monde, 2018
Site personnel : www.delpla.org
Sur Facebook : groupe ISSN (International Society for the Study of Nazism), adonné notamment, depuis février 2019, à l’exploitation des archives en ligne de l’Institut für Zeitgeschichte (Munich) : https://www.facebook.com/groups/StudyOfNS.