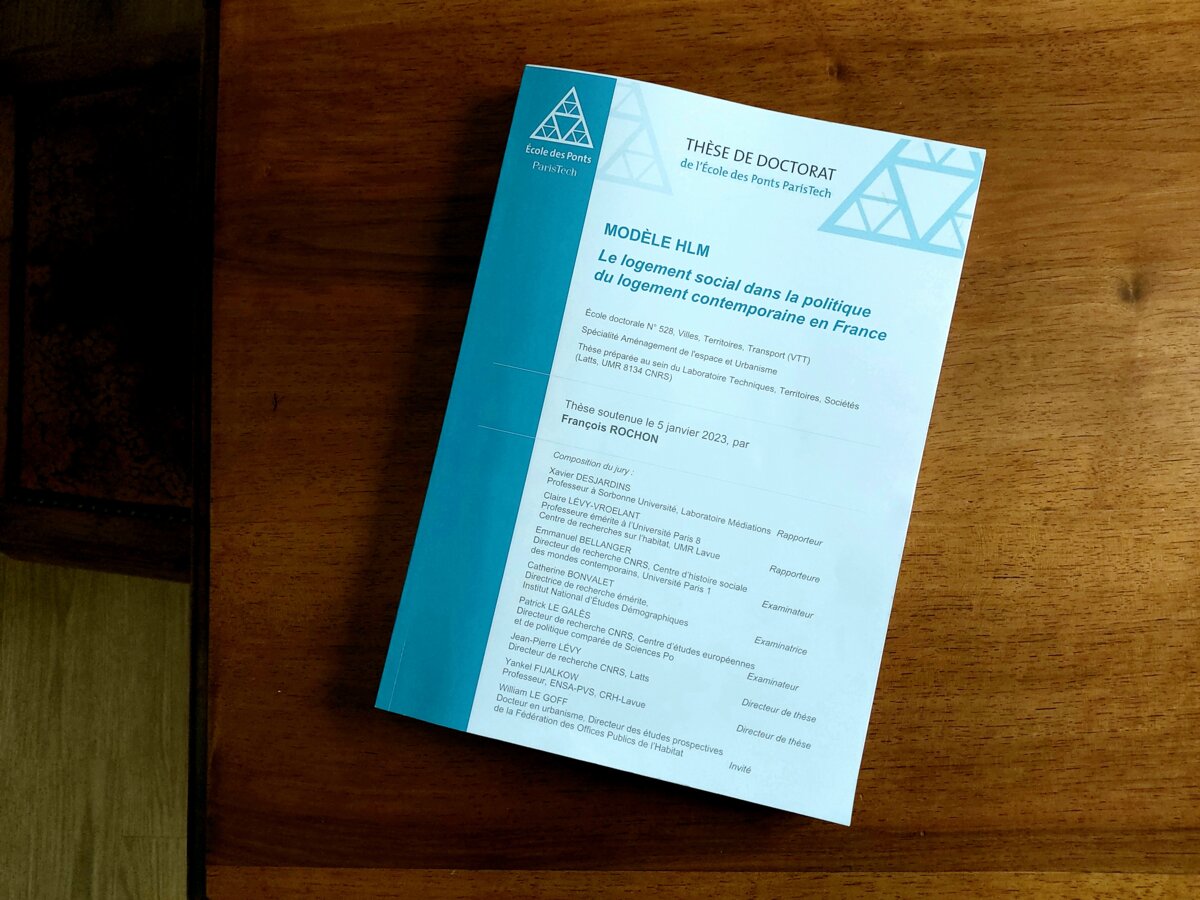
Agrandissement : Illustration 1
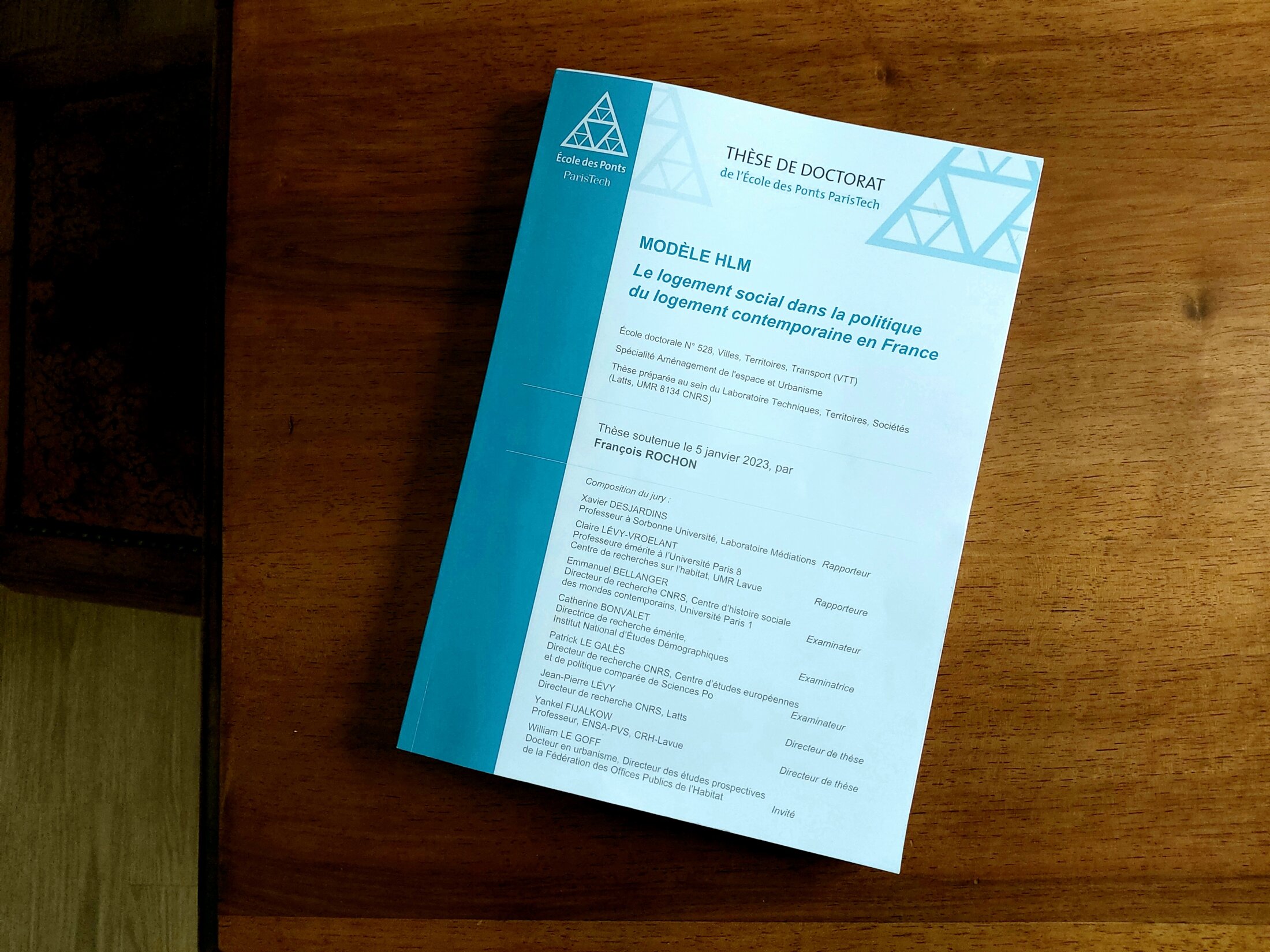
Monsieur le président du Jury,
Mesdames et Messieurs les membres du Jury,
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de prendre part, ce jour, à la soutenance de ma thèse intitulée « Modèle Hlm : le logement social dans la politique du logement contemporaine en France ». En introduction à la discussion scientifique qui s’annonce sur sa construction et ses résultats, je souhaiterais dans un premier temps remettre en contexte la démarche qui m’a conduit à la thèse, entamée administrativement voilà 6 ans. Deux aspects sont déterminants : ma formation initiale, puis mon parcours professionnel.
En effet, dès ma Licence de géographie à partir de 2005, je m’intéresse à l’habitat, en commençant sur le thème du périurbain qui conduira à un mémoire de Maîtrise sur ma commune d’enfance, Port des Barques près de Rochefort. Je me souviens avoir eu en main à cette époque « La question du logement » de François Ascher, « Les pavillonnaires » de Nicole Haumont, un vieux volume relié de Maximilien Sorre et croisé les débats théoriques sur l’habiter.
Mais c’est seulement à l’Institut d’Urbanisme de Paris que je découvre pleinement la politique du logement, dans le parcours coordonné notamment par Jean-Claude Driant. Des visites de terrain sur les programmes HLM organisées dans le XIIIe arrondissement de Paris sont pour moi marquantes, comme les cours à connotation historique sur l’urbanisme patronal, ou ceux sur la démographie à travers les trajectoires des habitants.
Cette initiation intellectuelle, pluridisciplinaire, constitue le bagage qui me permet d’aborder mon premier contact direct, professionnel, avec la politique nationale du logement, dès 2010. A l’époque, l’opposition de gauche à la mandature de Nicolas Sarkozy s’organise, suscite des initiatives comme celle proposée par l’Agglomération d’Aubagne à côté de Marseille, où se met en place un cycle de concertation original sur la crise du logement, au croisement des expertises et des expériences, sur 5 ans.
Ainsi, je me retrouve à coordonner ce projet, intitulé les « Rencontres nationales du logement et de l’habitat » qui inventent, selon leur formule, un « événement local à résonnance nationale », en rassemblant de nombreux acteurs. Je découvre progressivement le secteur du logement, en m’interrogeant sur les modalités d’y faire circuler les connaissances, afin de construire des propositions conséquentes.
A chaque étapes, un ou plusieurs chercheurs sont invités, davantage pour croiser, par principe, les regards, que pour donner toute sa place aux connaissances disponibles dans les débats. Mon intérêt pour la recherche devient plus concret lors du « Débat national sur la transition énergétique » de 2013. Le sujet est nouveau pour les acteurs du logement, si bien que pour parvenir à le traiter, il est indispensable de mobiliser plus largement les chercheurs que nous en avons l’habitude.
Cette année-là, je rencontre aussi Yankel Fijalkow et Jean-Pierre Lévy pour la première fois, invités à leur tour à Aubagne. Dans une conversation informelle entre deux séquences de la journée de débats, ils me remettent sur la voie de la thèse. En effet, le doctorat s’avère une compétence nécessaire pour pouvoir progresser dans mon activité d’animation du débat sur le logement. Il s’agit d’être en capacité d’opérer une capitalisation des savoirs, pour faire évoluer les positions en fonction d’eux.
Or, pour commencer une thèse, encore faut-il construire un sujet, y adjoindre un financement adapté. Plusieurs années seront nécessaires à cela, ce qui m’amène au contexte d’émergence du sujet de ma thèse. Lorsque le cycle de concertation des Rencontres nationales du logement et de l’habitat s’achève, je cherche de mon côté une façon de continuer sous une autre forme. J’ai alors la possibilité de travailler à l’Union sociale pour l’habitat. Cette institution m’apparaît comme placée au centre de la politique du logement et du système d’acteurs.
Et c’est là-bas qu’émerge l’idée de mon sujet de thèse sur le modèle Hlm, avec une opportunité de contrat Cifre, du fait d’une volonté de cette organisation de contribuer fortement au développement de la recherche. Mon idée de départ prend la forme d’une question : « Le modèle Hlm existe-t-il ? ». A l’été 2016, cette question n’est pas polémique en soi, elle relève plutôt d’une interrogation théorique, intéressant surtout les spécialistes.
Parce qu’elle pointe un angle mort, dans la suite d’une vaste concertation interne au secteur, intitulée « Cap Hlm », qui entend fixer la stratégie nationale de moyen terme. Elle répond aussi au constat présenté à l’époque d’un manque de recherches sur l’échelon national, dans une étude sur l’état de la recherche réalisée par Marie-Christine Jaillet.
Mais lorsque mon doctorat est effectivement enclenché, le contexte change brutalement. La nouvelle majorité issue des élections de 2017, qui s’est engagée au statu quo sur la politique du logement, décide dès la loi de finances 2018 une coupe drastique sur les APL, à la surprise générale. Des économies substantielles sont réalisées et le Mouvement Hlm tente, en vain, de s’y opposer.
Dès lors, une posture défensive se met en place, qui inverse le rapport de l’institution au « Modèle Hlm ». L’interrogation intellectualiste n’est plus à l’ordre du jour, il s’agit préserver concrètement le modèle, par des actions à court terme. Dans ce contexte nouveau, je continue d’avancer dans ma recherche, en conservant mon interrogation fondamentale. Ma réflexion doit faire en sorte de ne pas être brouillée par les derniers événements, et rester concentrée sur les questions de structurelles.
La problématique s’affine donc progressivement pour se fixer sur le sens de la politique du logement, sous le prisme du logement social, et à travers ses acteurs nationaux. Dès lors, une enquête peut se mettre en place sous la forme d’entretiens, auprès d’une cinquantaine de dirigeants. Un échantillon de 51 personnalités est constitué, complété d’une dizaine d’entretiens exploratoires.
Afin de croiser un spectre large d’acteurs, je veille à y faire figurer de hauts représentants du monde politique, tels qu’un ancien Premier Ministre, plusieurs anciens Ministres et Parlementaires, ainsi que de nombreux membres de cabinets. Je rencontre également de hauts dirigeants du secteur Hlm, soit dans des fonctions électives, tels que des Présidents de fédérations par exemple, soit comme permanents, tels que des Délégués généraux ou Directeur généraux. Figurent aussi des représentants nationaux d’organisations professionnelles, d’associations reconnues par les pouvoirs publics, syndicats de travailleurs, ou militants du droit au logement, et plusieurs universitaires ou journalistes.
Ce type d’enquête comporte des facilités connues, mais des difficultés sur le terrain me surprennent. Je les prends donc en compte pour affiner ma méthodologie. Comme le montre l’article classique « S’imposer aux imposants », il n’est pas très compliqué d’obtenir des rendez-vous assez longs avec de hautes personnalités dans le cadre d’une thèse. Il suffit d’oser, moyennant une bonne connaissance de l’art des courriers et des relances.
Je suis par contre frappé par la distance sociale avec les enquêtés, parfois une distance symbolique assez manifeste. Si leur aisance à déployer dans un discours une position très riche et structurée conforte l’intérêt de mener une enquête auprès de ces acteurs, je suis étonné du fait que ma connaissance du domaine soit à ce point mobilisée, y compris en termes de posture professionnelle. Je suis donc amené à m’interroger sur l’ambivalence de ma position entre acteur et chercheur, ce qui me conduit à approfondir la question des positions et rapports de positions sur le plan sociologique.
Ces éléments d’ordre sensible me mettent sur des pistes bibliographiques du côté de Pierre Bourdieu, sur les plans théoriques et méthodologiques. Ma représentation naïve sur les élites se réajuste donc par le terrain, mais aussi par une relecture plus approfondie de certains travaux de recherche. Elle m’amène en particulier à revenir longuement sur ce texte complexe de Bourdieu et Christin, « La construction du marché ».
Une autre difficulté plus technique apparait au même moment, que je mets du temps à résoudre. Mes enquêtés sont si connus dans le secteur qu’il n’y a pas de solution évidente pour respecter la confidentialité des entretiens, condition pourtant préalable d’une parole moins compassée. Une période de doute dans l’avancée de ma recherche s’installe. Et pour que l’analyse puis la rédaction de la thèse puissent avancer véritablement, il faut attendre que je prenne la décision d’un recul académique par rapport à mon organisme de Cifre. Après une nécessaire période en immersion propre à la phase de terrain, je dois entrer complètement dans la position du chercheur pour construire ma recherche, à distance de mon ancienne position de chargé de mission.
Concrètement, je déménage à Rochefort, puis commence à lire les classiques cités abondamment mais rarement commentés en détails. Parallèlement à la rédaction, je réalise une monographie de l’Office Hlm de Rochefort sur 90 ans et prend part à différentes réunions sur la gestion de l’organisme. Dans ces activités locales ponctuelles en marge de la rédaction, je constate que l’influence des problématiques nationales reste prépondérante.
Sur le plan de l’analyse, c’est aussi le moment où le traitement statistique s’impose comme la voie la plus adéquate. Il me permet de tenir à distance mon expérience sensible d’enquêteur, de mettre en lumière les effets de positions, tout en traitant de façon systématique et objectivée mes entretiens. Pour y parvenir, je reprends quelques cours de mathématiques. Cela me permet de mettre en place une enquête biographique complémentaire aux entretiens, sur onze critères de qualités et de fonctions. Cela me permet également de produire des classements et des représentations graphiques autours d’une série d’items que je mets en place, 19 au total, décrivant les idées structurantes qui ressortent globalement des discours.
*
Ma réflexion chemine et des ouvertures vers d’autres réflexions développées dans différentes disciplines apparaissent aussi, qui invitent au dialogue interdisciplinaire sur ce vaste objet qu’est le logement social et la politique du logement, dont témoigne le jury de la thèse composé par mes directeurs de recherche.
Par exemple sur le plan de l’histoire, mon travail de synthèse reprend la lecture de plusieurs des principaux ouvrages sur le logement, pour la plupart déjà assez anciens. J’en retrace les apports en signalant des résultats de recherches plus récents, tout spécialement ceux qui portent sur les circuits de financements. Cela me permet de relativiser l’histoire glorieuse des Hlm qui traverse le secteur, en mettant notamment en avant le fait que même au plus fort de la construction de logements sociaux, la politique d’accession à la propriété est déjà très forte. J’insiste également sur le poids structurel du parc social au sortir des Trente glorieuses, qui préfigure implicitement les effets de régulations contemporains, mis en avant notamment par Matthieu Gimat dans ses travaux.
Sur le plan de la démographie, je présente l’usage des chaînes de vacances dans la compréhension des trajectoires des habitants, lesquelles contribuent à forger du côté des sociologues et des géographes une approche par le système de l’habitat. Ces travaux s’appuient sur des données relatives à la population générale du pays et son évolution, croisant les conditions d’habitations.
Mais ma recherche concentre aussi une grande part de son attention sur la politique publique du logement, vue à travers les sommets de l’État, renvoyant aux Sciences politiques et à la Sociologie de l’action publique. Comme je l’ai présenté au début de cet exposé, mon approche s’est construite sur une vision du politique fondée sur un principe ferme, tiré de la culture des Lumières : la question du logement doit être instruite publiquement par les acteurs, en fonction des connaissances disponibles. Telle était l’engagement intellectuel des Rencontres nationales du logement et de l’habitat, qui m’a amené progressivement à la thèse.
Mais la sociologie de l’action publique invite aussi à tenir compte d’une approche nuancée de la période contemporaine. Le temps est révolu des grands plans et de la construction de l’État social. Nous sommes en présence d’une action publique complexe, parfois saturée ou contradictoire, influencée par de nombreux ajustements à la marge entre les décisions centrales et leur déclinaison locale, ce qui invitent à considérer tout autant les petits faits des agents sur les terrains, et peut-être moins les visions globales.
C’est pourquoi durant mon enquête, je me suis retrouvé confronté au doute qui traverse tous les acteurs nationaux que j’ai rencontré, sur l’influence réelle ou supposée de leurs positions au sein du logement social, par rapport à la politique du logement. Au fond, l’état de fait apparaît incontesté d’une perte de pouvoir du secteur, si bien que ce sujet même disparaît des discours. Cela ne va pas sans interrogation sur le plan sociologique. En effet, les élites étudiées, à savoir les acteurs nationaux du logement social et de la politique du logement, ne se déterminent que faiblement, ou indirectement par rapport aux connaissances.
Il existe cependant des moments qui font exception à cette observation, comme je le mets en évidence avec les travaux du Réseau socio-économie de l’habitat et le rôle du Puca. Mon analyse montre, in fine, que pourrait même être envisagée une vaste sociologie de la production des connaissances récentes sur le logement, dans son lien avec l’État, à l’instar de celle qui a été faite sur la sociologie urbaine. Cela représenterait certainement un sujet en-soi.
Enfin, la focalisation de ma thèse sur la seule échelle nationale, par opposition à l’échelon local, part du constat signalé plus haut que peu de recherches récentes portent sur la politique du logement au plan global. Mais ma recherche chemine aussi, tout du long, dans cette perspective précisément parce que sur mon terrain, les acteurs nationaux ne construisent pas leur discours en fonction du rapport entre local et national.
Les disparités territoriales en matière de marché du logement sont pourtant majeures, et leurs manifestations sont diverses, mais le cadre général est tel que la diversité locale remonte peu dans la représentation, supposant pour la recherche d’autres angles d’approches. Relier local et national constitue donc encore un enjeu important pour les connaissances sur le logement.
*
C’est pourquoi, revenant à la construction de ma thèse, il en découle que j’organise la réflexion en deux moments complémentaires. Le premier met en place une projection de la politique du logement à travers le logement social, en se concentrant sur les connaissances disponibles, pour pointer une limite qui m’apparaît importante, relative à la spécialisation de la recherche.
Pour ce faire, j’opère une synthèse d’environ 200 références, en m’attardant plus spécialement sur les ouvrages collectifs découlant de travaux des années 1990 début 2000, à mon sens importants pour comprendre le paysage contemporain de la pensée sur la politique du logement en France. J’en déduis trois grandes approches au plan national, en pointant leurs principales limites dans le débat public.
La première porte sur le mal-logement. Le diagnostic posé au milieu des années 1990 fait état d’une augmentation des exclusions. Une partie des chercheurs, associés aux acteurs associatifs de la lutte contre l’exclusion, développent une approche qui, par définition, traite des effets en dehors système.
La deuxième approche porte sur l’action publique. Puisque le diagnostic pointait l’inadaptation des instruments historiques de celle-ci face au grippage du système, une partie des chercheurs associés à certains acteurs tels que les associations d’élus locaux et l’Union Hlm, développent une approche par l’action publique. Elle s’intéresse davantage aux lois et règlements, et se concentre donc sur leurs effets sur le système, perdant de vue les principes sous-jacents à son fonctionnement propre.
Enfin, la troisième approche se consacre au système de l’habitat. Puisque le diagnostic pointe des principes structuraux, une partie des chercheurs se concentre sur leur mise en lumière théorique, avançant fatalement dans une voie supposant un travail supplémentaire de vulgarisation rendu possible seulement en lien avec les autres approches.
En définitive, la spécialisation qui a suivi le diagnostic de la situation du logement France a pu s’organiser sur trois de ses éléments clés, obtenant ainsi des résultats significatifs dans chacun de ses aspects. Mais cette spécialisation nécessaire s’est faite en mettant momentanément de côté l’effort collectif de vision d’ensemble. Cela m’amène à m’interroger sur le logement social non plus en tant que connaissance, mais sur le plan de sa réalité empirique. Comment cette projection de la politique du logement se traduit-elle dans la représentation des acteurs ? C’est ma deuxième partie de thèse.
J’étudie d’abord la position des enquêtés, en mettant en évidence trois grandes positions : Politique, Administrateur, Praticien. Ces trois positions sont assez proches de ce que pourrait observer la pensée commune, mais elles ont l’intérêt d’objectiver le fonctionnement du système d’acteur. Le caractère multi-positionnel est à cet égard développé. Il renvoie à des trajectoires.
L’analyse des discours quant à elle, permet de montrer comment circulent les 19 items dans la pensée des acteurs, à partir d’environ 200 citations commentées. Le traitement statistique conduit en outre à mettre en lumière 5 grandes conceptions du logement social dans la politique du logement, qui s’appuient sur 6 items structurants. Ainsi trois items renvoient à une politique sociale : modèle social, population, politique publique. Et trois autres items renvoient à la gestion urbaine : parc, financement, système de l’habitat. Ces items se combinent différemment selon les acteurs.
J’observe que les conceptions des acteurs ne croisent pas directement leurs positions. La représentation du logement social n’est pas construite en fonction d’une position principale, elle est plus profonde et renvoie à de grandes représentations de la cité, mise en évidence par Boltanski et Thevenot. Le type moyen renvoie à une « gestion pragmatique », qui mobilise les 6 items, mais avec une importance pour l’héritage que constitue le parc, à rapprocher de la cité domestique.
Deux conceptions se concentrent sur la politique sociale. L’une que j’appelle « idéal politique », accorde une grande importance au modèle social, à rapprocher de la « cité inspirée », tandis que l’autre n’en tient pas compte dans une conception que j’appelle « gestion sociale », plus attentive aux risques de désordres, à rapprocher de la « cité de l’opinion ».
Deux autres conceptions se concentrent sur la gestion urbaine. L’une que j’appelle « économie sociale », est à rapprocher de la « cité civique », l’autre à l’effectif réduit mais à la composition plus singulière, que j’appelle « gestion rationnelle », est à rapprocher de la cité industrielle.
Ces 5 conceptions, prises dans leur ensemble, ont la caractéristique de se révéler assez homogènes dans leurs composantes essentielles. Dès lors, cette recherche montre que le modèle Hlm est une réalité plus complexe et plus diffuse que les argumentaires émanant du secteur lui-même. Le modèle Hlm se rapport plus générale aux grandes conceptions qui circulent dans la cité, dans la société en général.
C’est pourquoi, à la question initiale du projet de recherche : « Le modèle Hlm existe-t-il ? », la thèse répond oui, mais nuance grandement le caractère univoque de cet objet. Si ses principales composantes apparaissent clairement, leur nature se révèle souvent équivoque ou discutée.
Ainsi décrit, le Modèle Hlm comporte des éléments de réflexion à approfondir au service d’une politique du logement conséquente. Je pense à la place des habitants, il serait certainement pertinent de les étudier et de les considérer comme un groupe. Je pense au système de l’habitat, qui permet d’intégrer les processus de changement propres à la question du logement, ce qui renverrait de facto à la relation entre les échelles nationales et locales, pour penser la mise en œuvre de la politique du logement.
En effet, des aspects essentiels de la représentation du logement social sont reliés à des concepts, c’est-à-dire à des connaissances. Ma thèse montre qu’un lien plus fort est envisageable entre les connaissances et l’action, du fait de la structure même de la représentation qui rassemble les acteurs.
En définitive, je pense que cette thèse apporte une contribution allant dans le sens d’un nécessaire approfondissement de la réflexion sur la politique du logement, en tant qu’objet de connaissance et dans le sens d’une vision d’ensemble. La recherche apporte des bases théoriques porteuses, qui sont aussi à disposition du système d’acteurs, dont le fonctionnement spécifique est ainsi mieux cerné par l’enquête.
Je vous remercie de votre attention.



