
Agrandissement : Illustration 1

« - C’est des mots, pas la guerre!
Elle-même insulte, piétine, saccage mon icône perdue. Nos mères nous transmettent l’ombre du monde, et nous y grelottons sans cesse de les adorer. »
Les autos passent de plus en plus souvent devant les Pins-Verts (aux alentours d’Antibes) en cet été 53. Deux femmes et deux fillettes serrent les poings, sursautent au moindre bruit de moteur, le cœur serré, la gorge sèche mais, pour des raisons différentes. Une épouse et une enfant craignent la voiture des gendarmes qui viendra leur annoncer officiellement la mort de leur héros sur le lointain champ de bataille asiatique. Une autre tremble à l’idée que son époux ait découvert sa nouvelle adresse et se radine, bras vengeur levé, lui qu’elle imagine désormais en homme de main de la pègre méridionale. Puis la dernière, la narratrice de sept ans, d’espérer qu’il revienne enfin, qu’il la retrouve finalement, son père. Un quatuor féminin reclus, jurant dans le paysage propret, engoncé, des 50´s (« toutes les quatre on se serre d’instinct, comme les huskys dans le blizzard »), deux hommes absents. Deux hommes que tout sépare : l’un engagé volontaire en Indochine, canardeur passionné de « Niaks », rêvant de FM et de M24 destructeurs, pensant patrie, graillant cadencé, pissant tricolore; pas du genre comme certains fragiles à s’interroger sur les buts et l’utilité de cette guerre en Indochine (« Qu’est-ce qu’on fout là ? se demandent les plus lucides. Les Viêts vont pas nous faucher l’Alsace et la Lorraine ! [...] les Français meurent en Indochine pour les plantations Michelin - le caoutchouc. Du sang contre l’or blanc »). L’autre, poivrot inactif dilettante, immature, allergique à toute autorité. « Mon oncle détruit beaucoup : nids de rebelles, paillotes, récoltes de riz et de soja, canards et buffles. Mon père se démolit lui-même. À sept ans, je l’ignore. Je sais seulement qu’il me manque toujours davantage, et ça me détraque, je vomis et je vomis. » Deux hommes qui se retrouvent sans le savoir mêlés au même drame, devenant l’obsession commune des habitantes de la maisonnée des Pins-Verts. L’un servant - contre-exemple parfait - à valoriser l’autre, et inversement (selon les regards portés), comme dans toutes les familles, qui depuis la nuit des temps chérissent assigner des rôles spécifiques à chacun de leurs membres (cela leur évite de trop s’interroger). Les hommes, décidément, semblent voués à la (l’auto-)destruction et aux rôles d’idoles ou de paratonnerres. Mais et les femmes, derrière les faux-semblants, les postures saintes à la Marie rédemptrice ?
« François Maxence Belair réussit tout, même son nom. Robert Dubois rate les marches, et le reste. Il ne sait pas porter un fusil, planter un clou, plier un drap. Mais il chante Le Chapeau de Zozo, imite la sauterelle, invente des histoires de cul-de-jatte. Pas longtemps... À sept ans je le quitte. »

C’est cette séparation brutale que nous conte Céline Debayle (ancienne grand reporter, auteure du remarqué ‘Baudelaire et Apollonie’) dans son dernier ouvrage, ‘Les grandes poupées’, tout juste paru aux éditions Arléa, sans que le lecteur ne sache vraiment la part autobiographique cachée derrière ces pages vives et émouvantes. La perte de cet anti-héros, mari déplorable, citoyen lamentable, travailleur démissionnaire mais père aimant et aimé. Les onguents ‘cicatrisants’ (pour qui ?) appliqués de force, les poisons inoculés distraitement en mode ‘je n’y avais pas pensé’.
La mère, Odette (« Odette ! On m’a défavorisée en me flanquant une dette dans mon identité ! »), a « emporté de Marseille la colère, la rancoeur aussi. La voix qui se soulève et se brise. Le front dans la main, front de plomb. Tout ça à cause d’un homme au regard marron, Robert Dubois. » La faconde est sympathique, l’instinct de protection maternelle (nécessaire ? Personne ne le saura jamais, on ne réécrit pas les histoires) admirable mais, la narratrice, du haut de son jeune âge, mesure tout de même la cruauté à lui interdire nostalgie des virées au Balto, évocation des pitreries paternelles qui la faisaient tant rire, elle la gosse, jusqu’à prohiber l’évocation du nom aimé, même. Mon père, ce zéro. « Et contre son visage fermé, je me cogne. Ma mère d’une tristesse d’élégie. Je suis désenchantée, répète-t-elle. » La tigresse blessée Odette de se faire, sans même le réaliser, carnassière cannibale. Et la cousine et la tante (comment leur en vouloir ? Chacune son histoire), dans le décorum militaire de leur maison-refuge, en pré-deuil déjà (le massacre de Nam Dong vient de se produire, trois cent cadavres de tirailleurs alignés sur l’axe routier Hanoï-Lào Cai, un tous les dix mètres sur trois kilomètres. « Ce sera une guerre entre un tigre et un éléphant, écrivait-il en 1946 [Hô Chi Minh]. Le tigre se tapit dans la jungle pendant le jour pour ne sortir que le nuit. Alors il s’élancera sur l’éléphant et lui arrachera le dos par grands lambeaux, puis disparaîtra à nouveau dans la jungle obscure. Et, lentement, l’éléphant mourra d’épuisement et d’hémorragie »), de se joindre à la litanie-défouloir des « pochard tocard ! » & co. « Alice attaque Robert, j’agresse François. Mots humiliants comme des coups de martinet : « poivrot feignasse », « Trouffion tocard ». On chiale en duetto, et toujours la même perdante. « Josette ! Tu es vicieuse comme ton père », me tance Emma. Mots plus déchirants que les morsures d’enfant. »

Agrandissement : Illustration 3

Désarticulée en silence façon pantin. La poésie paternelle s’en est allée, restent les mots qui cognent, les phrases qui blessent (« Clichés en noir et blanc, grand format. François Maxence Belair posant avec son « pépin » et son « lance-patates ». FMB faisant le V de la victoire. FMB buvant à son bidon de soldat. FMB lisant le Journal d’Extrême-Orient. FMB enfilant des bottes de saut... En cachette je lui arrache la tête, la remplace par celle de mon père. En tenue militaire, il devient le Chef des Princes. Il enfile des bottes de sept lieues, boit une potion magique, défend le royaume des Fées jaunes. Mon album de photos reconstitué, pauvres images dont je me gargarise. »)

Agrandissement : Illustration 4

Poupée démembrée sauce effets collatéraux-pas-graves. L’empathie vis-à-vis de ses proches en souffrance le dispute à la fureur de voir son héros servir désormais de paillasson à ces dames. D’où vient ce titre, d’ailleurs, cette évocation des poupées ? Aux lecteurs curieux de le découvrir. Aux lecteurs curieux de plonger dans ce roman faussement « ces années-là » mais en fait véritable réflexion sur la famille, sur les instincts sauvages (oui) de survie individuelle au sein des clans. Regard d’enfant, humour de mioche mais douleur vive, encore, malgré l’âge.
Derrière l’aspect ‘récréatif’, derrière les jeux de mots spirituels sauce comptoir populaire de ses personnages en survie - donc fiers et mordants - ‘Les grandes poupées’ se révèle aussi abouti que féroce, tenant l’esprit de revanche à distance mais implacablement conscient des forces en mouvement au sein du quatuor. Aussi tendre et nostalgique que basé sur un irréparable sentiment de gâchis. Car les guerres de proximité peuvent être aussi bestiales et destructrices que les grands conflits de l’autre bout du monde. Et le cœur d’une fillette se briser à jamais à cause des sottes passions adultes.
— ‘Les grandes poupées’, de Céline Debayle, éditions Arléa —
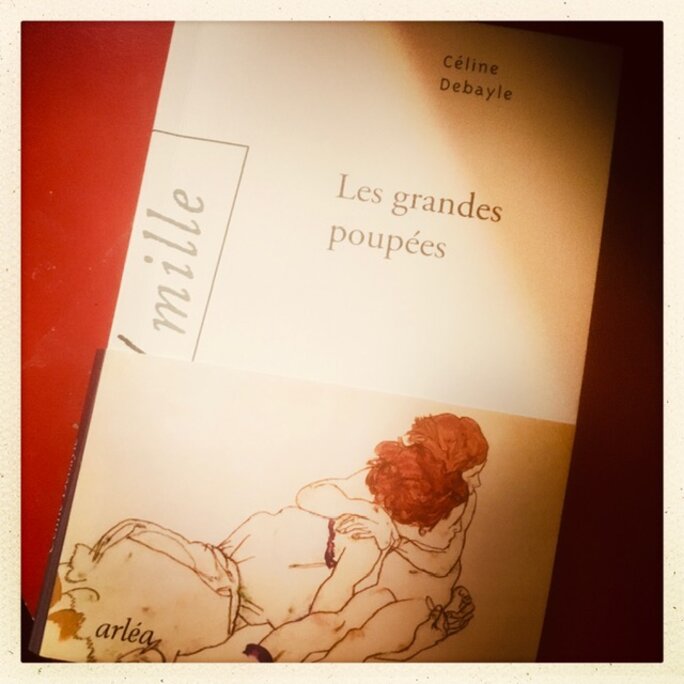
Agrandissement : Illustration 5
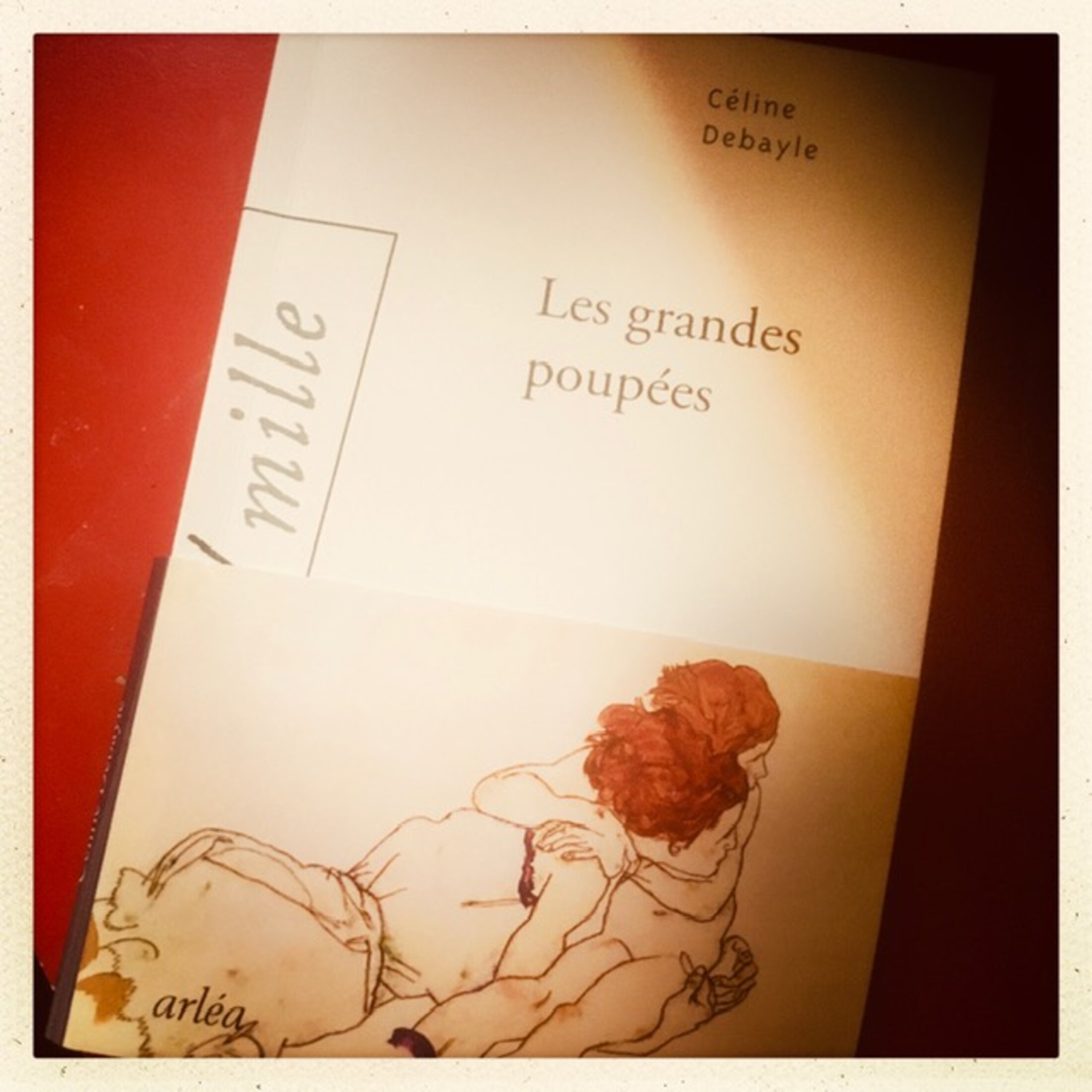
— Deci-Delà —



