
Agrandissement : Illustration 1

" Kote ayiti ?
Quelle chance ont les voix de Claudette, de Lorette, de Rose-Marie et même d’Étienne de franchir les frontières de Bas Peu de Choses ? Demeurent les prières silencieuses adressées aux mystères depuis la banlieue port-au-princienne.
Pa pouvwa Sen Nikola Soley jistis ki klere kat pati mond la. An lonè tou sen ak zang.

Agrandissement : Illustration 2

« Les téléviseurs bourdonnent partout pour qu’on n’oublie pas l’horreur des nouvelles, toujours les mêmes [...] D’ailleurs de par le monde, des milliers d’enfants ne mangent pas à leur faim. Alors que d’autres se prélassent dans un luxe inégalé dans l’histoire mondiale. D’une part, cette fausse impression généralisée de connaissances et de confort à portée de main et de l’autre, des pays ravagés où la vie s’épelle autrement. Entre les deux, des caméras aux lentilles biaisées et des regards débordants de certitudes. Curieuse mondialisation qui voudrait l’uniformisation des êtres et des lieux mais ne fait que renforcer les instincts les plus intégristes. Un grand village mondial où certaines rues s’enfoncent dans l’oubli. Un grand village mondial à la fois tour de Babel et centre d’achat universel. »
Les Ouïghours et les Rohingyas sont passés de mode, le Sud de Madagascar crie famine dans le vent, les enfants yéménites s’écroulent loin des yeux loin du cœur pour le plus grand bonheur des mouches (et des marchands de canons). Les embarcations de fortune des réfugiés bravant les colères de la Méditerranée sont devenues prétexte à se pencher tous ensemble entre la poire et le fromage devant le poste, air savant et détaché, sur les nouvelles techniques d’identification, d’évaluation de l’âge des homo sapiens mal nés (« seize ans, ça passe. Dix-huit, les marchés aux esclaves libyens ne doivent pas être si terribles »); plutôt que d’interroger nos modèles d’intégration, leur solidité, faisons confiance à Frontex ! Et à nos crustacés décapodes si goulus qui, avant de finir unis à la mayonnaise dans nos assiettes cet été, auront pu festoyer royalement eux aussi.
« En pleine situation précaire pour parler comme les économistes. Ce qu’ils ne disent pas c’est que la misère n’est pas belle, ma sœur, de l’appeler précarité ne la rend pas moins laide. »
Entre l’impossible omniscience et la cécité volontaire : comme un gigantesque blanc, comme un continent entier de douleurs sudistes, de complexités et d’injustices lointaines, juxtaposées, rendu invisible par les œillères de confort, slalom compulsif et asséchant entre les mêmes sujets en boucle, obsessions et nombrilisme maladifs entretenus en toute bonne conscience. Les doigts poseurs (propriétaires guettés par le cholestérol et les escarres) nourrissent sans vergogne un piaf bleu muskérisé, confondu encore (soi-disant) avec une agora moderne, à grands coups d’opinions définitives, en ce moment sur le pouvoir d’achat dans la 7ème puissance économique mondiale, 3ème européenne, prix de la lessive et des friandises Haribo traités sur fond musical dramatique H24 par nos précieuses chaînes d’info en continu qui semblent s’être mises d’accord pour nous persuader - quoi qu’il en coûte - de notre statut de véritables damnés de la Terre.
Il me semble que la misère...
Que peuvent les vèvè protecteurs posés par Évelyne Trouillot entre les lignes pour inverser telle féroce obstination nordique à brasser de l’air, à répéter les mêmes erreurs, yeux clos ?

Agrandissement : Illustration 3

« L’avenir est aux gens minces et beaux. Ceux-là qui règnent dans les émissions télévisées. Évasion. Survie. Débilité patentée. Un groupe de gens prisonniers sur une île déserte, tentent de survivre. Y arriveront-ils ? Pourront-ils surmonter les obstacles de la nature et leurs passions humaines ? Ne ratez pas le dénouement inattendu la semaine prochaine. Affrontez votre peur. Caressez le reptile qui vous fait horreur. Faites-vous enfermer dans un cercueil et affrontez votre claustrophobie. Jetez-vous en parachute du sommet d’un immeuble et affrontez votre peur du vide les yeux ouverts. Au Congo, des villages entiers fuient la guerre imminente. Ils ne veulent probablement pas affronter leur peur du viol, de la mort violente, de la famine. Leur réalité n’attend pas la lumière des projecteurs, elle ne sera jamais évaluée par le nombre de spectateurs qui l’ont visionnée, jamais annulée par un réseau de télédiffusion suite à son faible indice de popularité. Elle se situe hors vision des spectateurs privilégiés, à l’abri du cercle des pays où la pauvreté ne fait pas la une. »
Marasa nou ye.
Miroirs retournés : la gémellité ne s’arrête pas aux destins contrariés de Claudette et Lorette, elle prend des formes multiples dans le dernier roman de l’écrivaine haïtienne récemment publié aux éditions Project’îles.
Un thème qui résonne sur l’île caribéenne, tant les jumeaux et les jumelles y ont un statut particulier dans la culture populaire.
Les Marassa sont les jumeaux divins du vaudou, symboles des forces élémentaires de l’univers, liés à Saint Nicolas (qui ressuscita trois enfants découpés en morceaux par un boucher, deux Marassa et leur dossu(-a), jeune frère ou sœur détenant les pouvoirs unifiés de ses aîné(e)s), syncrétisme oblige.
Objets tant de fascination que de crainte (sorts jetés en tête-à-tête selon les croyances), jumelles et jumeaux doivent être honorés une fois l’an et leurs humeurs ne sauraient, les autres jours du calendrier, être prises à la légère.
Rose-Marie la matrone, ancienne rêveuse devenue aigre et brutale après une vie entière de non-choix, peut bien replacer correctement sur le mur son crucifié pour les yeux des visiteurs, prétendre se moquer des superstitions populaires : son autel aux lwas (esprits vaudous) n’en est pas moins secrètement entretenu derrière un rideau. L’incroyable ressemblance physique et le puissant lien unifiant sa fille Lorette à Claudette, nées le même jour, Rose-Marie ne peut les ignorer. Quand bien même ces deux dernières ne sont pas de véritables marassa.
Lorette (du nom des filles à la jambe légère du XIXème siècle français), papillonne de garçon en garçon, avide de liberté et de légèreté dans un monde qui ne l’est pas, dans un pays gangrené par l’insécurité et la misère entretenue par des puissances qui ne veulent plus entendre parler de lui (quel zappeur de compétition local est informé des renvois actuels, massifs et brutaux, des Haïtiens par le pouvoir dominicain ? L’ignorance est et demeure un choix politique). Sa commerçante de mère peut bien la grimer en jeune fille de la classe moyenne, éduquée et irréprochable, Lorette la séductrice n’en a cure, entendant bien adopter le dilettantisme de son père Étienne, grand coureur de jupons devant l’Éternel. Rose-Marie, enragée par l’idée obsessionnelle du quand-dira-t-on, de resserrer encore la bride. Ce à quoi hommes ont le droit...
Claudette, sa demi-sœur - fille d’Étienne et d’une conquête infortunée fauchée par le crabe - ne peut se permettre tel comportement d’enfant gâtée. Illégitime elle est, illégitime elle restera. La femme officielle, forcée de l’accueillir après le trépas maternel, de le lui rappeler chaque jour. Qu’elle s’estime heureuse de trouver un toit et de ne point finir restavèk (enfants pauvres d’Haïti placés en domesticité, statut souvent proche de l’esclavage contemporain) : que les voisins rendent grâce à la bonne Rose-Marie d’être si bonne chrétienne, protectrice charitable même après l’exil d’Étienne, parti tenter sa chance du côté de Miami ! Les études et l’amour des femmes (complication supplémentaire sur le chemin de l’épanouissement dans une culture peu à l’aise avec l’homosexualité) seront pour Claudette échappatoires; infimes sources d’espoir.

Agrandissement : Illustration 4

« Chaque semaine, elle me faisait venir dans la sècheresse de sa chambre et me délivrait des sermons préparés spécialement. Certains thèmes revenaient régulièrement. Ton nom rentrait dans ses tirades alors que tu n’étais pas là. "Tu ressembles à ton père, vous aimez trop la chair ta sœur et toi. Tu n’auras pas d’enfants, tu ne le mérites pas. Claudette et toi, vous êtes condamnées à n’être que des juments stériles. Vous nourrissez des pensées impures en vous. Vous serez punies comme vous le méritez." Elle a toujours envié ma tendresse envers toi. Toi, ma demi-sœur en teintes sombres. Tes yeux pareils aux miens cachent pourtant des zones dangereuses. Même si je parais la plus effrontée des deux. Je veux tellement te ressembler. Naviguer jusqu’au fond de ta pensée. »
À tour de rôle, les vraies-fausses jumelles Marassa de se livrer, de révéler leurs techniques de résistance aux assauts sauvages, tentatives de démolition de Rose-Marie; les incompréhensions, l’esprit de compétition, les irritations mutuelles, perdant parfois le lecteur qui ne sait plus laquelle des deux s’exprime.
Le savent-elles encore elles-mêmes, tant elles poussent loin - si différentes de caractère pourtant, si semblables physiquement aussi - les tentatives de fusion totale, surnaturelle quasi.
Laquelle des deux est promise au mariage blanc aux États-Unis (projet de l’infatigable commerçante haïtienne, toujours bien décidée à défendre les seuls intérêts qui comptent : les siens) ? Sont-elles une ou deux à déambuler de nuit « dans le subway parcourant les tunnels de Manhattan, de Brooklyn et de Queens », mettant en danger le crucial rendez-vous du lendemain à l’immigration ?
Lorette investit l’esprit de Claudette, Claudette s’approprie la psyché de Lorette, confusion des corps en mouvement, magie des Marassa. Ou ultime espace d’évasion, d’affection, pour deux exilées intérieures.
« Je ne trouve pas de rue à la mesure de mes souliers. J’ai humé les relents nauséabonds du Boulevard Jean-Jacques Dessalines. J’ai aussi arpenté les devantures de Flatbush Avenue. Ma folie s’est égarée entre les taxis jaunes, les magasins de pacotille, les McDonalds, les camionnettes tap-tap et les flaques d’eau sale. Ma parole ne sait plus quelle langue parler. Entre créole, anglais et français, je divague sans dictionnaire et sans grammaire. Je ne sais plus où je suis. Il importe peu à ma démence de s’établir à New York ou à Port-au-Prince, elle qui s’est logée en moi et qui ne parle que le langage de mes angoisses. »
Man Vonne se répand en mélopées inintelligibles lors d’une cérémonie purificatrice. Regard inquiétant d’un homme venu de la secrète Artibonite dans un appartement de Brooklyn aux relents de produits ménagers industriels. Une cliente européenne blanche qui se fout de la misère haïtienne mais n’est pas indifférente à la sensualité de la vendeuse noire lance sa main, quête du contact. Les deux sœurs rient encore, innocence de la jeunesse qui croit pouvoir tout contrôler. Jusqu’à l’apparition proche, possible, de la dossa symbolique, trait d’union pacificateur, ultime incarnation de leur amour mutuel et pouvoir commun. Férocement empêchée par les codes sociaux, par la main brutale de Rose-Marie qui l’extraira furieusement telle une mauvaise herbe menaçante.
Que reste-t-il alors aux sœurs, sinon la tentation du gouffre, du renoncement ? Bruits de clés, de verrous. De ceinturon. Qu’est-ce alors que la promesse d’une carte verte, sésame administratif pour un pays dont elles ne rêvent même pas ?
Les jumelles Marassa trouveront-elles la force de surmonter l’annihilation de la dossa ? De briser les chaînes de l’assignation ?

Agrandissement : Illustration 5

"
Évelyne Trouillot (‘Rosalie l’infâme’, ‘Désirée Congo’) revisite la légende de Saint Nicolas, octroyant le rôle du sinistre boucher à une femme trop éprouvée par la vie pour s’autoriser l’empathie. À travers ce conte qui ne craint pas la violence (l’époque l’est, comment les contes se paieraient le luxe de ne point l’être ? ), pose frontalement la question de l’identité, l’écrivaine nous livre ses réflexions sur l’exil forcé, les rapports Nord/Sud mais aussi sur la situation des femmes, fragiles parmi les fragiles dès lors que l’État se délite. Dès lors que les filles ne sont plus vues que comme terre glaise à modeler selon les besoins des plus fort(e)s.
« Marasa nou ye », murmurent en chœur Lorette et Claudette. « Marasa nou ye », reprend d’un ton mystère Évelyne Trouillot, nous fixant droit dans les yeux, invitation challenge à franchir en sa compagnie les frontières de la rue Nicolas, télécommande posée, novlangue de privilégié(e)s un instant oubliée.
— ‘Les jumelles de la rue Nicolas’, Évelyne Trouillot, ed. Project’îles —
* voir aussi ‘Plumes haïtiennes’
"" "
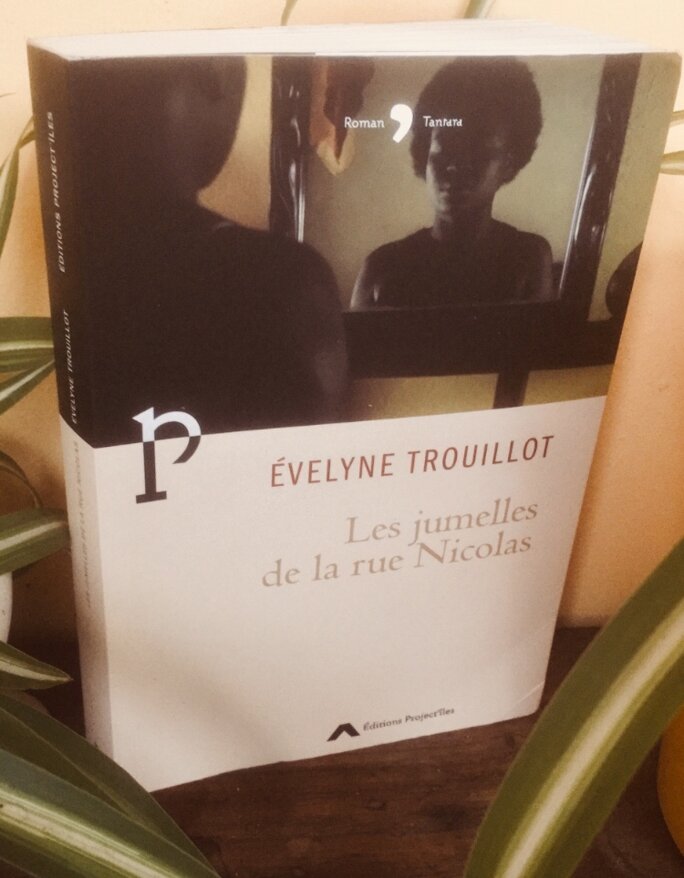
Agrandissement : Illustration 6
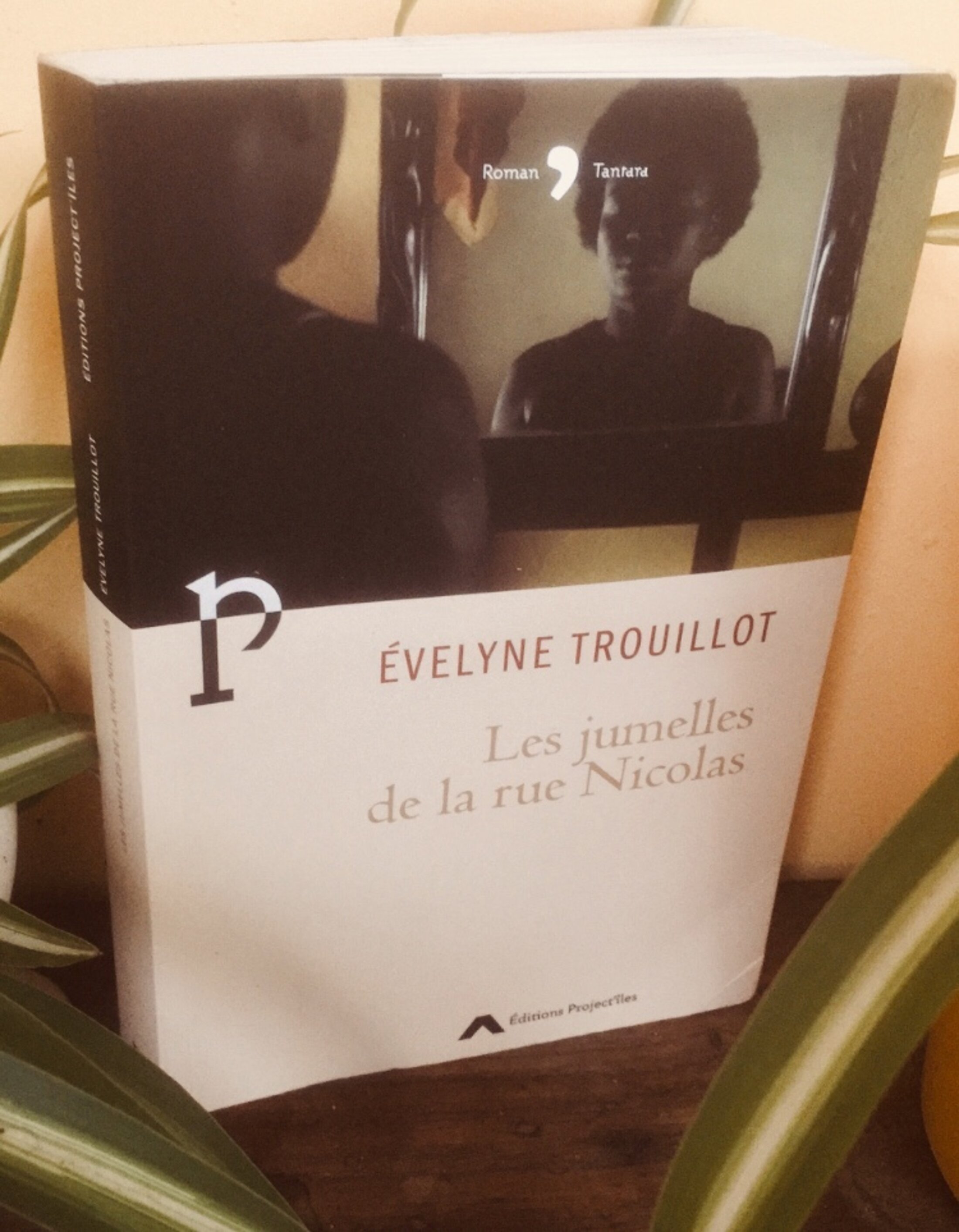
"
Illustrations : voir le très beau travail depuis Haïti de Vanessa Cass sur son site
—- Deci-Delà —-



