« Mon fils a tué votre fille », ainsi commence ‘Mother to Mother’, roman majeur sur l’Apartheid écrit par la grande écrivaine sud-africaine Sindiwe Magona il y a vingt-trois ans (1998) mais traduit en français et publié chez Mémoire d’Encrier seulement en 2020. Une série de conférences et de rencontres dans l’hexagone, organisée par la maison d’édition québécoise (créée par l’écrivain et poète haïtien Rodney Saint-Éloi) et en présence de l’auteure (oeil espiègle, art consommé de la répartie, charisme de ceux qui ont vu et vécu) de réveiller une critique tricolore froissée d’avoir manqué ce chef-d’œuvre à sa sortie. Et alors que l’Afrique du Sud, qui a tant de mal à panser ses plaies, refait la Une de l’actualité.
« Mon fils a tué votre fille », et la terrible histoire est véridique. 1993, Amy Biehl, étudiante américaine de vingt-six ans achève une année scolaire à l’université de Cape Town. Militante anti-Apartheid, engagée auprès des étudiants noirs dans la mise en place de la transition démocratique (Nelson Mandela a été libéré en 1990, de Klerk et lui négocient âprement, tentent d’éviter la guerre civile. Si la plupart des lois d’Apartheid ont été abolies entre 1989 et 1991, tensions et résistances demeurent, les élections multiraciales qui auront lieu en 1994 et verront la victoire du plus célèbre ancien prisonnier politique ne sont alors qu’un but incertain), la jeune femme passe sa dernière soirée sur le sol africain avec ses amies noires de l’université. Son avion de retour est prévu pour le lendemain. Décidée à prolonger encore un peu les difficiles adieux, aveuglée sur les dangers par son idéalisme de jeune occidentale épargnée par les haines solidement ancrées par des décennies d’humiliation, réparties en strates plus ou moins visibles, Amy Biehl propose de ramener ses condisciples chez elles, dans le township de Gugulethu (dans lequel a, au passage, grandi Sindiwe Magona). Décision insensée qui lui sera fatale. Elle sera vite repérée par un groupe de militants noirs chauffés à blanc, la voiture stoppée dans les rues par des pierres, sa conductrice poignardée. La couleur de peau de la jeune activiste - peu importe son passé, ses intentions, ses actions - aura signé son arrêt de mort.
« UN COLON, UNE BALLE !
AMABHULU AZIZINJA !
AVEC NOS BOÎTES D’ALLUMETTES, NOUS NOUS LIBÉRERONS !
— Tsaa-ah ! Vas-y ! Nous lançons le chien. Tsa-aah ! Il sait quoi faire, flairer la cible et la saisir à la gorge. Nous ne courons aucun danger. C’est le chien que nous lançons à l’attaque qui s’expose au risque. C’est le chien qui prend le risque, qui pourrait être blessé. Ou tué. Ou emprisonné. »
« Mon fils a tué votre fille », ainsi commence la longue adresse d’une mère désespérée à une autre, celle de Mandisa la narratrice, mère de l’un des tueurs désignés, à celle d’Amy Biehl.

Agrandissement : Illustration 1

« Mais les gens comme votre fille n’ont aucun sens inné de la peur. Ils croient si fort en leur bonté, sachant qu’ils n’ont fait de mal à personne, pensant qu’ils aident vraiment, qu’il ne leur vient jamais à l’esprit que quelqu’un veuille leur faire du mal [...] Pour les gens comme votre fille, faire le bien dans ce monde est une compulsion féroce, dévorante, qui les consume. Je me demande si cela ne rétrécit pas comme des œillères leur champ de perception. »
L’heure n’est pas aux reproches, pas plus aux excuses, mais elle n’est plus non plus aux délicatesses diplomatiques. Comprendre, comprendre les ressorts cachés qui ont mené au drame, ravagé les existences. Comprendre comment ce pays a pu tenir tant d’années impunément sur la détestation et la rancoeur et croire qu’il allait pouvoir se transformer si aisément en nation arc-en-ciel. Comprendre pourquoi si longtemps les hommes ont accepté les regards tétanisés des enfants. Comprendre ce que signifiait grandir et survivre sous ce régime.
« Ah, mon fils ! Mon fils ! Qu’as-tu fait ? Qu’est-ce que tu as fait ?
Votre fille. L’expiation imparfaite de sa race.
Mon fils. L’hôte parfait des démons de la sienne. »
Avec un art abouti des dialogues et des descriptions, des ambiances, des gestes et des regards signifiants, Sindiwe Magona de se lancer dans l’histoire de cette narratrice qui élève ses trois enfants en travaillant comme domestique pour une mlungu (une personne blanche), rejoignant le cœur serré Gugulethu, ce bidonville créé d’autorité par le pouvoir raciste pour y parquer les Noirs telles des bêtes. Ainsi lorsque Mandisa cherche à regagner sa maison, alertée sur les secousses qui déstabilisent le township mais ignorante encore des détails, de l’implication de son fils adoré, le sensible Mxolisi.
« - Que s’est-il passé, cette fois ? répliquai-je, cherchant à dénicher des renseignements.
Il se pourrait qu’elle en sache plus que moi, vu que je ne savais pratiquement rien. Le « Quelque chose s’est passé à Guguletu ! » de Madame n’était vraiment pas un bulletin d’information.
- Je n’en sais rien, répondit la femme et elle ajouta que les gens qui descendaient des autobus de Guguletu, qui venaient d’arriver de là, disaient que les élèves manifestaient.
Et alors, quoi de neuf ? La pensée s’inséra dans mon esprit. Ne connaissons-nous pas les émeutes de ces enfants depuis 1976 ? Pourquoi manifestaient-ils cette fois ? Je n’étais pas un peu énervée. Et en colère. Plus en colère qu’énervée, à vrai dire. Ces tyrans que sont désormais nos enfants, grisés par le pouvoir, au pied levé, ils en font de ces revendications souvent absurdes, à nous, leurs parents.
‘Pas question d’aller au travail !
L’école, non !
Interdiction d’aller aux magasins d’alimentation !
Défense de consommer l’alcool du Blanc !
Défense d’acheter de la viande rouge !’
Quant à moi, j’en avais jusque là, de toutes ces sottises.
Pressée et poussée de toutes parts, je me laissais projeter en avant par la foule, mes pieds ne touchant pratiquement pas le sol. Tandis que des corps serrés comme des sardines me portaient, des pieds éraflaient des chevilles inconnues et désunies. Des mains attrapaient d’autres coudes, et s’enfonçaient dans des épaules inamicales. Elles furent récurées par des barbes imprégnées de sueur et sentant la bière blonde de Lion, par des cheveux gras et emmêlés, et les surfaces rugueuses de manteaux élimés. Elles furent barbouillées de la mucosité froide des nez morveux des jeunes enfants perchés sur le dos de leurs mères.
C’était ainsi que j’avançais. Déplacée de corps en corps, sans aucune volonté ou direction de ma part. Je continuais d’avancer, flottant et cahotant, me rapprochant de plus en plus de l’autobus. Centimètre par centimètre cahotant. Je serrais mon sac fortement sur ma poitrine. Le tenais dans mes bras comme un nouveau-né. Ou un amant nouvellement rentré d’un long séjour dans les mines d’or de Johannesburg. Si dans le chaos le sac tombait, alors je n’aurais qu’à lui dire adieu.
Enfin, j’arrivai devant l’autobus. Projetée, de tout mon long, jusqu’au seuil de la porte. De ma main droite, je saisis la barre à la porte comme soutien, mon sac toujours à plat sur ma poitrine, mon bras gauche l’agrafant solidement là.
Le long couloir étroit entre les deux rangs de sièges s’était transformé en tube, le boyau d’une saucisse géante, et nous, la viande hachée, embossés au coup par coup de bout en bout. Poussés jusqu’au fond. Poussés contre les genoux et les coudes qui dépassaient de ceux qui, par miracle, s’étaient retrouvés installés dans un siège. Chancelant, nous suivions tant bien que mal le couloir. Nous ne formions certainement pas une farce bien lisse : grumeleux, irritables, tranchants, et nous regardant d’un air renfrogné. Un salmigondis de toute évidence mal à l’aise. »
Que peut une mère même attentive et protectrice contre un système fait pour broyer ou pousser à la violence ?
De l’enfance de la narratrice qui plonge le lecteur dans la réalité de l’Apartheid, la déshumanisation totale, à la conception de Mxolisi qui frôle la fable (poésie africaine oblige), des enfants tirés comme des chiens errants par la police du régime à la lassitude qui envahit les yeux d’une adolescente sans avenir, de l’expropriation sans ménagement à cette maladie si répandue qu’est l’absence des pères, puis l’impuissance des mères à tenir leur chair loin des folies des foules, Sindiwe Magona livre un roman aussi affûté et complexe que bouleversant, démontant les mécanismes des haines et des incompréhensions réciproques, de la culpabilité et du poids de l’Histoire.
L’écrivaine connaissait la mère de l’un des tueurs, elle n’a pas osé lui écrire après le drame. Se définissant avec malice et injustement bien sûr comme « coward », ‘Mère à Mère’ est le résultat (brillant et uppercut) de ce remords de ne pas avoir alors trouvé les mots. Le livre n’en parle pas mais, cette histoire étant définitivement hors du commun, les parents d’Amy Biehl ont après sa mort créé une fondation à son nom pour venir en aide aux jeunes sud-africains des townships, lutter contre ces inégalités qui mènent invariablement à l’essentialisation de l’autre. À l’heure du wokisme échevelé, il y a là matière à réflexion... Deux de ses assassins y travaillent encore aujourd’hui.
Après une rencontre en 1998 avec le père de la jeune femme, Sindiwe Magona décida d’avancer la sortie du livre en août, le jour anniversaire d’Amy Biehl.
Tout, finalement, tant dans l’histoire du livre que dans la suite réelle du drame, symbolise le difficile chemin de la réconciliation.
Tout, dans l’écriture de Sindiwe Magona, révèle une connaissance épidermique de ce qu’était l’horreur de la séparation par la couleur de peau mais aussi le travail titanesque d’une vie à tenter de réconcilier, de nommer les affleurements, de révéler les lueurs d’espoir. La traduction au cordeau faite par Sarah Davies Cordova respecte la voix singulière de l’écrivaine, mots xhosa et afrikaans conservés : elle est à saluer.
« Ici, les contours précis et l’étoffe d’horreur de l’apartheid dans sa froideur institutionnelle et sa violence méticuleuse sur le quotidien de ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces adolescents dont la pleine vie est niée au présent, au passé, au futur » écrit en hommage Christiane Taubira en 4ème de couverture.
Un souffle, une pensée, un style et une douleur transformée qui transportent, secouent, font mal autant qu’ils invitent à regarder vers demain, à se méfier des réductions et des appâts politiciens. Des victimes de l’Histoire, la sale, l’injuste, à jamais gravées dans la mémoire du lecteur, comme autant de lanceurs d’alerte désormais. La découverte d’une immense écrivaine dont on ne peut qu’espérer la traduction rapide des autres œuvres. Un regard sans concession sur les pièges et les obstacles qui freinent encore et toujours l’apaisement et l’union; mais aussi une analyse toute... maternelle de l’intime, dans lequel se cachent les graines d’espérance, de futur possible.
— ‘Mère à Mère’, de Sindiwe Magona, Mémoire d’encrier ed. —
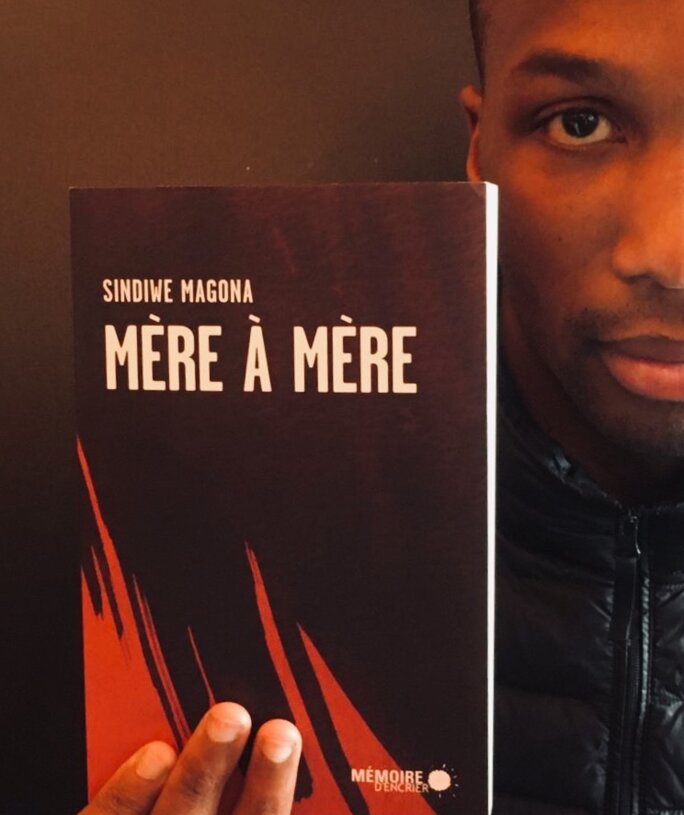
Agrandissement : Illustration 3
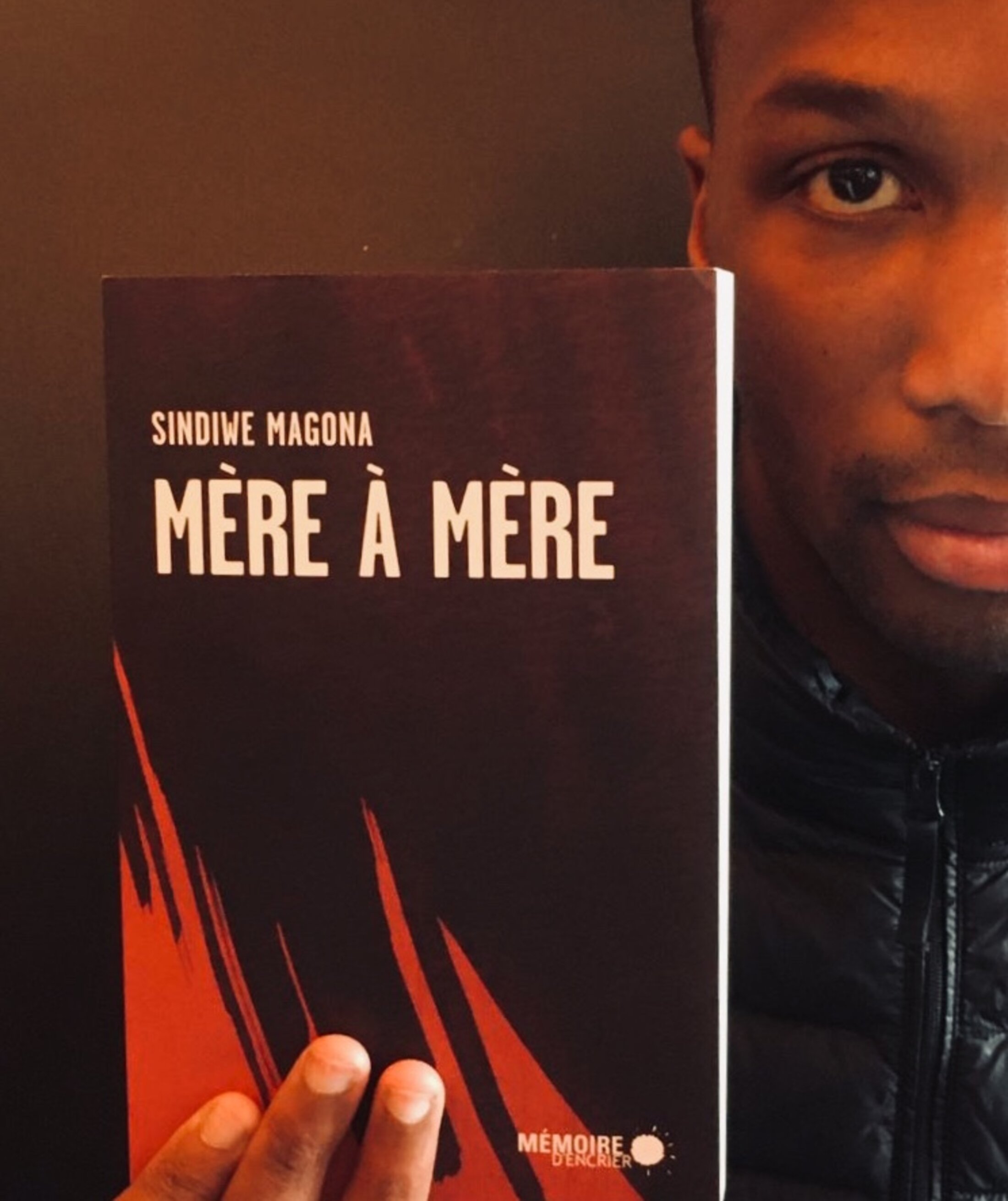
— Deci-Delà —



