
Agrandissement : Illustration 1

Occupy Wall Street, Sunrise (les architectes du Green New Deal), Justice Democrats, Black Lives Matter, Me Too, Women’s March, Rebellion Exctinction : autant de mouvements, d’organisations citoyennes, d'appels à la convergence des forces contestataires de la société civile nés sur « le fumier de l’ère Trump » (à l’exception d’Occupy Wall Street, 2011, mais le mouvement a laissé sa marque sur le mode de fonctionnement de l’activisme américain) : Mathieu Magnaudeix nous propose dans son dernier ouvrage de partir à la découverte de ce nouveau militantisme U.S qui tente de peser au sein d’une société plus divisée que jamais, de faire entendre ses voix au milieu d’un jeu politique bipartiste, cadenassé, alors que Bernie Sanders a été pour la seconde fois poussé à l’abandon dans la course à l’investiture Démocrate. Portraits, étude des théories, des capacités de mobilisation, de pression et des aspirations de chaque groupe sous le règne du ploutocrate raciste, idole des suprémacistes blancs et des bigots, génie auto-proclamé et grabber de pussies en chef.
‘Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains’ mais, restons un temps tout de même dans l’hexagone puisque cet essai de Mathieu Magnaudeix (essai très sourcé, approfondi, basé sur les entretiens de l’auteur avec des figures majeures, actuelles et passées mais toujours influentes de la gauche U.S dite radicale) invite avec enthousiasme les militants français de gauche à s’inspirer des méthodes des organizers américains, de cette gauche hors parti qui tente de se réinventer sur le terrain. Une distanciation (mot très tendance) dès le départ semble sur ce sujet nécessaire. Une distanciation sans doute rêche mais pas superflue tant les problématiques et la définition même de ‘gauche radicale’ dans les deux pays semblent éloignées (un socialiste tricolore y serait classé écarlate, pour dire). Même si, dans les deux cas, la gauche dans son ensemble paraît en effet en très mauvais état et pas du tout en position dominante (politiquement, culturellement). Le pouvoir de la mobilisation sauce community organizing serait enthousiasmant appliqué en France (surtout qu’en face d’un Président rejeté par l’opinion, toujours aucune force de gauche crédible n’émerge) si un modèle controversé pour y parvenir n’était pas proposé dans le pack.

Agrandissement : Illustration 2

« Cinq ans de suivi de la déprimante actualité politique française m’ont suffi pour constater ses impasses : le petit jeu des combines partidaires, le culte des chefs (tous des mecs), leur ego, leur présidentialisme maladif. Le plus triste pour moi fut pourtant d’assister à la conversion de la « gauche » au pouvoir au néolibéralisme, à la surveillance, aux doctrines sécuritaires. De constater, aussi, le racisme d’un certain nombre de ses représentants, occupés à faire du voile porté par certaines femmes musulmanes le défi principal auquel est confrontée la société française. Leur acharnement à déceler dans toute tentative d’organisation minoritaire l’hydre menaçante du « communautarisme », concept flou aux significations multiples qui surgit dès que des personnes racisées, des femmes, des queers tentent d’exister dans la sphère publique, ou (offense !) de s’organiser collectivement. »
Comment ne pas partager la première partie de cette analyse de Mathieu Magnaudeix ? Son agacement devant des politiques tricolores satisfaits se passant les plats, incapables d’inventer un autre chemin que celui de l’ultra-libéralisme, déconnectés des colères du terrain tant le trône du César républicain les hypnotise. Cependant, « l’organisation collective » dont il parle peut à son tour être taxée de « concept flou », de concept fourre-tout. Si les mouvements environnementaux par exemple peuvent être en ces temps d’urgence climatique un modèle très inspirant pour créer dans la rue un rapport de force avec les décideurs, une sorte de lobby citoyen que les gouvernants ne sauraient plus ignorer, d’autres entendent se baser sur l’essentialisation et lancent de plus en plus systématiquement et à la volée accusations faciles de racisme (ou d’homophobie, de misogynie, de transphobie etc) et de traîtrise à une ‘gauche véritable et pure’ à la face de tout contradicteur déclarant préférer le modèle du creuset utilisant la laïcité comme boussole, du melting-pot intelligent (cassé, à améliorer, à inventer) à celui des casiers identitaires d’où jaillirait systématiquement la Vérité dès lors que le mot magique ‘oppression’ aurait été brandi. L’intersectionnalité comme nouvelle grille de lecture en mode ‘c’est comme ça et c’est tout sinon vous n’êtes pas de gauche’ (pour une hypothétique union, faudra repasser. Macron peut souffler). Quant au « sécuritaire », une série d’attentats sanglants ayant frappé le pays, réalisés par des nationaux happés par l’intégrisme religieux, piétinant tous les efforts d’intégration de leurs parents et crachant au visage de la nation en même temps que leurs victimes expiraient, ne pas questionner (sans stigmatiser quiconque évidemment, il n’est pas question ici de la fange de notre vie politique) notre modèle - ainsi que l’hallucinante résurgence du sentiment religieux dans la société - aurait tout simplement été irresponsable. La France n’est pas une page blanche sur laquelle chacun poserait ses billes comme il l’entend : il ne suffit pas de l’affirmer, de le rêver pour que cela soit vrai. Personne n’a à être sommé de s’improviser sociologue, de se définir boomer, millennial, racisé, non-racisé, cis, non-binaire, queer, masculiniste & co s’il ne le souhaite pas : des tranches partout, des tranches pour tout (et la nature humaine étant ce qu’elle est, à tout faire ensuite pour obtenir le dernier mot en piochant ce qui arrange dans l’Histoire, en jonglant avec trois-quatre éléments d’une novlangue taillée sur mesure pour l’occasion). Génération post-it : no thank you, cheers, ta. Et si les recettes si prometteuses aux États-Unis se révélaient mortifères en France ? Un vrai débat, qu’amène par ricochet ce livre.

Agrandissement : Illustration 3

Mathieu Magnaudeix reprend la définition de l’intersectionnalité donnée par l’universitaire américaine Kimberlé Crenshaw (pour cette raison également que ‘Génération Ocasio-Cortez’ est intéressant : essayer de comprendre les concepts derrière les actions et les revendications) : « un prisme permettant d’inclure dans notre analyse du monde social l’éventail le plus large possible d’injustices sociales. Cela ne vient pas se substituer à l’analyse des rapports de classe, de sexe ou de race [...] mais cela permet de penser comment certaines personnes se retrouvent frappées par une convergence de désavantages. » Sur le papier, rien à dire. Mais dans les faits on voit bien que la course à l’oppression est lancée, que questionner par exemple les religions (espèces désormais non pas menacées mais pourtant surprotégées) sans se prendre une volée de bois vert dans la face devient difficile. Et qu’à force de vouloir se définir absolument, systématiquement (maladivement dans certains cas), on finit par oublier le liant pour ne plus que se concentrer sur les différences, la mise en accusation de mille bourreaux et aussi sur un programme bien trop large pour ne pas relever de l’utopie. Et même parfois à la dé-responsabilisation des individus du simple fait de leur appartenance à telle ou telle histoire. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de douter des spécificités, des inégalités, du racisme, du rejet, de ne pas reconnaître plusieurs histoires imbriquées dans un récit commun mais de se questionner sur les abus que ce concept d’intersectionnalité pourrait entraîner, sur la politique de la fracturation permanente, de la subdivision compulsive au nom d’une égalité qui, pour le coup, ne serait pas prête d’être atteinte.
« Le militantisme, j'ai horreur de ça [...] Des gens qui sont sûrs d'avoir raison et qui vont contre le Mal, sans discussion possible. » Étrange, sans doute, de placer dans ce billet sur ‘Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains’ cette citation de la regrettée Claire Bretécher qui a - incroyable - réussi à trouver sa place dans le panthéon des dessinateurs sans avoir eu besoin de jongler dans chaque bulle avec l’écriture inclusive. Qui a - rendez-vous compte - rencontré le succès avec un personnage d’ado mal fagotée, se moquant des codes imposés, sans avoir eu recours à une novlangue prétendument révolutionnaire. D’aucunes de répondre aussitôt : « Faiche ! Pour une Claire Bretécher, combien d’autres à qui on a volé la chance ? » Exact, elles auraient 100% raison. Mais il n’est pas démontré encore que de répéter en boucle ou de coller sur tous les murs des affiches XXL « à bas le patriarcat ! » et de rendre la langue illisible change quoi que ce soit, concrètement, aux inégalités hommes-femmes. De nouvelles amitiés, sûrement. Une solide communauté de followers, à coup sûr. La (re)découverte de l’action, indubitablement. Mais à part cela ? Une Bretécher revendiquant son indépendance aura sûrement plus incarné, bousculé les mentalités et fait avancer la cause des femmes que le bruit et les postures actuels sur le web. Recul revendiqué, donc, avant de plonger dans ‘Génération Ocasio-Cortez’ de l’engagé Mathieu Magnaudeix, correspondant de Médiapart aux États-Unis.
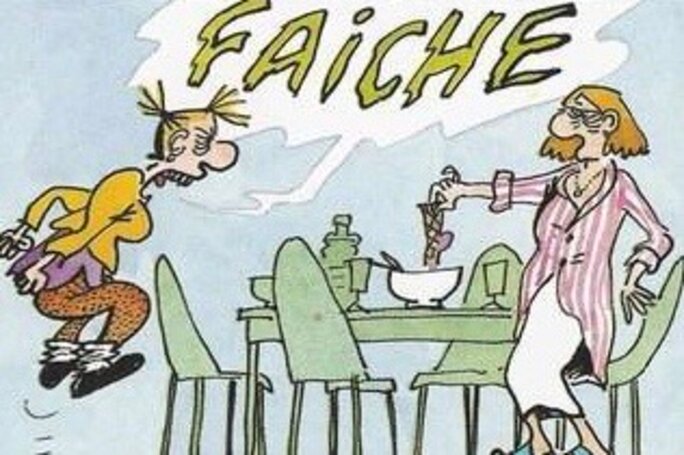
Nulle perfidie ici contre les femmes et les hommes qui entendent combattre les injustices par cette approche, simplement un rappel du droit à demeurer dubitatif non pas sur les combats menés mais sur le prisme de lecture qui essaie d’être imposé, sur les panaches levés des chevaliers du Bien 2.0 : un tour sur Twitter par exemple suffira à convaincre les plus sceptiques de la richesse du nouveau vocable militant, section noms d’oiseaux (« white tears », « mascu cis », « post-colonialiste privilégié », « laïcard » et autres joyeusetés vindicatives, synonymes modernes de « Tais-toi ! »). Une idéalisation de l’activisme moderne semblerait aussi dangereuse qu’une ignorance de sa grande énergie. Critiquer les pièges qu’il tend avec les meilleures intentions du monde - sans même s’en rendre compte, et, là est bien le drame - n’est donc pas du luxe. Les sensitivity readers aux Etats-Unis, par exemple, chargés dans l’édition de repérer et couper tout propos susceptible de froisser telle ou telle catégorie de lecteurs (Gosh...) et ce pour éviter les procès : est-ce vraiment ce modèle de société-là que nous désirons ? Car à force de censurer au nom du Bien, ils se coltineront probablement, les Américains trop susceptibles, un deuxième mandat Trump. Niveau efficacité, la technique de la cocotte-minute a l’air plutôt contre-productive. Quand on veut imposer au lieu de convaincre : l’affaire est en fait déjà pliée. La discussion mais... pas trop, en fait.

Une réserve sur le militantisme identitaire en France (aux États-Unis c’est différent, il n’y a qu’à regarder les chiffres de probabilité pour un Noir de se faire abattre par la police : 2,5 fois plus élevé que pour un Blanc. Le racisme est une part sombre de leur histoire, plus vivace que jamais) qui se devait d’être indiquée avant d’aller plus avant, toute lecture étant évidemment subjective et l’auteur faisant lui même le parallèle entre l’organizing de la gauche dite radicale outre-Atlantique et le nouveau militantisme français. Une réserve longuement développée mais le livre en vantant les mérites, elle n’est pas hors-sujet. Cette méfiance posée (et encore, l’exemple des Indigènes de la République n’a pas été dégainé. Un ange passe...), plongeons-nous vraiment dans l’ouvrage qui ne se concentre certes pas spécifiquement sur cet activisme-là (car il semble l’avoir déjà intégré) mais, pouvant en France être considéré comme le plus inquiétant, il méritait un traitement particulier. Le livre ne traite pas de ce sujet mais il le pose indubitablement. Et lorsque l’auteur en parle, c’est pour balayer ces critiques d’un revers de la main en les qualifiant de « fantasmes ». Chacun se fera son opinion, c’est après tout le but d’un essai.
Un bouquin très documenté et fort intéressant par ailleurs, qui se veut optimiste et positif. Mais oui mais oui : on peut tiquer sévèrement au plaquage des théories identitaires U.S sur la réalité française, sur son modèle (malade, oui, il faudrait être aveugle pour le nier), tout en s’intéressant à l’émergence d’un nouvel activisme américain, dynamique et imaginatif, héritier d’une culture de la mobilisation propre aux Etats-Unis (Magnaudeix le reconnaît bien volontiers d’ailleurs) et qu’il serait sot d’ignorer. Another country, some other rules.

Agrandissement : Illustration 6

« Ceux dont je vais vous raconter les histoires, la plupart jeunes adultes de vingt ou trente ans, sont en outre reliés par une expérience commune : ils n’ont connu que les crises. Ils entrent dans la vie adulte avec deux certitudes. La première est qu’ils vivront bien plus mal que leurs parents. La seconde est que le monde qui se dessine devant eux est détestable. Insoutenable. Invivable : un monde dans lequel la vie devient impossible.
La majorité d’entre eux sont nés sous la dynastie républicaine des Bush ou le mandat du démocrate néolibéral Bill Clinton. Ils se sont endettés pour faire des études hors de prix, ont vu les inégalités exploser, craignent à présent l’effondrement climatique dont ils seraient les premières victimes. Leurs parents et leurs amis exercent parfois deux ou trois boulots pour vivre. Gamins, ils ont vu les Twin Towers de Manhattan s’écrouler et leurs dirigeants déclencher, en représailles, une guerre absurde, meurtrière, géopolitiquement catastrophique en Irak, au prétexte de « preuves » fabriquées de toutes pièces par la Maison Blanche. Ils ont traversé l’ouragan de la crise financière de 2008, ont vécu sa cruauté, constaté avec dégoût que les banques et établissements de crédits coupables s’en sortaient à peine égratignés, sauvés par l’Etat. Comme AOC, certains ont fait en 2008 du porte-à-porte pour Barack Obama et ont applaudi sa victoire, pour vite constater que « l’espoir » promis était remis à plus tard, même avec le premier président noir des États-Unis. Beaucoup ont traîné leurs basques dans les assemblées générales interminables d’Occupy Wall Street, mouvement d’occupation de l’espace public apparu à Manhattan en 2011, qui entendait dénoncer la rapacité des 1% les plus riches de la planète et esquisser un autre avenir possible. D’autres (parfois les mêmes) ont crié : « Black Lives Matter ! » contre les violences policières et le racisme institutionnel [...] Ils rappellent que, dans un pays dont les premiers présidents furent propriétaires d’enclaves, la vie des Noirs vaut toujours moins que celle des Blancs. Beaucoup réclament l’assurance-santé universelle comme en Europe, l’annulation de la dette étudiante, et rêvent de dépasser le capitalisme.
Ces nouveaux activistes combattent en même temps les oppressions sociales, économiques, raciales. C’est en ce sens qu’ils sont radicaux. »
Et le journaliste d’enchaîner les entretiens avec certains de ces jeunes adultes qui ont décidé de s’engager non par caprice mais poussés par la nécessité tripale de faire, tenter du moins, de « créer du commun » pour ne pas tomber dans la désespérance durant le mandat Trump tant les injustices sont criantes et le parti Démocrate désespérant.
Ainsi Tara Raghuveer, jeune Américaine d’origine indienne du Midwest qui après des études à Harvard décide d’abandonner la promesse d’une carrière dorée pour retourner dans sa ville natale monter une organisation de défense des locataires à bas revenu. Ici un extrait de sa prise de conscience.

Agrandissement : Illustration 7

« Un ami d’enfance lui a proposé de la balader dans les quartiers pauvres où il possède des logements. Avec lui, elle découvre une ville qu’elle ne connaissait pas, à quelques rues de là où elle a grandi. Kansas City fait partie des villes les plus ségréguées des États-Unis. Les pauvres sont cachés derrière l’avenue Troost, la ligne urbaine de démarcation entre les Noirs et les Blancs. Son ami, ce gentil garçon qu’elle fréquentait depuis ses douze ans, se révèle être un marchand de sommeil cynique et violent. Les maisons qu’il loue sont délabrées. Il entre sans frapper, se permet des commentaires méprisants, exhibe devant Tara le pistolet qu’il utilise pour menacer ses locataires en retard de paiement. "Il me répétait qu’il faisait une bonne action en aidant les pauvres à se loger. Ça lui permettait sans doute de bien dormir la nuit." »
Après avoir utilisé les méthodes traditionnelles du community organizing et récolté une masse d’informations sur les expulsions à Kansas City, Tara Raghuveer défend désormais « au sein de People’s Action, une coalition de mouvements grassroots [campagnes de terrain], la construction de millions de logements sociaux, un contrôle national des loyers, le droit au logement pour tous. Elle ne cesse de s’émerveiller du pouvoir de l’action collective. Des déclics créés par la proximité et l’écoute. "S’organiser, dit-elle, c’est construire des relations fortes et agir ensemble. C’est rendre l’inévitable évitable." »
Ces rencontres de l’auteur aux quatre coins du pays avec les nouveaux activistes et les anciens influenceurs sont ainsi l’occasion pour le lecteur de découvrir des parcours, des personnalités charismatiques et, peu à peu, un tableau des injustices au cœur de l’empire américain. Injustices que ces jeunes activistes entendent bien réparer, amoindrir au moins, en inventant mouvements, coalitions, campagnes, persuadés que rien ou si peu ne viendra plus du parti Démocrate, même s’ils tentent encore de l’influencer (scène cocasse dans le bureau de la féroce Speaker Nancy Pelosi), mais tout de la synergie des forces militantes.
Un portrait aussi, bien sûr, d’AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, révélation 2018 de la vie politique américaine, ancienne serveuse du Bronx devenue la plus jeune candidate jamais élue au Congrès et désormais pugnace adversaire de l’administration Trump, symbole des possibles et du renouvellement.
Plusieurs chapitres poussés sur les techniques d’organizing également, qui ne manqueront pas d’intéresser les militants convaincus. Et une énergie qui se dégage de cet essai/enquête, une envie d’y croire qui ne demande qu’à être partagée (même si...Mais cela a déjà été dit).
Un livre qui pourrait donc devenir une référence pour certains militants. Et, pour les moins convaincus (qui a dit ‘boomers‘ ? Qui a osé ?), pour les ‘bretécheriens’ : l’occasion de découvrir, d’essayer de comprendre un logiciel différent du leur à l'heure où "les gauches" ne savent plus échanger et passent leur temps à s'envoyer des attaques ad hominem en mode scuds. Dans tous les cas un regard intéressant sur une Amérique en ébullition.
— ‘Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains’, Mathieu Magnaudeix, ed. La Découverte
* lire les bonnes feuilles de ‘Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains’ sur Médiapart
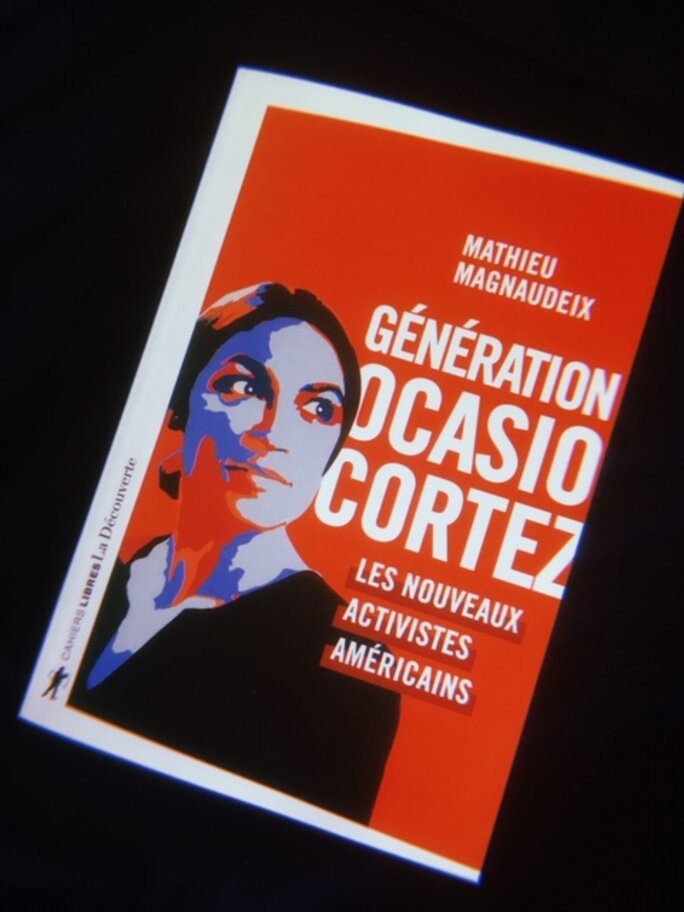
Agrandissement : Illustration 8
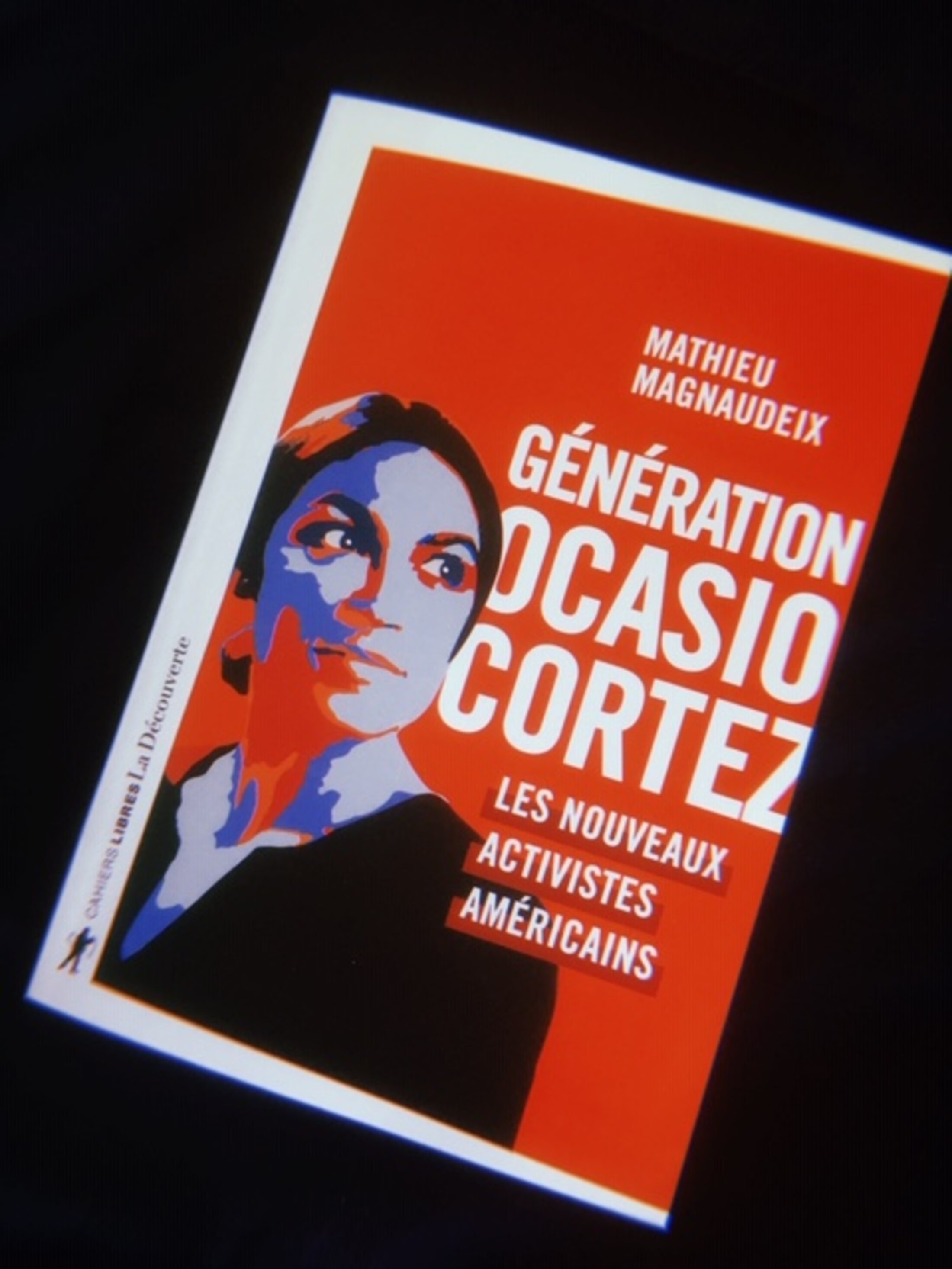
- Deci Delà -



