Aujourd’hui, en France, le « blocage des institutions » ouvre un débat sur les possibilités d’une VIème République. Du déficit de stabilité des institutions au déficit démocratique exprimé par la contestation sociale, la Vème ne semble plus contenter personne, annonçant l’arrivée probable d’un moment constituant.
S’il peut paraître salvateur, un processus de modification de la constitution peut avoir de nombreux visages et représente des risques, puisqu’il remet en question les droits acquis et les modalités de la séparation des pouvoirs. Le pire scénario, qui n’est d’ailleurs pas le moins probable au regard des forces politiques en présence, serait celui d’une rédaction autoritaire d’une nouvelle constitution – entre « experts » et sans recours à des procédés démocratiques – qui répondrait aux blocages par l’affaiblissement, voire la suppression, des contre-pouvoirs. Alors, il semble tout à fait nécessaire de réfléchir largement aux modalités de la création constitutionnelle, tout autant qu’à son contenu : quels droits une nouvelle constitution reconnaitrait-elle ? ; qui protégerait-elle ? ; quels pouvoirs déléguerait-elle ? quelles seraient les limites au pouvoir de l’État ? quelles institutions nouvelles pourraient-elles reconnaître ?
Un regard rétrospectif sur le moment constituant de l’après-seconde guerre mondiale se révèle riche d’enseignements contemporains. Pendant l’Occupation déjà, au sein de la Résistance, l’idée qu’il faut refaire la Constitution pour y inscrire des droits fondamentaux protégeant l’humanité est omniprésente. Le constat est simple : le système constitutionnel d’entre-deux guerres n’a pas su empêcher le désastre autoritaire, la violence du régime de Vichy et son implication directe dans la stigmatisation, l’internement et la déportation des Juif·ves, des Tsiganes, des homosexuel·les et des opposant·es politiques. Dès 1942, le résistant et professeur d’économie politique, André Philip, appelle, dans un discours prononcé à New York, à une « nouvelle déclaration des droits » qui serait « adaptée aux connaissances sociologiques actuelles et développée dans ses conséquences économiques et sociales »[1].
Dans cette veine, le programme du Conseil National de la Résistance adopté le 15 mars 1944 prévoit la reconnaissance de plusieurs revendications sociales formulées en tant que droit d’accès à la direction d’entreprise, droit au travail et au repos, l’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre, l’organisation d’un régime de sécurité sociale et de financement des retraites, une politique de salaire fondée sur la sécurité et la dignité, pour garantir la possibilité de « vivre une vie pleinement humaine ». Après deux assemblées constituantes, l’une conclue par le rejet du texte par referendum, la Constitution de la IVème République est promulguée le 27 octobre 1946 et consacre en son Préambule les « principes particulièrement nécessaires à notre temps » – les PPNT – toujours en vigueur aujourd’hui : l’ébauche d’une égalité entre femmes et hommes, le droit d’asile, les libertés syndicale, de grève et à la négociation collective des conditions de travail, le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence, etc. En somme, c’est la proclamation de droits sociaux qui n’existaient pas auparavant dans un texte constitutionnel français.
Dans ce panorama, deux Déclarations oubliées méritent, je crois, une attention contemporaine. Elles sont nées dans l’esprit de leur créateur et n’ont jamais été discutées dans une assemblée. On peut y voir des tentatives d’interventions intellectuelles, dans le sens où les deux auteurs essaient d’orienter un débat public, de susciter un désir social autour des conceptions qui y sont développées, voire même d’influencer le processus constituant à venir, sans succès.

Agrandissement : Illustration 1

La première est un ouvrage – La Déclaration des droits sociaux – rédigée par le philosophe/sociologue Georges Gurvitch, publiée en 1944, à New York, là où son auteur a trouvé refuge. La seconde est un article – « Projet d’une Déclaration des Droits des personnes et des collectivités » - publiée la même année dans la revue Esprit, alors interdite par le régime de Vichy, et rédigée par le fondateur de cette même revue, Emmanuel Mounier. Au premier abord, les deux auteurs ne semblent pas si proches. Si Emmanuel Mounier est un fervent catholique, inspiré par Charles Péguy, avec des visées politiques peu claires, Gurvitch, lui, se dit athée et anarchiste autogestionnaire. Les textes présentent eux aussi de nettes différences. Mounier reconnaît des rapports hiérarchiques dans la société qui permettent son dynamisme, alors que Gurvitch cherche justement à les réduire et espère un monde solidaire mu par des rapports de coordination. Mounier n’hésite pas à parler de « communautés naturelles », alors que pour Gurvitch tout est social. Malgré ces divergences profondes, témoignant de cultures philosophiques éloignées, les deux textes présentent de très nets points communs.
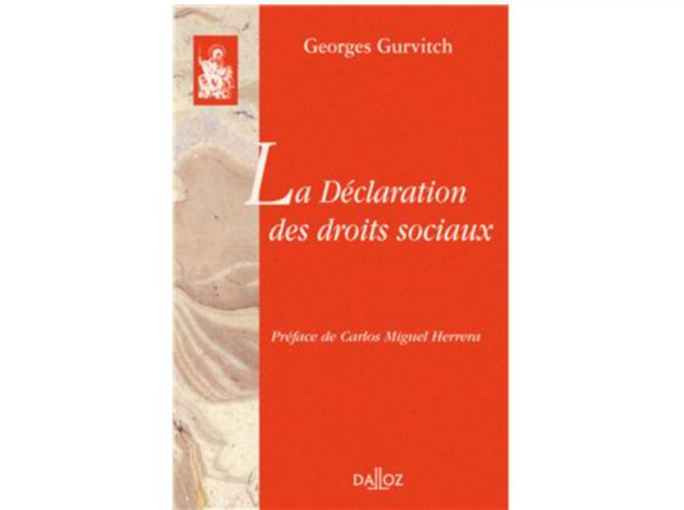
Agrandissement : Illustration 2
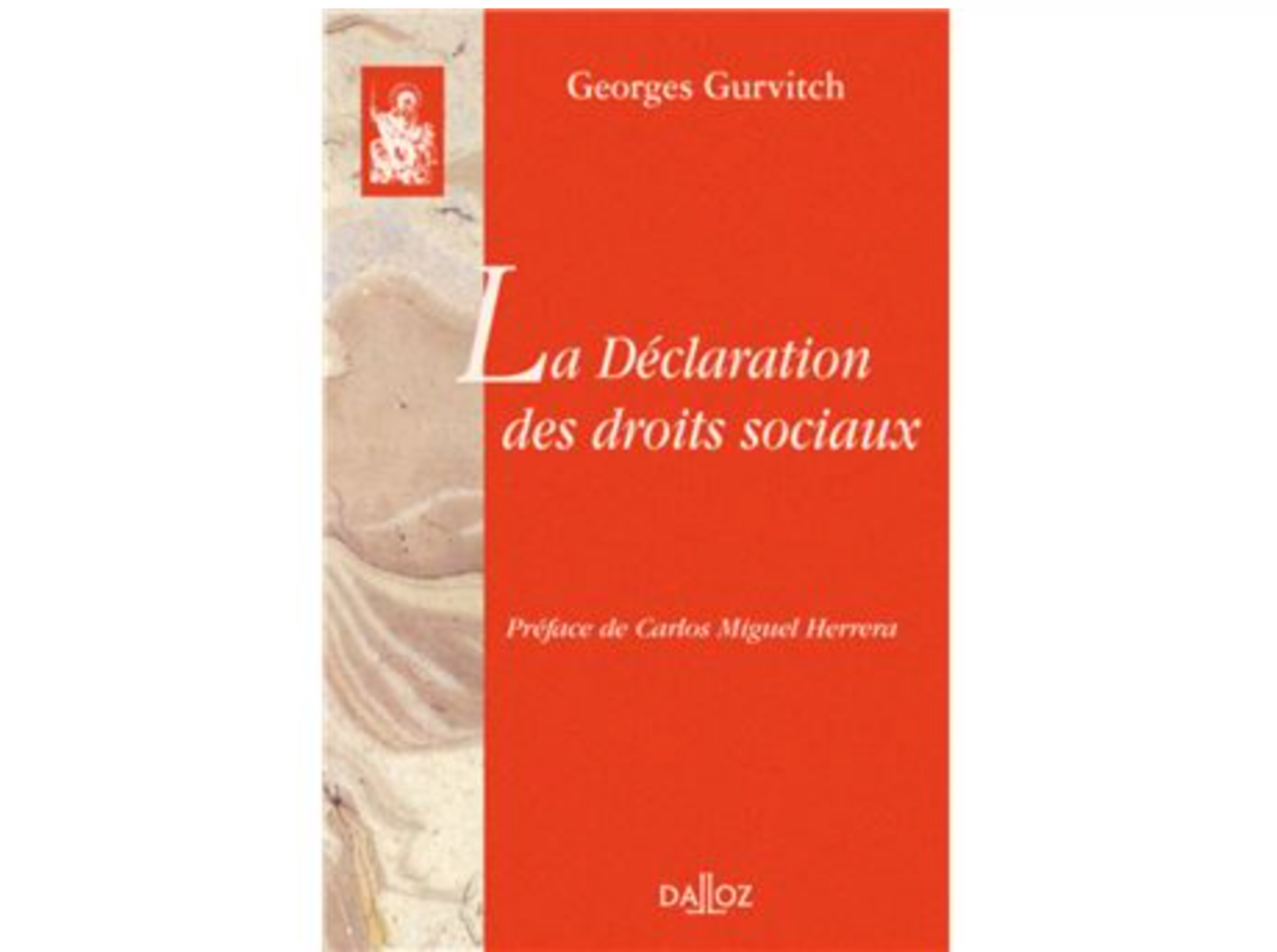
D’abord, l’un comme l’autre dénoncent l’individualisme juridique comme finalité unique du droit et critiquent la Déclaration de 1789 qui ne reconnaît que des individus-sujets de droit. Ils soutiennent un certain point de vue anthropologique commun : toute personne est constituée par les collectifs auxquels elle participe. Ainsi, reconnaître les individus en dehors de leurs appartenances sociales entrave la pleine protection de leur personnalité. Qui plus est, les individus isolés sont fragiles face à l’État, voire totalement incapables si ce même État devient autoritaire. Il faut donc compléter la Déclaration de 1789, car elle est « entachée de vices d’époque », comme le dit Mounier. Elle a été écrite dans un contexte où les institutions collectives – la société d’ordres – étouffaient l’individualité, mais en 1944, le constat est inversé, d’où la nécessité de la compléter.
Mounier et Gurvitch partagent ainsi une idée commune : les groupes sociaux ne doivent pas seulement être reconnus et protégés par des textes constitutionnels, ils doivent représenter de véritables contre-pouvoirs et participer, aux côtés des individus, à la démocratie. Pour Mounier, le pouvoir de l’État doit être « limité par les pouvoirs spontanés des sociétés naturelles qui composent la nation ». Dans son ouvrage, Gurvitch, lui, va plus loin qu’une compilation de droits nouveaux, il propose un véritable modèle d’organisation fédéraliste, un réseau de groupes institués fonctionnant démocratiquement qu’il pense en tant que réalisation concomitante de trois principes : l’égalité, la liberté et la souveraineté populaire.
Chaque entreprise, usine, service public, coopératives, etc. devrait être organisé par des décisions prises dans des conseils de contrôle et de gestion, pour ensuite désigner des représentant.es dans un Conseil économique régional, puis national, lui-même inclus dans le Conseil économique international. Il existerait ainsi des institutions collectives et démocratiques, du local à l’international, indépendantes de l’État, et réglementant divers secteurs des activités humaines. Ces institutions permettraient, nous dit Gurvitch, d’approcher « le but de la Société » qui est « la fraternité des hommes [et des femmes] et des groupes, se réalisant par la variété dans l’unité, c’est-à-dire par une pluralité d’associations de collaboration égalitaire, intégrées dans la communauté nationale et protégeant la liberté et la dignité humaine de chaque participant ».
Dans cette vision de la démocratie et de l’organisation des contre-pouvoirs de l’État, il y a une nette différence d’avec la logique de la Constitution de 1946 à venir. Cette dernière reconnaitra certes des droits sociaux – les fameux PPNT – mais dans une logique descendante, depuis l’État et ses organes vers la société. Si le droit à la participation démocratique au sein des usines et entreprises est reconnu, les mesures sociales sont pilotées par l’État et non par les groupes de travailleur.euses, de producteur·ices ou de consommateur·ices, autrement dit par la société organisée. La logique constitutionnelle – et du droit étatique en général – demeure celle d’individus-bénéficiaires, plutôt que celle d’individus-acteurs. Ce que l’État concède – une assurance-chômage, des droits à la retraite, des droits sociaux en général – il peut aussi le reprendre, et c’est bien ce que l’on constate aujourd’hui en France.
Alors, pour que chaque individu puisse participer à l’élaboration du droit qu’il doit ensuite respecter, le relais d’un tissu social organisé est nécessaire. Gurvitch et Mounier, presque comme le scande un célèbre collectif de rappeurs, voient dans les « bandes organisées » un terreau fertile de démocratisation générale de la société. Sans vouloir trop m’écarter du sens strict des paroles, « on ne peut pas nous canaliser », pourrait signifier « on ne peut pas nous dominer, nous soumettre, nier notre dignité tant individuelle que collective ». Et là aussi on trouve toute la force de ces deux textes : l’organisation collective de tous les secteurs de la vie humaine est un droit fondamental inhérent à la nature politique des humains, à leur besoin de participation à la détermination du droit, un vecteur d’émancipation.
Autant Gurvitch que Mounier savent bien que leurs textes ne seront pas débattus dans une assemblée constituante. Leur auditoire est autre. Ils cherchent à insuffler un désir d’autogestion dans la société, à discuter les possibilités d’une démocratie ascendante au travail et chez les consommateurs et par extension dans tous les groupes qui nous caractérisent : culturels, sportifs, religieux, partout en somme. Tous les pans des activités humaines peuvent être organisés par des décisions venant des membres eux-mêmes. Alors, c’est une réflexion sur les moyens de décider ensemble qui se dessine et dont la société organisée doit se saisir pleinement et massivement. Pour répondre à la crise démocratique, rien de mieux qu’une extension des lieux de démocratie, élargir le droit à faire du droit dans des institutions nouvelles, au-delà des seuls moments électoraux.
C’est une forme de démocratie où nos vies quotidiennes peuvent avoir droit de cité, s’inscrire dans des ordres du jour et être débattues par ceux et celles qui la vivent. Les projets de Mounier et Gurvitch invitent ainsi à un développement spontané de l’autogestion dans toute la société, à l’enracinement d’une culture de la décision collective par la prise de conscience que toute personne en est capable avec les autres, contrairement à la rhétorique classique du système représentatif fondé sur l’individualisme juridique.
Les textes de Mounier et Gurvitch résonnent dans l’actualité politique française où l’opposition contre les idées d’extrême droite, l’effondrement de la biodiversité et la destruction des acquis sociaux se qualifie de plus en plus en tant que mouvement de résistance. Résister, même dans les années 1940, ne se résume pas à une lutte armée ou à des actions directes de sabotage. L’action implique aussi la réflexion collective autour des institutions constitutionnelles, avant que le sujet ne nous échappe, penser ce que l’État doit permettre et ne pas empêcher. Elle invite aussi à prendre part aux prises de décisions les plus locales autour de nous, dans des associations, des groupes divers, à pratiquer la sociabilité par la prise de décision, à s’essayer à l’intelligence collective, l’écoute et la formation, autrement dit résister en s’engageant dans un processus constituant permanent.
[1] La conférence du 7 novembre 1942 fut publiée dans le journal Combat à Alger, n°63, le 19 juin 1943. De larges extraits ont été reproduits par Henri Michel et Boris Mirkine Guetzévitch, Les idées politiques et sociales de la Résistance, Documents clandestins 1940-1944, Paris, P.U.F., 1954, pp. 278-280.



