
Agrandissement : Illustration 1
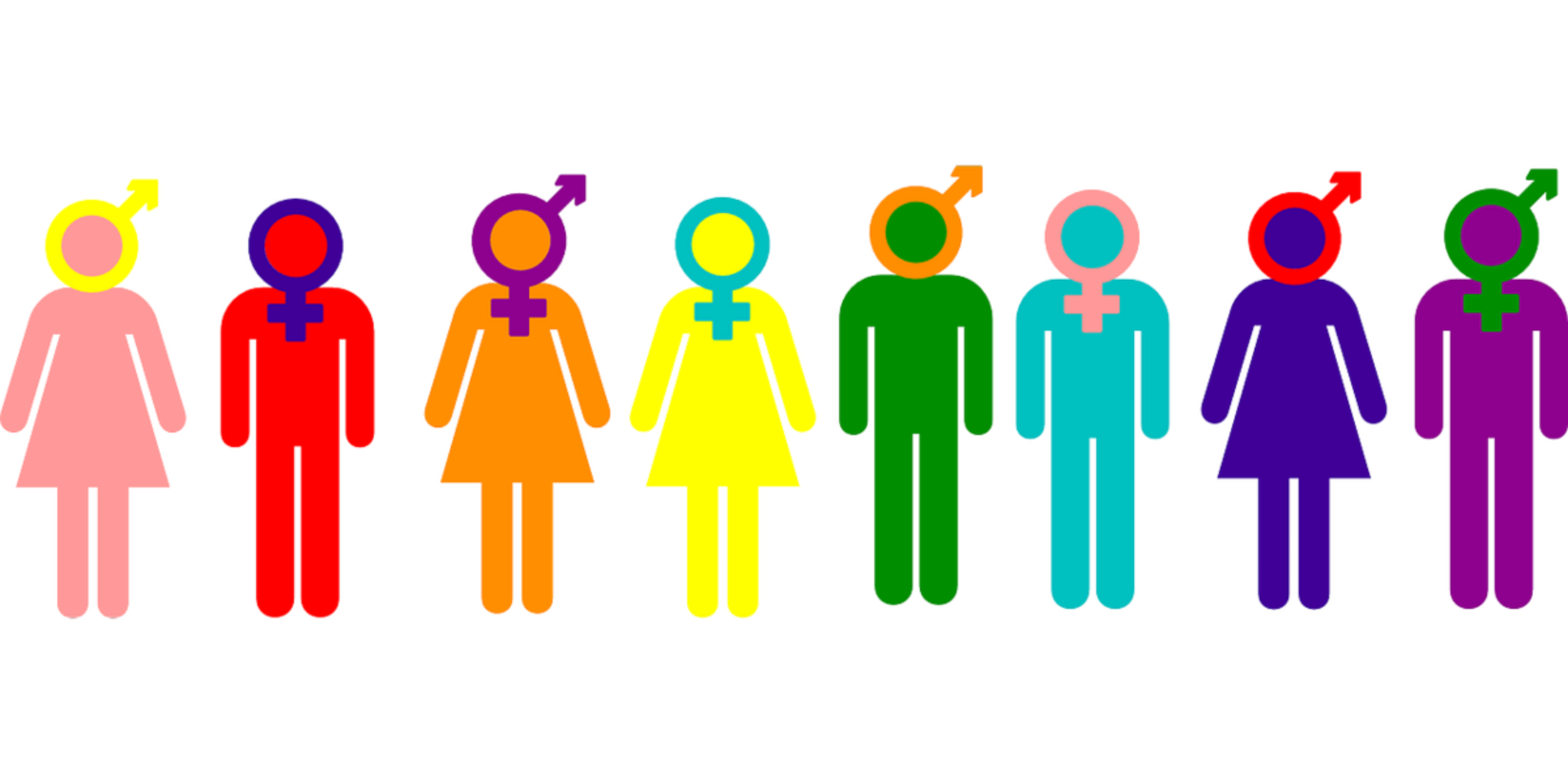
Une notion de « vérité » entoure désormais la sexologie moderne, voire de véridiction. La France, compte ainsi, ces dernières années, des dizaines d’écoles, d’institutions, de cours universitaires, laissant à penser que la sexologie a désormais acquis une posture de « garantie normative ». Si Freud[2], dans les Études sur l’hystérie, relève qu’il s’avère rare d’entendre des patients parler de sexualité, aujourd’hui en revanche, il s’agit d’une demande toujours plus récurrente afin de mettre des mots autour de cette thématique. Dans le sens large et objectif la sexualité renvoie à une série d’activités : l'imaginaire érotique et sexuel, les conduites sexuelles, les pratiques, la reproduction, les sentiments, aux ensembles des phénomènes sexuels. En dépit des nombreuses ouvertures ou avancées en matière de sexualité et de santé sexuelle, la pression de la Scientia sexualis ne s’est jamais pourtant éloignée du champ d’une sexologie très hétéronormée ou fondée en bonne partie sur les « dogmes hétéronormés du discours psychanalytique traditionnel »[3]. Cette tendance transparait d’autant plus que, plus de la moitié la sexologie et de la sexualité reposent sur des facteurs politiques : les fantasmes, le langage, les pratiques sexuelles, la vie de couple, la contraception, la règlementation en vigueur, la culture. Il convient d’évoquer en sus, la politique publique en matière de santé sexuelle, les valeurs qui forment le savoir du sexologue ou du spécialiste de la sexualité ou encore celles qui forment la morale du moment. William Masters et Virginia Johnson[4] (1966), démontrent que la finalité de l’acte sexuel ne réside pas uniquement dans la reproduction, mais dans le plaisir.
Ce dernier renvoie en effet, à une question politique que depuis de siècles imprègne tout lien ou question directe à la sexualité. L’un des premiers livres sur la sexualité est celui de Nicolas Venette, Tableaux de l’amour conjugal paru en 1696 et dans lequel le professeur originaire de la Rochelle propage ses conseils sur une meilleure réussite de la procréation au sein du couple[1]. Mais c’est avec les Lumières qu’une petite révolution centrée sur les corps s’installe en France[2]. Roy Porter soutient que c’est à cette époque qu’on assiste à une « libération hédonistique de la libido ».
Que peut la sexologie dans la compréhension de nouveaux phénomènes contemporains à forte pression sociale comme Me Too, l’homoparentalité, les nouvelles addictions ? Ou encore comment se pose-t-elle dans l’accueil de la communauté LGBTQI quand par exemple pour un couple homosexuel parler de sexualité ou de troubles sexuels avec un médecin peut paraitre très compliqué ? Les questions relatives à l’homosexualité relèvent aussi de cette sphère politique. Sylvie Tissot s’attache d’ailleurs dans Gayfriendly[1]à souligner la bienveillance à l’égard d’une homosexualité seulement si bien encadrée socialement et moralement. Structurée plus comme une norme mise en valeur par la bourgeoisie, elle finit par façonner l’espace public contemporain où la discrétion devient le seuil de respectabilité. Il s’agit en somme de demander aux homosexuels de se conformer aux mœurs et aux pratiques sexuelles dominantes.
En effet, il semble pertinent de s’interroger sur le fait de savoir s’il s’avère judicieux d’enfermer dans un cadre institutionnel et standardisé, l’univers des valeurs qui entourent les questions liées au sexe, aux troubles sexuels aux croyances, aux religions, aux sentiments, à l’inconscient même, à l’anthropologie, etc. ? A ce sujet, l’enquête[2] publiée en 2020 dans la revue Sexologie vise à identifier les caractéristiques sociodémographiques de la population des sexologues qui exercent en France. Selon ses résultats, 67 % des sexologues déclarent être non-médecins, dont une partie de psychologues diplômés et une autre partie de thérapeutes ayant suivi d’autres formations professionnelles. La majorité des participants ont obtenu un diplôme en sexologie ou santé sexuelle (62 %). La présence féminine s’avère majoritaire avec 83%. En effet dans beaucoup de formations, qu’elles soient universitaires ou non, dans le domaine de la sexologie, le couple hétérosexuel représente la norme.[3] La question LGBTQIA est vite fait liquidée autour de l’homophobie, de l’origine, du genre, des IST. Mais quid de toutes les autres dynamiques sexuelles et de couple ? Il suffit pour s’en convaincre de se référer à quelques sites internet de quelques experts en sexologie et de voir comment des pratiques comme le « libertinage » ou le « polyamour » où les « plans à plusieurs » se trouvent généralement associées au champ de l’homosexualité, caractérisé à son tour comme une sexualité plus « festive ». Encore les homosexuels valoriseraient « une sexualité plurielle et une multiplicité de partenaires » et leur sexualité serait finalisée à la pénétration[4]. Cela vient occulter, ou presque ignoré, la présence de ces thématiques, également chez les hétérosexuels. Par exemple, les résultats d’une étude, montrent « que beaucoup des femmes ayant développé des pratiques de pluripartenariat disent l’avoir fait en réaction à une « infidélité » masculine première (Combessie, 2008). Dans ce contexte la perception de l’homosexualité chez beaucoup de sexologues demeure trop nuancée, certains avançant « qu’elle ne s’installe (chez les garçons) clairement qu’après 21 ans, et que les « fantasmes homosexuels chez les adolescents peuvent conduire à des tentatives de suicide ». Il convient de s’interroger sur le fait de savoir si véritablement ce sont les fantasmes qui conduisent au désespoir ou plus véritablement la crainte et la peur de l’homophobie de certains ? Pour certains auteurs, les homosexuels s’apparentent à « une population problématique »[1]d’individus dépendants des psychotropes et d’une sexualité compulsive. L’auteur d’une enquête bien particulière prend ainsi pour cible les soirées bruxelloises de la Démence durant lesquelles, les hommes provenant du monde entier se laisseraient aller à leurs instincts et opteraient pour des pratiques sexuelles dignes de « scènes dantesques »[2]. Démence c’est le nom donné aux soirées dance, organisées depuis 1990 en Belgique, ou le public, surtout gay e bisex, danse généralement avec le haut du corps dénudé. Ces soirées sont généralement organisées sous forme de « party » et se prolongent pendant tout un weekend sous une grande amplitude horaire : du vendredi jusqu’au dimanche terminé en after dans l’un des plus grands saunas bruxellois. La sexualité humaine renvoie donc aux relations interpersonnelles et à l’imaginaire, et se révèle donc souvent plus fictive que réelle. Elle se rapporte dans le même temps à « une construction sociale »[3]. En quoi cette liberté au plaisir déragerait l’auteur de la recherche ? En effet les soirées de la Démence, du Circuit, Rapido, Délice, s’inscrivent avec de façons plus au moins accentuées dans la forte sexualisation de la communauté homosexuelle. Dans ce contexte, l’imaginaire sexuel s’entend comme l’ensemble des représentations que produisent, partagent et diffusent les membres d’une communauté. Ces représentations ne correspondent pas uniquement au fruit de l’imagination mais englobent également de réelles relations interactionnelles. Nous savons également que « l’imaginaire sexuel » traditionnel renvoie au « modèle de la sexualité hétérosexuelle monogame et pénétrative », perçu comme « système normatif structurant ».[1]
[1] Andro, A. & Bajos, N. (2008). La sexualité sans pénétration : une réalité oubliée du répertoire sexuel. Dans : Nathalie Bajos éd., Enquête sur la sexualité en France: Pratiques, genre et santé (pp. 297-314). Paris: La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.bajos.2008.01.0297"
[1] Gaissad, Laurent. « La Démence ou la dépense ? Le circuit festif gay entre consommation et consumation », Ethnologie française, vol. 43, no. 3, 2013, pp. 409-416.[2] Ibid.
[3] Mireille Bonierbale, Michel Bozon, Pierre-Henri Gouyon, À quoi sert le sexe, Belin, Paris, 2017.
[1] Giami, Alain, et Patrick de Colomby. « Profession sexologue ? », Sociétés contemporaines, vol. no 41-42, no. 1-2, 2001, pp. 41-63.[2] A. Giami, S. Michaels, Sexology as a profession in France: Preliminary results of a national survey (2019), Sexologies,Volume 29, Issue 2, April–June 2020, Pages e43-e51
[3] Crozier I., 2003, La sexologie et la définition du « normal » entre 1860 et 1900, Cahiers du Genre, 34, 17-37.
[4] COURDURIÈS, Jérôme. Chapitre 5. De la sexualité des couples gay In : Être en couple (gay) [en ligne]. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2011 (généré le 04 novembre 2021). Disponible sur Internet :<http://books.openedition.org/pul/11990>. ISBN : 9782729711153. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pul.11990.
[1] Sylvie Tissot, Gayfriendly. Acceptation et contrôle de l’homosexualité à Paris et à New York, Paris, Raisons d’Agir, 2008.
[1] Cité par Sarasin, Philipp. « L'invention de la « sexualité », des Lumières à Freud. Esquisse », Le Mouvement Social, vol. no 200, no. 3, 2002, pp. 138-146.
[2] A ce sujet on conseille la lecture de Karen Harvey, « Le Siècle du sexe ? Genre, corps et sexualité au dix-huitième siècle (vers 1650-vers 1850) », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 31 | 2010, 207-238.
[1] Foucault M., 1978-79, « Naissance de la biopolitique », in Dits et Écrits, tome III, n° 274, Paris, Gallimard, 2004, pp. 820-829.[2] Freud S. et Breuer J. (1895) Études sur l'hystérie, Éd. PUF.
[3]Tiphaine Besnard-Santini, « Clinique de la sexualité : diagnostiquer la différence ou le lieu de l’hétéronormativité », Genre, sexualité & société [En ligne], 16 | Automne 2016, mis en ligne le 20 décembre 2016, consulté le 22 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/gss/3825 ; DOI : https://doi.org/10.4000/gss.3825
[4] Masters W. & Johnson V., (1966). Human Sexual Response, Boston, Little, Brown & Co. [éd. Française, Les réactions sexuelles, Paris, Robert Laffont, 1968].



