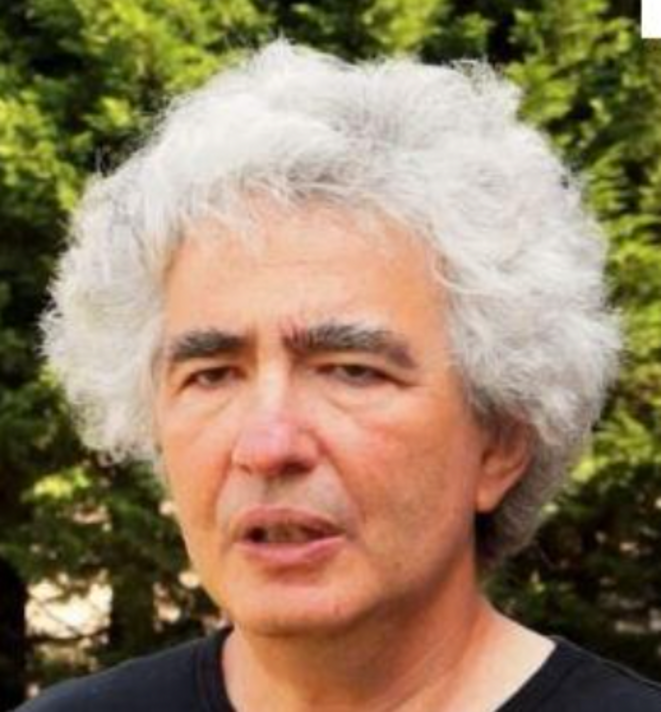Le changement climatique frappe à toutes les portes et à tous les étages. Il se manifeste par des records spectaculaires qui sont les meilleurs vecteurs médiatiques du changement climatique en cours, des feux de forêts qui se multiplient dans un contexte de sécheresse exacerbée autour du bassin méditerranéen, ou parfois, des feux dont l’intensité relève d’une ampleur inédite comme en Australie, ou encore surgissant à des latitudes plus insolites comme en Sibérie ou dans les pays du nord de l'Europe. Des cyclones dont l'intensité décuple les ravages en Atlantique, dans le Pacifique mais aussi en méditerranée. Des vagues de chaleur dont l'intensité et la durée sont inédites comme au Pakistan et en Inde ou au Canada. La litanie de tels événements et leur déferlement sur les différentes zones vulnérables mais également leur extension sur de nouveaux territoires et in fine sur les écrans de nos télévisions n’en finissent pas d'alerter sur les craquements du système climatique. Ce ne sont pourtant pas uniquement les événements extrêmes, aussi émotionnels soient-ils, qui révèlent les plus graves dangers à venir.
Sur le moyen terme, quasi chaque année qui passe prend place dans les années les plus chaudes du siècle, la mesure de plus en plus précise de la remontée du niveau marin montre une accélération notable. Ces tendances qui s’inscrivent dans la durée vont marquer les variations climatiques des années 2020 et malheureusement, l’augmentation globale des températures devrait atteindre 1.5°C, valeur de l’accord de Paris, dès la première moitié de la prochaine décennie.
La seule question qui vaille est alors : que faire, dès maintenant, pour modifier la donne pour 2050 ? De plus en plus de voix s’élèvent pour une planification de long terme pour atteindre nos objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Seules des politiques volontaristes, planifiées, cohérentes et justes socialement, permettront de modifier la trajectoire globale.
Décarboner l’énergie pour émettre moins de CO2 -qui s’accumule dans l’atmosphère et qui a un temps de résidence très long - , réduire considérablement les émissions de méthane -gaz à effet de serre bien plus efficace que le CO2, mais qui a l’avantage de ne résider dans l’atmosphère qu’une dizaine d’années - changer les modes de productions agricoles pour faire baisser les émissions de protoxyde d’azote (N2O) restent des objectifs qui peuvent être atteints pour 2050.
Ils impliquent un changement de nos modes de vie. Par exemple, ce grand vecteur de la société marchande qu’est la publicité est essentiellement produit dans un modèle consumériste auquel il conviendrait de substituer la sobriété. De tels bouleversements doivent se fonder sur des valeurs culturelles forgées par un renouvellement de notre modèle éducatif. Enfin, les rapports du GIEC, depuis l’origine, insistent sur l’éradication de la pauvreté et une forte réduction des inégalités sociales à l’échelle globale mais aussi territoriale, inégalités qui constituent un frein à l’adaptation au changement climatique.
Dans ce contexte, la disparition brutale du glacier de Marmolada, dans les Alpes italiennes illustre le fait que les dernières vigies de nos montagnes, les glaciers, partout dans le monde, se rétractent comme peau de chagrin, avec une vitesse fulgurante dans les massifs tropicaux, mais aussi diminuent dans les contreforts de l’Himalaya.
Au même moment où ce glacier s’arrachait à la plaque rocheuse et dévalait à plus de 200km/h, les pentes des Alpes, les températures y étaient de 10° et atteignaient plus de zéro degré au sommet du mont Blanc.
Tous ces dérèglements sont soigneusement compilés et analysés dans les récents rapports du GIEC. Même si on peut déplorer qu’ils ne percolent pas toujours sur nos écrans parce que concomitants avec le transfert de Messi pour le premier rapport, la guerre en Ukraine pour le second et enfin avec les élections législatives pour le troisième, ces rapports démontrent comme s’il en était encore besoin, que nous, citoyens des pays développés et nos gouvernements sommes bien informés depuis des décennies de notre responsabilité sur l’impact de l’émission massive de ces combustibles fossiles dans notre atmosphère.
L’effondrement de ce glacier de haute altitude illustre les ruptures de notre système climatique, et particulièrement la fragilité de notre cryosphère, avec la fonte rapide de la banquise l’été dans l’hémisphère nord, la disparition annoncée de très nombreux glaciers, la fonte des calottes Groenlandaise et Antarctique qui contribuent inéluctablement à une hausse du niveau marin inédite depuis des millénaires.
Paradoxalement, le temps entre le diagnostic, la prise de conscience et l’action devrait s’étaler sur des dizaines d’années, puisque ces bouleversements climatiques remettent en cause profondément notre système de production. Or, le défi illustré par la catastrophe de Marmolada vient mettre en évidence une nouvelle fois que ce temps nous est compté. Face à l’accélération du dérèglement climatique, il faut répondre par une accélération de politiques cohérentes d’atténuation et d’adaptation à l’échelle globale et territoriale. Or même en France, pays où a été signé l’accord de Paris à l’issue de la COP21 le compte n’y est pas, comme le montre le récent rapport du Haut conseil pour le climat.