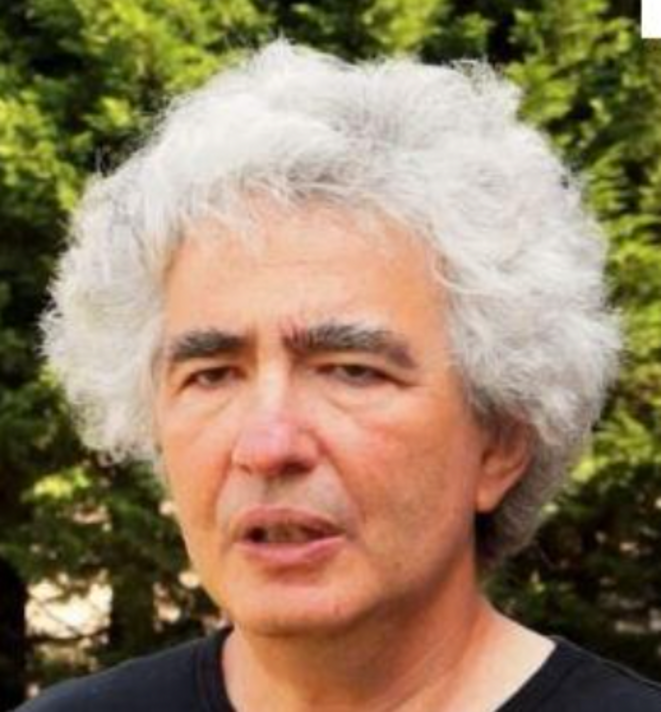Sans l’année géophysique en 1956, c’est-à-dire une initiative structurée au plan international, il n’y aurait pas eu besoin de volontaires pour aller hiverner, (c’est-à-dire en réalité passer toute l’année en Antarctique) et donc pas eu besoin de jeunes hommes (évidemment pas de femmes, on est en 1956) sélectionnés sur des critères physiques et surtout psychologiques pour affronter une telle expérience: vivre hors du monde dans une boîte à sardines un an durant pour accomplir de très nombreuses et nouvelles mesures météorologiques et physiques à l’intérieur de ce continent de glace, dans un froid polaire (1). Motivés au point que leur arracher toutes leurs dents de sagesse et leur enlever leur appendicite était une formalité. Parmi les 3 élus se trouvait Claude Lorius que rien ne prédestinait en 1956, à sa future carrière extraordinaire de glaciologue.
Voyage, voyage
Pour ces pionniers de l’hivernage, c’est d’abord une préparation physique, puis un voyage long, d’autant que le canal de Suez est fermé à cette époque. Ils affrontent les 50ème hurlants et les 60ème rugissants pour aborder enfin à Dumont d’Urville, la base française de l’Antarctique. Mais ce n’est là qu’une partie du voyage. Reste le plus périlleux, les 350 km qui les séparent de la base de Charcot à l’intérieur des terres. Il faut affronter blizzard et vents catabatiques qui vont faire plonger les températures jusqu’à -50°C, pour arriver enfin sur une base sommaire où il faudra survivre dans des conditions plus que spartiates (1).
Cette vie recluse commence un 21 juin en pleine nuit polaire avec ses 2 compagnons d’infortune mais surtout avec cette obstination, et cette abnégation qui sont nécessaires pour observer et mesurer le climat polaire.
Du whisky à la Vodka
Parti comme simple volontaire à l’hivernage en Antarctique, il va être pris par le virus de la glaciologie qui va le conduire, pendant des décennies, à travers la direction du laboratoire de glaciologie de Grenoble et la présidence du SCAR à révéler les secrets qui dorment sous ses pieds et qui s’étendent parfois sur plus de 3 km de profondeur. Aussi l’image de l’intuition géniale du glaçon qui désorbe son gaz dans un verre de whisky est belle mais un peu réductrice. Des efforts immenses entrepris, des collaborations internationales montées dans un contexte géopolitique difficile, malgré le Traité de l’Antarctique, mais aussi une capacité à boire de la vodka, à chanter des chansons russes et in fine de construire des relations d’amitié fortes et durables, pour finalement mettre à jour l’évolution des gaz à effet de serre piégées dans ces glaces.
Forer plus profond pour mieux remonter dans le temps
Il va s’investir à corps perdu dans tous les forages glaciaires. D’abord Dôme Concordia pour révéler les premiers 40 000 ans d’histoire climatique polaire, mais c’est surtout à Vostok dans cette collaboration avec les soviétiques et les américains en pleine guerre froide que sa capacité à créer des liens d’amitié va être déterminante. Mais c’est un travail d’équipe dans des conditions hallucinantes pour forer et remonter à la surface des carottes de glace dont la profondeur correspond d’abord à 150 000 ans d’histoire climatique polaire pour atteindre 800 000 ans. C’est aussi un travail d’analyse physique et chimique collectif où toute une génération de chercheurs va établir dans les mêmes carottes à la fois la variation des températures et les changements de contenu en gaz à effet de serre et en premier lieu le CO2. Ce travail va culminer en 1987 où la couverture de Nature est dédiée aux secrets que révèlent le forage de Vostok. Trois articles devenus iconiques seront publiés dans la prestigieuse revue.
Le résultat est là, sans appel, dans les cycles glaciaires interglaciaires, le contenu atmosphérique en gaz à effet de serre varie lui aussi. Ces recherches vont montrer qu’à travers les derniers cycles en particulier le taux de CO2 va varier dans une petite fenêtre passant de 180 ppmv (2) en phase glaciaire à 280 ppmv en phase interglaciaire. Même si les calottes de glace de l’Antarctiques ne permettent, grâce à l’analyse des bulles piégées dans les glaces, que de mesurer directement et précisément l’évolution des GHG cela ne correspond qu’à la peau d’orange de l’histoire climatique de notre planète, 0.8 Million d’années sur 4600 Ma, c’est une prouesse et un résultat fondamental à l’heure où les prémices de l’Anthropocène se font sentir.
Sortie de route
Mais l’intuition et l’intelligence des changement climatiques de C. Lorius ne s’arrêtent pas là, il comprend très vite que les variations du CO2 lors des cycles glaciaires-interglaciaires qui sont magnifiquement inscrites dans les archives de glace de l’Antarctique font désormais partie du passé révolu. Le développement industriel et le peuplement de la planète ont conduit à faire exploser cette petite fenêtre de variations dans laquelle le CO2 était cantonné depuis sans doute au moins 2 millions d’années. En parallèle, Ralph Keeling montrait de manière éclatante l’évolution fulgurante du CO2 dans l’atmosphère depuis les premières mesures du CO2 atmosphérique en 1959 au Mona Loa à Hawai, ce qui, inévitablement, produira un réchauffement brutal des températures à la surface du globe. La mise en place du GIEC et ses différents rapports allaient mettre en lumière pour Lorius comme pour des milliards d’hommes et de femmes la transition climatique et le basculement dans une nouvelle ère : l’Anthropocène. Cette ère où l’homme lui-même est devenu le principal moteur d’une évolution du climat et de la biodiversité.
Dans son livre « Voyage en Anthropocène» (3) , il décrira et alertera sur ce basculement.
Changer de vie, de système de production dans un monde aux ressources finies, de trajectoire énergétique, C. Lorius l’avait compris et son message résonne profondément à nos oreilles. Il disparait à la fin de la semaine qui avait commencé par la diffusion de la synthèse du sixième rapport du GIEC.
Sans aucun doute, C. Lorius a éclairé pour un très large public, ce que son compagnon, Jean Jouzel a appelé la bataille du siècle (4) pour montrer à quel point ils ont su saisir et médiatiser le formidable basculement qui prend toute son ampleur dès le vingtième siècle.
(1) « La glace et le ciel » éditeur Paulsen Luc Jacquet (photos) textes Lorius, Chappelaz et Ramstein et le film éponyme de Luc Jacquet.
(2) ppmv : partie par million en volume. C’est l’unité de mesure utilisée pour la quantité de CO2 dans un volume d’air.
(3) « Voyage en Anthropocène «, C. Lorius et L. Carpentier , Actes sud.
(4) « Jean Jouzel dans la bataille du siècle », film de Brigitte Chevet.