« Il faut étudier la société par les hommes et les hommes par la société : ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale n’entendront jamais rien à aucune des deux.»
Jean-Jacques Rousseau, Emile ou l'Education

Agrandissement : Illustration 1

Tourné dans la foulée de ce qu’on appela l’«automne allemand », La Troisième Génération (1979) est un film dont le titre renvoie à l’histoire récente de la Fraction Armée Rouge : la “troisième génération” des groupes terroristes d’extrême-gauche formés depuis la création de la RAF (Rote Armee Fraktion) en 1968 par Andreas Baader et Gudrun Esslin. Revendiquant leur héritage, ceux de la troisième génération réclamaient la libération de ces chefs historiques lors d’actions violentes et spectaculaires menées à l’automne 1977 : détournement d’un avion allemand sur l’aéroport de Mogadiscio, enlèvement d’Hans-Martin Schleyer, le patron des patrons allemands. Un automne meurtrier qui prend fin avec les “suicides” des leaders de la RAF (Baader, Esslin, Raspe) à la prison de Stammheim.
Clairement inspiré de ces événements, le film de Fassbinder joue aussi sur la signification première de l’expression : la troisième génération, dans une famille, ce sont les petits-enfants. La cellule révolutionnaire qu’on voit naître et agir est formée de jeunes bourgeois en guerre contre leurs parents, leurs grands-parents, leurs origines et leur éducation, qui veulent anéantir tout cela par l’action terroriste. Par-delà les mobiles politiques qu’ils ont d’ailleurs bien du mal à exprimer, la bande de terroristes a d’abord le désir de s’affranchir des modèles et carcans familiaux pour, à travers une vie clandestine et communautaire, s’inventer une nouvelle famille.
L’ambiguïté que porte le titre, entre la famille biologique et la famille qu’on s’invente, a des origines dans la biographie du cinéaste : né le 31 mai 1945 en Bavière, trois semaines après les bombardements, le jeune RWF passe ses premières années dans un appartement munichois sans fenêtre, entouré de nombreux adultes, ses parents, des amis, des réfugiés sans toit et même des prostitués qui fréquentent le cabinet de son père médecin. Au milieu de cette « grande famille », si l’on en croit Christian Braad Thompsen (The Life and Work of a provocative genius), le jeune Rainer n’a pendant longtemps pas su identifier ses géniteurs. A la fois seul et entouré, le cinéaste a grandi, selon ses souvenirs, « comme s[’il] était une fleur ».
Dans La Troisième Génération, les membres de la bande n'ont pas cette chance. Tous ont grandi et évoluent dans des familles qui, au moment où le film commence, les oppressent. Jamais exprimées verbalement, les raisons de leur engagement politique sont clairement posées comme relevant de purs conflits familiaux : dans la belle maison bourgeoise d’Edgar (Udo Kier), où toutes les générations cohabitent, le jeune homme s’oppose à son flic de père, un lâche qui « tire dans le dos » de ceux qu’il « traque ». Alors que sa mère, poupée décatie au visage blanchi, chantonne en buvant des verres, il doit supporter les tirades nostalgiques de son grand-père sur les bienfaits de la guerre et de la lecture de Nietzsche, deux choses qui, de son temps, donnaient de l’énergie aux jeunes gens... La femme d’Edgar, Suzanne (Hanna Schygulla), va au fond du mépris de soi-même en couchant avec son beau-père, qui la dégoûte d’autant plus qu’il est un représentant de la violence d’Etat. Mais pas besoin de vivre chez ses parents pour vivre en enfer : au domicile conjugal, Petra (Margit Carstensen) est tyrannisée par un mari qui lui fait subir pour rien de véritables « interrogatoires policiers » ; elle vit sa vie de couple comme une garde à vue prolongée. Quant à Rudolph (Harry Baer), au magasin de disques où il travaille, il sent que son patron le surveille comme un gosse.
Trop de pères ? Trop de peu de vrais parents ? Cela revient un peu au même, comme en témoignent les personnages de Franz Walsch (Günther Kaufmann) et Bernhard Von Stein (Vitus Zeplichal), deux paumés qui débarquent aussi dans la cellule avec leur histoire de famille. Walsch, le noir, est sûrement l’enfant d’un GI basé en Allemagne à la fin de la guerre et d’une entraîneuse de bar américaine : c’est le fils que Maria Braun n’a pas eu avec « Mr Bill », un enfant de la Reconstruction et du miracle économique, abandonné peut-être comme Guy Georges, le tueur en série. Pupille de l’Etat, puis soldat, il rejoint le groupe, parce qu’il est spécialiste en explosifs mais surtout pour tromper le miroir de solitude que lui tend Ilse, sa petite amie toxicomane, perdue dans les brumes de l’héroïne. Von Stein, le rejeton de l’aristocratie qui renie ses origines, transporte avec lui une lourde valise remplie d’exemplaires d’un livre de Bakounine.
Bref, tous les membres de la cellule semblent davantage mus par la névrose et le désir de se changer eux-mêmes, que par les théories révolutionnaires qui changent le monde.
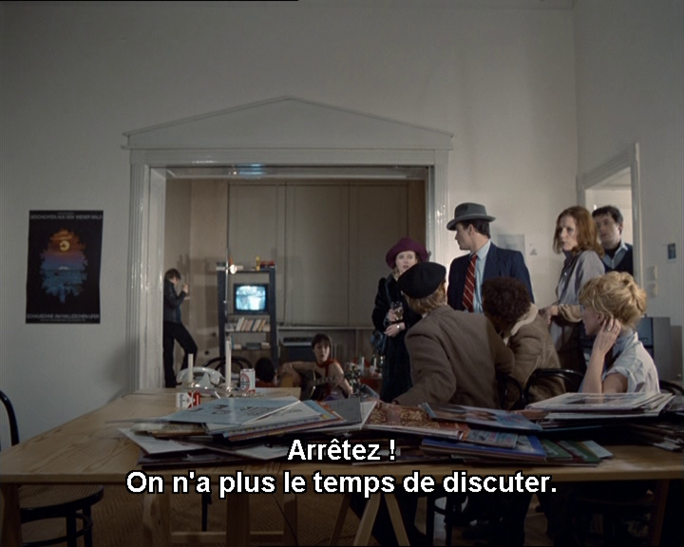
Agrandissement : Illustration 2
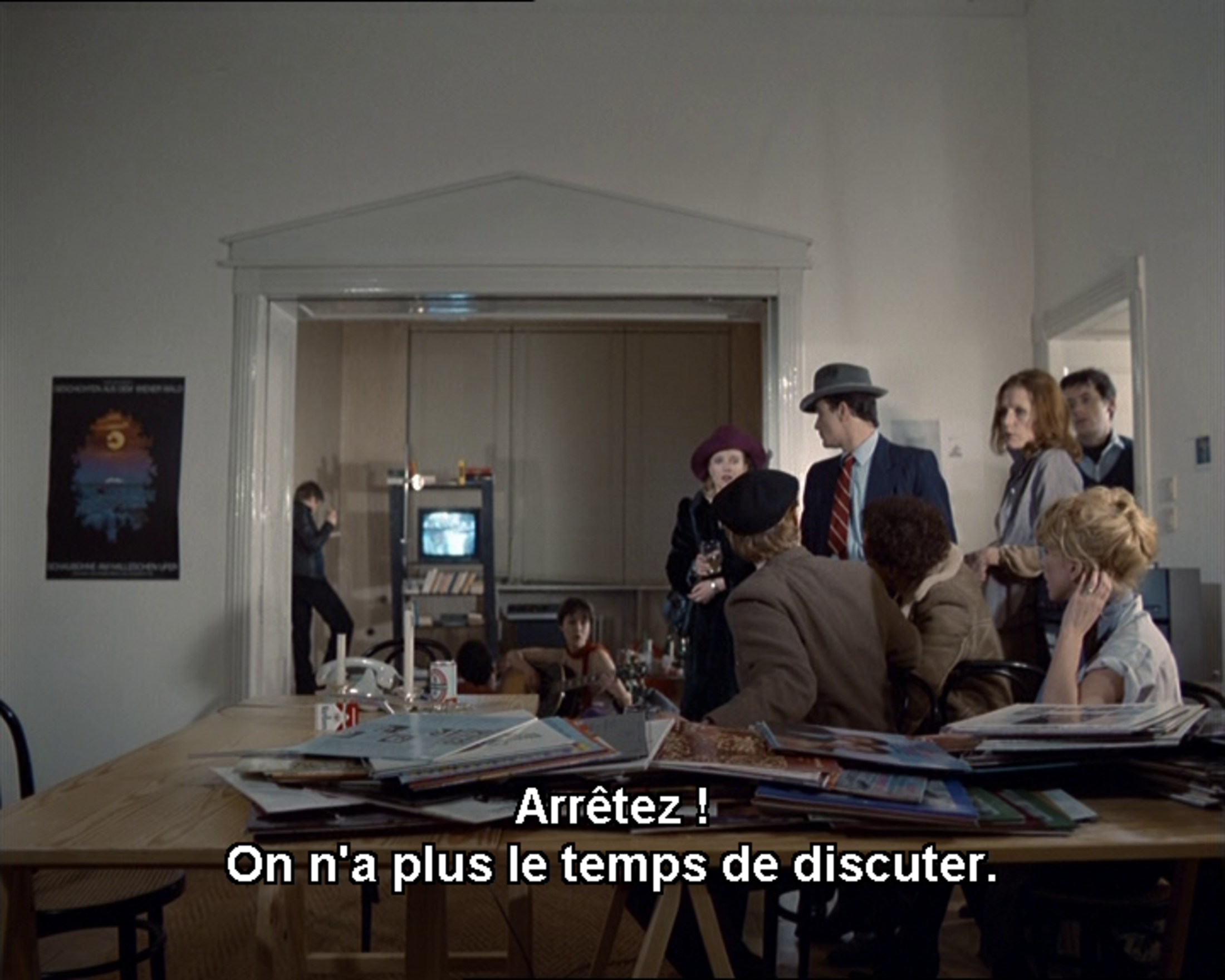
Fassbinder a l’air de préférer Freud à Marx ou Mao, de privilégier parmi toutes les motivations de ses « terroristes » celles qui ont le plus à voir avec leur vie privée (bien qu’elle soit parasitée en permanence par des discours politiques, ne serait-ce qu’en fond sonore). Il adopte une attitude provocatrice et se prête à l’accusation d’alimenter tous les clichés réactionnaires. Mais c’est qu’une réalité s’impose à lui : on n’échappe pas à son éducation, surtout quand elle résulte d’un mélange lui-même puissamment névrotique de comportements bourgeois et de parler nazi. L’éducation bourgeoise refait surface dans le dégoût inspiré aux membres de la cellule par Ilse, la jeune héroïnomane qu’ils hébergent :
Petra : Franchement, je trouve ça pénible d’être obligé de regarder cet être lamentable.
Rudolf : Ne regarde pas !
Suzanne : Et toujours les piqûres… Depuis mon enfance, j’ai une répugnance physique pour les piqûres.
Petra : On a ça sous le nez et je trouve ça indécent.
Suzanne : Ce désordre ! Que quelqu’un puisse à ce point perdre le contrôle de soi-même…
La rhétorique nazie, elle, réapparaît à son insu quand Rudolph veut convaincre Edgar (et se convaincre) des mérites des stages d’entraînement à la guerilla : « La grandeur ne peut naître que de la discipline et de l’ordre. » D’un côté, les femmes de la cellule font de Ilse un nouveau bouc émissaire qui les rassure sur leur équilibre mental. De l’autre, Rudolph justifie son besoin d’action en puisant dans les formules du IIIe Reich.
Même sur le plan des motivations politiques, les raisons affichées par les membres du groupe apparaissent plus que légères : l’action révolutionnaire est envisagée comme un moyen de tromper l’ennui, en s’offrant des sensations fortes.
Rudolph (buvant un verre de chablis) : Rien ne me plairait plus qu’un stage d’entraînement à la guerilla, pas toi?
Edgar : ça doit être plutôt dur et rigoureux, non ?
Rudolph : Oui, en même temps, c’est vraiment l’une des dernières grandes aventures de l’humanité.”
Grands consommateurs de télévision, ils choisissent leur attentat dans une liste déjà toute prête, en imitant ceux qui avant eux savaient pourquoi ils agissaient :
Edgar : Enlever l’ancien patron de Suzanne, P.J. Lurz.
Rudolph : A quoi ça peut bien servir ?
Edgar : Nous demanderons la libération de tous les prisonniers politiques.
Suzanne : Parce que c’est comme ça…
Edgar : C’est ce qui se fait…
Enfin, comme si ça ne suffisait pas à la ridiculiser, Fassbinder a pris soin dès les premières minutes du film de révéler qu’en réalité, la cellule était manipulée. A travers August (Volker Spengler), apparemment le plus impliqué et le seul capable d'organiser quelque chose (en réalité, c'est une taupe...), le projet révolutionnaire est commandité en sous-main par une firme de systèmes de sécurité électroniques soucieuse de booster ses ventes. Son patron, P.J. Lurz (Eddie Constantine), en cheville avec un commissaire de police qui se trouve être le père d’Edgar, sait que des attentats ne manqueront pas déclencher une demande accrue de sécurité. Alors qu’ils se rêvent en révolutionnaires, ils ne sont là que pour justifier le renforcement de l’ordre sécuritaire. Jeunes gens en révolte contre leur milieu davantage que militants bien formés, ils ne sont finalement que des publicitaires, et pour ceux qui les manipulent, de « bons terroristes » qui contribuent efficacement à la consolidation de l'ordre qu'ils contestent.
Le policier : J’ai fait un rêve récemment. Le Capital avait inventé le terrorisme pour contraindre l’Etat à mieux le protéger. C’est drôle, non ?
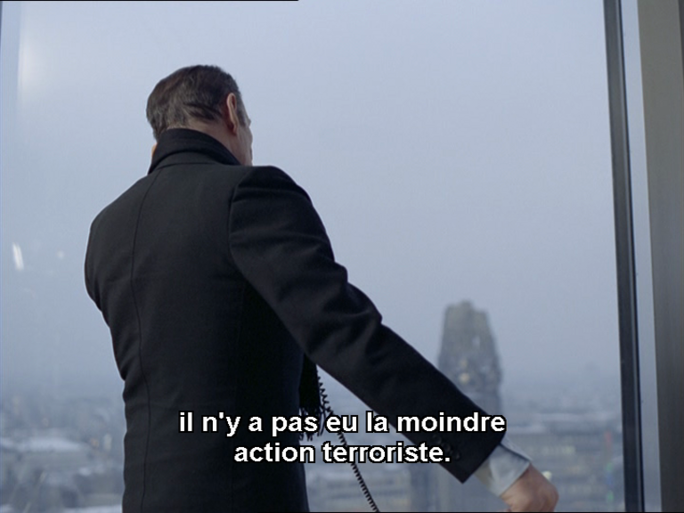
Agrandissement : Illustration 3
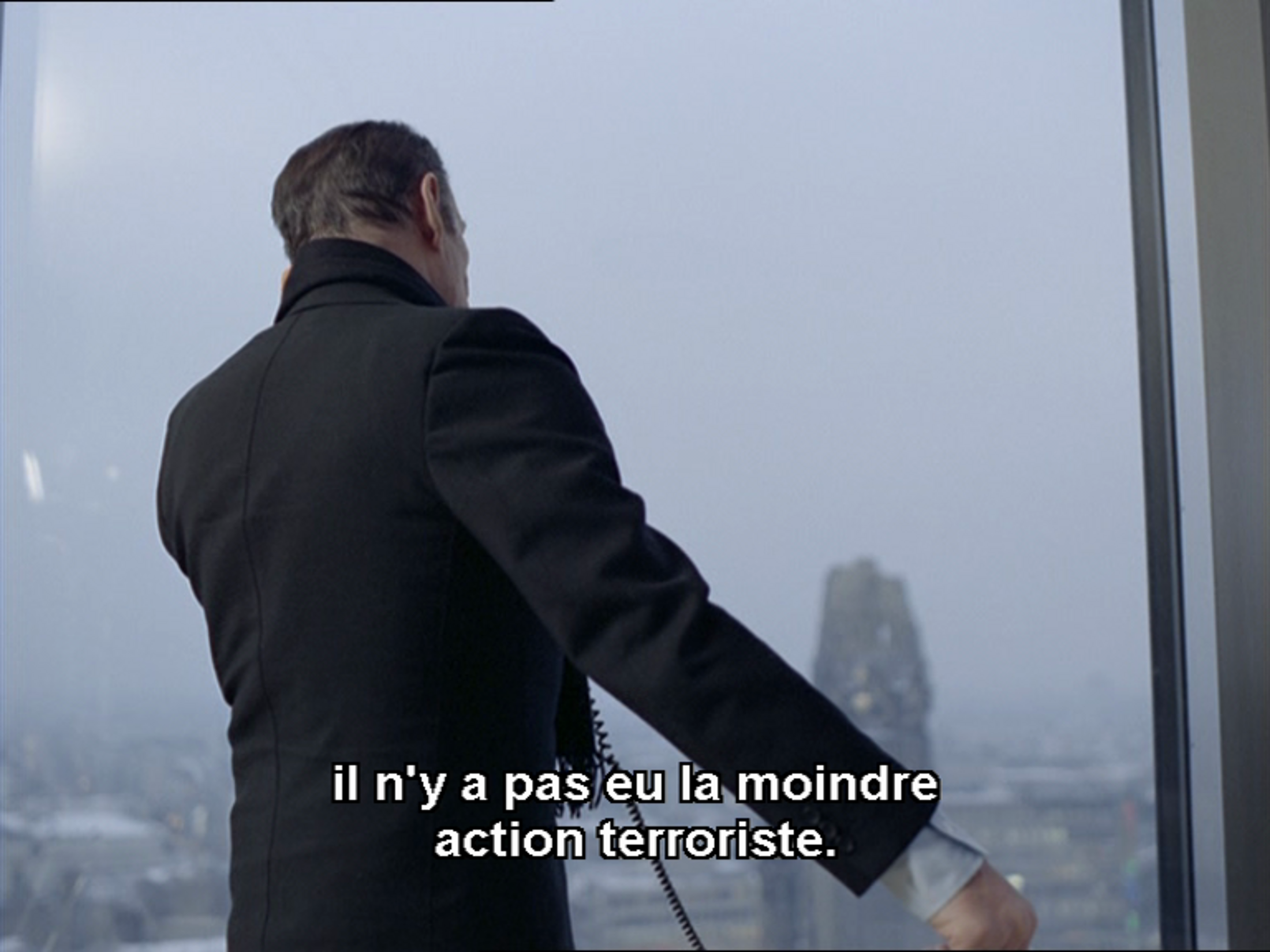
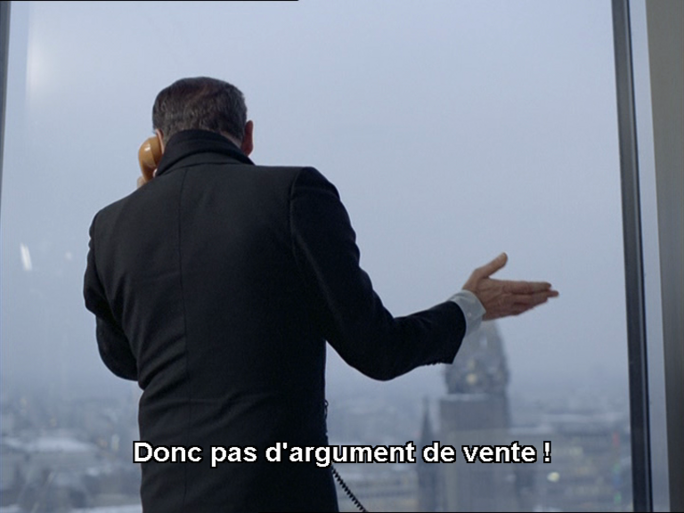
Agrandissement : Illustration 4
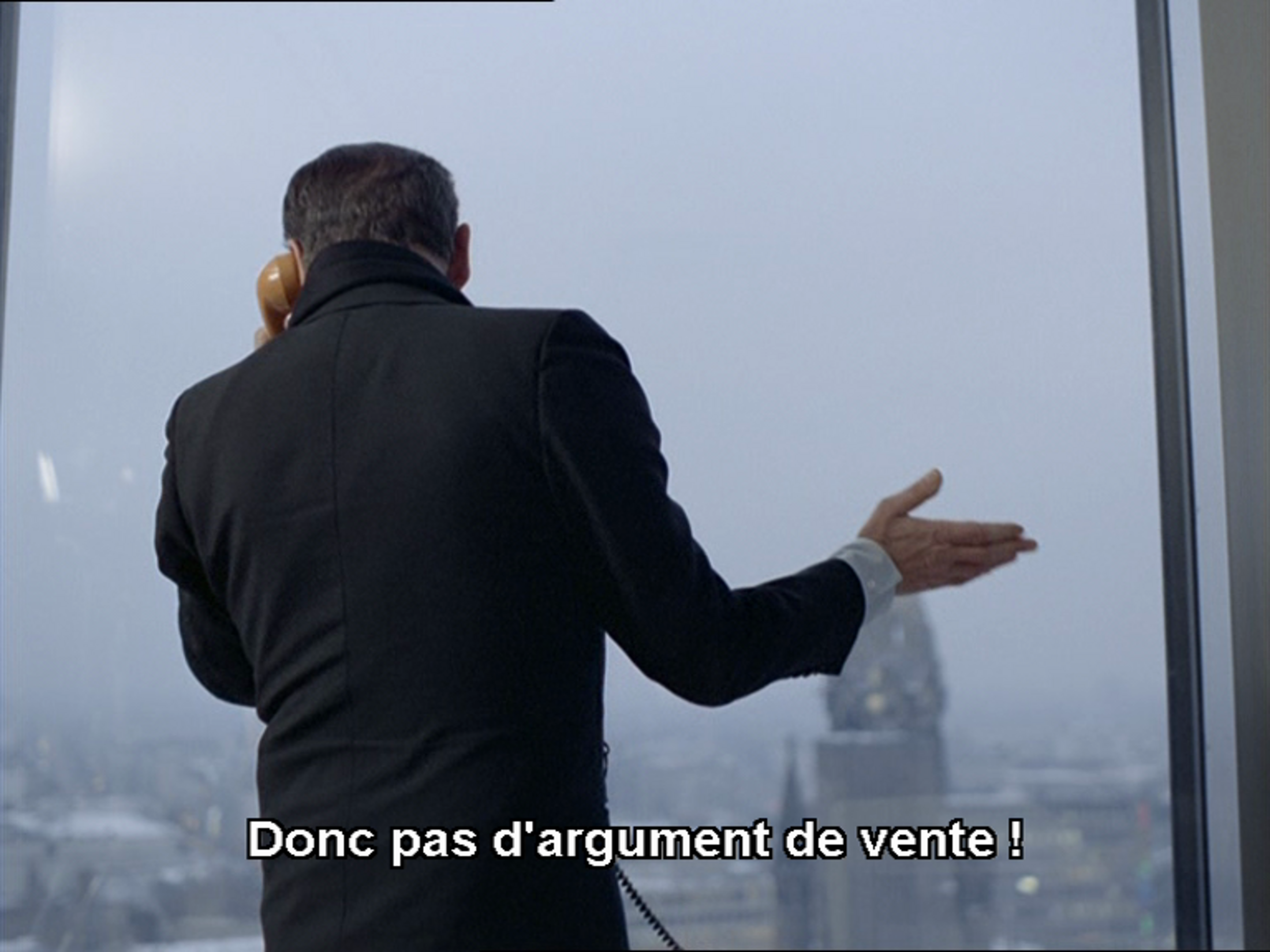
Et pourtant, Fassbinder ne se rallie pas aux clichés ressassés par les médias : les activistes de la RAF étaient de jeunes bourgeois-bohèmes en mal d’aventures, des délinquants qui décoraient leurs exactions avec des discours révolutionnaires. Cette interprétation s’est imposée dans le film La Bande à Baader sorti en 2008 (Der Baader Meinhof Komplex, Uli Edel) : Baader est un voyou un peu allumé, beau gosse et beau parleur, Esslin une fille de pasteur en révolte contre l’hypocrisie familiale et Meinhof une intello bourgeoise qui tente de résoudre ses contradictions. Fassbinder propose bien une variation sur ce thème mais au lieu d’insister sur les raisons individuelles, qui dévaluent mécaniquement l’action collective il met en évidence, dans cette réunion de jeunes gens, le désir de se construire une nouvelle famille.
Une nouvelle famille, c’est d’abord un nouvel espace : plus la maison des parents, ni celle du couple, mais un immense appartement, un QG, un squat : les appareils audio-visuels y sont toujours allumés, tous en même temps ; la radio, la télé, les disques et les conversations se superposent ; les filles et les garçons déambulent et se croisent mais chacun est libre d’y suivre ses obsessions parallèlement à tous les autres, de manière à la fois solitaire et collective : Ilse Joue de la guitare en chantant, Bernhard lit Bakounine à l’oreille de Petra, tandis que Hilde embrasse Paul, son voyou à la Melville, et que Cohn-Bendit et Rudi Dutschke débattent à la télé. Leur vie quotidienne est en elle-même une forme de rupture avec la société, comme le confirme la scène où le policier (le père d’Edgar) perquisitionne l’appartement. Son attitude évoque autant celle d’un flic que celle d’un père en visite chez son fils étudiant, un peu dégoûté par le désordre et la propreté approximative. Bernhard, hystérique, s’agite autour de lui, nomme tous les objets et les désigne à l'attention du policier, produisant une variation ironique sur le thème du « tout est politique » : «Voici une assiette, une soucoupe, un verre… une tasse à café… du vin… (…) Poignée, frigo... hélas vide ! (…) Musique, et livres, et casquettes ! Vous pouvez-les arrêter ! (…) Une plante grasse ! Un store ! Vous avez déjà arrêté un store ?».
Pour que la nouvelle « cellule familiale » ne dégénère pas, il lui faut ensuite un projet. L’action n’est pas à l’origine de la communauté : elle en est le résultat, le produit nécessaire. La cellule de La Troisième Génération, malgré son côté comique et pitoyable, va donc vivre de réels cas de conscience, des trahisons, se confronter au danger et a pas mal de morts violentes. Progressivement, les petits-enfants se mettent à jouer vraiment à la révolution ; cela leur évitera de passer leur vie, comme Hilde (Bulle Ogier) quand elle était prof d’histoire, à se demander pourquoi celle de 1848 a échoué... Ils commencent alors à s’émanciper de ceux qui croyaient les manipuler, trompés à leur tour.
Pour Fassbinder, cette émancipation ne peut advenir qu’en transformant la cellule en troupe de théâtre. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, quand il fréquente puis dirige l’Aktiontheater de Munich, la troupe de théâtre abrite les futurs terroristes de la RAF. En 1967, on y trouvait tous les futurs acteurs de Fassbinder, mais aussi, brièvement, Andreas Baader lui-même, griffonnant dans un coin des slogans politiques. Et puis Horst Söhnlein qui, fou de jalousie en voyant sa copine tomber sous le charme de Fassbinder, détruit intégralement le théâtre. La nuit suivante, en compagnie de Baader et Esslin, l’ex-directeur de l’Aktiontheater passe à la « lutte armée » : ils mettent le feu à deux supermarchés de la ville (cf Chritian Braad Thompsen, The Life and Work of a provocative genius, p15). Ici, c’est la troupe qui accouche d’une cellule.
Mais la troupe de théâtre et la cellule terroriste entretiennent des rapports plus profonds. Dans les deux cas, il s’agit de changer d’identité à plusieurs, de s’oublier dans un rôle, de se prendre pour un autre. L’art du déguisement peut y aider. D’abord, les vêtements : affublés d’imperméables trop banals et identiques pour ne pas être remarqués, ils comprennent vite que pour passer inaperçu, il faut être voyant. August se déguise en femme, Rudolph en grand-père, Franz Walsch (qui est noir), se repeint le visage comme ces jazzmen blancs qui se maquillaient en noir, puis devient aveugle à canne blanche. Tous virent déjà au clown, et c’est ce qu’ils deviendront à la fin. Ensuite les noms, changer d’état civil : « J’aimerais tant m’appeler Michaela Angela Martinez ! », dit Petra, toute joyeuse. Même réellement menacés, c’est encore comme des comédiens dans leur loge qu’Edgar et Susanne répéteront (aux deux sens du terme) leurs biographies fictives : « Je m’appelle David Grünbaum, né le 17.O2.1948 à Berlin, marié, un enfant. Profession : représentant d’édition ».

Agrandissement : Illustration 5

C’est en jouant à fond la carte du théâtre et de la mascarade, qu’ils réussissent finalement à mener à bien l’enlèvement de P.J. Lurz. Les « terroristes » suivent l’exemple des clowns de Blow-Up, qui faisaient irruption, à la sortie d’une usine, devant le photographe déguisé en prolétaire pour les besoins de son reportage. Leur farandole endiablée et leurs cris inarticulés ringardisaient d’un seul coup tous les projets de réforme sociale, offrant une échappée vers le monde parallèle de la Fête permanente. Mais les clowns d’Antonioni finissaient dans la fable métaphysique, à jouer un tennis sans balle. Déguisés en clowns, en libellule, en pirate ou en miss Monaco, la cellule-Fassbinder enlève P. J. Lurz en pleine rue, dans une avalanche de rires, de cotillons et de rafales de mitraillettes. Il faut dire que c’est mardi gras, le seul jour de l’année où il est normal d’être pris pour un clown. En le devenant réellement, ils embrayent sur le cynisme ordinaire qui transforme tout révolutionnaire en pantin du Capital, et s’en dégagent à la surprise de ceux qui les prenaient pour des enfants turbulents mais inoffensifs.
Dans la cave où elle retient l’otage, la « famille » accomplit son ultime mutation. Rudolph, à la caméra, met en scène le message de P. J. Lurz, dans une atmosphère d’amateurisme et de petites embrouilles qui confirme que parmi eux, au moins, il n’y aura jamais de chef. Pour l’ambiance sonore, Hilde lance un enregistrement de bruits de jungle ou de zoo. Ainsi est consommée la rupture, non seulement avec les parents, les patrons et les flics, mais aussi avec une certaine idée de l’humanité. Au risque de finir comme l’autre famille célèbre de l’histoire des communautés, la Manson Family ; elle aussi s’était extraite de la société, certains de ses membres vivaient dans une grotte, elle s’inventait des rites et une mythologie ; mais cela s’était terminé par le meurtre en série. La famille de La Troisième Génération elle aussi a rompu les amarres ; mais sous la forme d’une équipe de télévision sauvage, elle demande poliment à Lurz de réciter son texte en parlant «un peu plus fort ».
Lurz : Nous sommes aujourd’hui le mardi 21 février 1979. Mardi gras. Je suis détenu ici au nom du peuple et dans son intérêt.
Et il arbore un grand sourire.
Yvan Comestaz et Guillaume Goujet
(La semaine prochaine, suite de l'abécédaire sur le blog d'Yvan Comestaz : G comme Génie, Le Rôti de Satan.)



