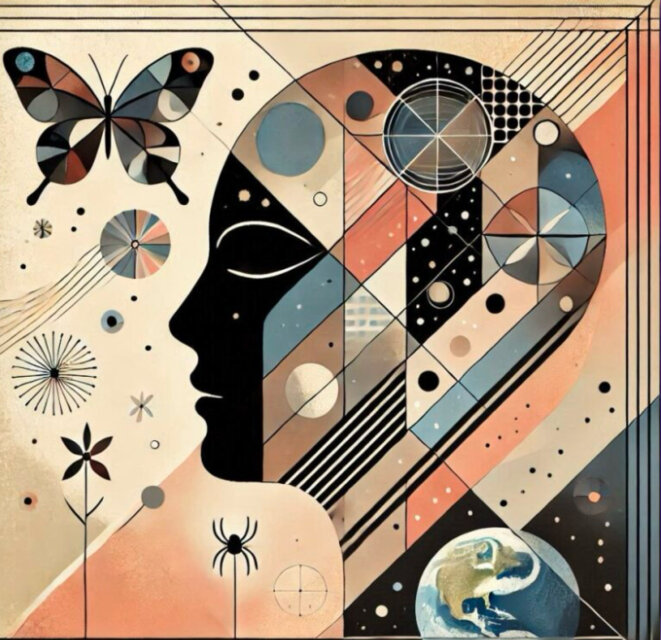La première génération crée; La deuxième génération maintient; La troisième génération dilapide la fortune de grand-papa. C'est le mal fatal qui frappe, implacable, les grandes familles bourgeoises. La chanson de Brel dirait-elle vrai : « Les bourgeois, plus ça devient vieux, plus ça devient bêtes » ?
En ce jour de ferveur populaire pour le couronnement du roi Charles III, cinquième monarque de la Maison Windsor, la prévalence de cette épidémie chez les bourgeois appellerait, par facilité, à stigmatiser leurs rejetons, soupçonnés d'une quelconque dégénérescence sociale.
Mais, plus que le rebelle même, le scientifique ne doit avoir aucun tabou et se méfier de ses biais cognitifs. S'il faut illustrer cette assomption, téléportez-vous au début des années 80 où les poppers, incriminés au début de l'épidémie de SIDA pour stigmatiser les homosexuels, furent mis hors de cause quand on diagnostiqua ce syndrome chez les premières victimes hémophiles*.
Ma récente visite au Familistère de Jean-Baptiste Godin m'a pareillement amenée à repenser l'épidémiologie de la malédiction des trois générations.

Agrandissement : Illustration 1

Le visiteur note de suite la différence architecturale entre l'aile droite et l'aile gauche. Il voudrait voir d'emblée dans cette aile dotée de balcons, tours d'angle, toits colorés et même d'une rotonde, l'emblème de la lutte des classes, assumant que cette richesse architecturale bénéficiait forcément aux seuls cadres de l'entreprise Godin, n°1 mondial des poêles à bois.
Epistémologie oblige, l'histoire de cette aile contrarie les préjugés. Le bâtisseur du Familistère, Jean-Baptiste Godin, la noble ambition, chevillée au corps, de construire des logements qui favorisent la solidarité entre les employés, avait bien entendu construit en 1860 trois ailes parfaitement identiques où y développer une vie harmonieuse.
Nous sommes à la troisième génération quand le sort toque aux portes du Familistère. Trente ans après la mort de son bâtisseur, une aile va être entièrement incendiée lors de la Grande Guerre.
Mieux que la bourgeoisie, la coopérative, fruit des expériences sociales et économiques de son fondateur, va-t-elle savoir relever le défi de la reconstruction ? L'héritage « aristocratique » des valeurs portées par Godin va être mis à rude épreuve.
Le piège se referme, inéluctable, sur la coopérative comme n'importe quelle entreprise. Le conseil de gestion, dont l'administrateur-gérant est élu, va jeter le mauvais oeil sur le Familistère en faisant le choix du tape-à-l'oeil. La bêtise les rattrape. L'architecte italien, engagé par le conseil, dénature le bâtiment en foulant les principes cultivés par Godin tout au long de sa vie pour mener à bien son oeuvre.
Raisonnable ? L'entretien de ce bâtiment coûte trois fois plus cher que les deux autres. Utile ? La tour de la rotonde n'a aucun usage. Convivial ? Les mansardes répondent à la demande d'individualisme des plus jeunes. La transmission par héritage des logements piétine l'héritage spirituel de Godin. La solidarité a engagé le bien-être, le bien-être a dégagé la solidarité. Le Familistère ferme définitivement en 1968, qui aurait dû être l'année de gloire de cette oeuvre révolutionnaire.
En mai, plus que tout autre mois, il est interdit d'interdire de réfléchir. Cette oeuvre révolutionnaire est morte ignorée d'un mal qui aurait pu, à l'instar du SIDA, donné lieu à une conversion politique. Alors, quelle raison explique l'échec du Familière à dépasser trois générations ? Marx parlait d'aristocratie ouvrière, mais
si le peuple était plutôt une bourgeoisie en puissance qui s'ignore ?
*Dominique Lapierre Plus grands que l'amour