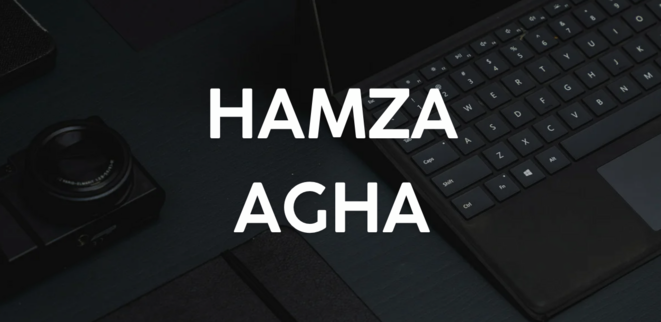Turquie, une nation, deux peuples
Les événements récents en Turquie, avec les milliers de manifestants hostiles au pouvoir en place, dirigé par RT Erdogan, traduisent quelque chose de très profond, ancré dans l’identité turque.
Au-delà du simple soutien au maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu (membre du parti kémaliste CHP - parti laïque de Turquie), accusé de corruption et de soutien à une organisation terroriste - à savoir le PKK- , ce sont en réalité des revendications bien plus profondes qu’une partie du peuple dans la rue semble réclamer.
Aujourd’hui, Imamoglu est quelque part juste un prétexte, un fusible, une allumette qui permet de mettre le feu à des décennies de fractures sociales, religieuses et même culturelles qui opposent les “peuples turcs” en Turquie.
Pour comprendre ce raisonnement, il convient de qualifier la notion de peuple. Un peuple est une communauté humaine partageant un certain nombre de caractéristiques communes, essentiellement basées sur :
- L’élément socioculturel : identité nationale, valeurs communes, pratiques culturelles et croyances
- L’élément historique : événements fondateurs (révolutions, guerres, indépendances, héritage historique... ) qui renforcent le sentiment d’appartenance
- L’élément démographique : caractéristiques communes, comme la langue, l'histoire, la culture
Sauf qu’en Turquie aujourd’hui, cette notion d’élément fédérateur d’un peuple est très fragile et très différentes.
Depuis la chute de l'Empire ottoman et l'avènement de Mustafa Kemal Atatürk, la Turquie a connu une transformation radicale qui, loin d'unifier pleinement la nation, a creusé une fracture profonde entre deux visions antagonistes du pays. D'un côté, l'héritage ottoman, imprégné d’identité islamique et de traditions enracinées. De l'autre, le kémalisme, un projet républicain et laïc visant à européaniser la Turquie en rejetant l'obscurantisme religieux et en imposant une modernisation rapide de la société.
Une fracture historique qui se perpétue
Dès les années 1920, Atatürk a imposé des réformes drastiques : abolition du califat, adoption de l'alphabet latin, interdiction du port du voile dans l'administration, séparation stricte entre l'État et la religion. Cette rupture avec l'héritage ottoman a généré une division persistante entre une élite kémaliste, souvent urbaine et occidentalisée, et une frange plus conservatrice et religieuse de la population, résistante à ces changements.
La montée en puissance de Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l'AKP, au début des années 2000 a marqué un retour en force du camp conservateur avec l’islam comme fondement. Sous son règne, l'État a progressivement renoué avec l'islam politique : l'enseignement religieux a été renforcé, le port du voile à nouveau autorisé dans la fonction publique, et une nostalgie de l'Empire ottoman s'est installée dans le discours officiel. Une véritable tragédie pour une grande partie de la population toujours attachée à l’idéologie kémaliste, souvent vu comme le père fondateur de la Turquie moderne, et parfois même sujet d’idolâtrie par ses partisans, nostalgiques de l’abolition du califat et de l’instauration d’un État laïque.
Erdogan, la fin du kémalisme ?
Les années Erdogan ont exacerbé cette dualité. Si le président turc a su répondre aux attentes d'une large frange conservatrice, l’autre partie, laïque, semble attendre sa chute de pied ferme, saisissant la moindre opportunité pour clamer sa démission, son départ et tenter de reprendre le pays politiquement.
Le cas d'Ekrem Imamoglu, maire d'Istanbul, illustre cette fracture. Cet homme politique, issu du Parti républicain du peuple (CHP), incarne l'opposition laïque et démocratique face à Erdogan. Son arrestation cette semaine pour corruption et ses supposés liens avec le PKK ne sont perçus par beaucoup que comme une tentative de neutralisation d'un adversaire politique redouté. La mobilisation massive de milliers de manifestants à travers le pays démontre combien cette arrestation a résonné comme un signal d'alarme pour la Turquie laïque et démocratique. Ainsi, le cas d’Imamoglu n’est que le prétexte populaire pour sortir et être soutenu à l’international afin de clamer haut et fort la démocratie et le départ du président en place, RT Erdogan.
Toutes les franges de la population hostile au pouvoir, formant cette dualité du peuple turc, à savoir les mouvements LGBT, laïques, européano-fanatiques, kémalistes, kurdes, adeptes du mouvement FETO... semblent saisir la brèche de défense d'İmamoğlu.
Un avenir incertain
La Turquie est aujourd'hui à un carrefour historique. Alors que la fracture entre les kémalistes et les conservateurs n'a jamais été aussi visible, les événements à venir seront cruciaux pour déterminer l'orientation du pays.
Le soutien des pays occidentaux aux opposants à Erdogan ne surprend pas, eux qui ont de tout temps été contre les différentes politiques conservatrices d’Erdogan. Ils soutiendront avec force toute opposition se dressant contre lui.
Vers une guerre civile ?
L'arrestation d'Ekrem Imamoglu nourrit un climat de plus en plus explosif en Turquie. Face à un État renforcé, les partisans de la laïcité, soutenus en sous-main par les puissances occidentales soucieuses de préserver un allié stratégique en Méditerranée, si tant est qu’il soit laïque et pro-européen, pourraient être tentés de durcir leur opposition.
La radicalisation du conflit entre l'État turc et ses opposants, pose la question d'un éventuel soulèvement populaire, voire d'une guerre civile. L'histoire récente a montré que les États-Unis et l'Union européenne n'hésitent pas à soutenir des mouvements contestataires lorsqu'ils servent leurs intérêts géopolitiques. Une Turquie déstabilisée affaiblirait l'influence d'Erdogan dans la région et pourrait provoquer un affrontement direct entre forces gouvernementales et groupes souvent laïques.
À l’image des printemps arabes ou des soulèvements dans des pays de la région.
Si un tel scénario demeure hypothétique, les manifestations de plus en plus violentes et la polarisation du pays laissent craindre une escalade. La Turquie pourrait alors s'enfoncer dans une crise politique et sécuritaire sans précédent, mettant en péril l'unité même du pays.
Une chose est certaine : la Turquie est aujourd'hui une nation aux identités multiples, divisée entre deux visions du monde, et cette fracture semble plus irréversible que jamais.
Hamza Agha

Agrandissement : Illustration 1