Depuis une dizaine d’années tous les chiffres dressent le même constat, les gays délaissent peu à peu la culture du safer-sex. Face à cette tendance, la prévention a été insuffisante, et surtout elle a pris une tournure excessivement bio-médicale. Tous les messages qui leur ont été adressés ne les ont pas incités à continuer d’apprécier l’usage de la capote. Le summum de cette dérive de la prévention a été atteint avec la mise en place tonitruante de la PrEP (prophylaxie pré-exposition) et l’annonce en 2016 de son remboursement intégral par la sécurité sociale.
Voici en quatre actes, le déroulement de la dégradation de la prévention auprès des gays, où l’on voit clairement se mettre en place un optimisme bio-médical, dont l’efficacité bute de plus en plus sur un effet pervers prévisible : à trop nous annoncer le miracle du médicament, on nous détourne du remède traditionnel qui a pourtant fait ses preuves. Les firmes pharmaceutiques s’en réjouissent, la santé publique courre à la faillite.
Premier acte :
Les trithérapies ont banalisé la maladie
L’apparition des trithérapies à partir de 1996 a profondément modifié la maladie : on ne meurt plus directement et brutalement du sida, les séropositifs sont asymptomatiques, ils vivent et ne portent plus de stigmates physiques.
Peu à peu ces trithérapies se sont améliorées, leur prise simplifiée et les effets indésirables ont diminué. Du coup forcément l’image de la maladie s’est banalisée, elle fait moins peur et n’incite plus autant à la vigilance. Et cela d’autant plus que les séropositifs sont devenus invisibles, à tel point que beaucoup de jeunes gays déclarent ne pas connaitre de copains séropositifs et ignorent tout de la réalité du vécu des séropositifs (lourdeur du suivi médical, angoisse récurrente sur sa santé, dissimulation de son statut sérologique, peur de la sérophobie…).
Ajoutons que ces dernières années la grande presse ne cesse d’annoncer « la fin du sida », ce qui s’avère très optimiste, mais plutôt démobilisateur pour motiver des jeunes à se sentir concernés par la prévention.
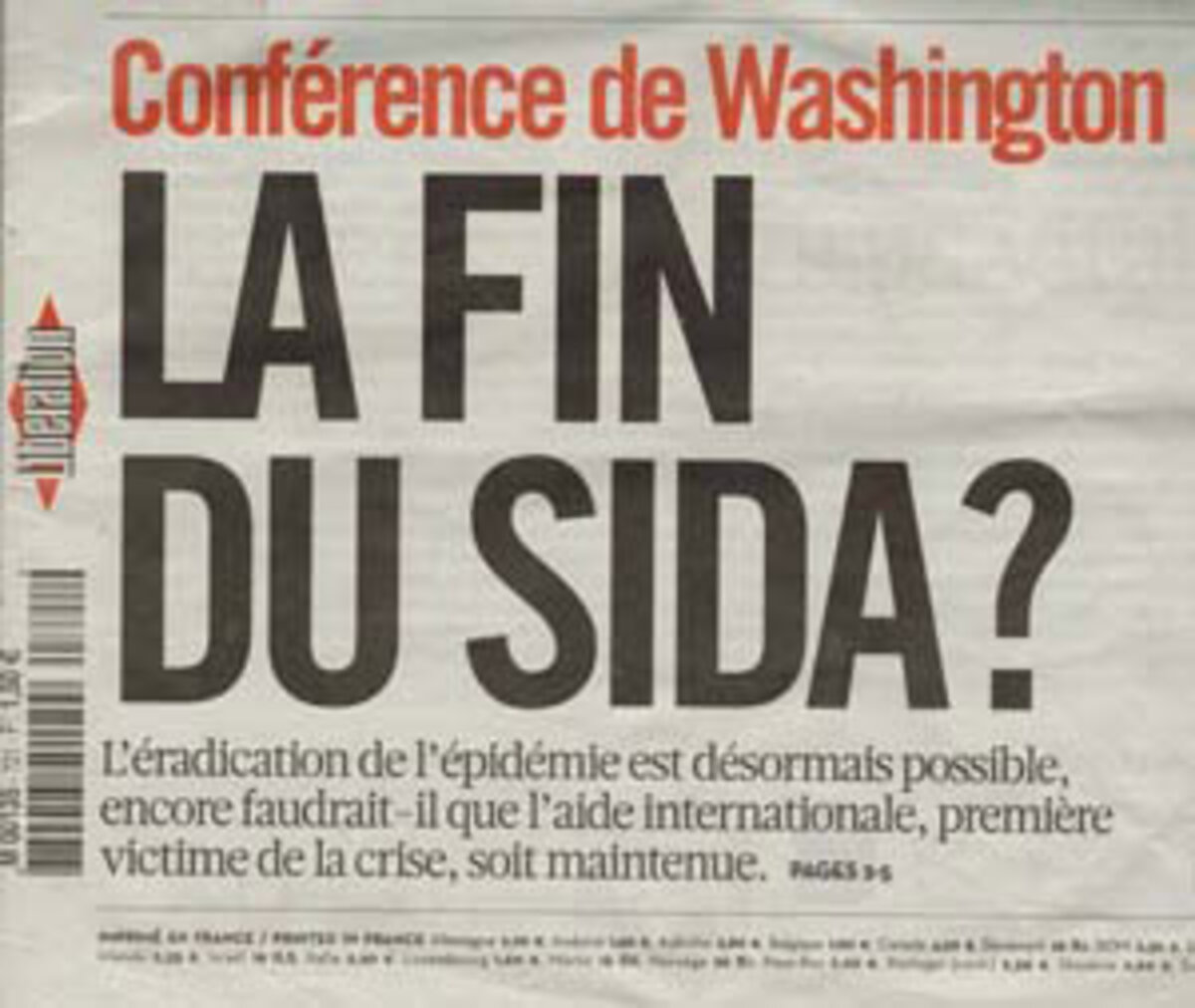
Deuxième acte :
La culture bareback perturbe le consensus de la prévention
Le grand chambardement de la prévention chez les gays est apparu brutalement au début des années 2000 lorsque certains séropositifs ont clamé bruyamment qu’ils préféraient abandonner la capote et pratiquer le bareback (expression anglo saxonne signifiant l’abandon revendiqué de la capote). Ce phénomène aurait dû être contenu, il mettait plus en lumière un malaise profond des séropositifs qui cherchaient à surmonter le rejet sexuel dont ils risquaient d’être l’objet, qu’une volonté délibérée de remettre en cause le safer sex. Au lieu de cela il y eu une énorme polémique, des accusations multiples (le barebacker séropo devenait un criminel, le séronégatif un inconscient) et une crispation autour d’une soi-disante opposition radicale entre les partisans et opposants du préservatif.
Toujours est-il que ce fut un combat idéologique et culturel à armes inégales : quelle pouvait être la force du rappel à la prudence face à des pro-bareback, souvent déjà séropos, qui magnifiaient la liberté et vantaient des sous cultures sexuelles audacieuses (notamment le hard et l’usage des drogues festives) ? On n’attire pas les mouches avec du vinaigre !
Peu à peu la culture bareback s’est répandue et a entretenu ouvertement des fantasmes qui ne demandaient qu’à se libérer. La meilleure illustration de cette victoire se trouve dans l’évolution des films pornographiques : les règles du safer sex appliquées durant les années 90 (sodomie avec capote et absence d’éjaculation buccale) sautèrent peu à peu. Aujourd’hui, en particulier sur internet, tous les jeunes adolescents gays s’initient à la sexualité en regardant du porno bareback.
Troisième acte :
La charge virale indétectable introduit le TASP
C’est à la fin des années 2000 qu’un nouveau paradigme de la prévention apparait : les séropositifs à charge virale indétectable, sous certaines conditions, ne transmettent plus le VIH par voie sexuelle. Dès lors le traitement devient un moyen de prévention (TASP) et toute la communication va se concentrer sur un nouveau message : dépistez-vous, soignez-vous et vous ne serez plus contaminant.
Les associations de lutte contre le sida vont se mobiliser pour pratiquer le dépistage rapide (TROD) et vont trouver là un outil pratique et quantifiable pour rendre compte de leurs actions auprès des financeurs, pouvoirs publics et laboratoires pharmaceutiques.
Durant toute cette période, force est de constater que la promotion du safer sex et du préservatif passent au second plan. Il suffit de feuilleter la presse gay, visionner les films pornos, faire l’inventaire des brochures des associations, analyser les campagnes officielles de prévention et suivre les discussions sur les réseaux sociaux, pour se rendre compte à quel point la confusion règne dans les esprits. La prévention est devenue un sujet hyper complexe, ses acteurs ne sont plus des activistes militants mais des salariés professionnels, les discours scientifiques sont tant bien que mal vulgarisés et les polémiques se succèdent au gré des modes et des querelles inter-associatives.
Comment les gays ont-ils perçus et réinterprétés ces messages confus ? En poursuivant leur relâchement du safer sex qui ne leur a plus été correctement et inlassablement enseigné ! Et c’est ainsi qu’au même moment réapparaissent les infections sexuellement transmissibles (IST) classiques (syphilis, gonorrhées, hépatites, condylomes…). En particulier, les gays séropositifs, probablement rassurés par leur charge virale indétectable, sont nombreux à se co-infecter.
Quatrième acte :
La PrEP consacre l’utopie bio-médicale
Au début des années 2010 face à cette dégradation de la santé sexuelle des gays que pouvions-nous faire ? Quelles études lancer pour mieux connaître les raisons de l’abandon du safer sex et les difficultés que rencontrent les gays avec l’usage du préservatif ? Quelle réflexion avoir sur leur sexualité ? Bref comment rénover et réformer la prévention qui leur est destinée pour les remobiliser en faveur de leur santé et de leur bien être sexuel ? En particulier comment se vit la séropositivité dans le milieu gay, et en quoi cela peut-il encourager les pratiques à risques ?
Pour faire face à ce défi, Aides, la principale association de lutte contre le sida en France va apporter une réponse à l’opposé de l’esprit foucaldien qui animait les fondateurs de l’association. Il ne va plus être question de changer les comportements des gays, mais de les soulager de leurs angoisses existentielles et sexuelles en leur proposant de prendre un traitement médicamenteux préventif. C’est l’idée de prophylaxie pré exposition (PrEP) qui consiste à donner à des non malades le médicament conçu pour les séropositifs : puisque la molécule active bloque les effets du virus, il est logique qu’elle évite la contamination sur un séronégatif. C’est un moyen connu depuis longtemps, expérimenté avec la pénicilline par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam pour envoyer ses soldats dans les bordels thaïlandais et les protéger de la syphilis, c’est aussi utilisé à grande échelle par la médecine vétérinaire dans les élevages industriels.
La popularisation de ce nouvel outil de prévention va se faire avec de grands moyens via l’essai IPERGAY, financé par l’ANRS et soutenu par le laboratoire pharmaceutique Gilead qui trouve là une extension inespérée de l’utilisation de son médicament vedette le Truvada™. Les millions d’euros furent réunis et la communauté gay fut littéralement inondée de publicités vantant l’arrivée de ce nouvel outil et tentant de recruter des volontaires : soyez Ipergay, c’est tellement sympa… Pendant ce temps-là les subventions aux associations de lutte contre le sida ont diminué.
Toute la communication faite autour de cet essai a continué de mettre au second plan la culture du safer sex. Du reste le concept de « prévention combinée » mis en avant par l’association Aides est explicite : il exprime l’idée que nous allons pouvoir disposer d’une palette d’outils différents et que nous pouvons piocher l’un ou l’autre selon les circonstances ou les préférences de chacun. Comme si on disait dans la prévention routière que l’airbag pouvait vous dispenser de la contrainte de mettre votre ceinture de sécurité. Aux gays on leur a expliqué que la PrEP n’empêche pas le préservatif, mais sur le terrain ce qui ressortait clairement des discussions était de se demander pourquoi continuer de faire l’effort de mettre une capote puisqu’on nous préparait un traitement préventif tellement alléchant.
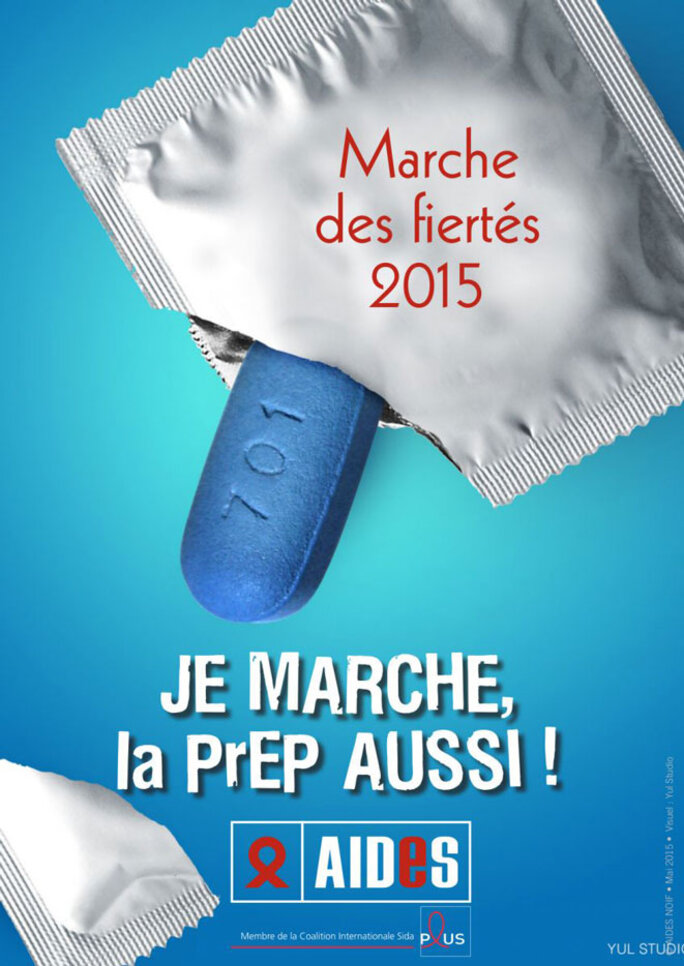
Agrandissement : Illustration 2
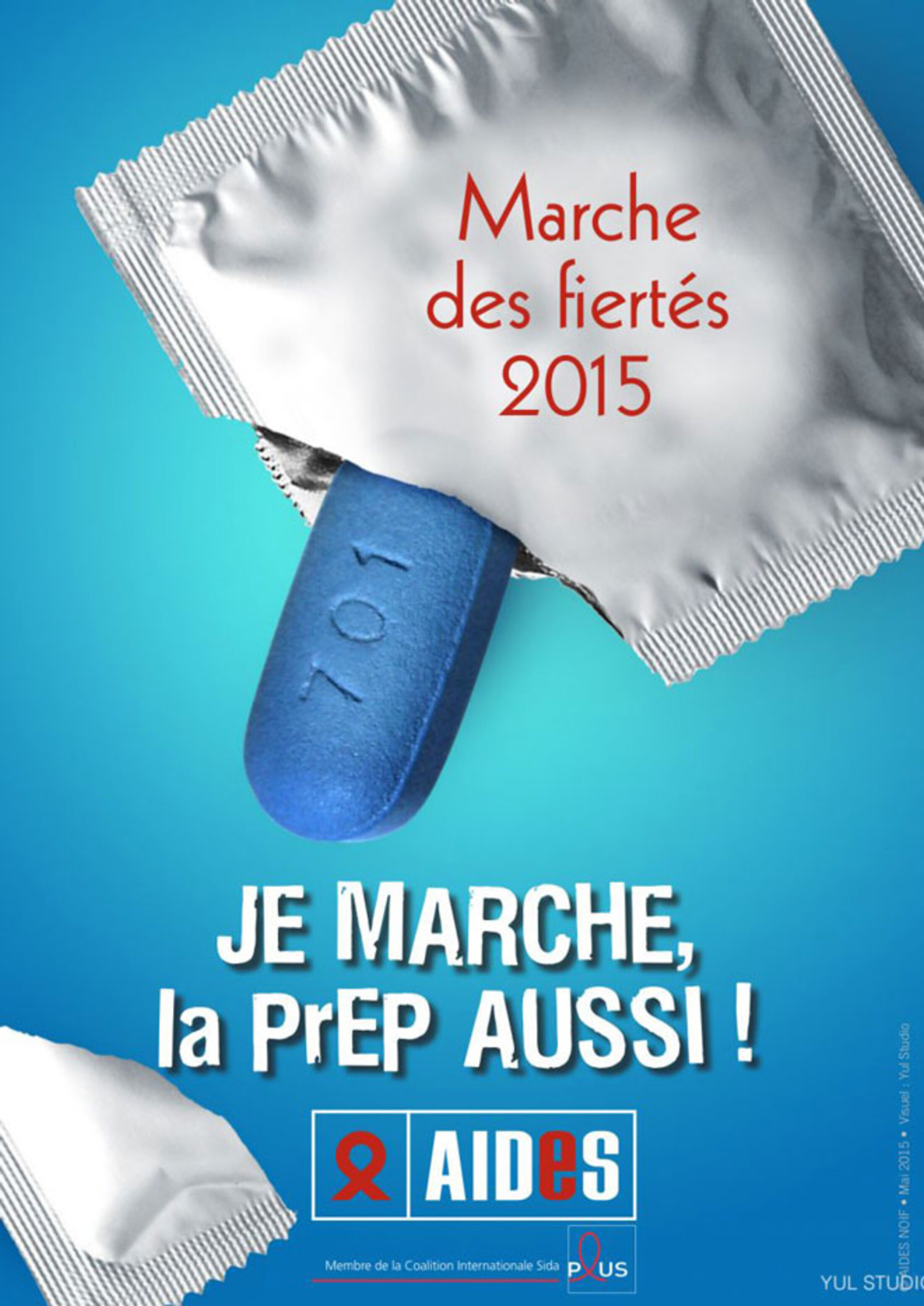
Ainsi la prévention bio-médicale, au lieu de responsabiliser les gays, les a plutôt incités à se détourner du préservatif. Beaucoup de professionnels de la lutte contre le sida pensent que les gays sont incapables de se prendre en charge et de limiter leurs pratiques sexuelles à risque[i]. C’est cette logique qu’il faut aujourd’hui combattre en proposant une politique alternative dans laquelle la prévention bio-médicale n’est pas conçue comme un moyen de se détourner du safer sex, mais au contraire, comme un appui à une meilleure prise de conscience et une aide à l’adoption de comportements plus favorables à sa santé sexuelle.
Quatre priorités pour en finir avec le sida et les IST :
- Une véritable politique de santé sexuelle en direction des gays.
Nos pratiques sexuelles exigent un suivi particulier avec un dépistage régulier de toutes les IST. Il peut exister des centres de santé sexuelle (notamment les nouveaux CeGIDD qui vont se mettre en place), mais il faut surtout former les médecins généralistes et entretenir un maillage national de professionnels de santé sensibilisés aux spécificités de la santé LGBT.
- Une prise en charge médicale et psychologique efficace des séropositifs.
Les personnes vivant avec le VIH doivent être correctement suivies, pour mieux vivre, mais aussi pour réduire la charge virale communautaire (objectif du traitement comme prévention, leTASP). Les ingrédients de cet axe d’action sont connus et déjà pratiquement en place : dépistage régulier, traitement immédiat des nouveaux séropositifs, éducation thérapeutique pour obtenir une excellente observance, poursuite des recherches sur l’allégement des traitements pour favoriser la bonne observance et diminuer leurs effets secondaires sur le long terme.
- Une mobilisation communautaire pour rendre plus visible la séropositivité.
Les gays doivent mobiliser toutes les structures communautaires (associations, médias, établissements de convivialité, sites de rencontre et réseaux sociaux) pour favoriser la visibilité des séropositifs, lutter contre la sérophobie et donner une exacte image du vécu de la séropositivité.
- La reprise des campagnes de promotion du safer sex.
Les gays ont su réagir lors de l’apparition du sida en développant la culture du safer sex, ils doivent aujourd’hui la remettre à la mode. Les campagnes de prévention comportementale doivent reprendre, innover, être imaginatives, et soutenues par l’ensemble de la communauté. On le sait, la prévention en santé est extrêmement difficile et doit être sans cesse renouvelée.
[i] Ainsi, France Lert, chercheuse épidémiologiste, a été chargée de mission par la Mairie de Paris pour définir la politique contre le sida de la ville. Elle ne cache pas son enthousiasme pour la PrEP, dans le bulletin de santé épidémiologiste en île de France, n°22, décembre 2015, elle analyse ainsi la situation : « la stagnation de la courbe de l’épidémie est due à l’efficacité insuffisante des dispositifs et non aux comportements individuels et collectifs », son objectif est donc « d’alléger le poids de la responsabilité pesant sur les individus et les communautés ».



