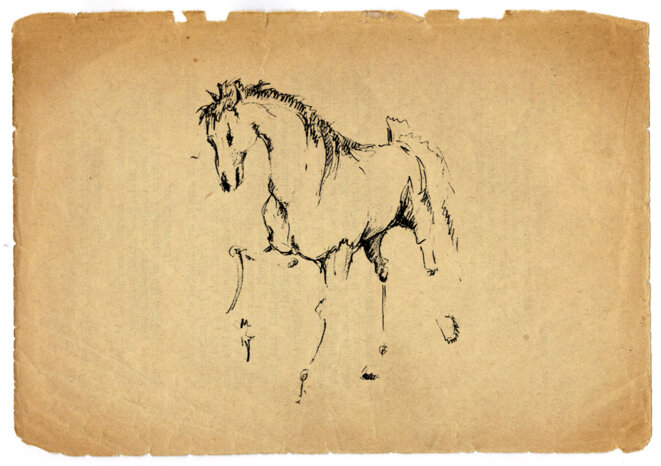En 2021, l’historienne Marlene Daut a eu un article intitulé “Napoleon Isn’t a Hero to Celebrate” publié dans le New York Times. Dans cet article, elle écrit, entre autres :
“After a year in which statues of enslavers and colonizers were toppled, defaced or taken down across Europe and the United States, France has decided to move in the opposite direction. The year 2021 is being hailed by many museums and institutions in the country as the “Year of Napoleon” to commemorate France’s biggest tyrant, an icon of white supremacy, Napoleon Bonaparte, who died 200 years ago on the island of Saint-Helena on May 5, 1821.”
Elle écrit également :
“...the French education system, which I taught in from 2002 to 2003, encourages the belief that France is a colorblind country with an “emancipatory history.” When French schools do teach colonial history, they routinely tout that the country was the first of the European world powers to abolish slavery.”
La même année, deux autres historiens, Manuel Covo et Megan Maruschke, ont fait le constat suivant dans la présentation de The French Revolution as an Imperial Revolution :
“Attempts to reframe the Age of Revolutions as imperial in nature have not fully integrated the French Revolution.” (« L'effort historiographique consistant à placer l’ère des révolutions dans leur contexte impérial n'est pas encore parvenu à pleinement intégrer la Révolution française. »)
J’ai adressé à un certain nombre d’historiens l’email suivant, qui vise à situer dans un contexte plus global la raison pour laquelle le passé colonial de la France reste occulté, particulièrement pour la période révolutionnaire. Ce passé est occulté tant par le système scolaire et universitaire que par les historiens, tant français, qu’anglais et américains, entre autres.
Les historiens n’aiment ni les études postmodernes, ni les études postcoloniales, ni la philosophie, en général.
Dans That Noble Dream: The 'Objectivity Question’ and the American Historical Profession, Peter Novick étudie, comme le sous-titre du livre l’indique, comment les historiens américains, depuis qu’ils sont devenus des professionnels, à la fin du XIXe siècle, se sont positionnés par rapport à la question de l’objectivité. Pour la plus grande part, jusqu’à aujourd’hui, ils ont considéré que l’objectivité était au fondement de leur métier et qu’ils s’y conformaient dans leur pratique. Mais, comme le titre de Novick l’indique, il s’agit là d’un « rêve », d’un « noble rêve » peut-être, mais d’un « rêve », ou d’une illusion, et donc d’un mythe.
La question de l’objectivité est une question philosophique, épistémologique, et une question que les historiens n’aiment en général pas aborder, comme le constate Novick :
“On one level what is at stake in the objectivity question is a philosophical issue: a technical problem in epistemology. Very few historians have any philosophical training, or even inclination. (Not a crime; not even blameworthy; most philosophers are rotten historians.) Though all historians have had views on the objectivity question, these views have rarely been fully articulated; even more rarely have they been the fruit of systematic thought. The historical profession does not monitor the philosophical rigor of what historians have had to say on the question, and no historian suffers professionally as a result of demonstrated philosophical incompetence.”
Comme le postmodernisme est, en autre, un mouvement philosophique, il ne faut pas s’étonner que les historiens y soient peu sensibles. Disons même plutôt qu’ils y sont dans leur très grande majorité très hostiles.
L’historien Keith Windschuttle, dans The killing of history: how literary critics and social theorists are murdering our past, a rien moins qu’accuser le postmodernisme de chercher à tuer la discipline historique.
Il est une discipline qui, elle, est beaucoup plus réceptive au postmodernisme, c’est le postcolonialisme. Les trois auteurs les plus notoires des études postcoloniales, Edward Said, Homi Bhabha, and Gayatri Spivak, ont reconnu parmi leurs principales influences des auteurs postmodernes, notamment Foucault pour Said, et Derrida pour Spivak, qui a traduit en anglais De la grammatologie (Of grammatology).
Le postmodernisme est une étude — et une critique — de la modernité, et un désire de la dépasser.
Les historiens de la révolution française sont tout particulièrement concernés par le postmodernisme parce que cette révolution est très souvent présentée comme une étape importante vers la modernité, quand ce n’est pas comme l’évènement inaugurateur de la modernité.
Dans ‘Paradigms and Paranoia: How Modern Is the French Revolution?’, Rebecca Spang constate :
“...how remarkably constant textbooks have been in assessing the import of the French Revolution. From classics of Cold War “Western” historiography to recent efforts to write history within a global framework, the fundamental message remains the same: the Revolution of 1789 is the turning point of the modern world. The wording may vary, but the substance does not. Said to mark “the beginning of modern history,” the French Revolution is deemed “a decisive event in world history” that initiated a “century of rapid and tremendous change”; after the events of 1789–1815, “the clock could not really be set back.” Authors may emphasize different aspects of this modern period—political Liberalism, triumphant individualism, nationalistic militarism—but their accounts coincide in treating the revolution as an identifiable period of rapid, irreversible change. An evocative but, in this non-geological context, far from precise word—watershed—has provided one popular metaphor for conveying some sense of the revolution’s relation to modernity. Pre-modern history, it is implied, flows away from the revolution to empty into some primordial sea of pre-history; modern history runs the opposite direction, to reach the shores of the present.”
L’article de Spang, cependant, fait planer un certain doute sur la pertinence de cette idée trop bien ancrée pour être si souvent assénée. L’incertitude sur ce qu’est réellement la révolution française est en réalité venue troubler au moins une partie, et apparemment une grande partie, de ses historiens.
Dans Revolutionary Ideas. An Intellectual History of the French Revolution from the Rights of Man to Robespierre, Jonathan Israel remarque :
“Historians working on the French Revolution have a problem. All of our attempts to find an explanation in terms of social groups or classes, or particular segments of society becoming powerfully activated, have fallen short. As one expert aptly expressed it: “the truth is we have no agreed general theory of why the French Revolution came about and what it was—and no prospect of one.” This gaping, causal void is certainly not due to lack of investigation into the Revolution’s background and origins. If class conflict in the Marxist sense has been jettisoned, other ways of attributing the Revolution to social change have been explored with unrelenting rigor. Of course, every historian agrees society was slowly changing and that along with the steady expansion of trade and the cities, and the apparatus of the state and armed forces, more (and more professional) lawyers, engineers, administrators, officers, medical staff, architects, and naval personnel were increasingly infusing and diversifying the existing order. Yet, no major, new socio-economic pressures of a kind apt to cause sudden, dramatic change have been identified. The result, even some keen revisionists admit, is a “somewhat painful void”.”
Pendant une grande partie du XXe siècle, l’interprétation marxiste de la révolution française s’était imposée grâce à des historiens comme Mathiez, Lefebvre et Soboul. Un mouvement révisionniste, dont, en France, la principale figure est Furet, a mis fin à cette interprétation, sauf pour ce qui reste de marxistes, sans réussir à en imposer une autre. On sait seulement qu’on est passé d’une histoire sociale à une histoire politique, ou plutôt on y est revenu, car un Aulard avait déjà écrit une Histoire politique de la révolution française.
Que l’histoire de la révolution française soit sociale ou politique, cependant, elle est presque systématiquement une histoire focalisée sur les révolutionnaires et sur Paris, comme le constate encore Spang pour la période révisionniste actuelle :
“...with a few notable exceptions, the French Revolution has become about politics conceived primarily in terms of the 600–1,000 men who served at any one time in the national political body.”
La révolution française serait le fait de ces 600 à 1.000 hommes qui ont servi à un moment donné dans le corps politique national. Eux seuls incarneraient cette révolution, qui elle-même incarnerait la modernité.
Les évènements extérieurs qui peuvent ou semblent pouvoir être rapprochés de la révolution française sont le fait de son influence, jamais l’inverse. Si la modernité apparaît ailleurs qu’en France, c’est par le fait de l’influence, ou de l’action directe, de la révolution française.
Mais y-eut-il réellement une révolution française ?
Alfred Cobban avait écrit un article qui, comme l’indique son titre, le niait : The Myth of the French Revolution.
Si l’on tire les conclusions que semble imposer l’œuvre de Thomas Kuhn, comme le fait Spang, la réponse est également négative :
“Rumors of the past paradigm’s death should lead us to ask: Was there a French Revolution? For if we take seriously the notion of “paradigm” developed in Thomas Kuhn’s famous The Structure of Scientific Revolutions, then our answer to this question might well have to be “no.” Or, rather, we might say that there had once been something we knew as the French Revolution, but there is no such object now. According to Kuhn, we could not merely say that we have changed our interpretation while the object remains the same. When we operate within a new paradigm, Kuhn claimed, we actually “work in a different world.” [...] If historians really have abandoned the past paradigm, then there may no longer be a “French Revolution” to analyze.”
La plupart des historiens de la révolution française continuent cependant d’écrite l’histoire de cette révolution avec la conviction du scientisme du XIXe siècle. L’objectivité dont ils se réclament, et dont se réclament les historiens an général, est cependant elle-même un mythe, si l’on suit Peter Novick, car ce que ce dernier a montré pour les historiens américains vaut évidemment pour les historiens français, anglais, italiens, etc.
Le contrecoup de la focalisation des historiens sur les 600 à 1.000 révolutionnaires des instances parisiennes est la négligence de tout ce qui leur est extérieur, une négligence qui est pour une très grande part un silence délibéré, ou plutôt une série de silences.
L’un de ces silences, le plus remarqué, est celui qui entoure la révolution haïtienne. Michel-Rolph Trouillot en a fait le sujet d’un livre : Silencing the Past: Power and the Production of History, livre dans lequel il écrit :
“The silencing of the Haitian Revolution is only a chapter within a narrative of global domination. It is part of the history of the West and it is likely to persist, even in attenuated forms, as long as the history of the West is not retold in ways that bring forward the perspective of the world.”
Trouillot met ici en cause la manière dont est conçue l’histoire en Occident, une conception de l’histoire qui a été qualifiée d’eurocentrique.
L’eurocentrisme est devenu un sujet d’étude passablement développé, sans avoir néanmoins le moins du monde attiré l’attention des historiens de la révolution française, qui sont pour ainsi dire tous des historiens eurocentriques (ou plus exactement, en général, francocentriques).
Dans son introduction au livre de Palmer, The Age of the Democratic Revolution, David Armitage relève en passant les « péchés académiques » (« eurocentrisme, essentialisme, téléologie, diffusionnisme ») qui sous-tendent l’œuvre de l’historien américain :
“Palmer’s masterpiece sprang from the conjunction of two revolutionary moments, past and present. The first was what he called the late eighteenth-century “Revolution of Western Civilization” in Europe and North America. The second was the great revolution of his own times in Asia, Africa, and Latin America: “Let us . . . use the revolutionary era to investigate what is most on our minds, to find out what a world is like that is divided by revolution and war.” The two movements were continuous yet counterposed, because the revolution of the West had created the tools for the ongoing revolution against the West. Palmer argued that the goal of both was equality, a fundamental value that had first been widely elaborated between 1760 and 1800, with lasting legacies for succeeding centuries: “All revolutions since 1800, in Europe, Latin America, Asia, and Africa,” he wrote at the very end of The Age of the Democratic Revolution, “have learned from the eighteenth-century Revolution of Western Civilization.” That judgment might seem guilty of almost every current scholarly sin—Eurocentrism, essentialism, teleology, diffusionism—but it captured the essence of Palmer’s endeavor: to understand the present through the past with the perspective of the longue durée.”
L’eurocentrisme (et par conséquent le francocentrisme) entraîne les trois autres « péchés académiques » que sont l’essentialisme, la téléologie et le diffusionnisme.
L’un des livres pionnés qui ont mis en évidence la conception eurocentrique de l’histoire est The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric History, de J. M. Blaut, qui est aussi l’auteur, en autre, de Eight Eurocentric historians.
La presque totalité de l’historiographie de la révolution française est essentiellement francocentriste, de par le fait non seulement d’historiens français, mais également anglais, américains ou encore italiens.
L’eurocentrisme consiste à étendre à l’histoire de l’Europe la conception francocentrique de la révolution française, à dire que la modernité est un fait européen, et que la diffusion de cette modernité dans le reste du monde fut et reste aussi inévitable que légitime, à légitimer par conséquent le colonialisme européen dans le reste du monde. C’est, pour reprendre le titre du livre de Blaut, le « modèle du monde du colonisateur » européen, comme le francocentrisme est le « modèle du monde du colonisateur » français.
Au niveau de l’histoire la plus officielle, chaque pays colonisateur européen a développé sa propre conception ethnocentrique (francocentrique, anglocentrique, etc.) de l’histoire. Les Anglais n’ont ainsi pas les mêmes héros que les Français et n’ont pas consacré l’année 2021 à célébrer la mort de Napoléon Bonaparte ; les Français, si.
Dans ‘Napoleon Isn’t a Hero to Celebrate’, publié dans le New York Times, Marlene Daut relève :
“After a year in which statues of enslavers and colonizers were toppled, defaced or taken down across Europe and the United States, France has decided to move in the opposite direction. The year 2021 is being hailed by many museums and institutions in the country as the “Year of Napoleon” to commemorate France’s biggest tyrant, an icon of white supremacy, Napoleon Bonaparte, who died 200 years ago on the island of Saint-Helena on May 5, 1821.”
Bonaparte est indéniablement l’une des plus emblématiques figures de l’impérialisme français. Le commémorer c’est commémorer, implicitement ou explicitement, l’impérialisme français. On peut en dire autant de la révolution française elle-même, dont il est le direct produit. C’est parce que la révolution française fut impérialiste que Napoléon Bonaparte est parvenu au pouvoir.
La difficulté — ou plutôt le refus — de regarder objectivement son passé colonial est une caractéristique très connue de la France, et cette caractéristique se retrouve au niveau de l’historiographie de la révolution française. Comme on l’a vu, cette caractéristique n’est cependant pas propre aux historiens français ; elle est commune aux historiens occidentaux en général.
Trouillot, en prenant le cas anglais, a relevé que le silence entourant la révolution haïtienne transcendait aussi les positions politiques :
“The Penguin Dictionary of Modern History, a mass circulation pocket encyclopedia that covers the period from 1789 to 1945, has neither Saint-Domingue nor Haiti in its entries. Likewise, historian Eric Hobsbawm, one of the best analysts of this era, managed to write a book entitled The Age of Revolutions, 1789–1843, in which the Haitian Revolution scarcely appears. That Hobsbawm and the editors of the Dictionary would probably locate themselves quite differently within England’s political spectrum is one indication that historical silences do not simply reproduce the overt political positions of the historians involved. What we are observing here is archival power at its strongest, the power to define what is and what is not a serious object of research and, therefore, of mention.”
Le silence ou quasi-silence sur la révolution haïtienne que Trouillot a relevé chez Hobsbawm, Armitage l’a relevé — avec quelques autres occultations — chez Palmer :
“Its omission of the Haitian Revolution and of Iberian America—not to mention the absence of the enslaved, women, and much cultural history—implied that Palmer was afraid to acknowledge the truly radical elements of the age of revolution, that he was blind to its exclusions and complacent about its failed promises.”
Hobsbawm et Palmer, deux historiens notoires, l’un marxiste et l’autre libéral, l’un anglais et l’autre américain, ont tous deux écrit sur l’« âge des révolutions », mais avec un point de vue évidemment en partie différent. Tandis que Palmer associe la révolution américaine et la révolution française pour en faire les deux principales étapes d’un mouvement démocratique libéral, Hobsbawm associe, lui, la révolution française et la révolution industrielle, en Angleterre, pour en faire les deux événements initiateurs d’une lutte de classes entre la bourgeoisie et le prolétariat, lutte qui serait au centre de la modernité, dont la principale caractéristique serait d’avoir engendré le système capitaliste.
Pour Hobsbawm, comme pour les marxistes en général, la révolution française est une révolution bourgeoise capitaliste qui doit être suivie d’une révolution prolétarienne. La liberté, dont les révolutionnaires se prétendent les promoteurs, n’est que pour les bourgeois, les capitalistes, qui usent leur pouvoir, celui de l’argent, pour exploiter le prolétariat, nouvelle classe asservie.
Pour Palmer, la révolution française est une révolution libérale et démocratique qui met fin à la monarchie et à la domination de l’aristocratie.
Ce sont donc deux conceptions différentes de l’histoire — deux philosophies de l’histoire — qui opposent ces deux historiens, et qui opposent historiens marxistes et historiens libéraux dans leur ensemble. Ce sont par conséquent deux conceptions de la société, de la liberté, de l’égalité, de la fraternité, des droits de l’homme, etc., qui séparent les uns des autres. Et cependant, ils se rejoignent pour entourer de silence la révolution haïtienne et l’impérialisme révolutionnaire en général.
La connivence des historiens avec l’impérialisme s’est manifestée et continue de se manifester plus souvent par le silence que par une approbation ouverte, à de rares exceptions, dont Palmer.
Si Palmer fait lui aussi le silence sur l’impérialisme révolutionnaire, il a pris en revanche ouvertement position en faveur du gouvernement français durant la guerre d’Algérie, dans la préface de 1958 de Twelve Who Ruled: The Year of the Terror in the French Revolution, livre publié initialement en 1941, dans lequel il fait un récit élogieux du comité de salut public :
“The year 1958, now ending, saw a flurry of revival of the term “committee of public safety.” Rarely even in politics has language been so abused. The small groups that formed in Algiers and elsewhere to defy the government of the Fourth Republic were the opposite to the real Committee of Public Safety, which was above all a government, and a government of republican defense, and which in all probability would have sent the leaders of any such defiance to the guillotine.”
Le livre de Peter Novick, That Noble Dream, est divisé en quatre parties. Dans la première et la troisième, ce que montre Novick est une croyance générale forte en l’objectivité de l’histoire. La troisième partie est intitulée ‘Objectivity reconstructed’ et commence par le chapitre ‘The defense of the West’, qui commence ainsi :
“The aftermath of World War I ushered in a period of negativity and doubt, the climate in which the relativist critique flourished. The coming of World War II saw American culture turn toward affirmation and the search for certainty. American mobilization, intellectual as well as material, became permanent in what most saw as one continuous struggle of the “Free World” against “totalitarianism”—first in its Nazi, then its Soviet embodiments. “Totalitarianism” as a theoretical and rhetorical construct had been employed occasionally and casually throughout the 1930s. For obvious reasons it succeeded in capturing the imagination of academics and publicists during the years of the Nazi-Soviet pact. For equally obvious reasons, use of the term dropped off during the wartime alliance between the United States and the Soviet Union. Then, for a generation after 1945, the construct served both as the principal theoretical underpinning of scholarly studies of Nazism and Communism in the United States, and as the foundation of American counterideology in the cold war.
C’est dans ce contexte résumé par Novick qu’est apparu le livre de Palmer sur la « révolution atlantique ». Sur ce contexte, Novick donne encore les précisions suivantes :
“Before World War I, the dominant institutionalist-evolutionist orientation of American historians had led them to stress the English origin of American institutions, and made English history the centerpiece of European studies. Between the wars, most Americanists stressed the distinctiveness of American society, and were little inclined to emphasize links with Europe. It is difficult to locate any clear focus in the work of Europeanists in this period. After World War II, both Americanists and Europeanists joined in arguing that “the Atlantic community” was the appropriate framework for both American and Western European history. “To those who are interested in the survival of democracy,” wrote Richard Hofstadter, “it is probably more important to see American democracy as a part of western European democracy than it is to stress its uniqueness.” Allan Nevins saw a “nationalistic” view of United States history replaced by “the international view, treating America as part of a great historical civilization with the Atlantic its center, as the Mediterranean was the center of the ancient world.” On the European side, Carlton J. H. Hayes, seeking to reverse continental drift, said that a historiography which treated “detached Eastern and Western Hemispheres” was “unrealistic, contrary to basic historical facts, and highly dangerous for our country at the present and in the future.” Garrett Mattingly likewise stressed that American history was Western history: “moved by the same rhythms, stirred by the same impulses, inescapably involved in the same crises. Sharing the same past with the peoples of Western Europe, bound to them by a thousand daily ties, we go forward with them to a common destiny.”
C’est ainsi la civilisation occidentale qui est mise en avant avec « la communauté atlantique », une communauté qui comprend les États-Unis et l’Europe de l’ouest, et qui est identifiée comme étant le « monde libre ». Le livre de Palmer, The Age of the Democratic Revolution, développe cette conception de l’histoire, une conception eurocentrique, accusée en outre par des historiens marxistes de vouloir légitimer l’Otan. Novick écrit à ce propos :
“Albert Soboul was no doubt being highly unfair when he designated work which posited an “Atlantic Revolution” in the eighteenth century as “NATO History.” And it is certainly an exaggeration to say, as did Gilbert Allardyce, that “educators equated . . . the Western military alliance with Western civilization.” Unfair, exaggerated, but with at least a grain of truth, especially in the case of that great curricular innovation of the postwar years, the Western civilization course.”
En incorporant les révolutions américaine et française (et quelques autres) en une seule révolution, la thèse de Palmer d’une révolution démocratique du monde atlantique heurtait les sentiments nationalistes tant américains que français. En France, la thèse fut très largement rejetée, tant par les historiens marxistes que libéraux (les uns et les autres également nationalistes), comme le relève Marvin R. Cox, dans ‘Palmer and Furet: A Reassessment of The Age of the Democratic Revolution’ :
“Palmer, playing down Cold War rivalries, had treated historians in Eastern Europe with respect; yet these historians dismissed [The Age of the Democratic Revolution] as a brief to provide historical legitimacy for NATO. More significant was the response in France. Palmer made his considerable reputation as an historian of the French Revolution and conceded pride of place to that event within the wider Democratic Revolution. The consensus among French historians who took note of the book, however, was that it unfairly diminished the importance of the event.”
Soboul, historien aussi nationaliste que marxiste, reproche à la thèse de Palmer de vider la révolution française « de tout contenu spécifique » :
« Cette conception en vidant la Révolution française de tout contenu spécifique, économique (anti-féodal et capitaliste), social (antiaristocratique et bourgeois) et national (un et indivisible), tiendrait pour nul un demi-siècle d’historiographie révolutionnaire, de Jean Jaurès à Georges Lefebvre. »
Soboul précise ainsi ce qu’il entend par la spécificité de la révolution française, qui, dit-il, « s’assigna finalement une place singulière dans l’histoire du monde contemporain » :
Révolution de la liberté, elle se plaça, comme la Révolution américaine, sous l’invocation du droit naturel et conféra à son œuvre un caractère universaliste qu'avait négligé la Révolution anglaise. Mais qui pourrait nier que la Déclaration de 1789 affirma ce caractère avec bien plus de force que les Déclarations américaines ? Ajoutons qu’elle alla plus loin dans la voie de la liberté. Elle affirma la liberté de conscience et admit les protestants et les juifs dans la cité ; mais en créant l’état civil, le 20 septembre 1792, elle reconnaissait au citoyen le droit de n’adhérer à aucune religion. Elle libéra l’homme blanc ; mais, par la loi du 16 pluviôse au II (4 février 1794), elle abolit « l’esclavage des nègres dans toutes les colonies ».
Révolution de l'égalité, la Révolution française dépassa singulièrement les révolutions qui l’avaient précédée. En Angleterre ni aux Etats-Unis, l’accent n’avait porté sur l'égalité, l’aristocratie et la bourgeoisie s'étant associées au pouvoir. La résistance de l’aristocratie, la contre-révolution et la guerre contraignirent la bourgeoisie française à pousser l'égalité des droits au premier plan. Ainsi put-elle rallier le peuple et vaincre. Mais ainsi s’esquissa en l’an II un régime de démocratie sociale caractérisé par un compromis entre les conceptions bourgeoises et les aspirations populaires. Les masses populaires se rendaient compte du sort qui les attendait : c’est pourquoi elles se montrèrent hostiles à la liberté économique qui ouvrait la voie à la concentration et au capitalisme. Leur idéal, à la fin du XVIIIe siècle, était que chaque paysan fût propriétaire, chaque artisan indépendant, que le salarié fut protégé contre la toute-puissance du riche. [...] Cette république égalitaire remplit la bourgeoisie possédante d’indignation et d’effroi ; après le 9 thermidor, elle parut bannie à jamais. Mais demeura dès lors, dans la conscience des hommes, cette conviction que la liberté sans l’égalité n’est que le privilège de quelques-uns, que la liberté et l’égalité sont inséparables, que l'égalité politique elle-même peut n'être qu’une apparence quand s’affirme l’inégalité sociale. [...]
Révolution de l’unité enfin, la Révolution française acheva la nation devenue une et indivisible. Sans doute, la monarchie capétienne avait constitué le cadre territorial et administratif de la nation, mais sans pousser cette tâche jusqu’au bout : en 1789, l’unité nationale demeurait imparfaite. La nation demeurait sectionnée territorialement par l’incohérence des divisions administratives et la persistance du « morcellement féodal » ; la diversité des poids et mesures, les douanes intérieures s’opposaient à la constitution d’un marché national. [...] Les ordres, états, corps et corporations abolis, les Français sont libres et égaux en droits, ils constituent la nation une et indivisible. La rationalisation des institutions par l’Assemblée constituante, le retour à la centralisation par le Gouvernement révolutionnaire, l'effort administratif du Directoire, la reconstruction de l’État par Napoléon, achevèrent l’œuvre de la monarchie d’Ancien Régime, par la destruction des autonomies et des particularismes, par la mise en place de l’armature institutionnelle d’un État unifié. En même temps, par l'égalité civile, par le mouvement des fédérations en 1790, par le développement du réseau des sociétés affiliées aux Jacobins, par l’anti-fédéralisme et les congrès ou réunions centrales de sociétés populaires en 1793, s’éveillait et se fortifiait la conscience d’une nation unitaire. [...] La Révolution française donnait à la souveraineté nationale une force et une efficacité qu’elle n’avait pas jusque-là. » (Postface à Quatre-vingt-neuf, de G. Lefebvre)
Palmer et Soboul écrivent l’un et l’autre avec une conviction inébranlable, mais antagoniste. Les mêmes « péchés académiques » relevés par Armitage chez Palmer se retrouvent cependant chez Soboul, l’eurocentrisme de Palmer devenant chez Soboul un rigide et étroit francocentrisme.
La manière dont Soboul présente l’abolition de l’esclavage est un mythe qui occulte entièrement la révolution haïtienne. Soboul écrit de la révolution française qu’elle « libéra l’homme blanc », préambule à l’idée suggérée au lecteur qu’elle libéra aussi l’homme noir, puisque, dit-il « par la loi du 16 pluviôse au II (4 février 1794), elle abolit « l’esclavage des nègres dans toutes les colonies ». »
Ce mythe se retrouve dans la plupart des histoires récentes de la révolution française. Marisa Linton et Michel Biard le reprennent dans Terror: The French Revolution and Its Demons, préfacé par Timothy Tackett, et publié en français en 2020 et en anglais en 2021. Évoquant les mesures destinées à réduire les inégalités sociales et à lutter contre la pauvreté, Linton et Biard écrivent :
“On top of these state-led economic measures were other decisions aiming at reducing social inequalities, tapping into the demands made in early spring 1793 by the Montagnards Jeanbon Saint-André and Ellie Lacoste, then deputies in the Dordogne and the Lot: ‘It is absolutely necessary to aid the poor if you want their help to complete the Revolution. In these extraordinary cases we should only see the great law of the public good.’ A whole policy of public aid was in fact born, in the name of national welfare (bienfaisance), which did not forget the colonial territories (abolition of slavery on 16 Pluviôse Year II [4 February 1794]). There were also measures to help soldiers and their families, which were necessary to encourage citizen-soldiers to spill blood at the borders or against ‘rebels’. A major concern for the Convention in 1793 was ensuring the access of the poorest in the countryside to land, even if a genuine land reform was never contemplated due to strictures about property rights.”
Selon Linton et Biard, l’abolition de l’esclavage serait une mesure prise par la convention et le comité de salut public, dont faisait partie Jeanbon Saint-André, dans le cadre d’une politique de bienfaisance.
Ce mythe se retrouve dans le système scolaire, à propos duquel Marlene Daut écrit, toujours dans ‘Napoleon Isn’t a Hero to Celebrate’ :
“...the French education system, which I taught in from 2002 to 2003, encourages the belief that France is a colorblind country with an “emancipatory history.” When French schools do teach colonial history, they routinely tout that the country was the first of the European world powers to abolish slavery.”
Dans ‘Trois notes pour l’histoire de l’aristocratie (Ancien Régime - Révolution)’ (dans Noblesse française, noblesse hongroise, XVIe-XIXe siècles), Soboul écrit, à propos de la thèse de Cobban de la non-abolition de la « féodalité » par la révolution française :
« L’argumentation de Cobban porte en premier lieu sur la « féodalité », dont il conteste la réalité économique et sociale. La Révolution n’a pas pu l’abolir, puisqu’elle n’existait plus. »
Dans le cas de l’esclavage, le décret de la convention du 16 pluviôse an II (4 février 1794) n’a pas pu l’abolir à Saint-Domingue, où se trouvait de loin le plus grand nombre d’esclaves (environ 500.000), puisqu’il n’existait plus. A la suite de la révolte des esclaves qui a éclaté en août 1791, et dans l’impossibilité de les vaincre, menacés de plus par les puissances espagnole et anglaise, Sonthonax et Polverel, les commissaires civils, face à la nécessité de recruter des soldats, et les seuls pouvant être recrutés comme soldats étant les noirs, ont progressivement aboli l’esclavage de juin à octobre 1793 pour préserver les chances de conserver la colonie à la France.
La convention a avalisé cette abolition et l’a étendue officiellement aux autres colonies, mais la cause initiale de l’abolition de l’esclavage à Saint-Domingue est la révolte des esclaves, et l’abolition officielle de l’esclavage dans cette colonie est le fait de Sonthonax et Polverel, haïs des colons blancs comme des jacobins, qui les firent décréter d’accusation.
Cette abolition provisoire de l’esclavage ne signifie pas la fin du colonialisme français durant l’époque révolutionnaire, ni outre-mer, ni en Europe. En Europe, la déclaration de guerre à l’Autriche en avril 1792 fut suivie, à partir de décembre de la même année, d’une politique d’annexion des territoires conquis, à commencer notamment par la Belgique, politique d’annexion légitimée par l’idéologie des « frontières naturelles », une idéologie inventée par la toute nouvelle république.
L’« histoire émancipatrice » évoquée par Marlene Daut cache en fait une histoire impérialiste, tant en Europe, qu’outre-mer.
La France n’a libéré ni l’homme blanc, ni l’homme noir. Elle a colonisé des hommes de diverses couleurs de peau sous tous les régimes politiques, y compris le républicain. La révolution française a perpétué l’impérialisme français en le réinventant. Presque toutes les histoires de la révolution française tentent de faire passer cet impérialisme pour de l’émancipation.
Tant le postmodernisme que le postcolonialisme contredisent ce mythe persistant d’une « histoire émancipatrice », postmodernisme et postcolonialisme qui sont pour ainsi dire disciplinae non gratae en France.
Hayden White, sans se situer lui-même dans ces courants — tout en étant l’une des principales références des historiens postmodernes — se reconnaissant en revanche dans le mouvement existentialiste, a remis fondamentalement en question, dans Metahistory, la prétention des historiens à l’objectivité. Si l’histoire est basée sur un travail de recherche dont la qualité peut être excellente, le fait qu’elle adopte le mode de la narration pour exposer le résultat de ces recherches en altère irrémédiablement, selon White, la véracité.
En étudiant notamment quatre historiens du XIXe siècle, dont Michelet et Tocqueville, deux historiens de la révolution française, White a dégagé quatre ou cinq types de récits auxquels peuvent se ramener l’essentiel de la production historiographique : la romance, la comédie, la tragédie, la satire et l’épopée, surtout les quatre premiers.
Dans The history and narrative reader, Geoffroy Roberts présente ainsi la thèse de White :
“The argument that historical narration is primarily an act of telling, not of discovery, is a major theme of the writings of Hayden White. In [‘The Historical Text as Literary Artifact’, in Tropics of discourse], he characterizes historical narratives as "verbal fictions, the contents of which are as much invented as found and the forms of which have more in common with their counterparts in literature than they have with those in sciences." The source of the invention of the verbal fiction which constitutes a historical narrative is, according to White, "emplotment" – the choice of plot structure by the historian. In order to endow past events with a meaning and order understood by both writer and reader the historian selects a story form or type – romance, tragedy, comedy, satire or epic. White's point is that this configuration of the past does not derive from events themselves but from a choice of pre-existing emplotment strategies imposed on the past by the historian. Like Mink, White sees historical narrative as a representational structure but also as “metaphorical statements which suggest a relation of similitude between such events and processes and the story types that we conventionally use to endow the events of our lives with culturally sanctioned meanings."
White présente lui-même ainsi sa thèse dans Metahistory :
“Providing the "meaning" of a story by identifying the kind of story that has been told is called explanation by emplotment. If, in the course of narrating his story, the historian provides it with the plot structure of a Tragedy, he has "explained" it in one way; if he has structured it as a Comedy, he has "explained" it in another way. Emplotment is the way by which a sequence of events fashioned into a story is gradually revealed to be a story of a particular kind.
Following the line indicated by Northrop Frye in his Anatomy of Criticism, I identify at least four different modes of emplotment: Romance, Tragedy, Comedy, and Satire. There may be others, such as the Epic, and a given historical account is likely to contain stories cast in one mode as aspects or phases of the whole set of stories emplotted in another mode. But a given historian is forced to emplot the whole set of stories making up his narrative in one comprehensive or archetypal story form. For example, Michelet cast all of his histories in the Romantic mode, Ranke cast his in the Comic mode, Tocqueville used the Tragic mode, and Burckhardt used Satire. The Epic plot structure would appear to be the implicit form of chronicle itself. The important point is that every history, even the most "synchronic" or "structural" of them, will be emplotted in some way. The Satirical mode provided the formal principles by which the supposedly "non-narrative" historiography of Burckhardt can be identified as a "story" of a particular sort. For, as Frye has shown, stories cast in the Ironic mode, of which Satire is the fictional form, gain their effects precisely by frustrating normal expectations about the kinds of resolutions provided by stories cast in other modes (Romance, Comedy, or Tragedy, as the case may be).”
Le romantique mode (la romance), utilisé par Michelet, est ainsi défini par White :
“The Romance is fundamentally a drama of self-identification symbolized by the hero's transcendence of the world of experience, his victory over it, and his final liberation from it... [...] It is a drama of the triumph of good over evil, of virtue over vice, of light over darkness, and of the ultimate transcendence of man over the world in which he was imprisoned by the Fall.”
Michelet, écrit White “fell back upon the mode of emplotment of the Romance as the narrative form to be used to make sense out of the historical process conceived as a struggle of essential virtue against a virulent, but ultimately transitory, vice.
As a narrator, Michelet used the tactics of the dualist. For him, there were really only two categories into which the individual entities inhabiting the historical field could be put. And, as in all dualistic systems of thought, there was no way in his historiographical theory for conceiving of the historical process as a dialectical or even incremental progress toward the desired goal. There was merely an interchange between the forces of vice and those of virtue—between tyranny and justice, hate and love, with occasional moments of conjunction, such as the first year of the French Revolution—to sustain his faith that a final unity of man with man, with nature, and with God is possible.”
White précise ce que Michelet entend par le « bien », la « vertu » ou la « lumière » :
“How the mode of Metaphor and the myth of Romance function in Michelet's historiography can be seen in his History of the French Revolution. His description of the spirit of France in the first year of the Revolution is a sequence of Metaphorical identifications that moves from its characterization as the emergence of light from darkness, to description of it as the triumph of the ''natural" impulse toward fraternity over the "artificial" forces which had long opposed it, and ends, finally, in the contemplation of it as a symbol of pure symbolization. France, he wrote, "advances courageously through that dark winter [of 1789-90], towards the wished-for spring which promises a new light to the world." But, Michelet asked, what is this "light"? It is no longer, he answered, that of "the vague love of liberty," but rather that of "the unity of the native land." (440) The people, "like children gone astray, . . . have at length found a mother" (441). With the breakup of the provincial estates in November, 1789, he averred, all divisions between man and man, man and woman, parent and child, rich and poor, aristocrat and commoner, are broken down. And what remains? "Fraternity has removed every obstacle, all the federations are about to confederate together, and union tends to unity.—No more federations! They are useless, only one now is necessary,—France; and it appears transfigured in the glory of July" (441-42).
La lumière, pour Michelet, c’est « l'unité de la patrie » :
« Rien de tout cela encore dans l'hiver de 1789. Ni municipalités régulières, ni départements. Point de lois, point d'autorité, aucune force publique. Tout va se dissoudre, ce semble, c'est l'espoir de l'aristocratie. . . Ah ! vous vouliez être libres ; voyez maintenant, jouissez de l’ordre que vous avez fait. . . — A cela que répond la France ? Dans ce moment redoutable, elle est sa loi à elle-même ; elle franchit sans secours, dans sa forte volonté, le passage d'un monde à l'autre, elle passe, sans trébucher, le pont étroit de l'abîme, elle passe, sans y regarder, elle ne voit que le but. Elle s'avance avec courage dans ce ténébreux hiver, vers le printemps désiré qui promet la lumière nouvelle.
Quelle lumière ? Ce n'est plus, comme en 1789, l'amour vague de la liberté. C'est un objet déterminé d'une forme fixe, arrêtée, qui mène toute la nation, qui transporte, enlève les cœurs ; à chaque pas que l’on fait, il apparaît plus ravissant, et la marche est plus rapide. . . Enfin l'ombre disparaît, le brouillard s'enfuit, la France voit distinctement ce qu'elle aimait, poursuivait sans le bien saisir encore : l'unité de la patrie.
Tout ce qu'on avait cru pénible, difficile, insurmontable, devient possible et facile. On se demandait comment s'accomplirait le sacrifice de la patrie provinciale, du sol natal, des souvenirs, des préjugés envieillis... [...] Rien de plus beau à voir que ce peuple avançant vers la lumière, sans loi, mais se donnant la main. Il avance, il n'agit pas, il n'a pas besoin d'agir ; il avance, c'est assez : la simple vue de ce mouvement immense fait tout reculer devant lui ; tout obstacle fuit, disparaît, toute résistance s'efface. Qui songerait à tenir contre cette pacifique et formidable apparition d'un grand peuple armé ?
Les fédérations de novembre brisent les États provinciaux, celles de janvier finissent la lutte des parlements, celles de février compriment les désordres et les pillages ; en mars, avril, s'organisent les masses qui étouffent en mai et juin les premières étincelles d'une guerre de religion, mai encore voit les fédérations militaires, le soldat redevenant citoyen, l'épée de la contre-révolution, sa dernière arme, brisée. . . Que reste-t-il ? La fraternité a aplani tout obstacle, toutes les fédérations vont se confédérer entre elles, l'union tend à l'unité. Plus de fédérations, elles sont inutiles, il n'en faut plus qu'une : la France. — Elle apparaît transfigurée dans la lumière de juillet. »
Comme Palmer et Soboul, Michelet passe sous silence le caractère impérialiste de la révolution.
Ce « drame du triomphe du bien sur le mal, de la vertu sur le vice, de la lumière sur les ténèbres » qu’est la romance est ce que la révolution française est, non seulement pour Michelet, mais pour les historiens libéraux et marxistes dans leur ensemble, qui ne s’accordent cependant que partiellement sur ce qu’est le bien et le mal, et sur qui le représente.
A propos des récits marxistes, Donald L. Donham constate, dans History, power, ideology: central issues in Marxism and anthropology :
“For, placed across irony, there is a romance in every Marxist story, a "romance” of oppositional consciousness and of future hope.”
Tous les récits eurocentriques, marxistes ou libéraux, sont des romances.
Un genre littéraire auquel certaines narrations historiques peuvent être rapprochées est l’épopée. En France, nombre d’écrivains ont tenté d’en écrire une qui puisse égaler en notoriété l’Énéide de Virgile, notamment Ronsard, avec la Franciade, et Voltaire, avec la Henriade.
White remarque à propos de l’épopée et de la Henriade :
“The Epic form, it was generally agreed, was not suited to the representation of historical events; and Voltaire's Henriade, an epic poem of the career of Henry IV, was generally regarded as a tour de force, a poetic triumph, though it was not to be taken seriously as a model to be emulated by either poets or historians in general.”
C’est en invoquant l’épopée, cependant, que Timothy Tackett rend compte du livre de Peter McPhee, Liberty or Death, révélant dans son compte rendu sa propre conception, similaire à celle de McPhee, de la révolution française :
“Liberty or Death recounts the epic story of a people struggling to give birth to the modern concepts of popular sovereignty, human rights, religious toleration, equality before the law, the abolition of slavery, and the beginnings of gender equality. Rejecting the facile and antiquated view equating the French Revolution with blood and violence, McPhee reveals a nation tragically swept up in waves of fear and suspicion engendered by the revolutionary process itself and by the violence of the groups and foreign powers who sought to destroy all such transformations. It is a masterful synthesis by one of the world’s greatest specialists of the French Revolution.”
Un compte rendu semblable du même livre est fait par Michael Rapport :
“This broader narrative is driven forward by the Revolution as a struggle, against overwhelming odds, of the revolutionaries to establish a political and social system based on the sovereignty of the people, civil equality, the abolition of privilege and seigneurialism (and, from 1794, of slavery), the separation of church and state and a (very mild) degree of women’s emancipation (in the shape of a liberal divorce law and equality of inheritance).”
Tandis que Tackett évoque « l’histoire épique d’un peuple qui lutte pour donner naissance aux concepts modernes de souveraineté populaire, de droits de l’homme », etc., mettant donc en avant le « peuple », Rapport voit cette même lutte menée par les « révolutionnaires ».
Tackett et Rapport passent cependant également tous deux sous silence le caractère impérialiste de la révolution française. L’abolition de l’esclavage est attribuée aux Français, sans mention des noirs eux-mêmes et de leur lutte contre les armées françaises.
Micah Alpaugh, dans son propre compte rendu du livre de McPhee, en constate le caractère francocentrique : “Though making several nods towards the revolutions occurring in France’s overseas colonies, McPhee’s treatment of the Haitian Revolution is largely restricted to its effects upon European France.”
Un autre historien, Hervé Leuwers, dans son Robespierre, traite le sujet de l’abolition de l’esclavage en moins de deux lignes, attribuant cette abolition aux députés français :
« Dans les premiers jours de février, Robespierre se tient en retrait des Jacobins et de la Convention. Alors que les députés abolissent l'esclavage (4 février-16 pluviôse an II), dont il a plusieurs fois rejeté la légitimité, il met la dernière main à son rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider l’Assemblée dans l’administration intérieure de la République. »
C’est la même « histoire émancipatrice » évoquée par Marlene Daut que l’on rencontre et continue de rencontrer chez la plupart des historiens, la même romance relevée par Hayden White chez Michelet, une « histoire émancipatrice », ou romance, qui occulte le caractère impérialiste de la révolution française.
Manuel Covo et Megan Maruschke pouvaient donc faire en 2021 le constat pertinent suivant, dans la présentation de The French Revolution as an Imperial Revolution :
“Attempts to reframe the Age of Revolutions as imperial in nature have not fully integrated the French Revolution.” (« L'effort historiographique consistant à placer l’ère des révolutions dans leur contexte impérial n'est pas encore parvenu à pleinement intégrer la Révolution française. »)
Ce qui manque dans le constat de Covo et Maruschke, c’est l’explication du fait rapporté.