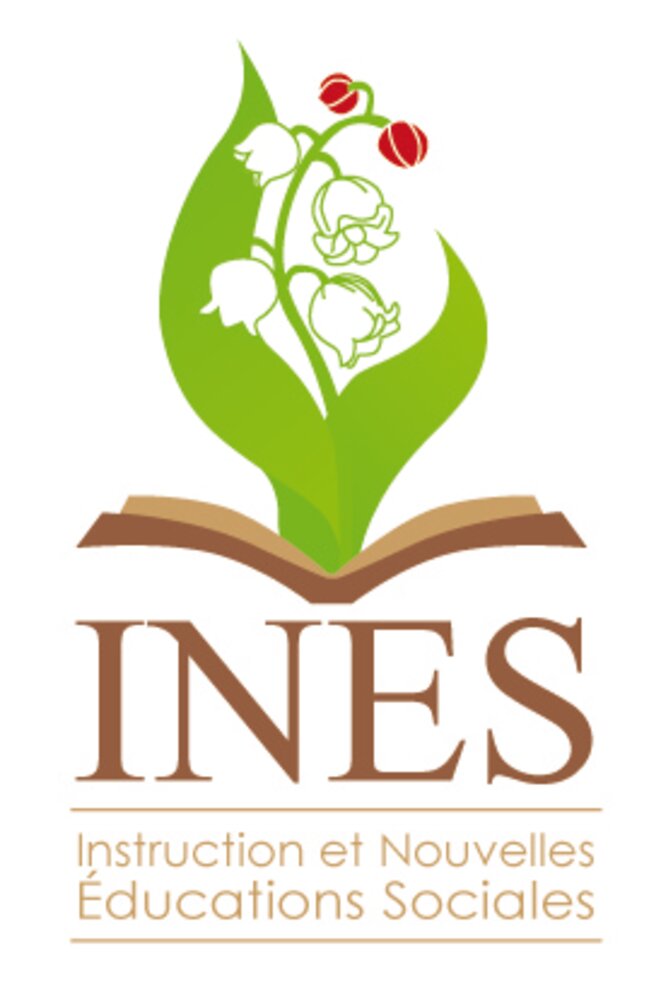La loi "pour une école de la confiance" fut élaborée en dehors de toute concertation avec la communauté éducative. Avec le pointillisme qui a caractérisé son projet pour l'école, le ministre Blanquer insérera dans ce texte "fourre tout" les touches nécessaires à la mise à mort de l'instruction en famille (#IEF) ; deux ans plus tard, le volet éducatif de la loi visant à Conforter le Respect des Principes de la République achèvera le dessein de révoquer, à leurs corps défendant, les parents instructeurs.
Quelles mesures ont permis, lorsqu'est évoqué l'intérêt supérieur de l'enfant dans notre pays, que les décisions de l'administration de l'éducation nationale soient désormais plus "légales" que celles des parents ?
Visite guidée :
Articles 11 à 18 - L'abaissement de l'âge d'instruction obligatoire place le tout petit en position d'élève dont les performances doivent être évaluées.
Notons que cette "primarisation" de la maternelle se réalise au détriment des objectifs d’éducation et de socialisation spécifiquement nécessaires aux enfants les plus éloignés de la "culture scolaire". Pourtant cette injonction à évaluation, calibrée en urgence, a posteriori de la promulgation de la loi, est portée par des éléments de langage progressistes : l'individuation des curriculum d'apprentissages, brique indispensable de la construction de l'école inclusive voulue par les articles 19 à 24.
Mais cette injonction s'est heurtée, dans le cycle 1 plus concrètement encore que dans les suivants, à celle de structurer une planification des apprentissages, occasionnant ainsi des dilemmes déjà documentés.
Dans le même temps politique, cette loi enjoignait les enseignants à la docilité : si l’article 1 semblait ne rien changer juridiquement, il a représenté un message d’intimidation envoyé à la communauté éducative pour la décourager de toute critique envers son administration. Les dispositions de ce texte prévoyant l'habilitation du gouvernement à décider ou modifier, par voie d'ordonnances, le Code de l'éducation, font d'ailleurs pléthore.
La combinaison d'injonctions contradictoires et d'intimidation a créé un terrain favorable à la mise en place, à l'école comme lors des entretiens pédagogiques annuels en IEF, d'exercices-types calibrés, effectués à un instant T et selon « la chronométrie scolaire » : « Ces conceptions conduisent à penser les apprentissages scolaires en fonction de temps de passage (le trimestre, le semestre, l’année scolaire) à partir desquels les performances sont jugées et les élèves classés comme étant à l’heure (donc « normaux »), en avance (donc « précoces ») ou en retard (donc « en échec ») » 1. Ce type d'évaluation est inapte à rendre compte de la situation propre de l'apprenant, mais est surtout de nature à exercer des pressions qui nuisent aux apprentissages : "quel que soit le niveau de classe, les élèves poursuivant un but de maîtrise obtiennent une meilleure performance en mathématiques que les élèves orientés vers un but de performance, en raison de leur moindre niveau de stress et d’une estime de soi amplifiée". Ces évaluations font donc porter à des enfants de 3 ans - qu'ils soient instruits à l'école ou en famille - des contraintes pédagogiquement infondées.
De quoi neutraliser in concreto la mythologie de bienveillance et de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant : malgré circulaires et vade-mecum, on assiste sur le terrain à l'identification de l'administration de l'éducation nationale à un tiers extérieur agresseur et harceleur. On pourrait rechercher dans ces erreurs majeures les liens statistiques avec les constats posés en mars dernier par le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l'âge (HCFEA).
L'article 11 a fortement impacté le nombre de déclarations d'instruction en famille : si les rapports DGESCO 2018-2019 présentaient 19 000 enfants entre 6 et 16 ans instruits en famille hors CNED, ceux de 2019-2020 en dénombraient 31 000, dont plus de 11 000 enfants entre 3 et 6 ans. Une augmentation purement liée au comptage, qui servit pourtant de base pour installer l'idée d'une « inquiétante augmentation exponentielle de l'instruction en famille ». Cette peur fut mobilisée quelques mois plus tard par l'étude d'impact de la loi CRPR, dont l'article 21 sera décrit comme une mesure s’inscrivant « dans la continuité de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, notamment son article qui a étendu l’instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à seize ans ».
La haute administration évita bien sûr de publier ces rapports avant que l'exécutif soit assuré de casser le thermomètre de la loi « école de la confiance »: sur 26 000 enfants attendus sur les bancs des écoles, seuls 15 000 auront été confiés « de plein gré » à une institution malade, par des parents destinés à une forme d'incompétence éducative dans la parole publique.
« En même temps », les articles 43 à 47 déroulaient la nouvelle organisation de la formation des enseignants, qui aboutit à ce que les trois objectifs du stagiaire - réussir le concours, réaliser un mémoire de recherche, s’adapter au métier - soient en concurrence (le premier objectif l’emportant inévitablement sur les deux autres). Comme en 2008 – les mêmes causes produisant les mêmes effets – en destructurant le dispositif d’insertion dans le métier, cette disposition accentue encore la crise de recrutement.
On a ainsi vu cette année des académies se lancer dans un mouvement schizophrène, assumant de mener en même temps :
- des job dating pour recruter des vacataires non formés à mettre dans les classes,
- des refus de scolarisation pour certains enfants, faute de classe pour les accueillir,
- et des injonctions à mettre fin à l'IEF pour d'autres, pourtant issus d'une fratrie évaluée positivement depuis des années.
Ici encore, il faut prendre quelques pas de recul pour observer l'œuvre : la destruction méthodique de l'école qui met à mal le contrat social. Et si certains parents pourront aisément mobiliser les moyens des alternatives permettant de pallier cette rupture de contrat, d'autres, dont nous faisons partie, seront faits comme des rats, assignés à l'impuissance vis-à-vis de leur responsabilité première : celle d'assurer protection et éducation optimales à leurs enfants.
Dans une population où la prise en charge de l'instruction en famille est majoritairement assumée par les femmes, on peut légitimement se demander si n'est pas ici à l'œuvre, une fois de plus, ce que C. Froidevaux-Metterie expose à partir de ses recherches : l'exclusion des femmes de la modernité démocratique (leur exclusion même de la philosophie politique), et la façon dont les penseurs modernes se réapproprient sans aucun complexe l'ancien schème patriarcal 2.
Nos observations du bilan de la loi pour une école de la confiance et de son annexe (article 49 de la loi visant à Conforter le Respect des Principes de la République) nous mettent naturellement en opposition au nouveau cadre global posé sur l'éducation : l'instruction en famille, tout comme l'outil d'émancipation que devrait être l'école, a besoin d'être réfléchi et co-construit par et pour les acteurs de la communauté éducative.
Pour en finir avec l'école 3 "de la méritocratie, outil de reproduction de l’élite. Pour que les dominés socialement ne deviennent plus des vaincus scolairement. Pour définir avec la communauté éducative les objectifs sociaux de l’école obligatoire" … Il serait nécessaire d'entendre les besoins réels de la société civile et de prendre en compte les préconisations portées par les corps intermédiaires jusqu'aux législateurs.
1 L’école des incapables. La maternelle, un apprentissage de la domination, Mathias Millet et Jean-Claude Croizet, éd. La Dispute, 2016
2 Pleine et douce, C. Froidevaux-Metterie, éd. Sabine Wespieser, 2023
3 En finir avec l’école : Un projet de société émancipateur, Prune Helfter-Noah, éd. Le Hêtre Myriadis, 2023