
Agrandissement : Illustration 1

Isabelle Chemin, professeure documentaliste : Amadou Elimane Kane, vous êtes écrivain poète sénégalais et en même temps enseignant et penseur dans le domaine des sciences cognitives. Vous travaillez en France, notamment sur la métacognition ou comment apprendre à apprendre. Vous êtes l’innovateur de la pédagogie qui s’appelle Ubuntu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes parvenu à élaborer cette pédagogie innovante ?
Amadou Elimane Kane : Je voudrais d’abord partager cette parole qui me tient à cœur, “ En faisant scintiller nos lumières, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant”, une pensée de Nelson Mandela. Et c’est vraiment cette parole que je veux transmettre et que je destine à la jeunesse, aux parents et aux enseignants, celle de toujours croire en l'éducabilité cognitive, de savoir que tout s’apprend, que tout le monde est capable de et que tout réside dans le travail. Je me souviens de cet instituteur qui n’était pas très pédagogue et très violent avec moi, car, à cette période de l’école primaire, j’avais des problèmes de vue, je ne voyais ni de près, ni de loin mais cela n’avait pas été diagnostiqué. J’avais donc des troubles du comportement, je provoquais et je m’opposais aux adultes. Cet instituteur m'avait décrété mauvais élève alors qu’en réalité, le problème était ailleurs et uniquement lié à mes problèmes de vue. Cette difficulté a parasité mon cycle primaire, alors que je n’avais aucun problème cognitif ni de compréhension. Il est tellement facile de dire que quelqu’un n’est pas capable alors qu’il est difficile de chercher à comprendre les obstacles des uns et des autres et d’installer les élèves dans la progression et la co-construction. J’ai compris que j’avais un réel handicap car, en réalité, je suis non voyant de l'œil gauche. Personne ne le sait, ni mes proches, ni mes enfants, ni ma famille et je profite de cette interview pour le dire. Pendant longtemps, je me suis adapté par rapport à ma situation de non voyant de l'œil gauche et j’ai mis en place des stratégies pour compenser cet handicap, en adaptant en permanence mon champ visuel. Durant l’enfance, j’ai même joué au football, et personne ne pouvait soupçonner mon handicap car je me démenais sur le terrain. Comme j’ai aussi des problèmes de motricité depuis l’enfance, j’ai toujours pensé que c’était lié au fait que je suis un gaucher contrarié mais finalement, c’est seulement parce que très jeune j’étais déjà malvoyant de cet œil gauche. J’ai dû travailler quatre fois plus pour surmonter cet handicap, car comme tout un chacun, on ne veut pas être stigmatisé, on veut pouvoir faire comme les autres. J’ai fourni des efforts colossaux pour parvenir à apprendre. Arrivé en France, j’ai été diagnostiqué de mal voyant à l'œil gauche mais je n’ai jamais voulu le dire à qui que ce soit. Aujourd'hui, à soixante-six ans, je peux dire que cette infirmité est réelle pour moi. Je n’ai jamais voulu m'apitoyer sur mon sort et être dans les gémissements mais aujourd'hui, moment où je n’ai plus rien à prouver, je peux révéler que je suis non voyant de l'œil gauche et ce depuis ma plus tendre enfance. C’est pour cela que je pense qu’il faut toujours faire attention avant de plaquer un diagnostic sur le profil d’un élève. Il faut savoir écouter et être très attentif à toutes les manifestations des apprenants qui peuvent révéler un trouble ou un handicap.
Par la suite, j’ai heureusement eu la chance de rencontrer des enseignants qui m’ont porté et soutenu. Je veux léguer cette attitude d’éducabilité cognitive afin de pouvoir faire scintiller les savoirs, toutes les manières d’apprendre, dans un espace de communion, de beauté et d’harmonie. Depuis ma terre natale, de l’école de Dagana 1 au Sénégal, en passant par Boghé et Podor où j’ai suivi l’école coranique et l’école française, puis par l’université Paris X de Nanterre, par le Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, puis par l’Ecole Normale mixte d’Etiolles de Soisy-sur-Seine et enfin par le collège de France en auditeur libre, je peux dire que j’ai mis à terre tous les préjugés à mon endroit, j’ai fait disparaître le plafond de verre. Je veux dire à la jeunesse que tout est possible quand on habite des convictions et qu’on aime le savoir. Le savoir ne se décrète pas, il se construit pas à pas, avec beaucoup de travail en trouvant son propre rythme. Il ne faut jamais tomber dans le piège de ceux qui veulent nier nos capacités car tout le monde peut embrasser les apprentissages. Depuis plusieurs décennies, je fais du corps à corps avec le système éducatif français où j’ai été en contact avec toutes sortes de pédagogie et à tous les niveaux dans ma formation d’enseignant. Donc, je travaille, depuis trente ans, sur le système cognitif pour continuer à enseigner de manière innovante. C’est ce que je nomme la pédagogie Ubuntu qui est une référence directe à la culture africaine. J’ai abordé cette question dans un ouvrage de pédagogie, avec une expérience menée sur le terrain scolaire, qui s’intitule Enseigner la justice cognitive par la poésie et l’oralité où j’évoque déjà, de manière explicite, la différenciation de la pédagogie Ubuntu. Cette manière de procéder tient compte du circulaire où le savoir, les savoirs endogènes, sont mis au centre pour favoriser la pluralité des manières procédurales, toujours dans l’exigence, l’écoute et l’équité cognitive afin de permettre aux apprenants d’être dans un processus d’apprentissage. Le va-et-vient est permanent et il n’existe pas de hiérarchie, ni de statut de supériorité. Ici la verticalité enseignant/enseigné s’efface.
Par ailleurs, la méthode Ubuntu a toujours été en arrière plan de mon écriture et de mes publications car écrire est un exercice solitaire. Et dans tous mes livres, quel que soit le genre, je donne la parole à des auteurs pour rédiger les para-textes, préfaces, liminaires, postfaces ou après-dire, car ça me semble fondamental de favoriser le dialogue textuel. C’est un des éléments qui me passionne dans l’écriture, c’est la richesse des échanges que la littérature procure. C’est pour cela que je peux dire que la pédagogie Ubuntu est toujours dans mon arrière-pays mental. Ça se vérifie également par l’existence de l’Institut Culturel Panafricain et de recherches que j’ai fondé à Yene au Sénégal et par celle de la Case de recherche en lecture écriture, association fondée en région parisienne et labellisée par l’académie de Paris, des espaces où j’invite toujours des écrivains, des enseignants, des artistes, des chercheurs pour que l’on puisse ensemble réfléchir à des actions culturelles en faveur de la connaissance et toujours dans la démarche unitaire Ubuntu.
Isabelle Chemin, professeure documentaliste : Pourquoi pensez-vous que cette méthode pédagogique est plus adaptée au système scolaire que les autres procédés ?
Amadou Elimane Kane : À mon sens, il nous faut sortir du système éducatif classique qui est orienté vers la rentabilité et une idéologie tournée vers le profit au mépris des uns et des autres et qui exclut toute différenciation cognitive. C’est un dogmatisme que je considère très autoritaire et qui est issu des sociétés où est valorisée la pensée unique. Or, il existe d’autres manières d’enseigner. Je m’inspire et je puise dans un certain nombre de valeurs africaines, sociales, philosophiques et éducatives qui sont à l’opposé de la transmission unilatérale. L’individualisme concurrentiel s’efface et le scintillement de chacun permet à l’ensemble d’exister dans l’harmonie pour l’acquisition des savoirs. Ces valeurs possèdent en elles-mêmes les notions d’équité et d’écoute. On peut prendre pour exemple les valeurs de la Charte du Mandé qui date de 1236 et qui stipule qu’aucune vie n’est supérieure à une autre vie. Il existe aussi les recommandations de Ceerno Sileymaani Baal et d’Abdoul Kader Kane, qui, après la révolution des Torodos au Fouta Toro, une région située en partie dans l’actuel Sénégal et dans l’actuelle Mauritanie, ont fondé L’Almaamiyat (1776-1890), une constitution basée sur des grands principes de justice pour tous et dont le texte dit que le peuple est protégé de la dépendance, de l’esclavage, de l’injustice et de l’asservissement. D’ailleurs, parmi ces révolutionnaires, je peux aussi évoquer Elimane Boubacar Kane qui est mon ancêtre tant du côté maternel que du côté paternel. On peut aussi s’appuyer sur les valeurs du Pulakuu, des principes de dignité et d’égalité, d’amour du savoir, de la patience, de la maîtrise de soi, d’équité cognitive où l’humain est au centre, des valeurs du monde peul que l’on retrouve un peu partout sur le continent africain. Ces valeurs ont une portée universelle et poétique qui s’oppose au prosaïque des sociétés de consommation. Quand je dis prosaïque, je veux dire ce qui est banal, commun, bassement matériel ou vulgaire et par extension qui manque de distinction, d’idéal, de fantaisie, de sensibilité.
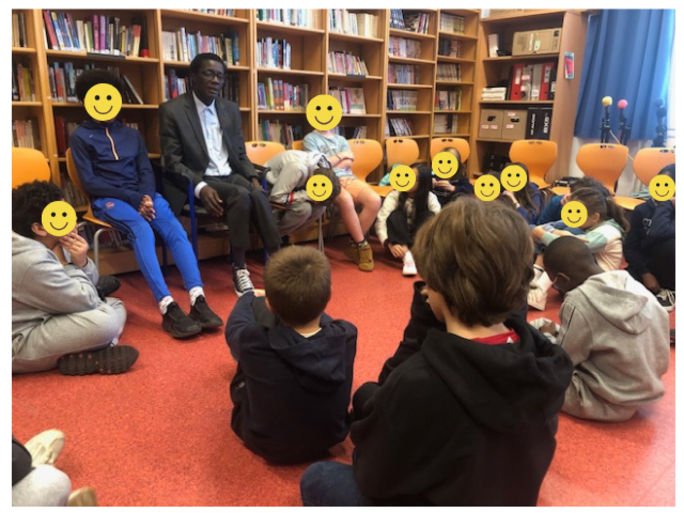
Agrandissement : Illustration 2

Isabelle Chemin, professeure documentaliste : Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à construire votre propre méthode d’enseignement et à partir de quels constats ?
Amadou Elimane Kane : Cette méthode s’est imposée à moi assez vite car j’ai eu la chance, dans mon enseignement, de rencontrer tous les cycles scolaires, de la maternelle à l’université.
Je suis très ému de parler de moi, car parler de soi dans mon éducation revient à être vaniteux et j’ai toujours préféré être dans l’action. Mais je choisis de parler de mon parcours aujourd’hui car l’information qui est à notre disposition, pléthorique d’ailleurs, est trop souvent dévoyée et déformée, par l’utilisation ininterrompue des réseaux sociaux notamment et par des gens de mauvaise volonté qui racontent des mensonges et déforment la réalité de nos parcours. Donc, là, je vous donne la primeur de mon parcours professionnel pédagogique par le biais de cette interview. J’ai d’abord été instituteur suppléant où j’ai eu, pendant toute cette formation, des visites tous les quinze jours avec des conseillers pédagogiques qui remettaient en question mes propositions pédagogiques et c’était vraiment enrichissant car c’étaient de véritables échanges sur comment améliorer la transmission pédagogique. Je me souviens d’ailleurs d’une conseillère pédagogique de l’Inspection académique de l’Essonne qui s’appelait Annie Jardinier qui m’a beaucoup apporté et soutenu dans ma formation pédagogique. Ainsi, j’ai pu vivre pleinement l’action et la théorie pédagogiques pour me forger une identité d’enseignant pédagogue pendant plusieurs années.
Ensuite, j’ai passé le concours interne pour obtenir le diplôme d’instituteur à l’Ecole normale mixte de l’Essonne Etiolles, 91450 à Soisy-Sur-Seine, qui était, à l’époque, une formation très prestigieuse et très solide et dont les conditions d’admission étaient très sélectives. C’est à ce moment-là que j’ai proposé une séquence qui s’articule autour de la poésie ou comment faire accéder les apprenants à la lecture à partir de la poésie. Très vite, j’ai eu la conviction que la poésie portée par l’oralité pouvait apporter quelque chose de novateur et faire bouger les lignes.
Parallèlement, j’ai obtenu un Certificat d’Aptitude aux Actions Pédagogiques et d’intégration scolaires, l'unité spécialisation 2, option F, qui m’a permis d’enseigner également dans les collèges et les lycées pour transmettre à des apprenants en difficulté massive et de les faire progresser dans leurs apprentissages. J’ai également obtenu un Certificat d’Aptitude Pédagogique Appropriée à l'Enseignement Supérieur (CAPAES). J’ai donc enseigné plusieurs années dans les Établissements Régionaux d'Enseignement Adapté et plus précisément dans l’un d’eux qui se situe à Montgeron dans le département de l'Essonne, car je dépendais de l’inspection de l'Essonne qui se trouve dans l’académie de Versailles. J’ai donc enseigné en EREA à des élèves déficients visuels notamment, mais qui ne présentaient pas de problèmes cognitifs particuliers. C’étaient des élèves de presque tous les niveaux, de la primaire à la troisième du collège. Dans ce type d’établissement, les enseignements ne sont pas cloisonnés car les enseignants ont été formés et détiennent un Certificat d’Aptitude et d’Intégration Pédagogique. D’une année à une autre, je pouvais être professeur de mathématiques et l‘année suivante professeur de littérature et de biologie, ce qui m’obligeait à reprendre toujours mes fondamentaux. J’ai aussi été enseignant dans des Sections d'Enseignement général et professionnel adapté qui accueillent des apprenants de la sixième à la troisième du collège pour des élèves présentant des difficultés scolaires importantes sans défaillances cognitives mais seulement des difficultés d'apprentissage. Il fallait que j’adapte en permanence mon enseignement aux besoins particuliers de ces apprenants. Voilà, c’est dans ce contexte, et pendant une bonne décennie que j’ai été formé et où j’ai appris à mettre en place ce que j'appelle aujourd’hui la pédagogie Ubuntu. Dans mon parcours professionnel de professeur, j’ai pu ainsi alterner différentes disciplines, la littérature, les mathématiques, les arts plastiques ou encore la biologie. Voilà ce qui fait que je me suis forgé dans l’humilité et moi-même dans l’apprentissage car enseigner de cette manière nous oblige à remédier à nos pratiques. Par exemple, l’année où j’enseignais les mathématiques, il fallait que je reprenne tous les rudiments du programme et l’année suivante, je pouvais reprendre toutes les bases de l'enseignement de la littérature ou des sciences. Ce qui m’obligeait à être constamment dans la construction pédagogique et la recherche pour enseigner de la meilleure manière qui soit pour ces élèves à besoins spécifiques.
J’ai également obtenu un Diplôme d’études supérieures spécialisées de troisième cycle option sociologie du travail au Conservatoire national des Arts et Métiers de Paris. De plus, pendant cinq ans, j’ai suivi des cours de sciences cognitives, d’anthropologie, de biologie, de littérature et de mathématiques appliquées aux sciences sociales au Collège de France, en auditeur libre, pour renforcer tous mes outils en tant qu’enseignant pédagogue. Ce qui m’a permis à la fois d’avoir des outils théoriques, tout en étant sur le terrain scolaire. Et comme je suis viscéralement poète, j’ai choisi d’articuler la pédagogie à la poésie. Je suis de ceux qui pensent aussi qu'être chercheur ne se décrète pas, tout s’élabore, tout se construit petit à petit pour avoir une identité de chercheur, pour savoir manipuler des concepts, les faire, les défaire pendant plusieurs décennies afin de pouvoir aboutir à la scientificité du domaine, en l’occurrence ici à la pédagogie Ubuntu.
Je suis vraiment parti de rien. Cependant, j’ai toujours eu soif de connaissance, d’apprendre pour renforcer mes pratiques pédagogiques. Je suis toujours dans l’apprentissage, en quête de connaissance, en quête de savoir. La lecture est au centre de ma vie et par ailleurs, j’ai toujours habité cette trilogie, la connaissance et l’estime de soi et la confiance en soi.
J’ai alors réfléchi à la fois aux contenus proposés autour des apprentissages, en m’assurant de toujours mettre en avant la connaissance plurielle et les contributions culturelles multiples pour valoriser toutes les diversités humaines mais aussi je me suis questionné sur les méthodes d’apprentissage pour mettre en place une autre façon de faire qui répondait davantage aux besoins des élèves, la différenciation, l’écoute et la construction commune. Cela m’a permis de rencontrer une plus grande adhésion culturelle, en restant tourné vers l’universel, en respectant l’équité cognitive et le principe de l’oralité comme outil d’apprentissage. Selon moi, le système pédagogique de manière général ne prend pas en compte l'altérité des cultures qui pourtant incarnent un cheminement particulier tout en rassemblant sur des significations communes. Et en ma qualité de poète écrivain, j’ai donc fait le lien entre enseignement, poésie et oralité.
En reprenant, de manière théorique, les concepts existants dans le domaine de la pédagogie active, de la méta-cognition et de la psychologie culturelle, j’ai commencé à utiliser la pédagogie Ubuntu comme un nouveau modèle qui a mis en lumière les fonctions collaboratives dans le domaine du dialogue cognitif à travers l’oralité.
Cela m’a permis de faire valider une combinaison pédagogique qui, selon moi, entraîne une rupture épistémologique avec nos pratiques, souvent calquées sur un modèle unilatéral, qui ne correspondent pas à notre mode de pensée. Cela enferme les apprenants et nous empêche, en tant qu’enseignant, d'assumer nos capacités à concevoir des modèles pour enseigner. Cette méthodologie de la pédagogie Ubuntu permet de poser sur la table de l’universel un principe innovant en se démarquant et en offrant de nouveaux outils de compréhension de nos propres savoirs et de la manière dont nous devons les transmettre.
Isabelle Chemin, professeure documentaliste : Pouvez-vous nous expliquer maintenant en quoi consiste la pédagogie Ubuntu dont vous avez créé le principe ?
Amadou Elimane Kane : Les chercheurs en sciences de l’éducation classent habituellement les diverses pédagogies en trois ou quatre types, avec toujours les mêmes cinq éléments : l'apprenant, l'enseignant, le savoir, la communication, la situation, le tout ordonné vers une finalité (instruire ou éduquer, former, du côté du maître ; apprendre ou se socialiser, s'épanouir, s'autonomiser, du côté de l'élève). Selon moi, il existe un sixième élément, celui que j'appelle l’équité cognitive et l’oralité comme outil d'apprentissage, qui est un nouvel apport en matière de pédagogie universelle, c’est-à-dire la pédagogie Ubuntu.
La pédagogie Ubuntu est un ensemble de valeurs éducatives en rupture avec les méthodes pédagogiques unilatérales. La pédagogie Ubuntu est une manière pédagogique où le groupe travaille, co-construit et progresse dans le principe de l’équité cognitive. La verticalité du binôme enseignant/enseigné ne règne plus sur le groupe. Chaque apprenant existe parce que l’autre existe et grâce à ce que nous sommes. Nous plaçons au centre l’éducabilité et l’équité cognitives pour faire coexister les trajectoires et faire partager et transmettre la pluralité des savoirs. Le scintillement de chacun permet à l'ensemble de faire jaillir nos objectifs communs et de favoriser les principes d’apprendre à apprendre pour l’appropriation des savoirs et des manières procédurales plurielles afin de bâtir un environnement où l’émulation poétique, à la fois individuelle et collective, remplace le prosaïque et la compétition, tout en faisant disparaître une certaine vision suprémaciste pour concevoir et élaborer une conjugaison universelle qui favorise le dialogue, l'épanouissement des apprenants et l’harmonie du groupe. Voilà la manière dont j’ai élaborée, conçue et définie la pédagogie Ubuntu.
Je pense que pour opérer de véritables changements dans notre monde, il est nécessaire de former les jeunes par le biais de la pédagogie Ubuntu car cela nous permet de sortir des mécanismes du profit et de la compétition qui ont tendance à prendre le pas sur les valeurs fondatrices des civilisations, qui sont celles de l’équité cognitive et du dialogue. Et cela concerne tous les êtres, qu’elles que soient les origines ou les appartenances, les capacités cognitives, pour les élèves à besoins particuliers par exemple, car cette méthode s’inscrit dans un humanisme universel. Cela permet d’installer les apprenants dans un processus actif et permanent pour s’approprier les savoirs. Car le savoir n’est pas figé, il n’est pas réservé à une seule élite, il est mouvement, il n’est pas cloisonné et il doit se conquérir de partout où l’on se trouve et partout où il se trouve dans l’univers. C’est en cela que la pédagogie Ubuntu est transversale car elle peut traverser toutes les disciplines scolaires, d’où l’importance de cette méthode, de ce paradigme novateur.
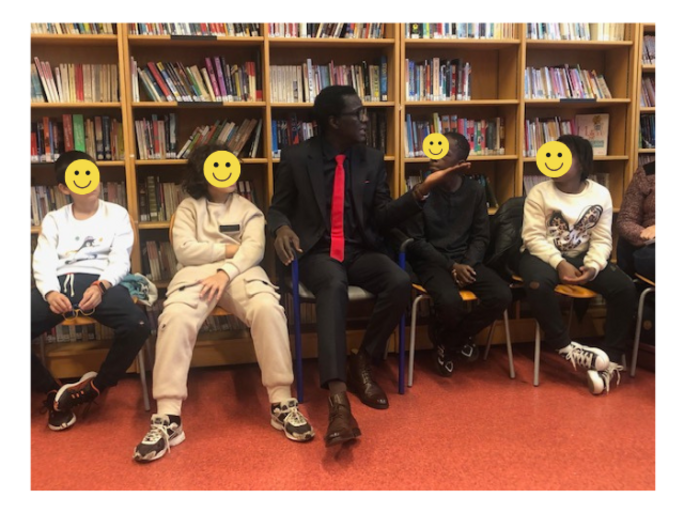
Agrandissement : Illustration 3
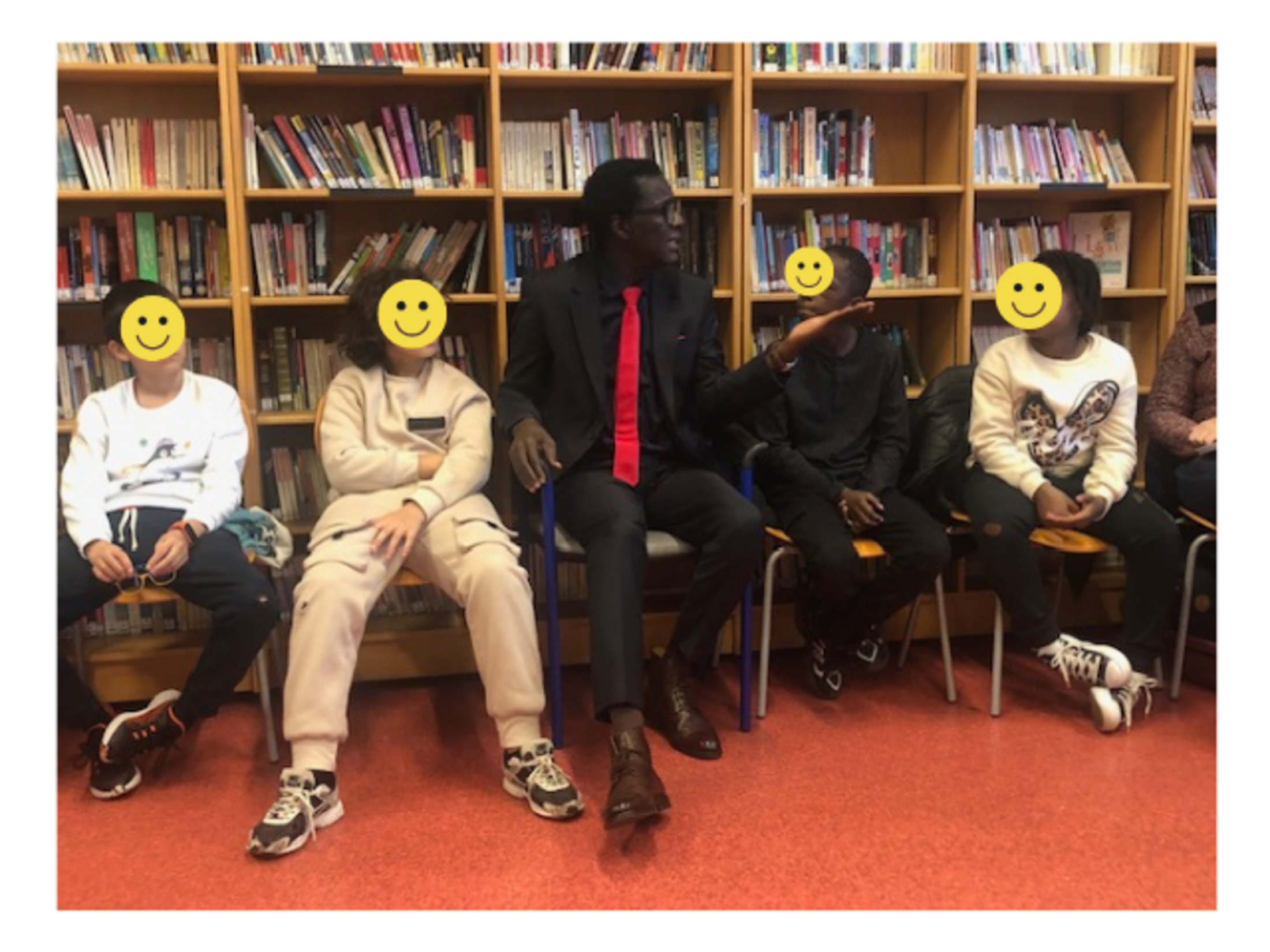
Isabelle Chemin, professeure documentaliste : Depuis combien de temps enseignez-vous en utilisant la pédagogie Ubuntu ?
Amadou Elimane Kane : La pédagogie Ubuntu est une méthode que j’applique sur le terrain scolaire depuis trente ans. Je l’ai d’abord expérimentée au sein de l’académie de Versailles, puis de l’académie de Créteil et enfin au sein de l’académie de Paris. Ce dispositif pédagogique que je propose depuis plusieurs années a été reconnu, soutenu et rendu visible par Madame Sophie Fouace, Inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale (IA-IPR) de l’académie de Paris, sur la période de 2013 à 2016, car elle m’a permis de présenter cette méthode pédagogique, de manière scientifique, auprès des mes pairs, c’est-à-dire, les inspecteurs, les enseignants de lettres, les professeurs documentalistes et les étudiants en master Métiers de l’enseignement et de l’éducation et du professorat de l’académie de Paris. Une vidéo a même été réalisée en classe lors de mes interventions avec les élèves et les enseignants par la Direction des Services Informatiques, à la demande de l’inspection de l’académie de Paris. En 2014, nous avons fait une table ronde à la Bibliothèque Nationale de France avec les enseignants qui participaient au dispositif, Michel Assedo, professeur de français, vous-même, professeure documentaliste et Gwénaële Guillerm, professeure documentaliste et fondatrice de Radio Clype. La même année, nous avons fait une présentation de ce travail, avec les enseignants du premier degré pour assurer la liaison inter-niveau, à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Paris Batignolles où il y avait un parterre d’inspecteurs, d'enseignants et d'étudiants en master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et du professorat .
J’ai également été l’invité d’honneur lors du 18e Temps des Poètes de l’académie de la Guadeloupe du 13 au 17 mars 2017, sous l’égide de Claude Rivier, délégué à l’Action Académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle. Lors de cet événement, j’ai présenté mon travail, à la fois en tant que poète et en tant qu’enseignant, auprès des acteurs pédagogiques et des professeurs de l’académie de la Guadeloupe.
Lors d’une résidence artistique et culturelle que j’ai menée en 2019 au collège Charles Péguy, le projet Dire le monde en poésie a été sélectionné et nominé pour le Prix de l’innovation pédagogique décerné par le Ministère de l’éducation nationale en France. En 2022, cette méthode a aussi été récompensée par le Prix du Poète pédagogue, qui m'a été décerné par les équipes pédagogiques de l’école du Général Lasalle et du collège Charles Péguy dans le 19ème arrondissement de Paris. En 2023, le projet L’oralité : un langage transversal et citoyen a été labellisé et reconnu par le Conseil national de la rénovation et le Fonds d’innovation pédagogique du ministère de l'Éducation nationale en France.
Tout en continuant de développer cette théorie cognitive, j’ai mené plusieurs projets en l’appliquant sur le terrain de l’enseignement et en tant qu’écrivain poète. Je mène ces rencontres en ayant deux postures, celle du poète et celle de l’enseignant, à la fois pour les élèves mais également pour les professeurs à qui je conseille cette méthode. Ces expériences innovantes ont été successivement publiées dans sept de mes livres consacrés à la pédagogie de 2013 à 2024.
Aujourd’hui, je voudrais humblement laisser cet enseignement à la postérité et que cela serve aux générations enseignantes futures. Comme je l’ai déjà dit, je suis parti de rien, avant d'explorer ce qui existait dans les domaines scientifiques et pédagogiques pour l’adapter à ma conception de l'enseignement, proposant un nouveau paradigme et en opérant des ruptures épistémologiques. J’ai beaucoup travaillé, sans compter mon temps car j’avais une vraie soif de savoirs. J’ai vécu intensément l’abnégation pour accéder à tout ça mais je suis très heureux de l’avoir réalisé car j’ai tellement appris au contact des apprenants et des enseignants.

Agrandissement : Illustration 4

Isabelle Chemin, professeure documentaliste : En 2006, pour valider mon mémoire professionnel du CAPES de professeur documentaliste, je me suis appuyée sur vos travaux autour de la poésie et de l’oralité pour approfondir la problématique de la médiation culturelle au CDI pour des élèves en difficulté d’apprentissage, et je dois dire que cela été une expérience très riche. Cela m’a permis de valider brillamment mon année de formation et de me créer une vraie identité professionnelle, tout en continuant à enrichir mes pratiques et à découvrir à chaque fois de nouvelles choses avec les apprenants. Cela a été, et continue d’être, une expérience véritablement passionnante et enrichissante, ce qui me conduit, presque chaque année, à travailler avec vous au moyen de votre méthode car je me suis rendue compte de tout le bénéfice que cela apporte à nos élèves dans un cadre qui pose les bases du collectif.
Amadou Elimane Kane : Cela me permet de vous dire merci de m’avoir fait confiance et que vous ayez eu la perception que vous deviez vous inscrire dans le temps au moyen de la poésie et de l’oralité. C’est toujours un plaisir de venir travailler avec une équipe pédagogique impliquée et qui a à cœur le développement cognitif de ses élèves. Alors, je ne peux que vous féliciter pour tout ce que vous faites.
Isabelle Chemin, professeure documentaliste : Merci à vous aussi ! Est-ce que vous pensez justement que cette méthode pédagogique innovante peut faire des émules et enclencher une prise de conscience au niveau des systèmes éducatifs en général ?
Amadou Elimane Kane : Écoutez, je l’espère et c’est même un des objectifs principaux. Pour cette rentrée 2025, le programme de français de 6e au niveau national semble évoluer dans ce sens. C’est en discutant avec Michel Assedo, qui est professeur de français au collège et avec qui je travaille cette année sur le récit d’Afrique autour du conte et de l’oralité, qui me l’a fait remarquer. L’accent est mis notamment sur l’oralité et l’écoute, d'apprendre à prendre la parole en respectant les codes de la communication, dans des échanges construits par le dialogue et l’analyse des productions orales, un langage oral qui doit servir à toutes les disciplines. Il est également indiqué que l’apprenant doit pouvoir rendre compte des émotions et des sentiments des personnages, et des intentions de l’auteur et réussir à rendre l’intonation, le rythme par une attention portée à la voix, à l’espace et au corps, en renforçant des contextes d’apprentissage où le cours traditionnel est remplacé par des situations d’interactivité ludiques et de créativité. C’est une des formes de la pédagogie Ubuntu qui permet à l’apprenant d’apprendre à son insu tout en prenant confiance en ses capacités car la notion de compétitivité est reléguée au second plan. On apprend et on progresse ensemble.
Je pense même que cela peut se pratiquer au-delà de la France car selon moi, la pédagogie Ubuntu est une méthode qui relève de l’universel et qui met en jeu le principe d’équité cognitive, de la parole et de l’écoute.
Pendant longtemps, j’ai mené ces recherches et leurs applications de manière académique mais sans relais médiatique. C’est pourquoi, je vous accorde cette interview aujourd’hui afin de faire connaître plus amplement la pédagogie Ubuntu. Selon moi, il est toujours important de remonter dans le temps et de se questionner dans le domaine de la recherche et à ma connaissance, depuis trente ans, je construis et je déconstruis cette méthode que j’ai moi-même élaborée, conçue et initiée au sein de l’académie de Versailles, de Créteil et de l’académie de Paris. Et c’est aussi grâce à la solidité de la formation que j’ai reçue sur le terrain scolaire professionnel, en France, que j’ai pu faire ressortir ce que j’avais en moi d’universel, et aussi en tant qu'homme de culture africaine, pour proposer aux uns et aux autres une autre manière de faire, une autre manière d’enseigner, un autre paradigme, avec une véritable rupture épistémologique, ce que je nomme ici la pédagogie Ubuntu.
Je le redis encore mais c’est grâce à Madame Sophie Fouace, Inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale (IA-IPR) de l’académie de Paris (2013-2016) qui avait compris les enjeux de la pédagogie Ubuntu, que j’ai pu travailler de cette façon au sein de l'académie de Paris. Elle m’a ouvert les portes des amphithéâtres de l’université et de la recherche scientifique pour faire scintiller nos lumières. Si certains sont tentés de s’emparer de la méthode, j’en serai fier mais il ne faut pas oublier que je suis le seul à avoir travaillé de cette manière, depuis le début de ma carrière d'enseignant et en particulier ces vingt dernières années en tant qu’intervenant pédagogue et poète écrivain.
Je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui m’ont soutenu jusque-là et qui m’ont permis de contribuer à la réflexion pédagogique que je continue de porter en bandoulière. Selon moi, il est nécessaire de transmettre le poétique de l’universel pour sortir du prosaïque, de la compétition et de considérer tous les écrits du monde comme autant de dimensions signifiantes. En tant que concepteur de la pédagogie Ubuntu et comme étant celui qui l’a expérimentée, à la fois de manière théorique et pratique, je propose cette méthode d’apprentissage en détail dans l’ensemble de mes publications consacrées à cette manière novatrice d’enseigner que je nomme la pédagogie Ubuntu.
Mais cette méthode est au fond un prétexte car, selon moi, ce qui demeure essentiel c’est de militer et de faire de l’école élémentaire un lieu d’épanouissement, un espace où la compétition est absente et où l’on construit ses savoirs et ses apprentissages progressivement pour permettre l’appropriation. Ce n’est pas un sprint que mesurerait un chronomètre mais une course de fond qui nécessite du temps, de l’écoute et de la re-médiation. C'est pour cela également que j’utilise l’oralité car elle permet de mettre au centre la construction cognitive de la pensée, c’est un outil pédagogique indispensable dans la formation de l’esprit, de pouvoir mesurer ses capacités, de nommer ses difficultés dans une dynamique d’émulation au sein d’un groupe qui ne juge pas mais, qui au contraire, s’efforce de construire ensemble. Voilà le modèle de l’école élémentaire où le savoir est au centre porté par la générosité, l’hospitalité et surtout l’humanité des uns et des autres. Aujourd’hui, il est possible de faire rayonner cette pédagogie en Afrique, au Sénégal et un peu partout de par le monde car cette expérience que j’ai vécue, j’ai tout simplement envie de la partager, toute une pratique professionnelle que j’ai consignée dans les livres pédagogiques que j’ai écrits, publiés et diffusés par les éditions Lettres de Renaissances, et qui a été relayée par des vidéos réalisées par l’académie de Paris de 2014 à 2023.
Je voudrais ajouter que ce n’est pas seulement les diplômes, les attestations et les titres qui décident de notre parcours. Selon moi, c’est la persévérance, l’éthique et surtout les convictions que l’on porte jusqu’au bout pour faire aboutir ce que l’on est. Les concepts ne se décrètent pas, ils ne tombent pas du ciel, c’est un travail de longue haleine qui peut prendre plusieurs décennies. Il faut travailler, sans pasticher, ni imiter mais s'approprier de tout cela pour dessiner des perspectives et pour être dans une dynamique d’intellectuel, de penseur. Et je le dis à tous les jeunes, étudiants, enseignants, chercheurs que cela prend du temps mais que ce qui importe c’est la continuité et la rigueur. Pour illustrer mon propos, j’aime bien ce proverbe africain qui dit que “On ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour”.
J’ai envie aussi de dire que j’ai quitté mon pays natal, le Sénégal, avec toutes les souffrances liées à l’exil que cela implique. Mais je ne suis pas parti pour des raisons économiques mais parce qu’on m’avait enseigné qu’aller capter le savoir ailleurs était une belle expérience et je suis fier aujourd'hui d’être parvenu à cette existence plurielle qui me permet d’être ce que je suis et de continuer à défendre ces valeurs de l’enseignement dans le partage, la connaissance et surtout l’ouverture.
Propos recueillis par Isabelle Chemin, professeure documentaliste de l’académie de Paris
Bibliographie Amadou Elimane Kane
Pédagogie
Enseigner la lecture, l'écriture et l’oralité : à la rencontre de 14 poètes sénégalais contemporains, anthologie, éditions Lettres de Renaissances, 2013
Enseigner la poésie et l’oralité, éditions Lettres de Renaissances, 2014
Enseigner le dire poétique : Les compétences majeures de l’oralité, éditions Lettres de Renaissances, 2015
Enseigner apprendre à apprendre par la poésie et l’oralité, éditions Lettres de Renaissances, 2016
Enseigner la justice cognitive par la poésie et l’oralité, éditions Lettres de Renaissances, 2017
Le dire poétique - S’initier à la poésie et à l’oralité, éditions Lettres de Renaissances, 2019
Enseigner l’oralité : un langage transversal et citoyen, éditions Lettres de Renaissances, 2024
A paraître :
Éduquer par la pédagogie Ubuntu ou par le poétique de l’universel
Transmettre par le récit ou éduquer par le panafricanisme pour le poétique de l’universel



