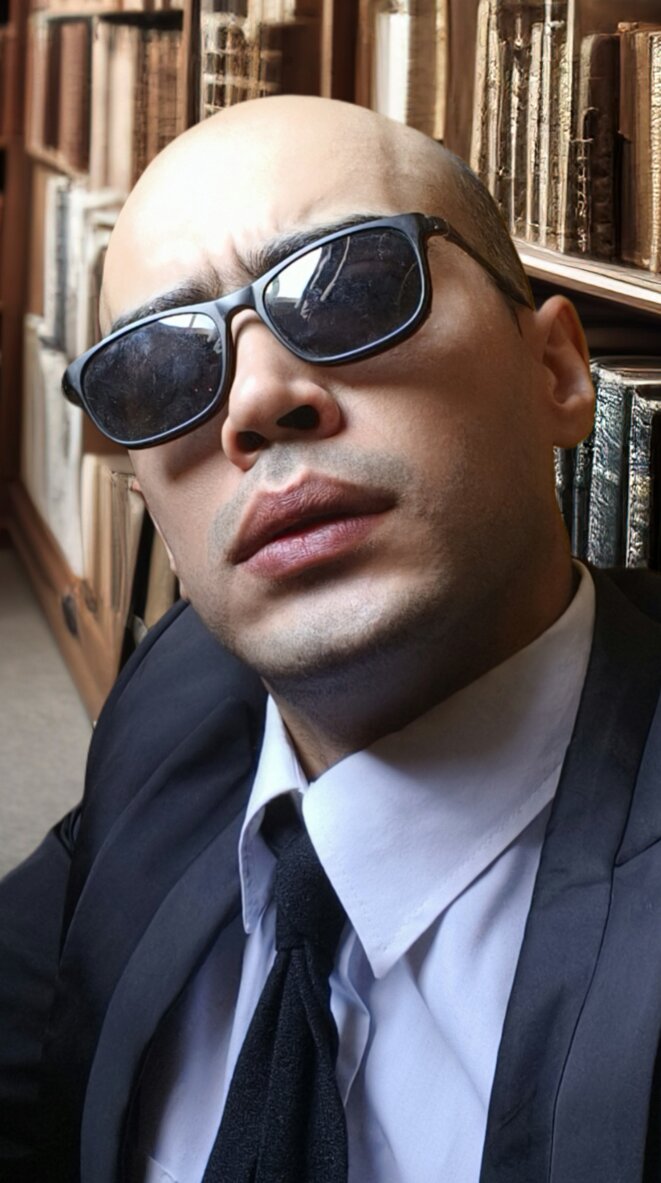L’Algérien ne veut pas d’un chanteur. Il veut un martyr qui chante.
Cheb Khaled, pendant que les kalachs tonnaient, essayait de sauver l’honneur de la vie. Il chantait l’amour dans une langue que tout le monde comprenait, même les muets : le raï, cette langue bizarre entre l’arabe, l’alcool et le soupir. Il disait : « Je chante pour que les gens dansent, même quand tout va mal. » Mais en Algérie, on veut que les gens pleurent, même quand tout va bien.
Au milieu des années 90. On voit Khaled sur un plateau français, entouré de gens qui attendent qu’il prenne position comme si c’était une réunion du FLN clandestin. Il parle de musique, d’amour, de fête. « Cela fait cinq ans que je ne suis pas retourné en Algérie... Quand on voit les horreurs, il faut penser à l’avenir. »
Matoub Lounès, assis à côté, lance sa phrase célèbre comme une gifle historique : « Je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. » C’est noble, c’est fort, c’est grave. Et surtout, c’est le ticket d’entrée pour être aimé en Algérie : parler de mort. Rien n’émeut plus un Algérien qu’un homme qui parle de mourir.
En Algérie, tout artiste qui ne cite pas Frantz Fanon, ne chante pas sur un char, ou ne crache pas sur les accords d’Évian, est immédiatement suspecté de trahison. Si en plus il danse, sourit, et ose parler d’amour : on le range aux côtés des touristes et des footballeurs.
Cheb Khaled, dans les années 90, s’est rendu coupable d’un crime impardonnable : il a chanté pendant qu’on enterrait l’Algérie au rythme des kalachnikovs. En un instant, il fut déchu de sa nationalité par la brigade des patriotes de canapé, et même aujourd'hui, les révolutionnaires de Facebook et les poètes en exil intérieur rêvent de le voir déchu officiellement de sa nationalité.
« Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort, les deux sont belles ». Enchaîne Matoub. Les Kabyles en particulier voient dans chaque non-engagement une offense à Matoub. Comme si on n’avait pas le droit de ne pas vouloir mourir, comme si l’amour n’était pas une forme de résistance. Car dans notre Algérie magique, on confond tout. On veut que le chanteur soit révolutionnaire, le romancier militant, le journaliste martyr, le comédien historien...
On oublie que tout le monde n’a pas le goût du sacrifice, ni l’envie d’entrer dans la légende à coups de balles. On oublie que faire la fête peut être un acte de bravoure dans un pays qui ne connaît que le deuil.
Même s'il est vrai que Khaled a compris que dans un pays où l’on tue pour des idées, le mieux était peut-être d’en avoir le moins possible. Ou les plus simples : aimer, danser, survivre. Mais en Algérie, malheureusement, on demande à un chanteur de faire la guerre et à un écrivain de rédiger la Constitution.
Matoub Lounès était un immense chanteur, et il est mort assassiné parce qu’il disait ce qu’il pensait. Il mérite le respect, l’admiration, l’étude. Mais doit-on vraiment opposer les deux ? Doit-on rabaisser Khaled pour faire briller Matoub ? Comme si la lumière de l’un devait forcément éteindre l’autre ? C’est notre maladie nationale : si quelqu’un ne souffre pas avec nous, alors il doit être contre nous.
N'oublions pas que Khaled a été censuré, interdit, diabolisé, accusé d’avoir "perverti" la jeunesse. N'oublions pas que chanter " Serbi Serbi" à une époque, c’était déjà risqué. N'oublions pas que dans un pays où une jupe peut choquer, faire danser des millions de gens, c’est déjà une révolution.
Cette manie algérienne de tout politiser, elle nous tue à petit feu. Nos romanciers, ils savent plus écrire une histoire d’amour sans y coller la guerre d’Algérie, la décennie noire ou un sermon sur l’islam. Nos cinéastes tournent des films où chaque plan crie « souffrance » ou « révolution ».
Ainsi s’efface l’art de jouir d’une mélodie, d’aimer un refrain pour sa seule grâce. Ainsi s’oublie la douceur d’un instant volé à la grisaille, l’éclat d’un rire partagé sous un ciel d’étoiles.