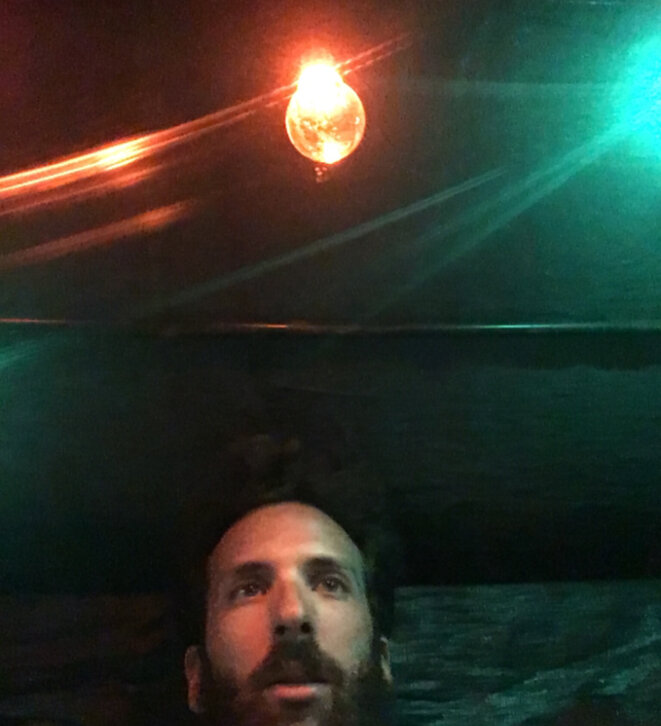Agrandissement : Illustration 1

Quand un événement fait l'actualité, il est nécessaire d’aller saisir ce qu’il se joue. C'est pour cette raison que le photographe Corentin Fohlen et la rédactrice Eve Szeftel ont été envoyés « couvrir les émeutes » pour le journal Libération, au Pablo Picasso à Nanterre dans la nuit du 28 au 29 juin.
Dans ces moments de tension, il est indispensable de construire une stratégie pour réussir à recueillir les images et témoignages des scènes auxquelles on prend part. A la lecture de l’article, on constate que les deux journalistes adoptent des stratégies opposées propres à leur moyen d’expression.
De son côté, la rédactrice, Eve Szeftel se positionne selon des techniques qu’elle a apprise en formation « formé par les gendarmes mobiles, j’ai retenu qu’il y avait trois endroits ou il ne ne fallait pas être - derrière les forces de l’ordre, derrière les émeutiers, et entre les deux ». Elle fait le choix de se mettre à l'écart pour tenter de parler aux personnes à proximité, tout en ressentant une dichotomie entre sa présence et les éléments qu’elle a sous les yeux.
A l’inverse, Corentin Fohlen se positionne au niveau des forces de l’ordre, si l’on en croit les images disponibles sur le site de son agence et au récit qu’il livre sur sa page Facebook. Dans un moment de confusion et suite au repli des forces de l’ordre, il se retrouve à circuler « parmi les émeutiers » . Il « profite de la confusion pour tenter de faire quelques images ». , il donne des précisions sur la situation « je croise une trentaine de jeunes qui reprennent possession du rond-point, après le départ des flics. Ils ne me calculent pas. Une fois qu’ils m’ont dépassé, je m'arrête pour les prendre en photo, je me dis que ça peut être intéressant d’avoir le point de vue des émeutiers ». Tout à coup, « je ressens un choc sur le casque, je me retourne et la un gars me hurle dessus : qu’est ce que tu fous là ? Et il commence à tirer mon appareil ».

Agrandissement : Illustration 2

Si l’altercation est une éventualité commune à tout mouvement social, il arrive parfois que les photographes se retrouvent dans des situations de tension, qui les conduisent à être les témoins intrusifs d’une situation. Dans la course à l'actu, la mise en concurrence des individus va de pair au phénomène de précarisation du secteur. Par crainte de passer à côté de l'image, qu’il faut absolument saisir, la prise de risque est minimisée, car il faut se garantir un revenu et une reconnaissance.
Bien que ces difficultés soient inhérentes au métier de journaliste, est-il pour autant nécessaire de construire tout un article sur un événement qui déroule l’opinion tiède d’un photographe ?
Dans un florilège de mauvaises foi et de stigmatisation, Corentin Fohlen, a défaut de tirer les conclusions d’un comportement qui a pu causer ces déboires, exprime “les causes” sous jacentes de cet épisode, dans une analyse confusionniste « il y a toujours eu une défiance. Pour eux, on est une élite, on n’a pas la même éducation, la même culture. Surtout, les journalistes représentent une institution, un pouvoir, quelque chose auquel ils n’ont pas accès. ». Tout en rejetant la faute sur les réseaux sociaux « ils peuvent se passer de nous. Ils s’en foutent qu’on montre qu’ils sont violents, car ils assument cette violence, et s’en vantent sur les réseaux sociaux. » Mi amer, mi fataliste, cet examen à l'emporte pièce est symptomatique des discriminations propres aux projections dont une partie de la presse est friande.
Ces propos, d’une condescendance de classe certaine, sont à l'image du manque de compréhension qu’a suscité cette aspiration à la révolte, survenue quelques jours après la mise à mort d’un adolescent racisé de 17 ans. Ce témoignage est, sans équivoque, un amalgame de vérités toutes relatives, ou l’opinion personnelle minimise la possibilité de construire une analyse globale d’un conflit social complexe. On ne peut évidemment pas nier les difficultés d'être pris pour cible, pour autant, quel est l'intérêt de cette prise de parole ? N’a-t-on pas vu des altercations similaires lors des nombreux rassemblements qui ont jalonné le calendrier social ? Pourtant, le photographe est un professionnel chevronné, au pedigree bien établi, comme rappelé au début de l’article “il a couvert les émeutes de 2005, les révolutions arabes, le séisme à Haïti ou le conflit du Donbass”. Se serait-il permis les mêmes écarts de langage, s' il avait été pris à parti lors d'un reportage à l’etranger ? Ou, est-ce tout simplement parce que l'édition du week-end donne la parole aux photographes de Libération, qu’il a paru naturel de tenir ce type d’argumentaire ?
Il est facile de se réfugier derrière une posture paternaliste qui assigne et crée encore un déterminisme. Mais, de quelle violence parle-t-on, au juste ?
Revenons en arrière, pour rappeler, rapidement, les faits. C’est suite au décès de Nahel, tué par un agent de police au motif “d’un refus d'obtempérer”, que les jeunes se sont révoltés. Corentin Fohlen était au Pablo Picasso accompagné de la rédactrice Eve Szeftef pour capter les effets liés à une cause précise L’altercation subit par le photographe est donc corrélé à un fait qui a bien plus d’ampleur que la simple retranscription d’une mésaventure. Initialement, la violence, celle dont il faudrait parler, est celle de l’Etat. Et, non celle des jeunes qui sont dans une posture de défense face à un système de domination qui les assigne. L’article occulte la violence initiale dans un déni du réel qui déploie les griefs d’une pensée sclérosée par l’individualisme, tout en ajoutant de la violence verbale à la violence d’Etat.
Bien entendu, les réseaux sociaux sont l'épouvantail tout trouvé pour dénoncer l’ensemble des maux sociétaux. Pourquoi pas les jeux vidéo, aussi ? Plutôt que de s'empêtrer dans des opinions approximatives et dans la reproductions d'étiquettes infondées, il devrait s’engager une réflexion autour des éléments qui ont conduit à cette altercation. Il est certain qu’aucuns des motifs ne soient liés au décès de Nahel, ou des actualités récentes. C’est autour du déclin, de la paupérisation et des méthodes utilisées par la presse traditionnelle que se cache un amoncellement de réponses.
Finalement, seul un journalisme de terrain, qui s’attache à donner la parole aux personnes au cœur des enjeux locaux et nationaux, aura la capacité de dépasser les aprioris. Seul l’ancrage aux territoires et à la population peut construire les conditions nécessaires à l'élaboration d'éléments réflexifs et à la construction de reportages qui développent des angles qui s'émancipent du prisme coutumier adopté par la presse traditionnelle.
Entre les lignes de l’article de Libération, il se cache la cécité d’une profession préférant banaliser une prise de parole malsaine, au lieu de se pencher sur les causes du déclin de confiance de l’opinion.