Gwenola Ricordeau (dir.), 1312 raisons d'abolir la police, Lux, 2023.
Dans cet ouvrage, l'attention est portée sur l'ensemble de l'activité de maintien de l'ordre public (policing) et non seulement l'institution policière. Née dans des contextes d'esclavage (USA), de colonialisme (Canada), ou de collaboration avec le fascisme (France), la police est une institution raciste, aux coûts sociaux et financiers énormes, sans que la mission qu'elle se donne (assurer la sécurité publique) soit une réussite.
Au contraire, réprimant les pauvres, les minorités (racisé·es, LGBT, personnes handi·es, peuples autochtones) et les opposant·es politiques, sa principale mission est de protéger l’État, l'ordre capitaliste mais aussi d'assurer sa propre existence. Ainsi, comme le rappelle l'autrice dans son introduction «dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, choisir le camp des opprimé·es, des exploité·es et des tyrannisé·es, c'est compter la police parmi ses ennemis».
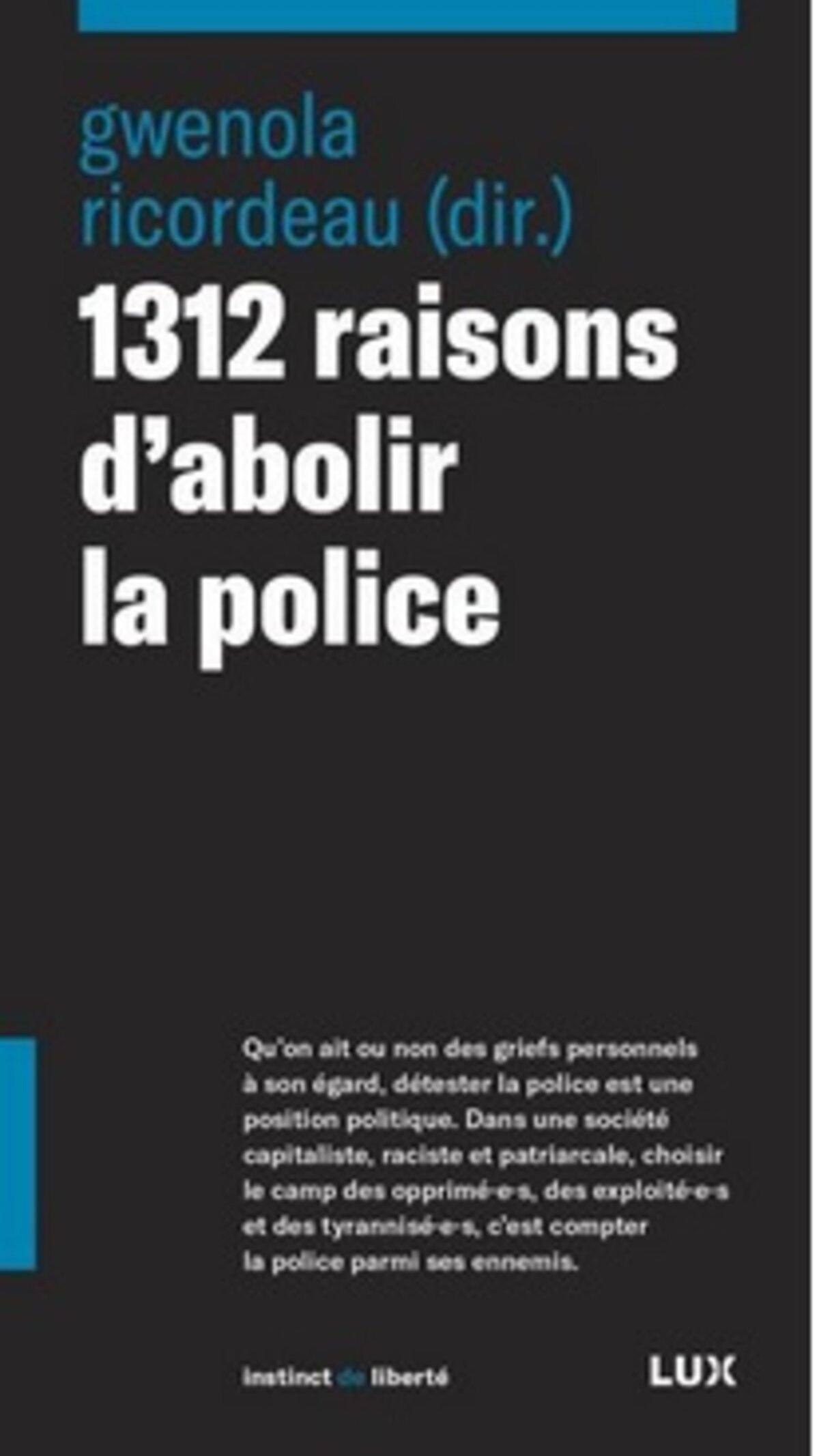
Si la contestation de la police a toujours existé au cours de son histoire, c'est au milieu des années 2010 aux USA que les luttes politiques la remettant en cause ont connu une nouvelle dynamique, influencées par les expériences et analyses du Black Panther Party des années 1960.
L'émergence du mouvement Black Lives Matter, né en juillet 2013 après un énième crime policier, marque le développement des réflexions réformistes. Cette position évoluera dans un second temps, pour devenir abolitionniste, avec la naissance de #8ToAbolition en juin 2020, après le meurtre de Georges Flyod à Minneapolis.
Penser l'abolition de la police, définie par Grégoire Chamayou comme «l'appareil de capture du pouvoir pénal1», permet de saper les fondements du système pénal dans son entièreté et d'envisager sa disparition complète. Cette position politique des mouvements nord-américains diffère de celle des mouvements français engagés contre les violences policières ou l'incarcération.
C'est là que réside l'importance du travail de Gwenola Ricordeau : organiser la traversée de ces voix abolitionnistes dans un pays où le débat public sur l'institution policière est quasiment impossible et qui permettent de réfléchir et chercher des pistes à cette question : «comment en finir avec cette nuisance qu'est la police ?».
Le réformisme de la police, garant de l'ordre établi.
Première étape : rompre avec le réformisme, c'est-à-dire l'idée qu'il serait possible d'avoir une « bonne police », position largement défendue par les partis politiques de gauche en France. Dans son propos introductif, l'autrice revient sur les fausses bonnes idées véhiculées par le mouvement réformiste : superviser et contrôler la police, limiter son usage de la force, développer une police de proximité, avoir recours au système pénal pour sanctionner un·e policier·ère, etc, sont autant d'objectifs qui n'ont aucun impact sur les nuisances de la police, et qui au contraire, permettent de renforcer l'institution.
Les différents textes qui émaillent cette première partie démontrent qu'il est intenable de soutenir des mesures réformistes pour la police : outil du colonialisme canadien et de répression des populations autochtones, institution raciste qui permet le contrôle aux frontières, et qui participe à la violence de l’État contre les personnes handies ou la criminalisation des travailleur·euses du sexe (TDS), la police est pour ces groupes de personnes l'obstacle qui les empêchent de vivre librement et dignement. Envisager qu'il soit possible de la rendre plus responsable, de la réformer, est une illusion qui «rallie les abolitionnistes potentiels et les canalise». Abolir la police, c'est abolir la frontière, les services d'enfermement psychiatrique, décriminaliser les TDS et reconnaître leurs droits ; c'est lutter pour la résistance des autochtones et des personnes racisé.es.
Stratégies abolitionniste.
Comment construire cet abolitionnisme ? G.Ricordeau propose de combiner trois options stratégiques : la «stratégie de la destruction» associée aux courant insurrectionnalistes qui regroupe des pratiques différentes de rébellion face à la police ; la «stratégie de l'abandon» qui consiste à «libérer des espaces» pour vivre sans police en faisant appel aux ressources, aux responsabilités et liens communautaires, une sorte d'autogestion de la conflictualité dans laquelle on pourrait retrouver la justice transformatrice2 ; et enfin, la «stratégie du démontage» portée par des organisations abolitionnistes comme #8ToAbolition ou Critical Resistance qui se concrétise par des appels au définancement de la police et l'orientation de ses budgets vers des secteurs essentiels (santé, éducation, logement) et des populations qui en ont le plus besoin.
L'abolition n'est pas un résultat à obtenir, une utopie lointaine, mais une pratique quotidienne. C'est dans cette optique que les textes qui occupent cette seconde partie réfléchissent à la manière de réduire le périmètre d'intervention de la police dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans le secteur de la santé mentale et du travail social, dans les transports ou dans les lieux de vie, en mettant en place des médiateur·trices de conflits, des techniques de désescalade. L'objectif est aussi que les communautés se réapproprient la gestion des conflits et réfléchissent à la notion de sécurité et ce que cela engage réellement. Ainsi, «c'est pied à pied qu'il faut lutter contre la police. Que c'est ainsi qu'on la fait reculer, car elle ne recule que quand nous avançons. Car elle ne recule que quand nous attaquons» conclut G.Ricordeau.
Lutter contre la police c'est lutter contre l’État et l'ordre capitaliste.
Dans la dernière partie du livre, l'autrice s'interroge sur le bilan des mobilisations abolitionnistes. Une des premières victoires est d'avoir fait sortir ce courant de pensée des marges politiques en Amérique du Nord, et de permettre sa circulation à travers le monde. Elle pointe néanmoins une faiblesse : les malentendus qui existent entre les mouvements pour l'abolition de la police d'un côté, et les mouvements contre les violences policières et de défense des victimes des crimes d’État. Ces derniers réclament «Vérité et Justice» pour les crimes subis, ce qui apparaît totalement illusoire pour les abolitionnistes pour qui «la vérité ne peut être réduite à la ''vérité judiciaire'', pas plus que le système judiciaire ne peut répondre à la nature d'un crime d’État», tout en considérant également problématique la croyance en une décision de justice qui permettrait à la victime de réaliser un deuil ou une guérison.
Le corpus de textes présentés analyse les tactiques abolitionnistes à partir des mobilisations actuelles en Amérique du Nord. Une première réflexion se penche sur la ville de Camden, où l’institution policière s'est servie des propositions réformistes pour repenser son maintien de l'ordre et instaurer une surveillance de masse de sa population. Un autre texte présente la lutte des jeunes noir·es et latinos contre la présence policière dans les écoles, et la réaffectation des fonds budgétaires de la police à des services destinés à la jeunesse. Une dernière réflexion analyse le copwatching (surveillance citoyenne de la police) qui ne peut se concevoir uniquement en terme légaliste et doit s'inscrire dans un «plus large éventails d'actions politiques suscitant la participation d'un grand nombre de personnes et capables d'arracher des concessions aux autorités».
G.Ricordeau conclut l'ouvrage en insistant pour que l'abolitionnisme ne soit pas une lutte autonome, et appelle à «défliquer toutes les luttes», car «il ne peut y avoir une abolition de la police sans abolition de la propriété privée et de la société de classes qui résulte du capitalisme, du racisme et du patriarcat. L'abolitionnisme doit donc être révolutionnaire et, en ce sens, s'affirmer aussi comme anticolonial, anti-impérialiste, internationaliste et écologiste». Point de salut ici pour un réformisme de l'institution policière, «parce que vivre libre, c'est vivre sans police».
1Grégoire Chamayou, Les chasses à l'homme, La Fabrique, 2010
2Voir Gwenola Ricodeau, Pour elles toutes. Femmes contre la prison, Lux, 2019.



