En six chapitres incisifs se déclinant sur six-cent pages, Abderrahim Berrada, l'avocat dans les grands procès politiques que connut le Maroc, reprend son ultime plaidoirie contre les injustices, l'arbitraire et le « despotisme » qu’il n’avait de cesse de dénoncer là où ils sévissent, dans son propre pays d’abord, le Maroc. Ça sonne, à leur lecture, comme un testament pour l'Histoire. Légué aux générations présentes et futures avant qu'il ne rende son dernier souffle le 20 février 2022. À l’image de sa vie, sa mort survenue comme par hasard un jour d’anniversaire du Hirak marocain dans le sillage de celui que traversa de l'est à l'ouest nombre pays arabes, a été sobre, pudique, digne, laissant un vide abyssal difficile à combler parmi ses amis les plus chers ; des prétoires orphelins d'une voix libre, engagée, intrépide, ayant pendant quatre décennies remué magistrats et parquet pour avoir crié courageusement la vérité, rien que la vérité, toute la vérité.
Au long de l’ouvrage, en tournant avec délectation les pages les unes après les autres, on a l’impression que c’est la voix ferme et révoltée que l’on entend, tantôt mordante tantôt douce, jamais complaisante, que l’on entend, qui nous interpelle, et non pas devant des lignes brodées élégamment noir sur blanc. Dans une préface éloquente, c’est celle de son compagnon de toujours, son ami fidèle, maître Abderrahim Jamaï, qui annonce d’emblée le ton, assène sans fioriture : « L'avocat est le contre-pouvoir. » Abderrahim Berrada, à travers ce livre posthume, témoigne son alter ego, n’est pas qu’un ténor des barreaux épris de justice, mais aussi « le révolté, l'intellectuel, le militant, l'homme politique. » Nous ajouterons le souci de précision, la clarté de la pensée, la sobriété du style et le refus de toute langue de bois.
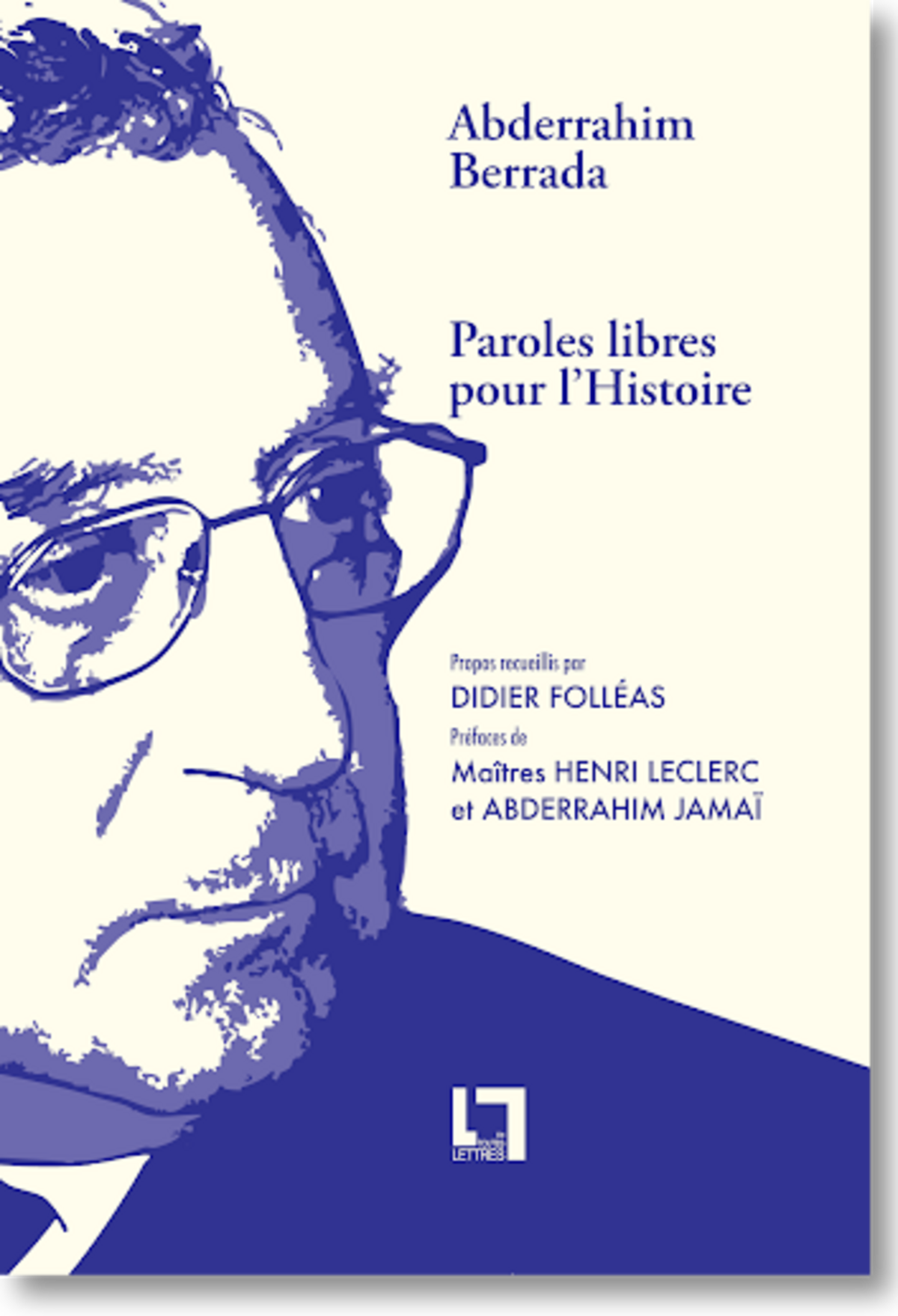
L’auteur de Paroles libres pour l’Histoire a forgé ce caractère à Paris, alors encore étudiant de droit à la fin des années 1950, à travers ses lectures variées sans à priori politique ou idéologique, il nous dresse lui-même son propre portrait pour éviter tout amalgame : « Je suis quelqu’un qui cultive le doute, qui le vit. J’ai toujours cherché à écouter et à lire ceux qui appartiennent aux bords opposés au mien. Je me revendique de gauche mais je m’intéresse beaucoup au discours de la droite. J’ai le sens du respect des autres, de leurs idées, tant qu’elles restent compatibles avec les valeurs qui constituent les piliers de mon éthique. À commencer par la dignité, la justice, la liberté, la bonne foi, la sincérité. » S’il fut un ennemi juré que combattait Abderrahim Berrada, c’était l’idéologie étriquée et le dogmatisme de tous bords, matrice, martèle-t-il, du « nationalisme haineux et du fanatisme religieux. » C’est la lecture de l’œuvre de Raymond Aron, le proscrit des gauchistes parisiens de l’époque, qui lui ouvrit les yeux, qui inocula en lui le virus du doute et du refus des certitudes sans effort de remise en question. Lui, il était pour le droit à la différence, au pluralisme et contre toute forme de violence. S’il devait y avoir une « révolution au Maroc », elle devait être « pacifique. »
Ses cheveux se hérissèrent sur la tête le jour où il entendit quelques-uns de ses camarades de la section parisienne de l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP) – parti créé par Ben Barka en 1959 suite à une scission du parti de l’Istiqlal – (rebaptisé Union Socialiste des Forces Populaires – USFP – en 1975) défendre le parti unique. Ni Ben Barka, ni Omar Benjelloun qu’il connut à la même époque à Paris, – ni à fortiori la ligne officielle du parti – ne défendaient l’option du parti unique, tranche l’auteur. Le premier, rappelons-le, fut enlevé à Paris sous le régime de de Gaulle sans jamais retrouver son corps le 29 octobre 1965 dans des circonstances pour le moins troubles; le second sauvagement poignardé à Casablanca par les islamistes avec la bénédiction du despote-roi Hassan II, dix ans plus tard, le 18 décembre 1975.
Et « l’option révolutionnaire » de Ben Barka, alors ? « Ce n’était pas l’action violente. C’était la transition volontariste et méthodique, par les luttes, d’un État féodal vers un État moderne, démocratique et socialiste… » Dans l’esprit de Ben Barka, l’option violente était positionnée en dernier lieu, comme « légitime défense », nuance Abderrahim Berrada, au cas où le Palais n’aurait pas adhéré aux réformes structurelles que prônaient les « militants modérés », de l’UNFP, et leur opposerait « une violence d’État. » En réalité, ajoute l’auteur, le parti de Ben Barka était historiquement écartelé entre l’aile modérée de ses leaders comme Abderrahim Bouabid, Omar Benjelloun et, dans une certaine mesure, Mehdi Ben Barka, et l’aile blanquiste de Mohammed Fquih Basri qui avait à plusieurs reprises pris les armes pour renverser le régime monarchique.
Électron libre abhorrant toute tutelle politique quelle qu’elle fût, Abderrahim Berrada rendit son tablier comme militant de l’UNFP en 1963 et se consacra à sa vocation d’avocat. Il aurait bien aimé passer le concours d’agrégation et s’orienter vers l’enseignement, « l’un des plus beaux métiers où l’on apprend l’humilité », mais cela exigeait de lui une disponibilité totale et plusieurs années d’études après le doctorat, ce qu’il ne pouvait supporter. Il se contenta alors d’un stage sous l’aile vaillante du grand avocat parisien Charles Delaunay ; tout en affutant ses premières armes, à partir de 1963, auprès de grands ténors tels Maurice Garçon, René Floriot, Paul Bauder, ou encore l’ancien Président du Conseil Edgar Faure, Roland Dumas, Henri Leclerc et d’autres avocats aussi brillantissimes les uns que les autres.
En 1966, Abderrahim prit ses cliques et ses claques et rentra dans son pays, obéissant ainsi à une voix intérieure qui lui susurrait : « Personne n’a besoin de moi en France alors que le Maroc a besoin de tous ses enfants. Je rentrerai pour la bagarre, pour donner un sens à ma vie », abandonnant ainsi une carrière stable et des honoraires plus que prometteurs. Dans un contexte marocain glauque marqué par l’enlèvement de Ben Barka, les émeutes de Casablanca du 23 mars 1965, et l’état d’exception qui s’ensuivit décrété par le roi Hassan II. À cela s’ajoutait « une angoisse sur mon avenir professionnel », se rappelle-t-il. S’il regrettait quelque chose en prenant cette folle décision, c’est « la majesté du Palais de justice avec des magistrats de haut niveau ; j’ai laissé le spectacle quotidien des procès avec des avocats immenses ; j’ai enfin laissé Paris, la ville- lumière dont j’ai toujours été amoureux. »
À la femme de sa vie, Monique Becquet (de cette union naquit Yassin, leur enfant unique), il ne promit point monts et merveilles, plutôt de la patience et un train de vie humble, digne, à son image, loin des paillettes d’avocats haletant derrière le prestige matériel. Elle ne l’a pas déçu, Monique, puisqu’elle était un soutien indéfectible à ses côtés face à un Makhzen qui s’échinait à étouffer toute voix libre, celle d’un avocat qui disait ce qu’il pensait, avec comme seules armes les lois du pays régissant la justice, au mépris d’une monarchie « allergique à toute opposition ».

Agrandissement : Illustration 2

Vinrent les grands procès politiques qui s’égrenaient les uns après les autres pendant quatre décennies du règne du roi Hassan II. Peu importait la bannière politique des accusés, qu’ils fussent blanquistes, chefs de partis politiques légaux ou clandestins, syndicalistes, journalistes, marxistes-léninistes ou maoïstes, il avait toujours répondu présent pour les défendre, sans jamais réclamer d’honoraires, « il n’y a pas eu de procès politique où je n’ai pas été mêlé », avoue-t-il. Non sans conditions : pour mener à bien sa mission, et pour une meilleure justice, l’avocat se doit de mettre une « distance » entre ses convictions personnelles et celles de son client, « l’avocat qui ne jouit pas d’une forte personnalité qui lui permette d’assurer l’indépendance dont il a besoin en toutes circonstances ne devrait pas être membre du barreau » avertit-il. Il cite une autre règle non moins exigeante dont doit se prévaloir tout avocat : ne pas obliger son client « d’abandonner ses propres idées – pour lesquelles il est jugé – et épouser les siennes. »
Et de citer quelques cas flagrants d’avocats lors du grand procès politique de 1977 (l’affaire Abraham Serfaty & Cie où comparaissaient 178 accusés devant la chambre criminelle de Casablanca) qui s’étaient débinés à la dernière minute sous prétexte que les accusés défendaient le principe d’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Dont un ténor du barreau, grand progressiste et patron de l’USFP, Abderrahim Bouabid, qui avait décliné l’invitation d’Abraham Serfaty (son ami par ailleurs et membre de son cabinet quand il était ministre de l’économie au gouvernement d’Abdellah Ibrahim en 1958) de venir le défendre parce qu’il ne partageait pas sa position sur cette affaire. Là, fustige-t-il, « j’ai déploré son attitude, et, pour l’Histoire, je continue de le déplorer, Bouabid s’est comporté exclusivement en politicien. Il a oublié qu’il était avocat. », s’insurge Abderrahim Berrada.
Ce procès battit tous les records en termes d’irrégularités, l’auteur en recense un florilège affligeant, s’ensuivit un bras de fer cinglant entre la cour présidée par Ahmed Afazaz (« un président aux ordres ») et le corps de la défense dont Abderrahim Berrada assurait la coordination. Il en paya les frais, sans jamais geindre : téléphone sous écoute, sentinelle de police à l’entrée de son domicile, menace d’arrestation, et, pour finir, un passeport sous-scellé. Il ne lui sera restitué que quinze ans plus tard, en 1992, au prix d’une série de louvoiements et d’une longue bataille plus politique que judiciaire. Un réseau d’avocats et de journalistes, à leur tête Henri Leclerc et Stephen Smith (écrivain et journaliste à cette époque au quotidien parisien Libération), s’était remué pour obliger le pouvoir à lâcher de lest, allant jusqu’à le menacer d’un article incendiaire.
Pour déjouer la manœuvre, le roi fit venir à Rabat, pour un entretien, trois journalistes du même quotidien et non des moindres (Serge July, le directeur du journal, Marc Kravetz ainsi que Stephen Smith). Hassan II se mit alors, dans une diatribe, à louer sa « politique sélective en matière de passeports. Vous n’avez donc pas de clandestins marocains à me reprocher… » Smith saisit au vol la perche : pourtant « il y a un Marocain qui n’a aucune raison d’aller en France comme émigré clandestin, car il a la certitude d’y être bien reçu. C’est maître Abderrahim Berrada… » Stupéfait, Hassan II, rapporte Smith (cité par l’auteur), « commence par éteindre l’appareil d’enregistrement. Puis il entre dans une colère qui nous étonne, tellement forte que son discours en devient incompréhensible. »
Fin du règne du roi Hassan II. L’opposant historique et l’ex-condamné à mort, Abderrahmane Youssoufi, fut appelé, en 1998, à diriger un gouvernement dit « d’alternance consensuelle », suite aux législatives tenues une année auparavant qui avaient donné à l’USFP une majorité relative. Objectif : assurer une transition à la douce vers le nouveau règne, Hassan II se savait vivre ses derniers jours (il décéda le 23 juillet 1999). Pas de souci, à priori, ironise Abderrahim Berrada, mais pas à n’importe quel prix, il fallait à la primature poser quelques conditions, la plus importante – qui ne lui coûterait pas « un seul centime » –, est d’apurer d’abord le passif « monstrueux » des violations graves des droits humains perpétrées durant le règne du roi Hassan II. Or, Yousssoufi (dont le parti, l’UNFP, puis l’USFP, « a longtemps payé le prix fort pour son engagement en faveur de la démocratie ») s’est montré à ce propos d’une « frilosité scandaleuse ».

Agrandissement : Illustration 3

À commencer par l’affaire d’Abraham Serfaty banni de son pays sous prétexte « fallacieux » qu’il était Brésilien (libéré en 1991 après dix-sept ans de prison, de sa cellule il fut embarqué illico presto dans un avion en partance vers Paris). Youssoufi aurait dû signer « une seule ligne », sous forme « de décret annulant l’expulsion », sachant que Serfaty « est indubitablement marocain », annulant pas le même coup la décision de la cour suprême entérinant cette décision. Cet opposant politique sera autorisé à récupérer sa nationalité et rentrer – avec tous les honneurs – à son pays au tout début du règne du roi Mohammed VI. Décision éminemment « politique » à mettre « à l’actif du nouveau règne » concède Berrada. Avait-elle été entérinée au moins par une quelconque juridiction ? « Absolument pas. Le roi a pris sa décision et elle suffisait. Il est le chef suprême de l’État, et, plus précisément, un monarque absolu du droit divin. Personne n’a à confirmer ou infirmer ce qu’il décide. »
Deuxième erreur grave de Youssoufi : sa décision aberrante d’interdire d’un seul coup, en 2000, trois hebdomadaires : Le journal, Assahifa et Demain. Troisième erreur, le procès « infâme intenté au capitaine Mustapha Adib », son emprisonnement deux ans et demi, et sa révocation de l’armée. Son crime ? Avoir informé sa hiérarchie de détournements de carburant perpétrés par des officiers de sa base (en 2000, ce capitaine avait reçu le Prix de l’intégrité de Transparency International et vivra en exil en France après avoir purgé sa peine.) Quatrième erreur, Youssoufi aurait cédé sur les violations commises sur l’exercice des libertés publiques. Erreur numéro cinq : le chef du gouvernement socialiste, au lieu de soutenir le plan « progressiste » d’intégration qui rend justice à la femme, il avait préféré remercier son auteur, le ministre Saïd Saâdi. Dernier reproche et « le plus sévère » juge A. Berrada : Youssouf aurait dû exiger que le pouvoir reconnaisse les responsabilités de l’État dans l’assassinat de Mehdi Ben Barka et de Omar Benjelloun. Youssoufi « aurait dû montrer qu’il n’était pas n’importe qui. La modestie devait être écartée lorsqu’il s’agit de négocier avec un interlocuteur tel que Hassan II qui ne s’est jamais gêné, lui, de se comporter en tant que demi-dieu. »
Et le règne du roi Mohammed VI ? À son début, s’est profilé à l’horizon un balbutiement dans l’exercice de la liberté d’expression (pas de censure préalable de la presse, le roi n’est plus au-dessus de la critique, retour de Serfaty…), sur le plan des droits de l’Homme (création de l’IER -Instance Équité et Réconciliation- en 2003 pour enquêter sur les violations graves des droits de l’homme entre 1956 et 1999), et une avancée « relative » en matière des droits de la femme. Mais l’espoir caressé un moment de voir une rupture avec le passé douloureux du pays, de questionner et de juger les responsables de ces crimes, de tourner la page, d’enclencher un processus « véritablement démocratique de régime parlementaire », s’effiloche à mesure que les années passaient. « Il n’y a pas de réelle séparation des pouvoirs au Maroc, même sous la constitution de 2011 qui se prétend, fallacieusement, démocratique. »
Abderrahim Berrada, par ce livre, nous lègue un document pour l’Histoire, des « paroles libres » qui sortent des sentiers battus.
> Abderrahim Berrada, Paroles libres pour l'Histoire, Éditions En toutes lettres, 2025, Casablanca. 602 pages, 150 dirhams, (25 €).
> Jaouad Mdidech est journaliste et écrivain. Entre autres de ses ouvrages : La Chambre noire ou Derb Moulay Cherif, préface d'Abraham Serfaty, éd. Eddif, 2000. Son dernier ouvrage : Escapades dans le Haut Atlas, éd. Le Fennec, Casablanca, 2025.



