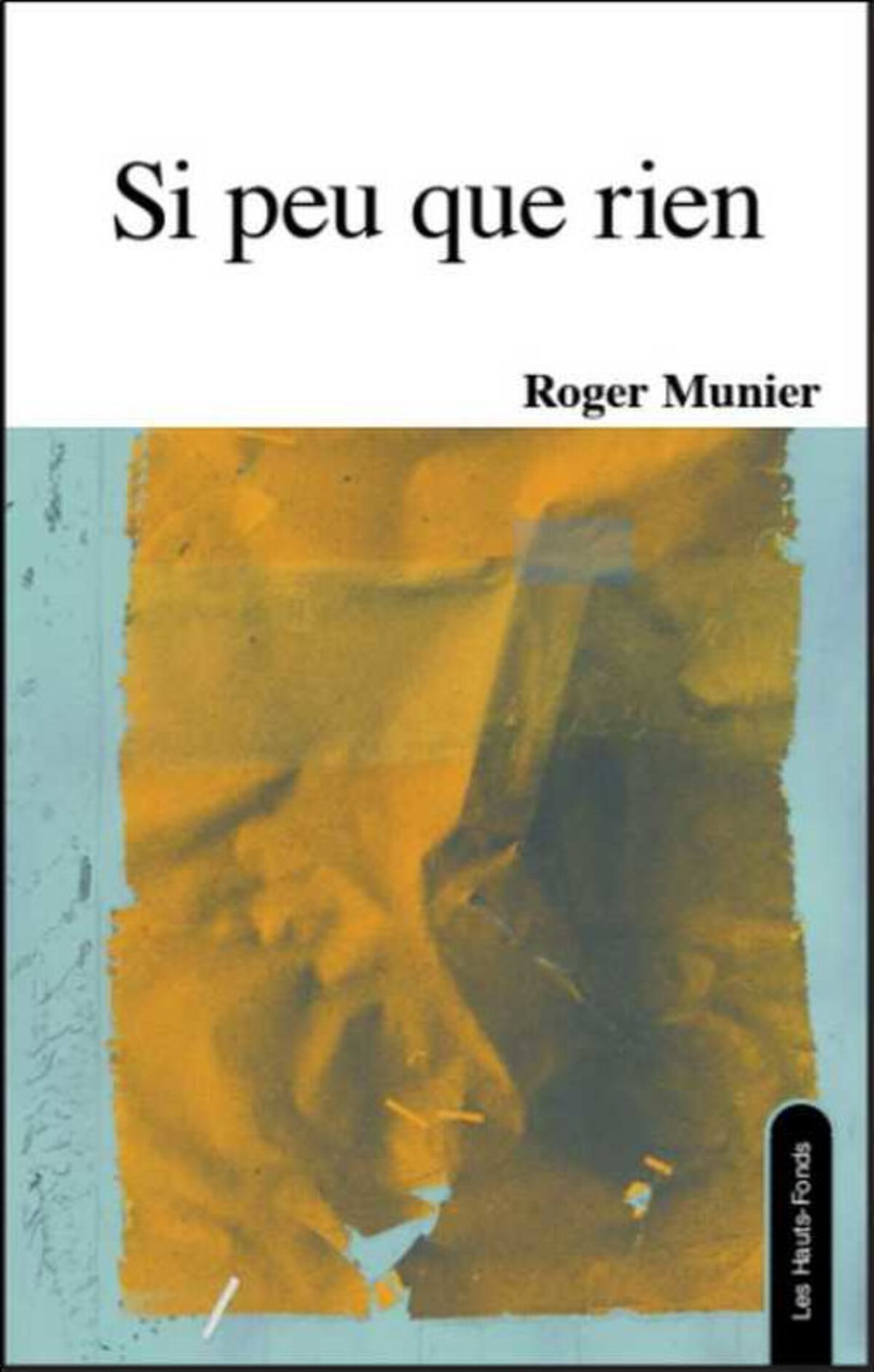
Agrandissement : Illustration 1
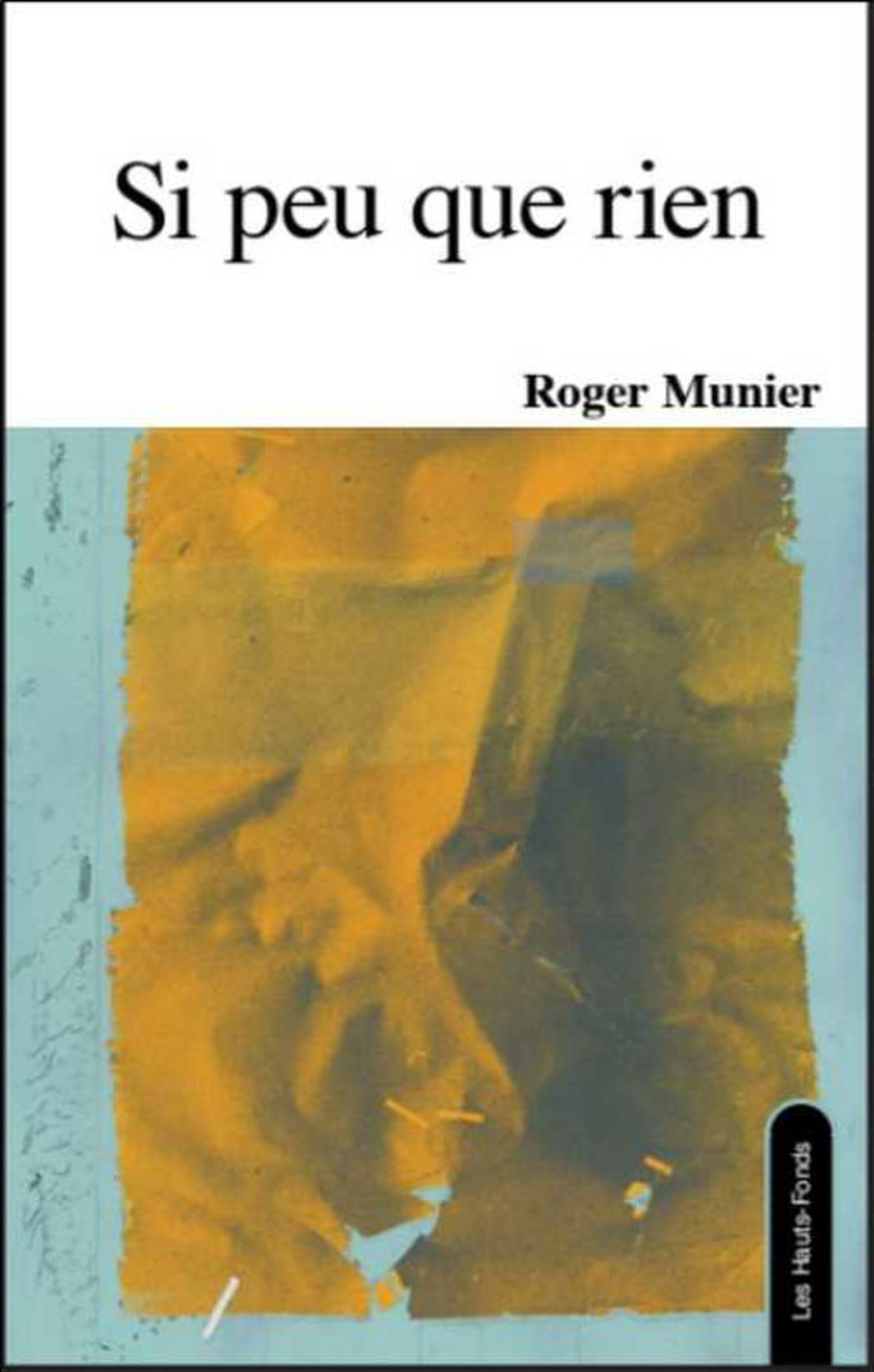
« Le Rien n’a pas priorité, mais préséance. » [p. 47]
Il y a bientôt quinze ans que Roger Munier a disparu, de son temps il avait été discret, et pourtant fort présent pour bon nombre de lecteurs avertis. Traducteur de poètes tels qu’Octavio Paz, Roberto Juarroz ou R. M. Rilke, il a aussi frayé avec Heidegger ou Héraclite qu’il a tourné l’un et l’autre en français. Il fut philosophe et poète, enclin à la réflexion ontologique, il a parlé avec le « rien », avec le néant ou le vide existentiel, qui n’est en rien le néant ni le vide. Imprégné des pré-socratiques, de Maître Eckhart ou de Silesius, mais aussi des taoïstes ou de Bashô, il s’est montré lecteur et exégète de la phénoménologie, celle de Husserl ou celle de Heidegger, mais finalement n’a pu que se dévoiler tel qu’il était, occupé par la mort et méditant le désastre dont elle est, par anticipation, la cause.
« Comment faire que ce que je ressens ne soit pas seulement ce que je ressens ? » [p. 143]
Avant que ses textes n’aient pris forme philosophique ou poétique, avant qu’ils n’aient emprunté au développement ou à l’image, ils n’étaient que notations brutes dans un cahier. Et c’est cet état brut de la pensée, au risque du laconisme ou du partial instantané, qui fait la matière de ce journal : Si peu que rien, un journal qui, pour ce volume, couvre les treize mois qui vont de janvier 1994 à février 1995. Matière extrêmement grave de bout en bout, où on ne sent ici encore aucune complaisance envers une quelconque diversion, d’autant que ne sont conservés ici que les questionnements les plus ténus, de ceux qui se posent depuis l’origine à l’esprit embrouillé comme à l’esprit le plus éclairé, avec la même force et la même opacité.
Parfois une simple observation « le cri rauque, craquement, grincement, crécelle noire…. » [p. 117], elle se suffit à elle-même et nous met en présence. Parfois une remarque obscure, ou qui paraît telle, et l’on reste en dehors, circonspect, avec décision d’y revenir plus tard. Mais le plus souvent, c’est une formulation qui parle, une manière autre de repréciser, de tourner autour de cette question du rien plutôt que quelque chose, avec définition à l’appui, déclinable à l’infini, tout autant qu’insondable. À aucun moment, une trace de trivialité, rien que du concentré réflexif, et toujours solidement appuyé sur sa syntaxe. Cela tournerait presque à l’esprit de sérieux, si l’on voulait autrement s’en départir !
« Les évangiles ne nous montrent jamais le Christ en train de rire. Ni, à ma connaissance, aucun peintre en Occident…
[…] Le rire est un étrange orgasme, On éclate de rire…» [p. 51]
Ou n’est-ce pas plutôt ce refus de nommer, cette obsession de l’effacement, de la négation, de l’obstacle ? On peut parler à l’envi d’un horizon, mais lorsque c’est le mur au contraire qui obsède, on ne sait rien faire d’autre que rendre le mur. Chez Munier, le mur est toujours ce mur du rien ou du néant. Refus évident (sic) de l’incarnation, du corps et des organes, et mentalisation extrême, voilà qui n’aide pas à vivre ! Pas un hasard bien sûr si l’essai que Sébastien Hoët consacre à Roger Munier s’intitule Le monde sans moi 1. Dans cette étude virevoltante de l’auteur du recueil Des plus grands déserts (titre ô combien disciple de Munier !) paru aux mêmes éditions. Hoët souligne que chez Munier « l’aphorisme est béance qui défait la chose dans son sillage. » [p. 133] On ne se repose pas chez Munier, c’est un laboratoire, pas une chambre.
« La vie ne se perpétue qu’à la faveur du vivant, en consommant du vivant. C’est au prix de la mort qu’elle se voudrait immortelle. » [p. 110]
Dans un développement à propos de l’essai de Munier intitulé Contre l’image, où il est question d’une « image, de plus en plus parfaite techniquement, qui transmettra avec d’autant plus de force, à une humanité passive et extasiée, cette hypostase du monde machinal érigé dans sa différence » 2, Sébastien Hoët trouve un appui solide chez un ennemi implacable de Heidegger (dont Munier fut proche), Günther Anders, qu’il cite abondamment, ou encore chez Jacques Ellul.
C’est aussi, parmi d’autres, Simone Weil, qui est ici convoquée, afin d’envisager, par exemple, l’amour de Dieu pour l’homme, quand Munier écrit : « Dieu n’a pas de Soi. Il se cherche dans les ‘‘moi’’ » 3. Et si, en écho du cahier dont il est ici question, Hoët insiste sur l’importance du fragment et prend en compte le regard négatif de Blanchot sur l’aphorisme 4, c’est pour mieux défendre cette forme naturelle chez Munier, puisque : « seule l’écriture fragmentaire peut accueillir l’instant dans sa brièveté, sa rapidité. » 5
C’est au demeurant ce qui est à l’œuvre dans Si peu que rien, des instantanés qui n’en sont pas seulement, alors qu’on y perçoit la rumination soudain accélérée par le geste immédiat d’écrire.
« Le rien, comme rien : ne rien dire, ne rien faire… n’est jamais seulement ‘‘rien’’. Ne rien dire, ne rien faire, c’est encore dire et faire ‒ dans l’élément et comme la sourde épaisseur du ‘‘rien’’. » [p. 67]

*
Roger Munier, Si peu que rien, éditions Les Hauts-Fonds, 164 p., 2024, 21 €
Sébastien Hoët, Le monde sans moi, voir avec Roger Munier, éditions Les Haut-fonds, 172 p., 2024, 19 €
1) Reprise d’un titre de Roger Munier pour un article paru en revue en 2001.
2) Sébastien Hoët, Le monde sans moi, voir avec Roger Munier, p. 44-45.
3Roger Munier, cité in Le monde sans moi, p. 140.
4) « L’aphorisme est fermé et borné : l’horizontal de tout horizon. » (Maurice Blanchot, in L’entretien infini, cité in Le monde sans moi, p. 113).
5) Le monde sans moi, p. 112.



