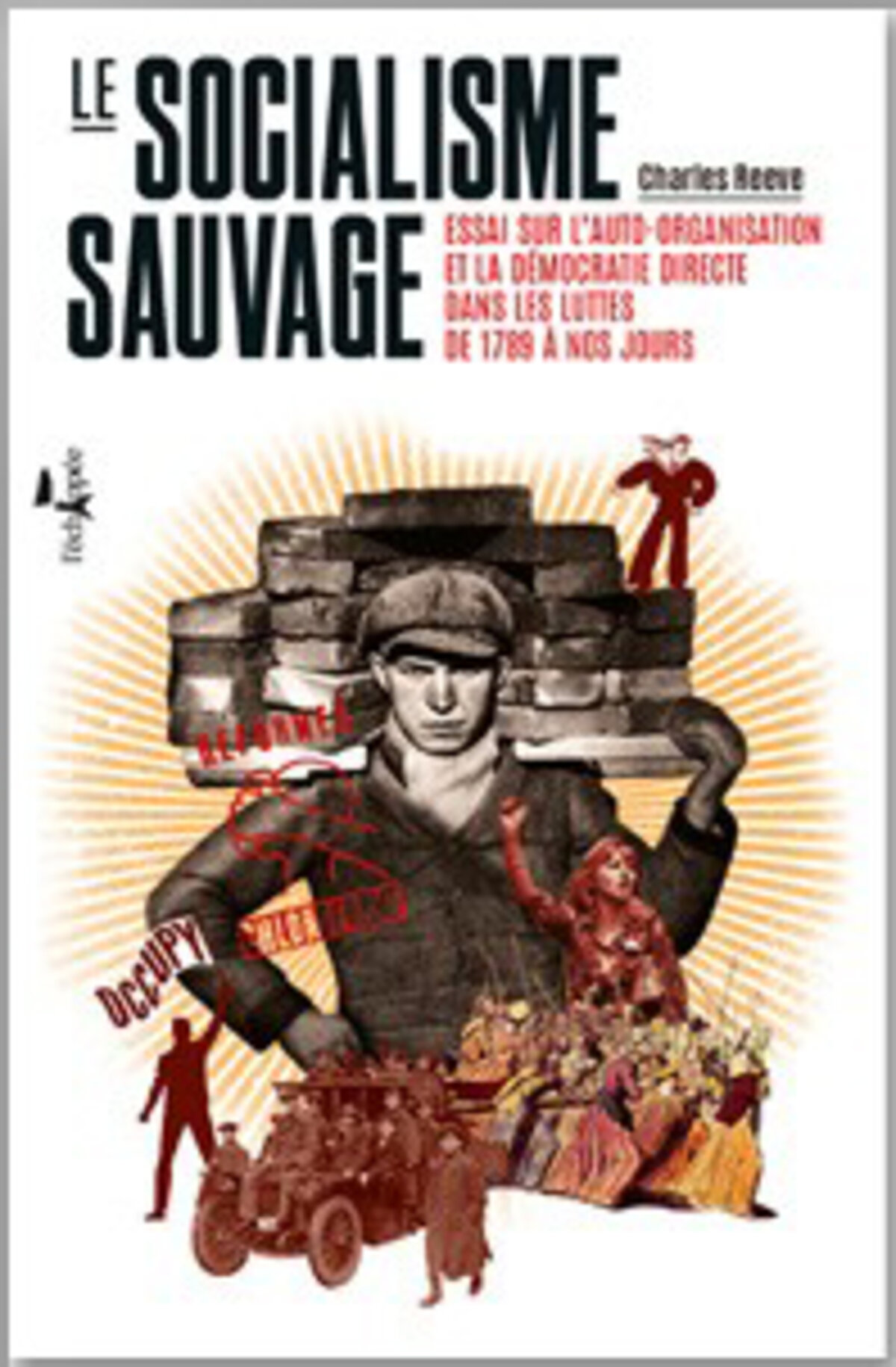
Puisque, comme on a pu le lire sur certains murs de nos villes il n’y a pas bien longtemps, une autre fin du monde est possible, voyons comment d’autres devenirs ont déjà été dessinés, esquissés, désirés lors des mouvements révolutionnaires passés. Retissons sur le canevas le plus courant les hétérodoxies du socialisme, ou ses mouvances toujours défaites, et voyons en quoi le discours habituel sur les vaincus de l’histoire pourrait laisser place à un récit plus énergique et inventif. Charles Reeve se propose ici d’éclairer une série de repères, de nous apprendre ou nous rappeler certains faits, certaines idées, certains personnages ou groupes, ou peuples, certaines forces en action.
Il nous rappelle qu’en France, durant la Révolution, c’est la pression populaire qui donnait le rythme, notamment dans les années 1792-1793. Cette vague insurrectionnelle, sous forme de Commune révolutionnaire de Paris, revendiquait un gouvernement direct du peuple. La méfiance qu’inspiraient aux gens de la Convention ces aspirations jugées trop radicales explique les dispositions prises à l’encontre de ces gens de peu. Il s’agissait, pour la bourgeoisie, de limiter la souveraineté populaire. Pour autant on peut affirmer avec Kropotkine que c’est au sein de la Révolution française que naquirent les mouvements communistes, socialistes et anarchistes 1.
L’opposition entre le centralisme et le fédéralisme qui marqua la révolution française remontait en fait à plus avant, où les féodalités provinciales s’affrontaient au centralisme autoritaire. Sur le front des idées nouvelles on retrouvera ce type d’antagonisme avec le clivage Proudhon/Marx dans le courant du siècle dix-neuvième. Quand les événements de 1871 à Paris surviennent, et la proclamation de la Commune par le comité central de la garde, les élus sont aussi bien jacobins que fédéralistes, et se disent tous collectivistes. Dans son analyse de cette séquence exceptionnelle Marx estimera que les principales mesures prises par les communards le furent en faveur de la classe moyenne, alors que c’étaient des ouvriers principalement qui avaient appuyé les événements. Ce peuple qui aurait pu « bien faire par lui-même 2».
« De plus en plus, l’impossibilité pour le peuple d’exercer pleinement son pouvoir et l’absence de démocratie directe révélaient les défauts du système parlementaire et dévoilaient l’inégalité sociale qui était son fondement. » En Allemagne, en Belgique, en Hollande et en Russie, dans les années 1900, l’idée de social-démocratie évoluait vers une vision hiérarchique, centralisatrice, où le parti incarne la conscience de classe, tandis qu’en France, en Italie et Espagne, « les membres des courants anti-autoritaires du mouvement socialiste, les anarchistes, gardèrent une forte présence dans le mouvement ouvrier et persistèrent à contester cette voie. »
Grande figure du socialisme, Rosa Luxembourg insistera sur le fait que l’éducation politique doit se faire dans la lutte. Elle s’oppose ainsi à l’autoritarisme du parti et constate une surestimation du rôle de l’organisation, en même temps qu’une « sous-estimation des prolétaires inorganisés ».
Quant à la révolution russe de 1917, si impérieuse, c’est à Cronstadt que fut balayé définitivement tout espoir d’en faire un événement émancipateur du peuple, des peuples. « Le système capitaliste d’État montrait son total antagonisme avec les principes de la démocratie directe, de la souveraineté des producteurs. […] Emma Goldman l’avait prédit : dorénavant « rien n’arrêterait la roue infernale de la machine communiste. »
Charles Reeve n’oublie pas l’épisode conseilliste en Allemagne, ni bien sûr la tragique révolution espagnole, il s’attarde aussi sur mai 1968 en France. On sait que ce furent alors les plus grandes grèves que connut le pays, et d’abord un mouvement étudiant à forte connotation révolutionnaire, quoiqu’en ont pu dire les directions syndicales, lesquelles s’appliquèrent à contrôler les événements et à ramener l’ordre initial. Le parti communiste français et la CGT ont toujours jugé sévèrement toute forme d’auto-organisation, tout devant plutôt passer, selon eux, par la science marxiste-léniniste.
« […] Cornélius Castoriadis insista sur ceci : ‘‘La question centrale de toute activité politique, et présente pendant mai 68, est la question de l’institution.’’ Pour lui ‘‘une formidable resocialisation’’, la recherche de ‘‘la vérité, la justice, la liberté, la communauté’’, ainsi que ‘‘le refus des formes d’organisation traditionnelles’’ caractérisèrent mai 68. »
Le même Castoriadis écrira plus tard : « Nous sommes là devant le nœud de la situation historique contemporaine. Les gens tirent de leur expérience la conclusion que les institutions ne peuvent être que des institutions de l’hétéronomie – concrètement, bureaucratiques – que donc il est futile d’essayer d’en créer d’autres. Par là même, ils renforcent et consolident l’existence de ces institutions que leur action aurait pu mettre en question s’ils pensaient et se comportaient autrement. 3 »
Bon connaisseur du Portugal, l’auteur4 consacre un chapitre à la révolution de 1974-1975, singulière puisqu’elle advint par le biais d’un coup d’État militaire renversant une dictature vieille de 50 ans, en guerre avec ses colonies. La marge de liberté recouvrée par le peuple lui suffit à se saisir de son sort ; des grèves, des revendications, des mutineries dans les casernes, le système colonial lui-même était mis en cause. Les militaires auteurs du coup d’État étaient dépassés. C’est le puissant parti communiste qui par la suite insista sur la nécessité de ne pas brûler les étapes. « ‘‘Le changement, ce n’est pas la révolution’’, précisait un de leurs slogans. »
Charles Reeve passe également par le Mexique et le Zapatisme, la littérature insurrectionnelle du Comité invisible et la révolution des communs qui pourrait lui faire contre poids. Pour Pierre Dardot et Christian Laval, auteur de Communs, essai sur la révolution au XXIe siècle5. « Ce terme de ‘‘communs’’ désigne non la résurgence d’une Idée communiste éternelle, mais l’émergence d’une façon nouvelle de contester le capitalisme, voire d’envisager son dépassement. […] Commun est le nom de principe qui anime cette activité collective et qui préside en même temps à la construction de cette forme d’auto-gouvernement. » En tous les cas, nous rappelle Charles Reeve : « La ‘‘prétendue’’ réalisation du commun par la propriété de l’État n’aura jamais été que la destruction du commun par l’État.6 »
De tous les mouvements sociaux visités dans ce livre, résumé subjectif et salubre effectué au galop de deux siècles et demi de soulèvements bafoués, l’auteur tire quelques enseignements, par exemple : « la lucidité est un élément de radicalité alors que tactiques et stratégies activistes ne sont que des machines à produire de l’optimisme momentané qui brouille l’horizon et engendre la désillusion de demain. »
La lucidité et l’action ! La vie…
*
1 Pierre Kropotkine, La grande révolution, éditions du Sextant, 2011.
2 Cette formule est de Robespierre, cité par Charles Reeve.
3 in préface de : Jean-Michel Denis, Les coordinations, Syllepse, 1996.
4 Charles Reeve est l’auteur du livre : Portugal, l’envers du décor d’Euroland, éditions L’Insomniaque, 2006.
5 Aux éditions La Découverte, 2014.
6 Pierre Dardot et Christian Laval, Les Communs, éditions La Découverte, 2014.



