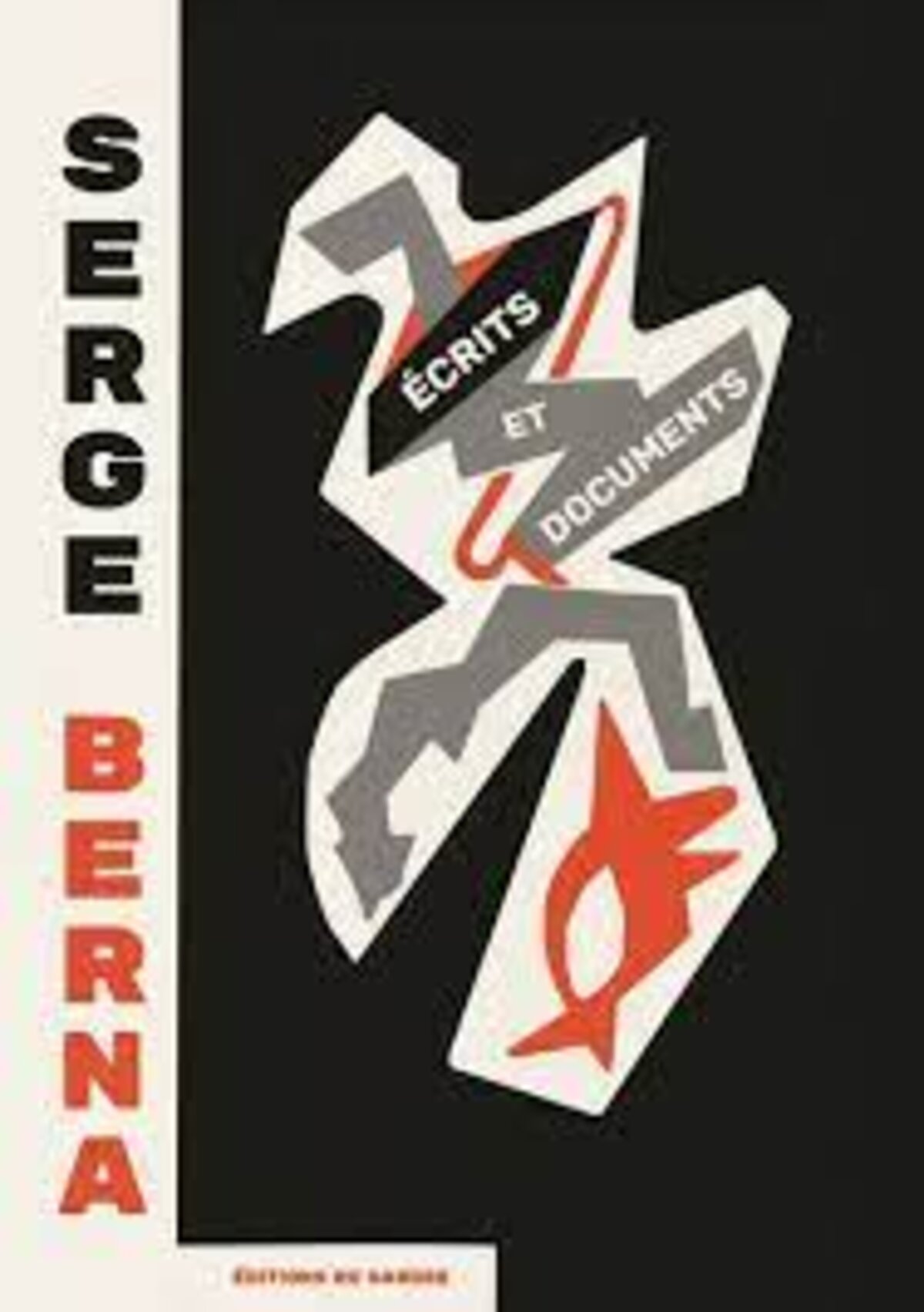
Le « scandale de Notre Dame » paraîtrait-il anodin aujourd’hui, alors que les provocations de tout style sont si nombreuses, souvent diligentées par les opérateurs du spectacle eux-mêmes, en vue de divertissement ? Une certaine histoire de l’agitation se plaît à conserver un bon souvenir de ce fait d’arme pratiqué sans autre arme que le verbe dressé contre la morale chrétienne et la prédominance cléricale. C’est que des trublions à la réputation de voyou osèrent, en ce dimanche de Pâques 1950, troubler la cérémonie pascale que conduisait l’archevêque de Paris, Monseigneur Feltin. L’athéisme comme outrance ou comme blasphème, ou encore comme respiration 1, chacun appréciera.
L’éructeur de cette diatribe bien sentie s’appelait Michel Moure, mais son auteur, c’était Serge Berna, figure assez mineure, quoique sémillante, d’une époque remuante et remuée, entre guerre mondiale et guerres coloniales, entre libération des uns et répressions des autres, un jeune voyou à la fois paresseux et inventif, nietzschéen et Lettriste.
Avant que le discours eut été prononcé tout à fait, les fidèles furieux avaient pourchassé les protagonistes du scandale 2, manquant de les lyncher. Vêtu d’une soutane de dominicain, Moure s’était en effet emparé du micro pour s’écrier comme de juste : « J’accuse l’église catholique d’infecter le monde de sa morale mortuaire, d’être le chancre de l’Occident décomposé ! » Requise et rapide, la police sauva les importuns de la sauvagerie des bigots pour mieux les ramasser à son tour, mais seul Michel Moure fut écroué, pour « entrave à libre exercice du culte » 3.
« Les jeunes fainéants crasseux de Saint-Germain ont cette fois été un peu loin. Il serait indiqué que la police s’occupe un peu de cette faune de pseudo-étudiants et de ratés que la jeunesse française, celle des ateliers et des facultés, méprise avec une vigueur que l’on partage aisément. » écrit L’Aurore (le 10 avril 1950) à propos de cette incursion somme toute joviale.
Ratés, justement certains d’entre eux se réclament avec enthousiasme du « club des ratés » fondé l’automne précédent, notamment par Serge Berna, qui se présentait dans un trac comme « syphilitique de gauche », car « il faut que chaque inadapté, chaque raté, chaque inutile constitue un canal d’écoulement qui vide la société, que chacun de nous soit en quelque sorte un court-circuit social » 4.
Il y a une bonne vingtaine d’années, Jean-Michel Mension, à l’occasion d’un livre d’entretiens accordé à Gérard Berréby pour les éditions Allia 5, avait évoqué Serge Berna. Presque en même temps paraissait en France l’essai de Greil Marcus, Lipstick Traces, onze ans après sa sortie aux États-Unis. Sous-titré Une histoire secrète du vingtième siècle, y sont fondus dans un même élan une série d’avant-gardes allant du Dadaïsme au Lettrisme et au Situationnisme, le tout articulé à partir du mouvement punk, de Johnny Rotten et des Sex Pistols ! On y croise Serge Berna en de nombreuses occurrences, et bien sûr à propos du scandale de Notre-Dame, raconté là aussi par le détail. Bien sûr, le nom Berna se trouve aussi dans le premier volume de la correspondance de Guy Debord.
Ce dernier n’avait-il pas commencé d’enregistrer avec Berna, entre autres, et sur un magnéto à fil, lors de la fameuse virée des Lettristes au festival de Cannes de 1952, un montage de leur cru présenté en tant que Promenade parmi les débris de l’ancienne poésie regroupant des vers d’Apollinaire, Breton, Desnos, Éluard, Mallarmé, Michaux, sans compter les sieurs Paul-Henri Michuard et Guillaume-Henri Michinaire (sic). Le tout sera finalisé l’année suivante s’appellera Les environs de Fresnes, « dédié à Serge Berna de l’Internationale lettriste, actuellement détenu n°2797 au fort de Cormeilles-en-Parisis ». Une partie de ce texte, qui ne manque pas de sel, est donnée dans le livre organisé par Jean-Louis Rançon pour les éditions du Sandre.
Cette même année le film de Debord Hurlements en faveur de Sade est projeté au ciné-club du Musée de l’homme, non sans être interrompu avec violence par le public et les dirigeants du ciné-club. Si le film ne comprend effectivement aucune image, on y entend plusieurs voix, dont celle de Serge Berna. Debord signait là une entrée en scène fracassante à souhait, s’inscrivant dans une négativité qu’il ne reniera par la suite.
Vu sa condamnation passée pour le vol d’un livre, le coffrage de Berna est l’occasion de le faire examiner par des experts psychiatres qui fourniront à l’intéressé en guise de pedigree de quoi l’habiller pour le reste de ses hivers, lisons plutôt : « Silhouette de fakir en gabardine. Physique d’employé de Pompes funèbres. Déficit du point de vue moral.. Sous-alimenté et autodidacte. » C’est évidemment une manière pour ces spécialistes de le rendre responsables et coupable de ses actes et de ceux qu’il pourrait commettre par la suite. À l’inverse de la plupart des périodiques, si enclins à renforcer le travail des polices, le journal Libération, celui qu’avaient fondé Emmanuel Dastier et Jean Cavaillès, ne verra dans ce bilan qu’« élucubration forcenées », apportant quelques précisions sur le parcours de Berna : « La conduite de Berna sous l’occupation fut des plus honorables. Incorporé de force dans l’armée allemande comme sujet lorrain, il déserte et s’engage dans le Forces Française Libres… » Quelques années plus tard, en dépit du diagnostic désobligeant des experts, le résistant se fait compagnon des premiers Lettristes et participe en 1950, quelque temps après le « scandale de Notre-dame », à la revue Ur, où il signe deux textes, dont l’un, non achevé, qui devait être l’amorce d’un essai sur l’esthétique du scandale…
« […]
Je marchais lentement dans l’or. Je flottais dans le velouté de ces cantiques. Les peaux et les voix trop hautes coulaient dans les lisières des gazons entretenus comme Arlette par son commanditaire en gros. Les strates épaisses successives des corps, des odeurs se balançaient sur les bilboquets noirs : flics, prêtres… En fait, on s’emmerdait un peu à attendre ce fameux moment propice : c’était bourré de flics et on était un peu visibles, nantis de chemises à carreaux et d’espadrilles (une nuit je me levai et je pissai dans la cheminée ; du milieu de la cendre glaireuse et des souches très noires ont jailli quelques courtes flammes multicolores absolument inattendues qui firent crier de malaise les morts humides) dans un coin très fourni en populace. Plein le dos de regarder là-bas, vers le fond, par-dessus la ligne sombre des orphelins, vers l’autel comme une noce de jaunes, de rouges, de violets avec des individus rôdant autour d’une tige de fer blanche dressée sur une tête triangulaire… »
En 1952, au débouché de l’épisode cannois, le mouvement lettriste se scinde en trois groupes : le groupe dit « externiste », composé notamment de Yolande du Luard et Marc’O (producteur du premier film d’Isou et futur auteur de la pièce et du film Les idoles (1965, 1966) qui publie le périodique Soulèvement pour la jeunesse ; le groupe des « Lettristes esthètes », avec Isidore Isou, Maurice Lemaître et Gabriel Pomerand ; le groupe « L’Internationale lettriste », organisation de gauche fondée par Guy Debord et Gil J Wolman, que rejoignent Jean-Louis Brau et Serge Berna.
Cette même année, L’internationale lettriste rédige et diffuse le tract Finis les pieds plats, attaquant violemment Charlie Chaplin alors de passage à Paris pour la promotion de Limelight. Qu’on en juge par l’entame : « Cinéaste sous-Max Sennett, acteur sous-Mac Linder, Stavisky des larmes des filles-mères abandonnées et des petits orphelins d’Auteuil, vous êtes, Chaplin, l’escroc aux sentiments, le maître-chanteur de la souffrance... »
Le texte ajoute, assez inconsidérément : « … nous ne croyons pas aux persécutions absurdes dont vous seriez victime. » Désapprouvant la démarche, Isou, Lemaître et Pomerand se désolidarisent publiquement (dans le journal Combat).
En cette même année, Berna compose ce qu’il appelle un « roman-film influentiel », Les jeux de l’amour et du hasard, montage de photos d’actrice et d’acteurs, extraits de chansons, de romans de chevalerie, de poèmes. L’œuvre est restée inédite, retrouvée dans les archives de Gil J Wolman.
Par ailleurs, accompagnant un ami récureur de caves et de greniers qui « avait dans la vie connu beaucoup plus de fonds de verres que de marques d’estime de la part de ses concitoyens », Berna découvre des manuscrits d’Antonin Artaud dans un grenier de la rue Visconti, il s’empresse de les négocier. Vie et mort de Satan le feu paraîtra l’année suivante aux éditions Arcanes, sous les bons auspices d’Éric Losfeld. Entre-temps, Berna a dû effectuer une peine de six mois ferme (prononcée en 1949) à la prison de Fresnes, puis à Cormeilles-en-Parisis. Dans une lettre à son ami Gil J Wolman, il raconte sa nouvelle arrestation : « 26 décembre. Gueule de bois, huit heures du matin, un inspecteur frappe à la porte du n°13 rue Guisarde, j’ouvre, fort de cette innocence inébranlable qui fait mon charme, il déplie comme un hérault [sic] un parchemin sale et me lit avec hiératisme que je dois aller en prison pour six mois… » Dans une autre lettre au même Wolman, qui lui vient en aide par mandats interposés 6 : « Je crois que tu es en train de travailler à une ‘‘œuvre’’, et je crois que c’est ce qu’il y a de ‘‘moins pire’’ à faire dans la vie, pour ma part, j’ajoute journellement quelques pages à ceci ou cela, mais je n’ai pas le cœur encore bien accroché. »
Parce qu’il s’agit de remettre le décor à sa place, les éléments dans leur époque, voyons les Repères chronologiques qui bouclent à bon escient ce volume Serge Berna, Écrits et documents. On y apprend, par exemple, que c’est en janvier 1953 que l’inscription « Ne travaillez jamais » fut portée sur un mur de la rue de Seine par Guy Debord, avec le succès que l’on sait 7.
En juin 1954, L’Internationale lettriste publie le n° 2 de la revue Potlach, stipulant dans ses dernières pages l’élimination de la vieille garde se poursuit. Isou est exclu en tant qu’individu moralement rétrograde, Pomerand pour être un falsificateur, Ivan Chtchegloff, pour mythomanie, délire d’interprétation et manque de conscience révolutionnaire, Mension pour être seulement décoratif, Berna pour manque de rigueur intellectuelle 8.
En 1955, alors qu’ils publieront bientôt des textes de Debord sur la géographie urbaine dans leur revue Les Lèvres nues, les surréalistes belges donnent à lire un récit du scandale de Notre-Dame, soulignant que : « Bien que le surréalisme n’ait point été évoqué, il est manifeste que le scandale de Notre-dame relève directement de son exemple, de son esprit, et qu’il apparaît un peu comme le couronnement de toutes les manifestations de cet ordre, aucun précédent n’ayant pareil envergure. » De son côté, Serge Berna publie le premier numéro de sa revue En marge (sous-titrée revue des refus). On peut y lire Berna, mais aussi Henri Pastoureau, François Dufrêne, Gaston Criel et quelques autres. En vue d’un deuxième numéro (qui ne verra jamais le jour), Berna sollicite notamment Étiemble, qui vient de publier Littérature dégagée, second tome de son Hygiène des lettres, qu’il a, semble-t-il, beaucoup apprécié.
Par la suite, ayant renoncé à l’édition et à l’écriture, Berna se lance dans les arts plastiques, on le trouve à Nice en 1959 lors d’une exposition dont il a pris l’initiative et intitulée « Nouvelle école de Paris ». Ses vieux camarades lettristes, Gil J Wolman et Jean-Louis Brau, sont de l’aventure. À propos de Berna, Nice-Matin (15 août 1955) écrit : « Ses expositions en 1957 à Alger et à Oran puis récemment à Forcalquier ont eu un certain retentissement ainsi d’ailleurs que ses conférences sur les étapes de peinture moderne dont la conclusion est toujours : ‘‘L’art pictural doit être un amalgame peinture-poésie’’. »
Selon le témoignage du peintre Michel Gribinski, recueilli en 2021, qui a connu Berna à Saint-Tropez en août 1959, celui-ci expliquait qu’il avait inventé une technique permettant de faire « très vite des tableaux et des formes nouvelles […] Il s’agissait de peindre à plat sur du Panolac […] que l’on couvrait de vernis à tableau et, tandis qu’il était encore liquide, on y ajoutait des piments, dilués ou non dans la térébenthine. » Il semble toutefois qu’aucune des peintures de Berna n’ait été conservée.
En 1960, Berna est de nouveau condamné, André Breton témoigne en sa faveur lors d’un procès en appel, le soutient, la peine est réduite à 24 mois, au lieu de 30. Il est écroué aux Baumettes en avril 1961, remercie Breton pour son soutien : « … Ce qui est remarquable en prison, [lui écrit-il] : la longue immobilité et le tête-à-tête prolongé avec les mots qu’on écrit permet (sic) de revenir à certaines sources d’énergie qui reviennent sur les mots ‒ il y avait assez longtemps que la veine poétique s’était renfouie et la voilà de nouveau à jour, certains jours... »
En novembre de la même année, il est libéré. Ensuite, plus rien, plus de traces de Serge Berna. On ne sait rien. S’il vivait encore aujourd’hui, il aurait 100 ans !
* * *
Serge Berna, Écrits et document, éditions établie par Jean-Louis Rançon pour les éditions du Sandre, 210 p., 2024, 35 €.
1) Parlerait-on aujourd’hui d’« arme par destination » ?
2) Outre Michel Moure, on pouvait compter Jean Rullier, Guillain Desnoyers de Marbaix, et donc… Serge Berna.
3) Ce n’est pas innocemment que Michel Moure a revêtu cette panoplie, il a en effet effectué lui-même un noviciat au couvent dominicain de Saint-Maximin près de Toulon, avant de s’en extraire incidemment athée. Cependant, déconcertant tous ses soutiens, Moure se repend et revient bientôt à sa foi dans le Christ, il publie alors un ouvrage ouvertement réactionnaire et catholique aux éditions Julliard (1951) : Malgré le blasphème.
4) À propos du club des ratés et du rapport au travail, Jean-Michel Mension déclare dans La Tribu [p. 86] : « tout le monde n’était pas escroc ‒ Berna, lui, oui ‒ , mais il fallait vivre, il ne fallait pas travailler non plus, on avait l’air con si on travaillait, ce n’était pas des choses à faire à l’époque, on se déconsidérait. »
5) Cf. Jean-Michel Mension, La Tribu, Allia, 1998.
6) Mme Moineau sert aussi d’intermédiaire à l’occasion. La fameuse Mme Moineau, du café « Chez Moineau » qui fut très fréquenté des Lettristes, puis des Situationnistes en cette période ‒ Jean-Michel Mension l’évoque dans La Tribu (éditions Allia, 1998)… Voir aussi Patrick Straram, Les bouteilles se couchent (Allia 2006).
7) Dans l’ouvrage Un Paris révolutionnaire (Les Éditions libertaires, 2019), dirigée par Claire Auzias (disparue au début d’août 2024), la notice (rédigée par Benoist Rey) consacrée à Jean-Michel Mension le décrit comme un écrivain des murs et lui attribue la première occurrence de cette injonction majuscule que Debord se serait ensuite appropriée. Il semble pourtant, d’après Christophe Bourseiller, qui l’a interviewé, que Mension n’ait pas été très sûr de sa mémoire. Cf. Ch. Bourseiller, Vie et mort de Guy Debord, éditions Plon, 1999, p.67-68.
8) Cf. Potlach, éditions Gallimard/Folio, 1996, p. 21.



