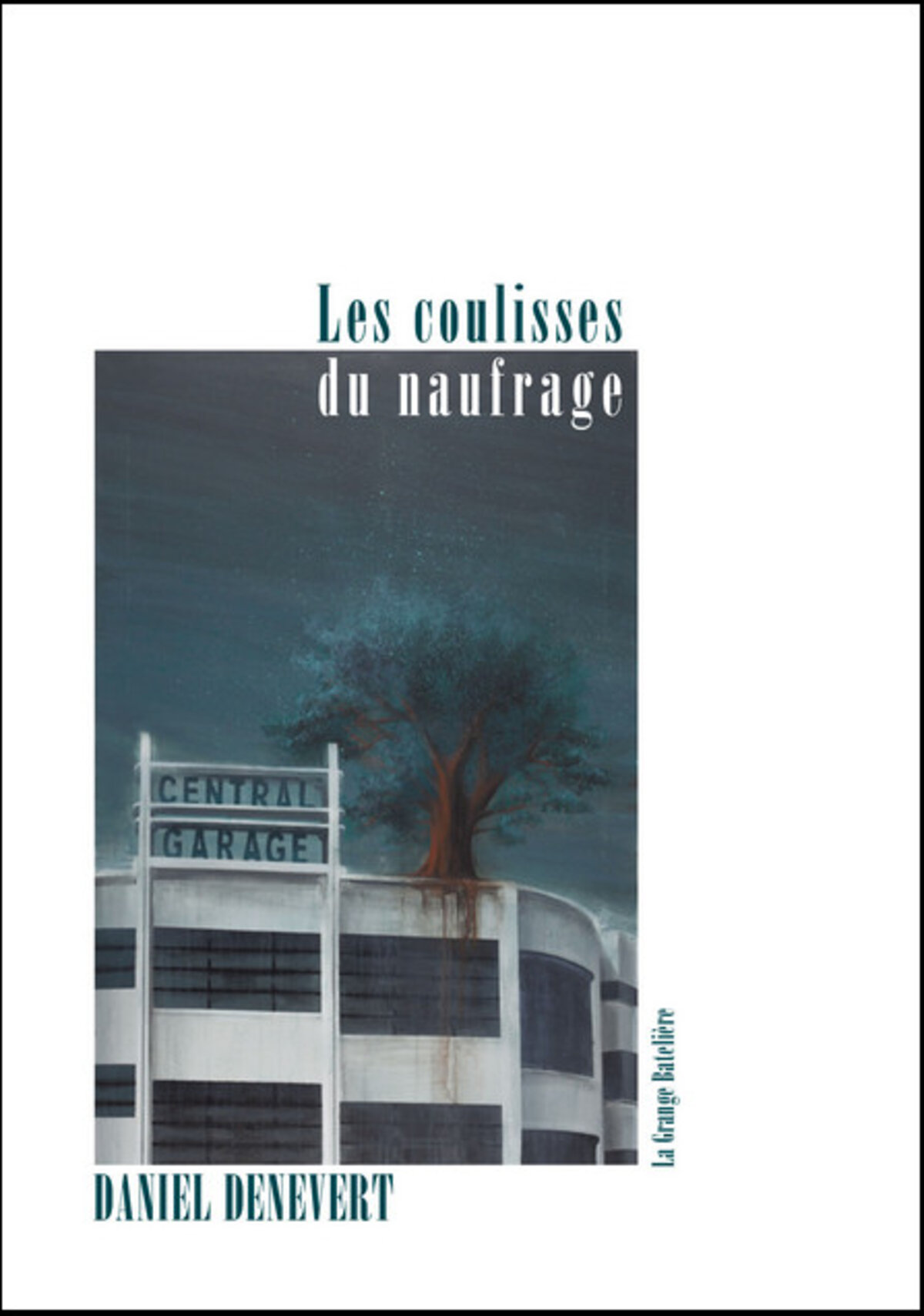
Agrandissement : Illustration 1
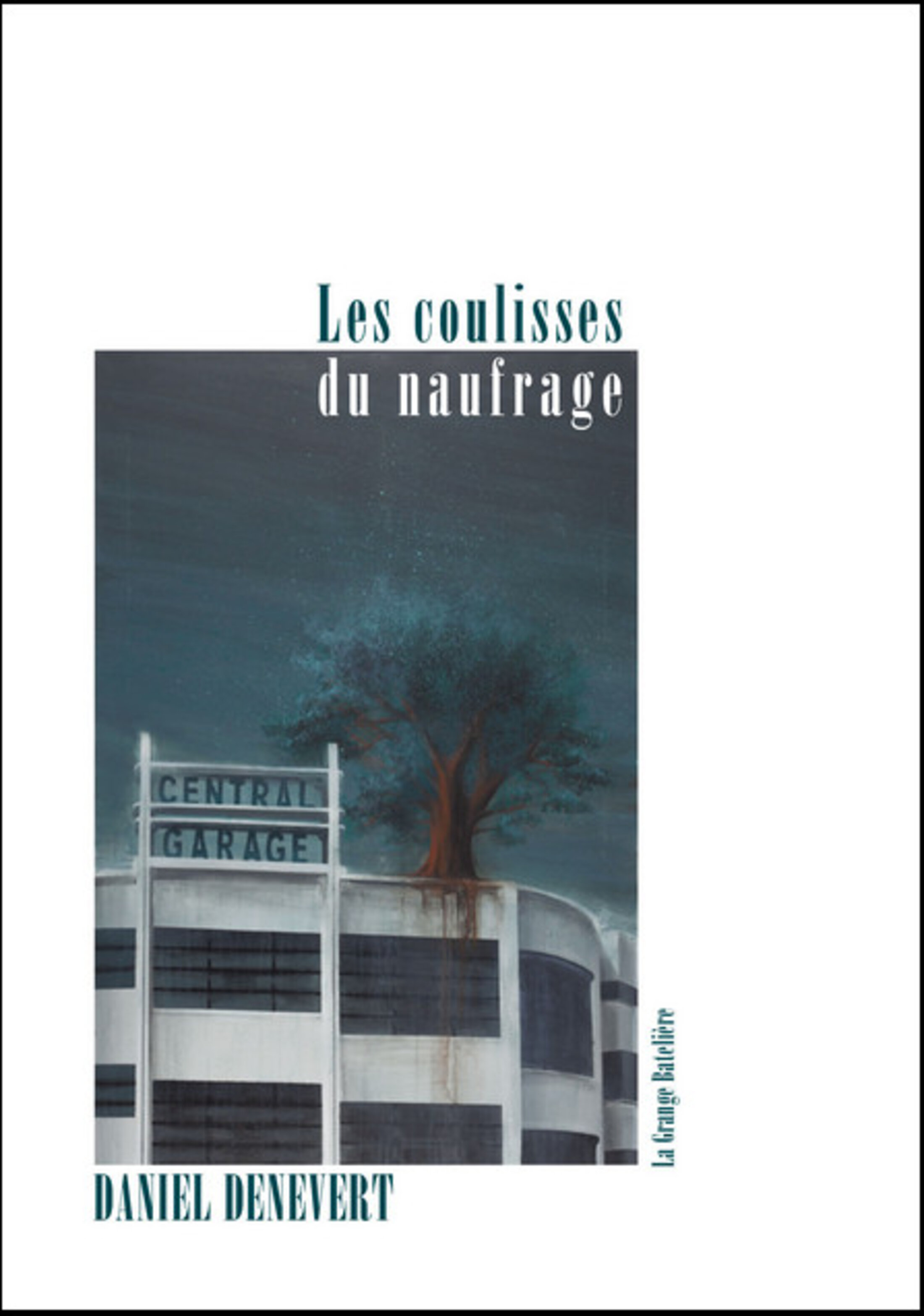
Il y a deux ans Daniel Denevert publiait un recueil d’articles remarquables sur les temps qui sont les nôtres. D’abord parus dans des feuilles locales et/ou militantes, ces textes mis ensemble déroulaient une critique sans concession dont on ne sait malheureusement trop que faire, sinon remercier son auteur de nous montrer combien nos révoltes et nos humeurs ne sont ni absurdes ni solitaires.
Est-ce le succès de cet opus ? toujours est-il que son éditeur, La Grange Batelière, sort un deuxième volume comprenant des textes d’intervention plus récents. C’est ainsi qu’on peut lire, par exemple, Pandémie mon amour, qui constitue sans doute un des morceaux de choix de ce nouvel ensemble. Rédigé d’une main qui aime écrire et le fait très bien, c’est le meilleur tableau dressé de la crise pandémique actuelle. La largeur de vue autorise la largeur d’attaque et à son auteur fait prendre en considération un panel intéressant des travers qui ont fini par faire obstacle à la mondialisation heureuse rêvée par les affairistes et leurs multiples cautions, l’obstacle n’étant ici que l’envers de la route. S’il décrit à son tour les défauts de la cuirasse étatico-libérale, non sans condamner sous cape le principe même du capitalisme ou de l’État, il porte aussi le fer là où peu d’entre nous songent à se risquer. Quand il note, par exemple, à quel point le comportementalisme du corps médical (« dû sans doute à l’habitude prescriptive ») s’accorde bien avec le « comportementalisme d’État ». Quand il parle du modèle omniprésent de la « ville-monde » (plus de 10 millions d’habitants), « idéal architectural de la démence affairiste, qui menace à présent de finir en tombeau dans lequel le système va s’ensevelir. Le Covid n’est probablement qu’une première sommation, parmi les plus douces qui nous attendent. » 1 Quand il nous ramène quelques années en arrière, au moment où l’ordinateur se généralise et chamboule la société, « à partir de ce moment-là le temps libre commença à s’organiser à la maison autour du même outil que sur le lieu de travail », on peut dire qu’il ne fait pas de cadeau à notre paresse intellectuelle et c’est tant mieux. Jusqu’à nous rappeler qu’« il faut toute la vanité de l’Occident et avoir oublié la fameuse dialectique du maître et de l’esclave ressassée dans les classes de terminales pour s’imaginer qu’un Chinois à qui l’on confie la charge technique de produire tous les biens essentiels restera longtemps votre obligé. L’artificialisation générale des besoins fabriqués de toutes pièces au gré de la conjoncture, la frénésie consumériste des services immatériels et du divertissement ne font que faire écho au reste. » 2
Si les guerres à venir s’armeront de robots connectés tout à fait docile (ils sont déjà presque au point), il faudra toutefois les alimenter à l’électricité, la solution nucléaire encore une fois s’imposera pour le meilleur, c’est-à-dire pour le pire. Dans un autre article de ce volume, Daniel Denevert ouvre un œil espiègle sur un entretien accordé par le président de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), organisme qu’on aime désormais présenter comme indépendant (il l’a été moins, il est vrai) au quotidien Le Monde. Et bien sûr, il a beau jeu de rappeler dans quel pétrin se trouve la filière française, notamment à travers la somme des « incidents » de parcours des chantiers EPR, pourtant programme étendard indéfectible des forcenés hexagonaux de l’atome. La gabegie comptable de cette fuite en avant industrielle atteint de tels niveaux qu’on n’a plus d’autre choix que de les justifier davantage, comme pour toute imposture dont on pourrait se sentir responsable. Si, avec les faillites d’Areva et d’EDF (renflouée de justesse par la force publique) le consortium nucléaire a perdu toute crédibilité, il s’efforce néanmoins de ne pas perdre la face et poursuit ses objectifs irrémédiables. Denevert nous rappelle, en guise d’exemple, l’ambition de ces mêmes funestes gougnafiers d’installer en Inde une centrale de neuf mille neuf cents mégawatts, soit de quoi alimenter plus de deux fois toute la population française, sachant la centrale serait située exactement… sur une faille sismique !
Avec des manières, le président de l’ASN dresse un constat globalement satisfaisant de la situation. La gestion de la crise sanitaire en cours s’est bien passée, d’autant que les contrôles n’ont pas pu être effectués, sinon à distance. Exception à ce bilan idéal : le centre de La Hague où « les salariés, apparemment plus impressionnés par le Covid que par le plutonium, ont exercé leur droit de retrait et mis une installation de retraitement à l’arrêt. La Hague dont on dit en passant que les piscines sont complètement saturées, de même que tous les autres sites d’entreposage de déchets sur le sol français. Un détail de peu d’importance, quand on sait qu’EDF s’apprête à sortir de ses cartons un projet providentiel de super-piscine “centralisée” » dont on envie par avance les futurs riverains. » 3
Poursuivant sa lecture de l’entretien, Denevert se paie gentiment l’expert chargé de rassurer tout en ne mentant pas trop. « Avec la rouerie d’un père jésuite et la formule très choisie de “déficit de culture de précaution”, notre homme va dresser à son corps défendant un tableau proprement ahurissant du domaine dont il a la charge. On y apprend que la production d’électricité est à sa capacité maximale, ce qui laisse peu de marge pour réagir en cas d’accident sur une centrale. “Il serait difficile de prendre des décisions de sûreté qui nous conduirait à demander l’arrêt d’un ou de plusieurs réacteurs.” On découvre de même que les capacités d’ingénierie d’EDF sont à saturation, alors que de nombreuses interventions liées à la prolongation de la durée de vie des réacteurs sont nécessaires. Le doute plane sur la capacité à assurer leur réexamen. C’est le responsable de l’ASN qui le dit ! » 4
Quand on voit ce que donne en milieu hospitalier des « capacités à saturation » en cas de crise, on imagine trop bien dans quelle panade se retrouvera la population si un accident survient.
Texte sur Lubrizol, texte sur les Gilets jaunes, texte sur les projets qui s’annoncent sur le plateau de Millevaches – « apprendre par voie de presse ce qui se prépare à côté de chez vous est toujours mauvais signe », il y a ici et ainsi rassemblés une petite dizaine de tableaux fort bien tournés, sentis. Et pour conclure ce volume, la bonne idée que de reprendre un passionnant entretien accordé à Lundi matin en décembre 2018.
« Dans sa forme générale, la marche de ce monde est un outrage permanent à la raison, chacun peut s’en convaincre. Mais l’affirmer comme je viens de le faire, c’est encore de la généralité. À l’opposé, le sentiment de révolte par lequel tout commence, la texture de notre subjectivité, le début d’une intelligence, se forgent à travers notre immersion dans les détails. La révolte est une réalité singulière, elle procède du ressenti existentiel. C’est que dans notre rapport physique au monde, le détail constitue pour nous le seul milieu sensible. Le dévoilement du sens général, l’abstraction, vient plus tard. Piégés au milieu des détails, c’est par inférence que nous devons risquer notre compréhension du monde. Voilà pourquoi, je trouve nécessaire et stimulant de s’attarder dans les détails pour mettre une théorie à l’épreuve. »5
* * *
Daniel Denevert, Les coulisses du désastre, édition de La Grange Batelière, 2020. 10 €
Voir le site de l'éditeur : ici
1) Daniel Denevert, Les coulisses du désastre, p 51.
2) Ibid. p. 57
3) Ibid. p. 40-41.
4) Ibid. p. 41-42.
5) Ibid. p. 116. ou voir sur LM



