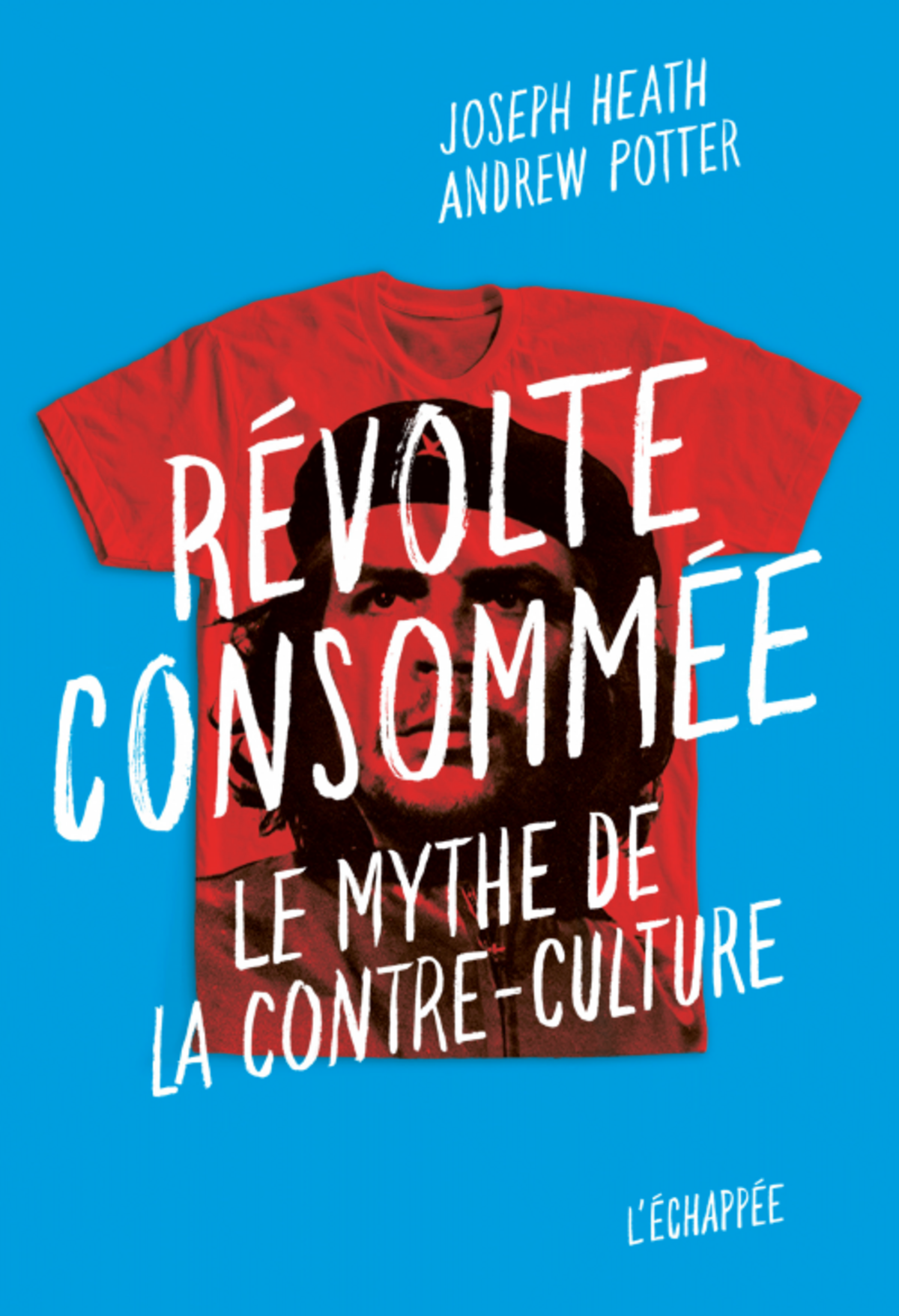
Agrandissement : Illustration 1
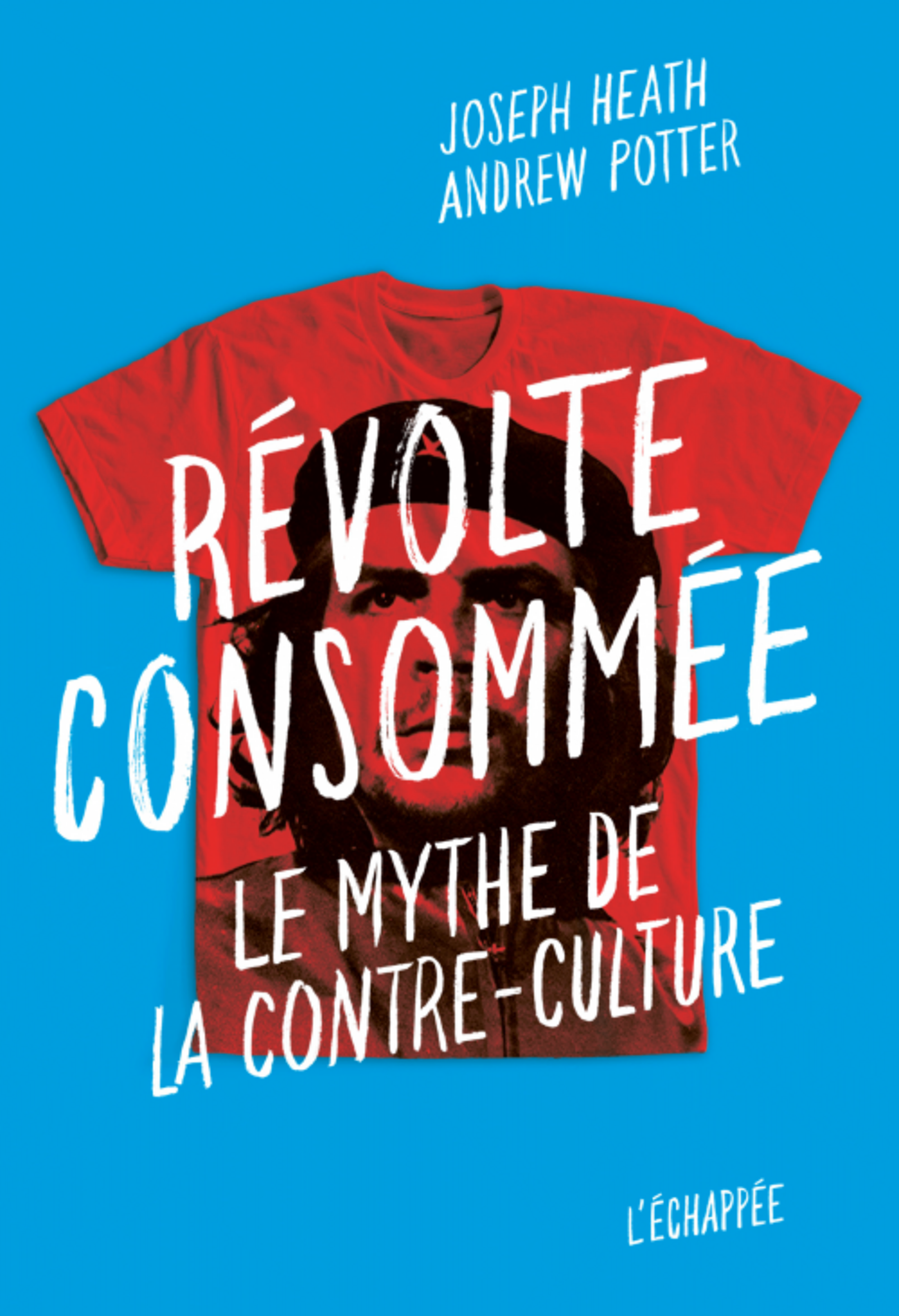
« On peut se poser la question : le style contre-culturelle 1960 et 1970 a-t-il été produit par les rebelles ou par l’industrie de la mode ? Les rebelles répétaient que l’industrie récupéraient leur style, mais la vérité est beaucoup plus complexe. Même si certains mode ont pris naissance dans la rue avant d’arriver plus tard dans les boutiques, beaucoup plus de styles ont été créés par l’industrie pour se retrouver dans la rue. »1
On se souvient qu’un livre fameux de deux sociologues français nous avait expliqué combien des idées de mai 68 avait pu être réintroduite dans le marché pour son plus grand profit, combien les demandes de la critique artiste avaient été satisfaites au dépens des attentes de la critique sociale2. La machine capitaliste avait été plus stimulée que contrariée par la contestation du moment. Voici qu’un essai américain (datant de 2004 et réédité aujourd’hui en France) nous propose de regarder l’effet ou le contre-effet du phénomène de la contre-culture, laquelle connut un large succès non seulement aux États-Unis mais aussi en France et en Europe.
« Dans son livre Le Regain américain, l’universitaire Charles Reich écrit ‘‘La révolution doit être culturelle. Car c’est la culture qui contrôle la mécanique économique et politique, et non pas l’inverse. Actuellement […] la mécanique produit ce qu’elle veut et oblige les gens à acheter. Mais si la culture change, la mécanique n’a plus qu’ ‘à se soumettre.’’ Et personne ne s’est indigné d’entendre les Beatles chanter dans leur morceau Revolution qu’au lieu de changer la Constitution ou n’importe quelle institution, mieux valait libérer son esprit. »3
Pour les auteurs de Révolte consommée, Joseph Heath et Andrew Potter, la consommation n’a cessé d’être un marqueur social. Quand je me décide pour un produit qui me semble hors système, j’ai beau avoir la vague impression de ne pas cautionner ainsi le capitalisme dominant, je n’en contribue pas moins à le nourrir, vu qu’il a toujours un coup d’avance et que les produits alternatifs ne sont en fait que des produits candidats à la première place. Le tout est de toujours ringardiser un produit et qu’il apparaisse soudain dépassé à l’acheteur qui se veut à la page. Pour développer ce thème, les auteurs font largement appel aux thèses que Bourdieu a développé dans son essai : La Distinction.
Ce qui est globalement exposé ici avec beaucoup de conviction et à partir de nombreux exemples (américains), c’est qu’« il n’y a jamais eu de contradiction entre les idées contre-culturelles qui ont nourri les rebellions des années 1960 et le capitalisme ». En effet, « l’idéologie hippie et l’idéologie yuppie ne sont qu’une seule et même chose ». Par son allant disruptif, et en dépit d’un discours qu’elle pouvait tenir avec la plus grande sincérité, la jeunesse rebelle des années 60 n’allaient pas tant contre le système qu’elle ne le motivait davantage. On ne peut vraiment dire que les désirs ou les compulsions étaient récupérés, ils étaient plutôt l’inspirateur des formes à venir, des nouvelles modes. L’aubaine des entrepreneurs en quête d’idées pour s’étendre et grossir encore.
Par ailleurs, Joseph Heath et Andrew Potter racontent à quel point les thèses d’un activiste radical et solitaire tel que Ted Kaczynski (le fameux Unabomber)4 sont en fait proches de celles d’un politicien aussi convenable que Al Gore, même si les moyens employés pour les faire connaître divergent. Critique du développement technologique et industriel et convictions que l’action à mener doit se faire directement contre l’économie elle-même et ses ressorts plutôt qu’au sein de la sphère des décideurs en place. Occasion de rappeler au passage que, parmi les minorités en lutte pour leur reconnaissance et l’égalité, les militants les plus adeptes de la violence ont toujours trouvé davantage de soutien chez des blancs majoritaires à l’abri de toute retombée qu’au sein de leur propre communauté. Au nom d’une esthétique de la lutte politique et du combat proprement dit, on peut très bien, lorsqu’on est protégé par son ascendance ou sa condition sociale, être séduit et prôner à son tour des moyens expéditifs sans jamais encourir le risque d’en supporter l’inconvénient.
Pour nos deux auteurs, si la « pensée contre-culturelle a « engendré » une certaine naïveté face au crime », elle a aussi idéalisé la maladie mentale, la folie. En extrapolant les thèses l’antipsychiatrie, qui pointait des coercitions bien réelles, elle a aussi oublié qu’il y avait aussi de grande souffrance chez le malade mental, et pas seulement des tentatives hors-normes ou des phénomènes de subversion. Au demeurant, ces ressorts de subversion, même soutenus par d’autres et très en vogue, n’ont jusqu’à maintenant pas produit d’effets transformateurs sur le monde réel qui, quoique mis en cause et attaqué, n’a cessé au contraire de renforcer.
La contre-culture, c’est aussi une recherche intérieure plus ou moins authentiques qui semble ne pouvoir se faire sans un détour par des cultures et des sources d’inspiration exotiques. L’Inde traditionnelle constitue à cet égard un marché à disposition, avec ses raffinements, et ses attraits – on se souvient de l’engouement d’alors pour cette destination. Plus largement, le tourisme vise toujours à fournir une dose d’authenticité au consommateur, alors même qu’il se persuade que ce qu’il vit ne relève pas de la consommation, mais de la pure relation. Parallèlement à la généralisation de ce tourisme de masse déguisé en masse d’expériences personnelles, on a vu croître aussi bien les médecines alternatives que les chiffres d’affaires qui leur sont liés. Autant de diversions qui interdisent peut-être l’évolution d’un système de sanitaire cohérent et crédible. Aux États-Unis le système public de santé est, on le sait, calamiteux, tandis que les médecines alternatives et privés sont florissantes, les auteurs de Révolte consommée y suggère un effet de cause à effet qu’ils ne se donnent cependant pas trop la peine d’étayer.
Le problème de la société actuelle n’est pas tant qu’elle produise des impasses que le fait qu’elle a suscité chez chacun, souvent à son corps défendant, ce désir d’en arriver là. D’une manière générale, c’est à un matérialisme toujours plus accru que nous pousse le consumérisme, même le plus avancé, qu’on le veuille ou non, qu’on soit persuadé ou non de consommer selon un mode vertueux ou pas.
Ce que semble avoir choisi d’ignorer Joseph Heath et Andrew Potter, c’est que la « contre-culture » n’a pas été qu’une imposture, elle a aussi été pour certains une voie de transformation de leur mode de vie, avec un épanouissement réel et des tentatives authentiques menées parfois à bien. Pas que naïveté dans tout cela, ni même échec, dans bien des cas. Certes la potentialité subversive d’une série de destins individuels ou même communautaires n’a pas à être fantasmée, elle est quasi nulle, mais l’écarter comme inexistante, c’est risquer de simplifier à outrance une histoire contemporaine qui n’en a pas besoin.
Dans la préface à cette édition, les auteurs actualisent en partie leur propos et soulignent que l’importance du consumérisme a diminué aujourd’hui parce que les réseaux sociaux ont substitué à la possession des objets, la représentation de cette possession, il n’est plus autant besoin de posséder mais besoin de se montrer avec ou de montrer que l’on a. L’image compte davantage, elle est le vecteur, tandis que le mode de vie matérialiste a été démonétisé par la baisse des prix moyens des marchandises due à la production reléguée dans des pays à bas coût de production.
Les changements semble découler davantage de causes techniques et macro-économiques en rapport avec à la systématisation du commerce mondialisé qu’à la vertu des critiques du consumérisme, sans compter la virtualisation des échanges et la valorisation des flux et des usages. Nous voyons bien aujourd'hui qu’un grain de sable presque immatériel, pourvu qu’il soit dissuasif, glissé dans les rouages de la machine peut suffire à mettre à l’arrêt la production. Qui sait, du « toujours plus » ou du « beaucoup moins », où se portera demain le désir humain ? Celui d’un seul ou celui de tous
* * *
Joseph Heath et Andrew Potter, Révolution consommée, le mythe de la contre-culture, éditions L’Échappée, 2020. 20 €
Voir sur le site de l'éditeur ⇒
1) Joseph Heath et Andrew Potter, Révolution consommée, éditions L’Échappée, p. 177
2) Il est bien sûr question ici du livre de Boltanski et Chapiello : Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.
3) Joseph Heath et Andrew Potter, Révolution consommée, éditions L’Échappée, p. 76-77.
4) Peut-être rappeler que Unamomber, mathématicien américain, s’est fait connaître par son manifeste anti-industriel dont il imposa la lecture alors qu’il commettait des attentats à l’encontre de personnalités attachées au développement technologique, sous forme de colis piégés, tuant trois personnes et en en blessant une quinzaine d’autres. La traque du FBI pour l’attraper dura les 18 années durant lesquelles il opéra. En 1996, il a été arrêté en 1996 et condamné deux ans plus tard à la prison à perpétuité.



