« Je voulais à tout prix quitter mon âge pour obtenir une nouvelle nature. » [p. 37]
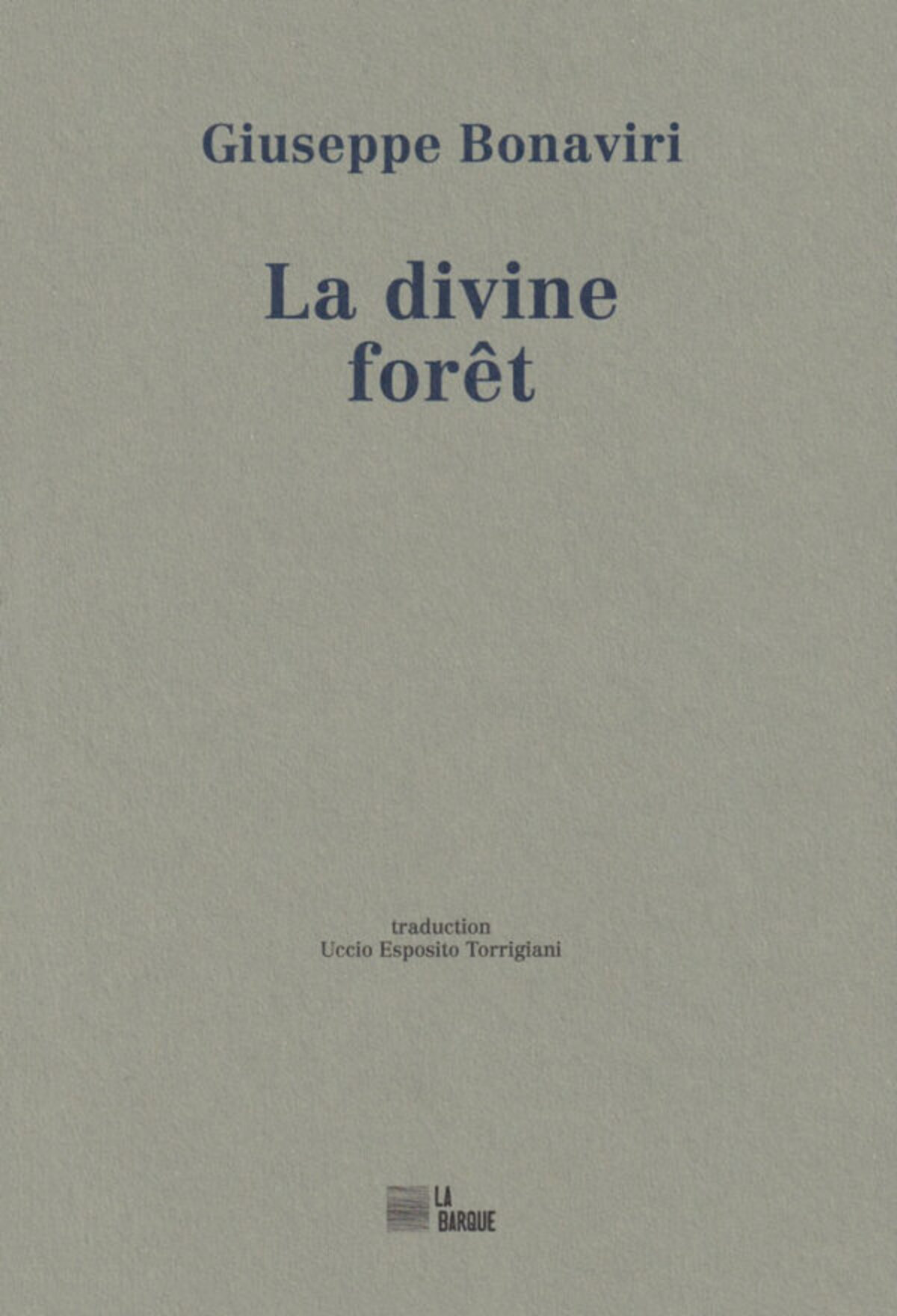
Agrandissement : Illustration 1

Une grande évasion que cette Forêt divine, non pas seulement vers le grand-dehors, mais aussi vers le dedans de la vie dans tout son infini, la vie perdue dans la liberté du temps tel que nous avons inventé de le décrire, avec sa flèche pourtant fatale qu’ici l’on retrouvera autrement crue, signant le danger des hommes chasseurs dans la faune première. Parole ou dire (aussi bien muet) ne viennent en bouche qu’avec la conscience, laquelle ne s’allume que par friction, puisqu’il faut bien sûr une altérité pour exister. C’est en tout cas ce qui est clairement exposé à l’entrée de ce fabuleux roman pour lecteur en apesanteur, où l’on voit qu’un « désennui » va naître d’une rencontre quasi abstraite tant les protagonistes sont d’abord élémentaires, ainsi qu’au début de toute « éternité », ou « histoire ».
Mais c’est l’instinct vital qui est ici montré, moteur des aspirations et de la volonté même. Ainsi l’animal, y compris le bipède « intelligent », doit tuer pour survivre, doit dévorer, prédater, subir la loi qu’il applique (presque) malgré lui. C’est parce que le héros vautour accomplit des gestes de vautour que persiste la lignée des vautours, utiles équarrisseurs. Les états d’âme ici prêtés à l’oiseau de proie n’y changent rien, les scrupules sont perversion peut-être, ou littérature.
« J’éprouvais envers cet animal une soudaine attraction qui n’était, au fond, que lourdeur de moi-même, ou mieux, une peine profonde.
J’étais immobile, les ailes déployées. La nature semblait dissoute en des formes imperturbables. Le lapin s’était arrêté, comme s’il pressentait une loi très ancienne.
« Allons ! », me disais-je.
Je fondis sur le lapin qui s’aplatit sans rien dire, et je lui plantai mes serres dans le cou, en éprouvant un plaisir qui dépassait tous les autres. » [p. 46]
Nourrissant son aventureux narrateur à plumes du « sentiment d’être » et du « besoin de se dire », ce diabolique Bonaviri tisse très à l’aise les pages de son roman. « Qu’est-ce que je suis en train de faire ? » se demande-t-il, comme soulignant de mauvais gré l’ananké où chacun est pris.
Accepter d’être ce que l’on est, tel que la nature nous a faits, poussés par elle, est-ce une liberté souveraine et assumable dont on peut jouir ou se plaindre ? Fatalité ni triste ni joyeuse.
« Alors je m’envolais au-dessus des amandiers et des oliviers, toujours à la même place, inchangés, et de là-haut je chantais ‒ je ne sais pas si c’était agréable à entendre ‒, élevant la voix, j’emplissais de bruit la vallée qui en résonnait toute. À ce son les arbustes, les broussailles et les fleurs se pliaient tandis que moi, parfois, je riais, car je me sentais nature, esprit, logos. »[p. 51]
Tout vautour qu’il est, le narrateur ne manque pas d’affectivité, il se sociabilise presque malgré lui. Après un temps de solitude, le voici accompagné d’une camarade vautour qu’il a trouvée prisonnière d’un buisson de ronces et dont il a entendu l’appel, soit son propre nom, Apomeo. Et bientôt il se trouve en quelque sorte apprivoisé par la rescapée, Toina, découvre près d’elle la cabriole, le plaisir qui attache, sans compter les hauteurs vertigineuses qu’ils atteindront tous les deux.
Une société d’oiseaux et autres animaux se met à exister pour lui, avec lui, ainsi Cratete, un merle, Apollodoro, un rouge-gorge, l’araignée noire Isinera et son ami oncle Michele, un hibou de grand âge dont plus tard il portera le deuil. En attendant, ce sont eux qui le consoleront quand Toina disparaîtra. Et puis il y a les hommes, « étranges animaux à la démarche très lente et dont les hurlements sauvages résonnaient dans la vallée ». Occasion d’un dialogue entre notre vautour préféré et un groupe d’enfants dont certains cherchent à l’atteindre avec des pierres, avant d’être « étonnés de l’entendre parler comme eux ».
C’est pourtant la vision d’un homme qui le renversera tout à fait, lui portera le coup d’une première et indéfinissable maladie. Un homme gisant cerné par des rapaces, comme un aperçu du mal en soi, qu’il faut porter.
Publié en 1969 chez Rizzoli, et traduit chez Denoël en 1975, avant que La Barque n’ait l’heureuse idée de le redonner à lire, ce texte est postfacé d’un bel article de Giorgio Manganelli dont la conclusion résume parfaitement l’enjeu d’un roman aux effets magiques : « La divine forêt est traversée par le thème de la recherche. La recherche de « quelqu’un », dans un monde qui ignore quelle pourrait être la consistance d’un quelconque « quelqu’un », c’est l’itinéraire de la nostalgie pure, parfaite, insoluble, implacable ; un itinéraire infini comporte des pertes infinies, la connaissance de l’adieu, comme structure secrète du monde, ce noyau de peine qu’aucun Orphée ne parvient à consoler de la volatile grâce de ses cantilènes solitaires. »
*

Giuseppe Bonaviri, La divine forêt, (traduction d'Uccio Esposito Torrigiani, revue & complétée, postface de Giorgio Manganelli : « À propos de La divine forêt », traduction : Philippe Di Meo), éditions La Barque, 176 p., 2024, 23 €.



