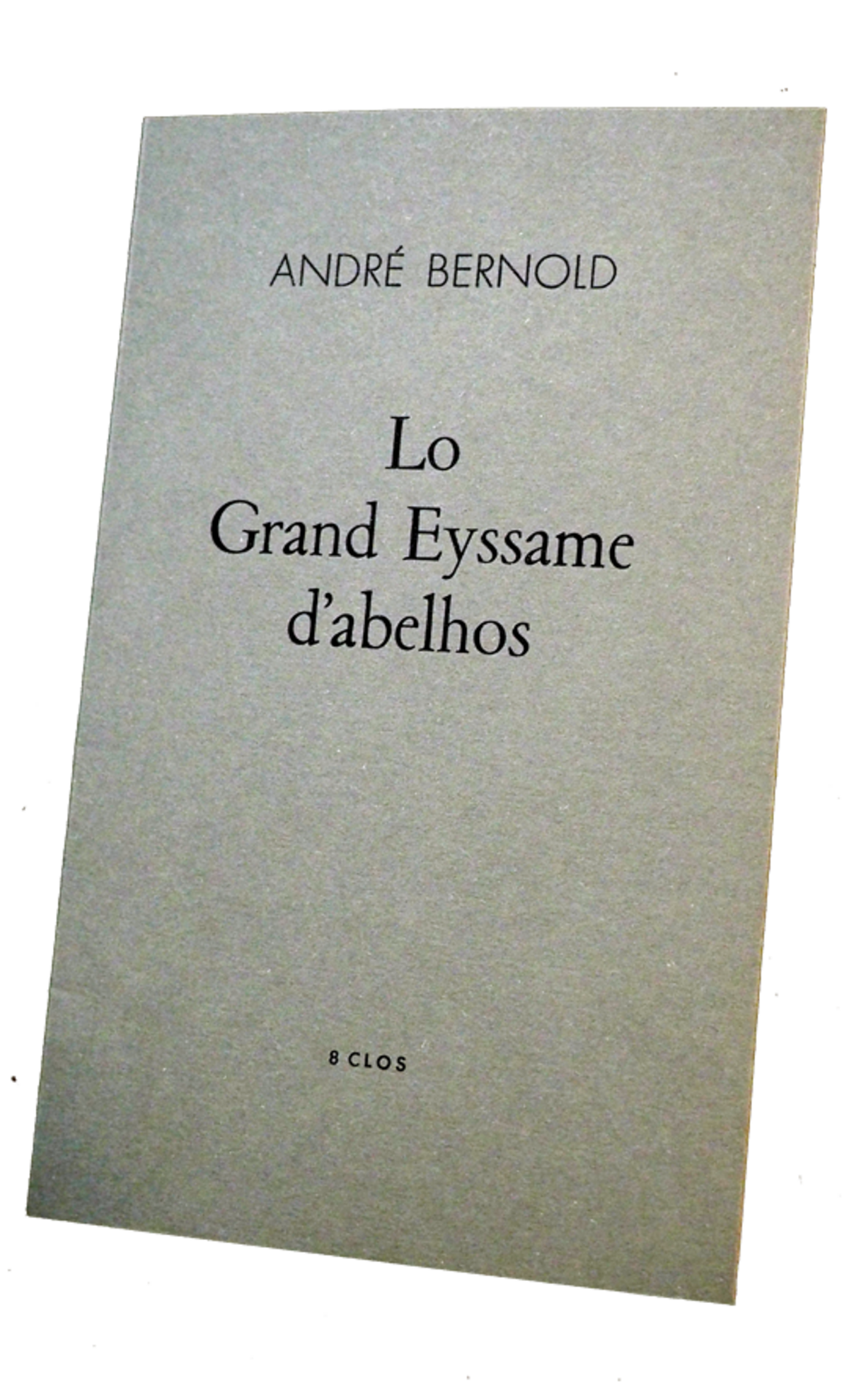
Agrandissement : Illustration 1
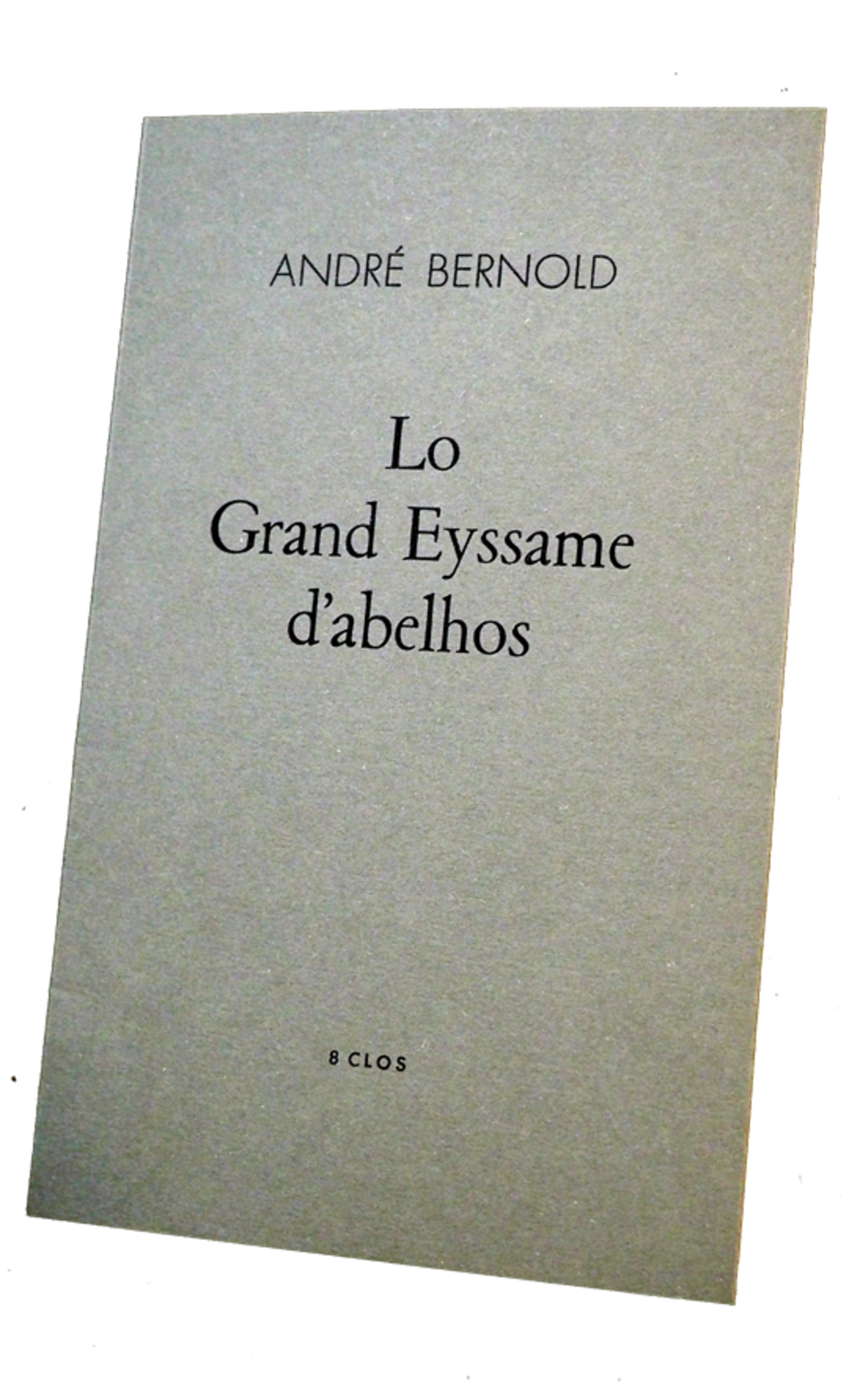
André Bernold ignore toujours l’usage des ordinateurs (ils mourront tous avant lui), sa mémoire se passe des moteurs de recherche, les choses lui viennent de l’intérieur, où des lectures passées ont imprimé ce qui veut bien ressurgir au gré des circonstances de la pensée. Les aimants de l’analogie dessinent un propos à peine improvisé, cependant spontané. Les mots ricochent les uns sur les autres, font sens même là où l’habitude syntaxique ne les connaît pas.
Est-ce plutôt, là aussi, le fait d’un procédé, qui révèle en ce cas la magie visionnaire, ou poésie : l’annonce de ce qui est déjà, mais non perçu ?
Le poème Lo Grand Eyssame d’abelhos que publie aujourd’hui l’éditeur Éric Pesty dans un beau geste de fabricant de sens est extrait de matériaux anciens, et pourtant il prend place dans le présent comme un coin s’enfonce dans le fil de la bûche qu’il va fendre. Exercice poétique dont nous ignorons le point de départ, sinon la lecture de Nostradamus, médecin et astrophile provençal, et, par ailleurs, celle de Germain Colin-Bucher, poète angevin du XVIe siècle, pas même retenu dans les anthologies couvrant la période, mais qu’André Bernold a lu avec assez d’attention pour en sélectionner quelques vers plus que valables. Qui d’autre aujourd’hui se préoccupe de ces deux-là ?
Cet assemblage de vers choisis parmi les préférés, comme pour en augmenter le scintillement, c’est le jeu savant auquel s’est livré l’auteur de L’amitié de Beckett, y ajoutant quelques vers de sa main (dont l’ultime et clef de voûte…), comme pour enserrer les premiers autres dans une même et sienne optique.
La revue La Polygraphe, que dirigeait Henri Poncet, accueillit jadis ce surprenant poème à saveur apocalyptique. Au hasard d’un déplacement de livres dans sa bibliothèque polymathe, ce numéro 15, datant d’octobre 2000, est revenu à son auteur, avec ce poème (un centon) qu’il avait signé. C’était il y a quelques semaines seulement, ou quelques mois, soit 24 ans après sa parution, et, dans ces quelques quintils, lui sauta au visage le sens que prenaient certains vers, au vu des événements en cours au Moyen-Orient, c’est-à-dire le massacre de tant de Palestiniens de Gaza par les forces armées d’un État constitué, et occupant.
« Sur l’océan sera la porte ouverte »
Le geste de faire coïncider deux morceaux peu conçus pour vivre ensemble, c’est tout l’art du montage chez Jean-Luc Godard, et c’est d’abord l’art poétique indiqué par Pierre Reverdy. Introduire un œil dans une orbite exogène, c’est aussi un art de l’intervention, de l’à-propos interrogatif.
Par son étrangeté même, qui insiste à parler, à dépasser l’opacité d’un langage non encore entendu, le poème d’André Bernold souligne l’indifférence empoisonnée que chaque vivant éprouve (ou n’éprouve pas !) à l’égard des souffrances de l’autre, à l’égard des souffrances de tous ces autres. Comment ne pas se sentir complice, coupable d’être naturellement vivant quand d’autres sont abattus froidement, coupable de vivre à présent, quand le présent insulte toute raison ?
La difficulté d’intervenir ne se pose qu’à celui qui se reconnaît partie prenante de ce monde, quelle que soit sa situation et, cela va sans dire, son pedigree. Le plus incapable, a priori, il peut quelque chose, et reconnaît aussi la vanité d’un geste trop ténu. Ce n’est pas lui ôter son sens ni sa vertu propre.
On sait ce que la « poésie engagée » embarque comme laideur et ce qu’elle représente en tant que signe de soumission. À ce jeu-là, les vitupérations rageuses d’Armand Robin, ou celles de Maurice Blanchard, restent indéniablement supérieures à celle des encartés Aragon ou Éluard, et le Michaux d’Épreuves, exorcismes s’avère autrement plus remuant encore et résistant toujours. Mais c’est aujourd’hui d’une incongruité que nous parlons, quelque chose qui jure par ses accents fantasques et nous questionne en tant qu’elle nous charme, un poème laconique, étranger à notre époque, et, de ce fait même, plus intime et plus éclairant, parce que travaillant par le dedans du temps et de soi (attelage de ces deux-là). « Après ma mort je te ferai la guerre »
Promesse invérifiable, certes, mais le froid dans le dos existe vraiment, et il arrive toujours qu’il nous rattrape, c’est la force de l’esprit, et c’est être vivant que de s’y soumettre ‒ ce qu’au demeurant le monde objectivé refuse, se « nazifiant » si volontiers, à vitesse éperdue.
Errant dans les villes ou les villages, chacun voit qu’un graffiti sur un mur est parfois plus parlant que la chaîne des discours qui saturent les sonos des propagandes, fussent-elles, dans certains cas, culturelles. Un poème comme celui d’André Bernold a ainsi même fonction que la fleur sauvage saillant sur le tas de fumier d’une humanité tenue en laisse (par elle-même). « Brin de paille dans l’étable [1] », sans doute, mais d’espoir, point. Un geste de déprise que de mettre Lo Grand Eyssame d’abelhos sous les yeux d’un monde abîmé dans sa perte.
Jean-Claude Leroy
paru dans lundimatin#458, le 7 janvier 2025
André Bernold, Lo Grand Eyssame d’abelhos, éditions Éric Pesty, 2024.
[1] « L’espoir lui comme un brin de paille dans l’étable »...



