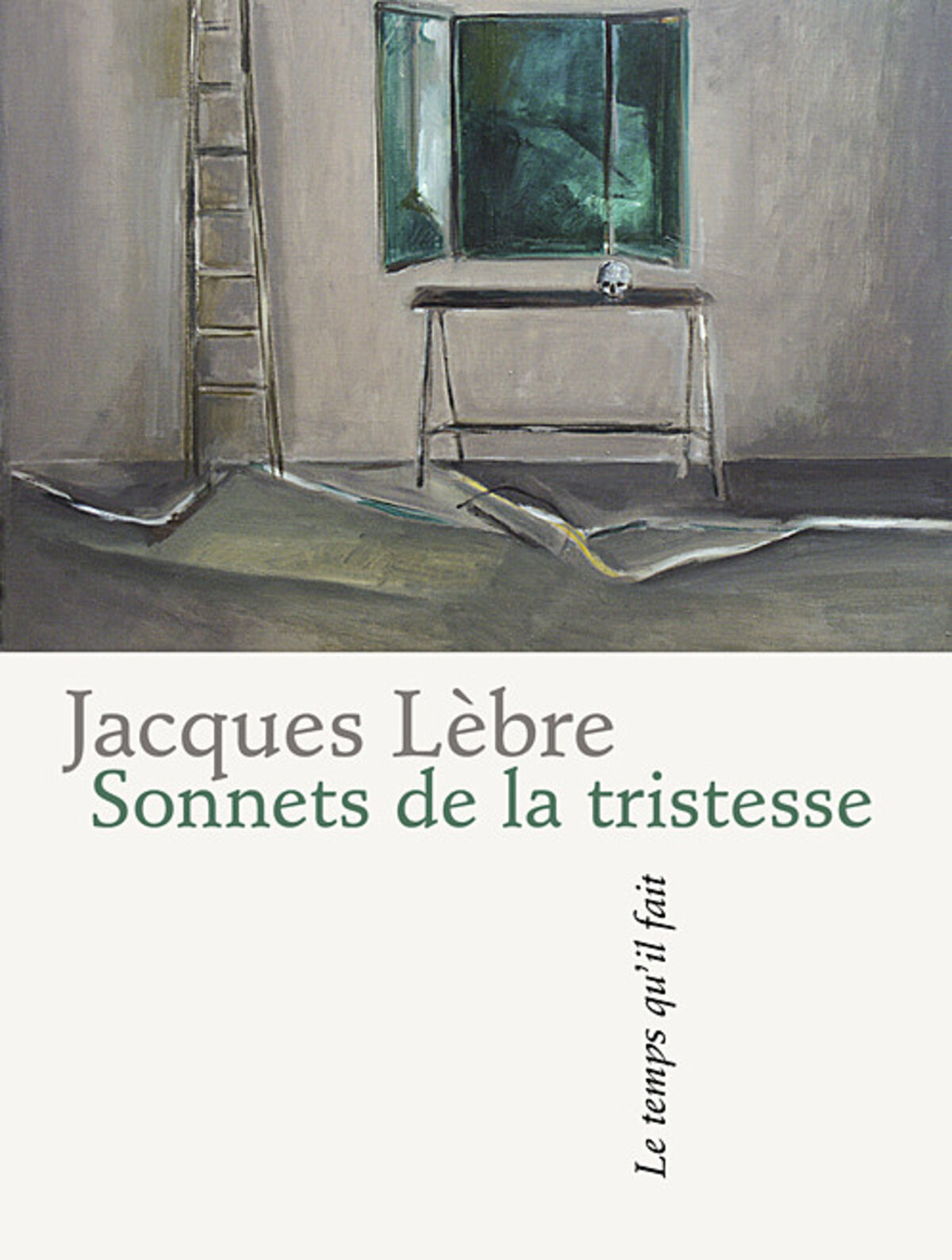
Agrandissement : Illustration 1
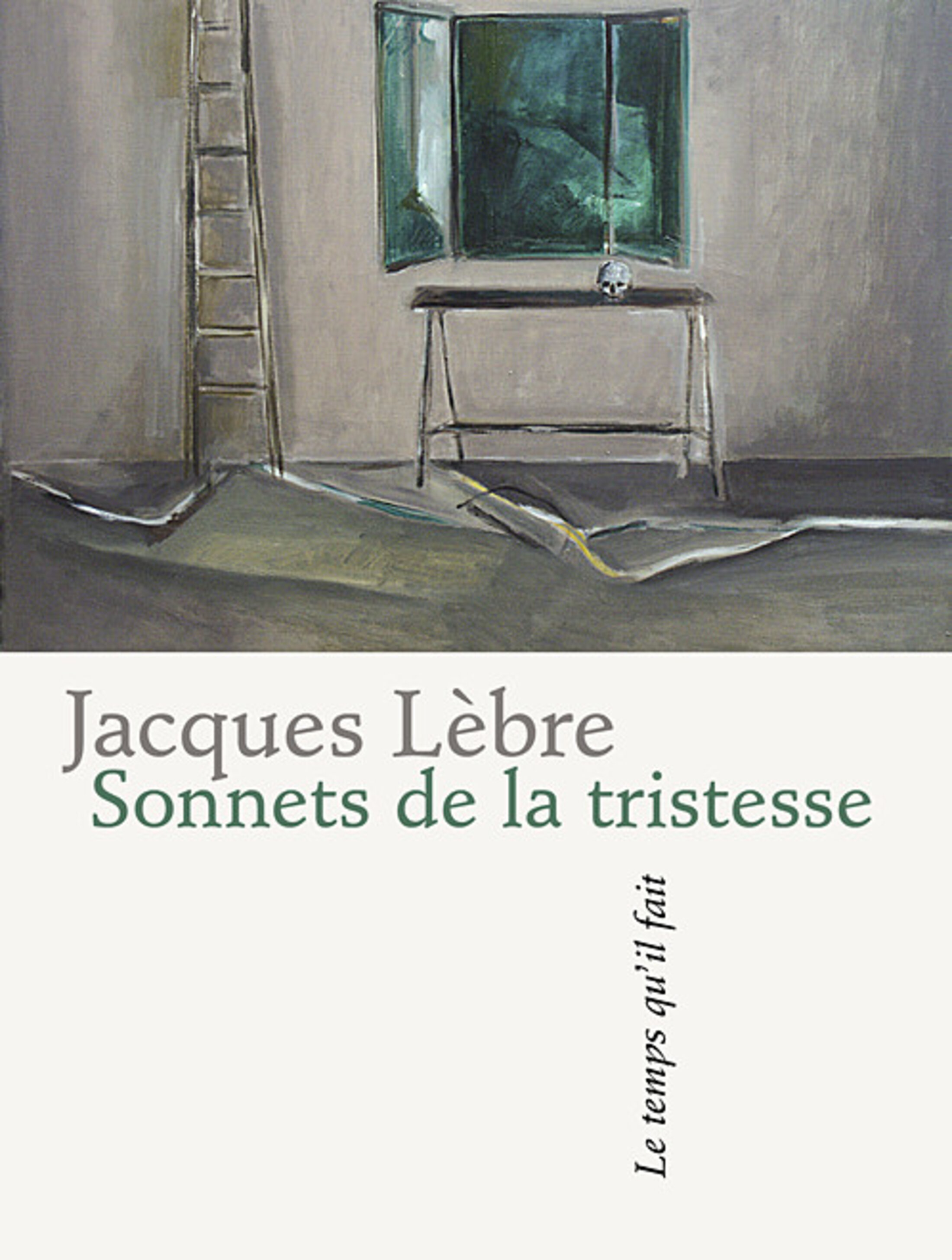
Là sur la feuille, les poèmes de Jacques Lèbre ne seraient que pour garder la trace d’un quotidien peu bavard, autant dire : ce qui se voit mal à première vue. Non pas exactement mettre à jour quelque chose, mais rien que son soupçon. C’est tout un art de la discrétion confiante qui restitue sans dévoiler et partage ce compagnonnage secret que les marcheurs solitaires emportent dans leur pas, sur les sentiers. Ici ce bout de chemin avec un ami sans mémoire, puisqu’une part de soi s’efface peu à peu, quelquefois trop tôt. Un éprouvant et digne vis-à-vis en forme de lent adieu, une présence à l’autre qui ne peut s’évaluer qu’à tâtons… « Que faire d’une amitié démeublée ? » s’interroge Jacques Lèbre dans Onze propositions pour un vertige (premier des trois ensembles qui composent ce volume, paru d’abord dans la collection le phare du cousseix qu’animait Julien Bosc).
De ce suspens existentiel, nous passons à d’autres rendez-vous qui sont toujours des rapports de présences, des silences ou presque silences qui naviguent d’un regard à l’autre, d’une attention à une attente, quand l’attente n’a plus rien d’autre à attendre. Ainsi le poète rendant visite à sa vieille mère qui vit en maison de retraite : « à la façon dont elle me regarde / je me sens obligé de lui dire : c’est Jacques ».
Je ne sais s’il y a une part de vérité dans ce que j’écris,
mais si j’écris, sans doute est-ce pour répondre à un choc,
faire ressentir, peut-être ce qui ressemble à une violence.
Douce narration poétique, ce témoignage d’un recueillement à deux, près de soi-même, la mère et son enfant, elle bientôt centenaire, lui qui ne quitte ses lectures et sa rêverie que pour être là, près d’elle, avec silence et grand respect. Avec silence et redite, car il faut dire et redire, entendre et réentendre, l’oubli mange tout ce qui se présente, désormais, il est avide.
À côté, dans la chambre voisine, il y a un appel auquel personne ne répond, il n’imprime plus. Sans doute une « vieille folle » ou un « vieux fou », c’est-à-dire soi-même dans quelque temps, dont les murmures comme les cris n’auront plus d’intérêt pour quiconque.
Quand le fils demande à la mère pourquoi ces résidents de la même maison ne parlent pas entre eux, elle répond « avec mépris » : « il n’y a que des vieux » !
Ainsi le déroulé des jours avec fenêtre qui donne sur le paysage et la résolution des mots mêlés, jusqu’à laisser cette odeur singulière dont le fils prend conscience alors que la chambre est maintenant vide et que pas une réaction ne s’observe parmi les vieux qui restent là, à attendre leur tour.
Le livre de Jacques Lèbre se clôt sur quelques poèmes tournés vers l’enfance, et c’est alors un heureux et salubre dénouement, réinscrivant les âges de la vie dans leur première promesse, promesse du temps qui s’ouvre tout d’abord en grand, avant que l’existence ne vienne s’y frotter plus sévèrement. Toujours avec attention et discrétion, et une justesse de ton qu’il faut souligner, le poète de Sonnets de la tristesse accompagne l’humanité tout entière, notamment à travers sa parole adressée aux enfants : « Dis-moi, petite, la réalité ne serait-elle / qu’un peu d’eau que l’on prend dans sa main / et qui s’évapore ? »
À plat ventre sur un banc de pierre,
une petite fille émiette du pain.
Elle parle aux moineaux sous les branches
et les arbres acquiescent à cette source.
Le monde règne dans une fraîche unité.
Sauf que, dans l’allée les passants s’en vont,
les arbres font de vastes gestes d’adieu
et je ne sais pas ce qui là se brise.
*
Jacques Lèbre, Sonnets de la tristesse, éditions Le Temps qu’il fait, 2025, 15 €



