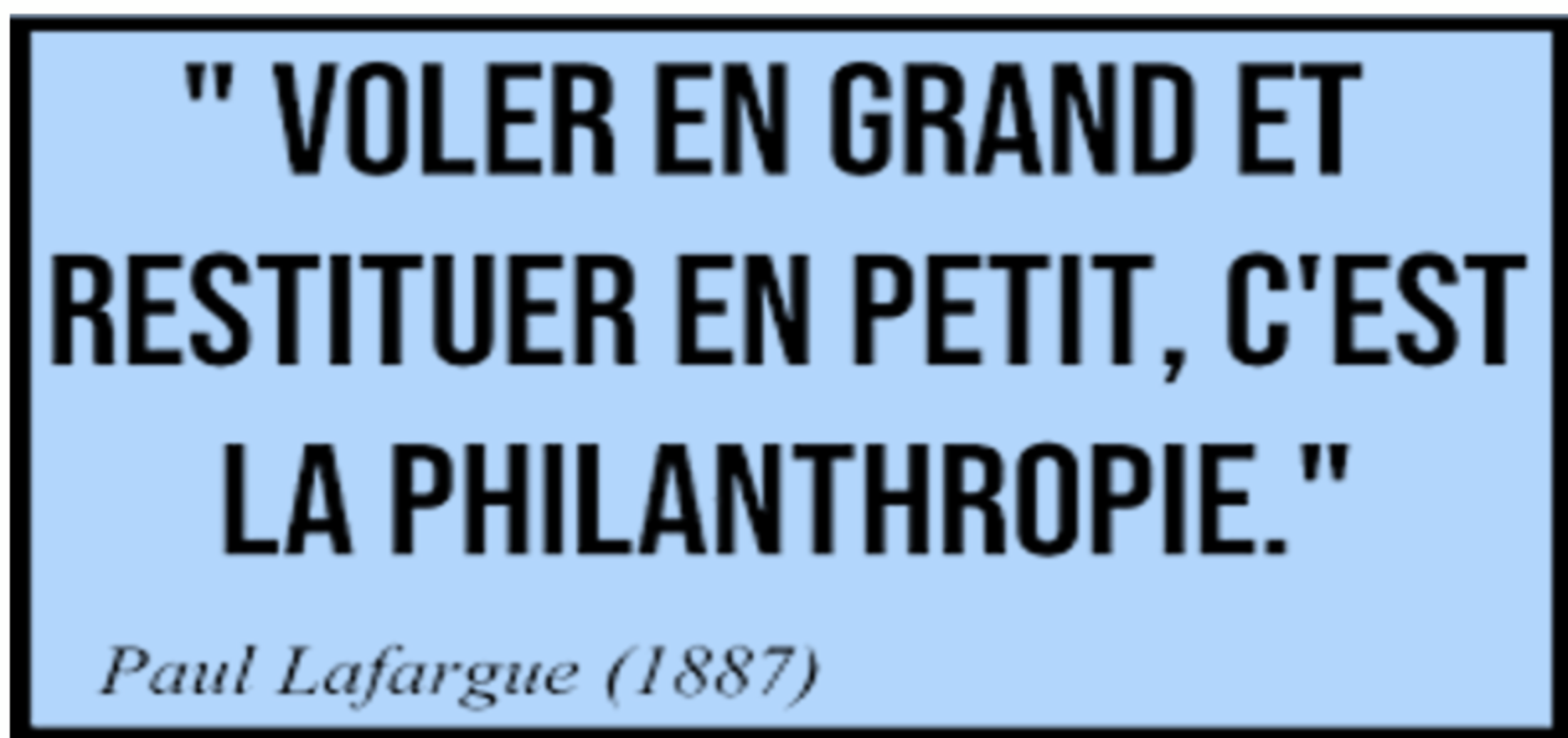La chose nous rappelle furieusement une mesure analogue prise en 2016 par le Premier Ministre d’alors, Manuel Valls, et intitulée « Prime d'activité ».
Examinons ensemble ce qu'était alors la Prime d'activité, cet ancêtre de l'Indemnité inflation.
Une prime ? Dans la liturgie chrétienne, nous dit Larousse, la prime est la partie de l'office divin qui se récite au lever du jour.
Plus prosaïquement, la Prime d'activité, instituée en 2016, sous l’ère socio- libérale, était quant à elle la somme d'argent ou le don accordé à titre de récompense ou de gratification, au salarié, en plus de son salaire, reconnu insuffisant.
En quoi consistait-elle ? Le Gouvernement enterrait le RSA et la PPE (Prime pour l'emploi), dispositifs qu'il jugeait coûteux et mal adaptés et dont le généreux objectif, sortir de l'exclusion et de la grande pauvreté les travailleurs pauvres, les poor workers, cet objectif étant loin d'être atteint.
La fusion de ces deux dispositifs caritatifs en un seul, quérable (c'est-à-dire qu'il fallait en faire la demande, le réclamer ou le quêter, à vous de choisir), était d'arracher à la grande misère ceux qui travaillent et n'en obtiennent pas le nécessaire pour survivre. L'estimation moyenne du don public tournait autour de 150 à 250 € mensuels, dont pourraient bénéficier environ 5 millions de personnes, celles percevant entre 0,5 et 1,2 Smic, le tout restant dans l'enveloppe de 4 milliards d'euros consentis par la collectivité, enveloppe résultant de la fusion du RSA et de la PPE (Prime pour l’emploi). Pas un sou de plus, c'est entendu ! Bruxelles veille.
Empoignez vos calculettes et vous verrez que le compte n'y était pas (en moyenne 150 € mensuels x 12 mois = 1800 € annuels x 5 millions d'attributaires = 9 milliards d'euros exactement, soit plus du double que les 4 récoltés par la suppression RSA + PPE).
N'y voyez là aucun cynisme, mais la simple lucidité technocratique, celle qui sait que les pauvres ont honte d'être pauvres et donc n'en ferons pas la demande (le dispositif est, nous venons de vous le dire, quérable, c'est-à-dire qu'il fallait en faire la demande pour en bénéficier). Pour rester dans les clous de ces 4 milliards, le gouvernement tablait alors sur un taux de recours, il précisait dequérabilité, de moins de 50 %. Bien anticipé, car si tous les pauvres savent qu'ils sont pauvres, beaucoup peinent à le reconnaître.
Nos recherches historiques nous permettent aujourd'hui, chers lecteurs, de vous parler de l’Auberge du Pélican à Speenhamland, petite localité du comté de Berkshire au Royaume-Uni.
L'historien Karl Polanyi, dans son magistral ouvrage La Grande Transformation, écrit en 1944 et dont nous n'aurons de cesse de vous recommander la lecture, fresque somptueuse du basculement du monde dans l'ère du libéralisme à partir de l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, nous relate l'événement suivant :
« Les juges (justices) du Berkshire, réunis tôt le matin du 6 Mai 1795, en un temps de grande détresse, à l'auberge du Pélican, à Speenhamland, près de Newbury, décidèrent qu'il fallait accorder des compléments de salaire (subsidies in aid of wages), conformément à un barème indexé sur le prix du pain, si bien qu'un revenu minimum serait ainsi assuré aux pauvres indépendamment de leurs gains. Voici ce que disait la fameuse recommandation des magistrats : quand la miche d'un gallon de pain d'une qualité déterminée coûtera 1 shilling, alors chaque pauvre et industrieuse personne aura pour son soutien 3 shillings par semaine par une allocation tirée de l'impôt pour les pauvres (poor rates), et pour le soutien de son épouse et de chaque membre de sa famille, 1 shilling 6 pence ; pour chaque penny dont le prix du pain augmente au-dessus de 1 shilling, il aura 3 pence pour lui-même et 1 penny pour les autres ».
Conçue comme une mesure d'urgence cette disposition caritative devint très vite la loi du pays dans la plupart des campagnes du royaume.
En réalité, l'innovation sociale et économique dont elle était porteuse n'était rien moins que « le droit de vivre ».
Jamais mesure ne fut plus universellement populaire. Les employeurs pouvaient réduire les salaires à volonté ; les ouvriers, qu'ils fussent occupés ou oisifs, étaient à l'abri de la faim ; les humanitaristes applaudissaient la mesure comme un acte de miséricorde ; et les contribuables eux-mêmes furent très lents à comprendre ce qu'il adviendrait de leurs impôts dans un système qui proclamait le
« droit de vivre », qu'un homme soit payé ou non un salaire lui permettant de subsister.
Avec l'indemnité inflation, ne nous inviterait-t-on pas aujourd'hui à un tel unanimisme, au bénéfice de ceux dont le salaire qu'ils versent, les patrons, ne peut suffire pour vivre à ceux à qui ils l'ont versé, les salariés ? Peut-être !
Au moment de l'annonce à grand fracas médiatique de ce projet d'Indemnité inflation, paraissait l'enquête du magazine Challenges recensant, pour 2021, les 500 plus grandes fortunes de France. En tête, Bernard Arnault, suivi de très près par Francoise Bettencourt, François Pinault et Gérard Mulliez.
Bernard Arnault devenu première fortune de France, félicité ici par qui de droit
Mais laissons là la polémique et revenons à notre Premier Ministre, Jean Castex, peut-être enfant secret de l'Abbé Pierre, et à sa bienfaitriceIndemnité inflation.
Revenons-en au fond et à l'essentiel. Admettre et instituer que le prix de la force de travail, le salaire, peut être inférieur au coût de sa reproduction (ce qu'est en principe le salaire minimum) et qu'il faille lui rajouter une prime, est une aberration non seulement sociale mais économique car, en économie, ne l’oublions pas, le coût d'une marchandise, la force de travail, est constitué des intrants nécessaires à sa production. Le salaire étant le coût de la reconstitution de cette force de travail.
Le salaire étant insuffisant est maintenant introduit et sanctifié l'appel à tous, contributif ou caritatif.
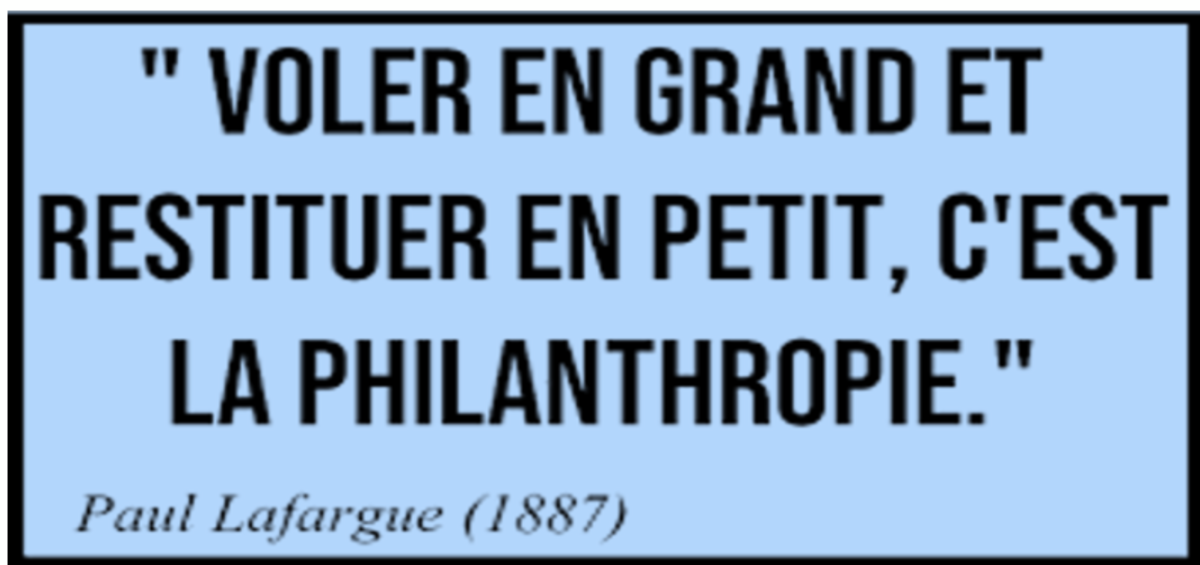
Agrandissement : Illustration 1