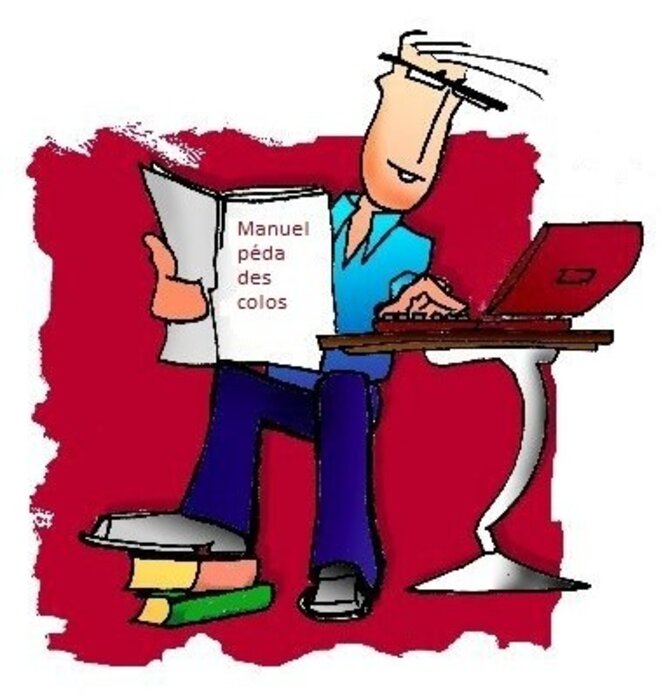Le gouvernement et les organisateurs de colos viennent de faire trois annonces importantes pour le secteur des colos. L’action est concertée et les mesures doivent venir en aide aux familles, aux animateurices et garantir une vigilance sur les violences sexuelles et sexistes. Ces annonces sont censées montrer la vision sociale du gouvernement et des organisateurs de colos. Pourtant la réalité est plus complexe, ces annonces affirment en fait l’immobilisme du secteur sur les questions pédagogiques et le renforcement de la régulation du secteur des colos par le marché libéralisé.
Trois annonces
Les annonces faites par le gouvernement sont dans l’ordre : un engagement des organisateurs de colos à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, une augmentation à 50€/jour du salaire minimum des animateurices signant un contrat d’engagement éducatif, et la création d’un pass colo de 350€ maximum pour permettre aux enfants de CM2 de partir en colos.
Ces trois annonces sont le fruit des travaux du « comité de filière animation » qui regroupe les grosses associations du secteur de l’éducation populaire, les financeurs, l’Etat et des syndicats et elles tentent de répondre à la crise des colos : recrutement difficile, nombre d’enfants qui diminuent, #MeTooAnimation. Les trois mesures ont en commun le fait de ne pas remettre en question ce qu’est une colonie de vacances, ses finalités, son organisation, les manières de les vendre, les outils permettant de construire les groupes d’enfants ou la vision générale du rôle des colos. Pourtant les colos sont en crises successives depuis 40 ans, elles souffrent de la fin des politiques sociales de vacances de l’état et des collectivités, elles souffrent de l’ouverture des colos aux marchés libéralisés et concurrentiels, elles souffrent d’un glissement d’une activité militante vers une activité commerciale, elles souffrent des changements de pratiques des familles en matière de vacances, elles souffrent d’absence de mixités, elles souffrent du désengagement des comités d’entreprise, elles souffrent d’un modèle pédagogique traditionnel et violent pour beaucoup d’enfants, elles souffrent des affaires de violences sexuelles et sexistes, elles souffrent… depuis 40 ans. L’ensemble de ces souffrances se résument pourtant en deux maux : libéralisation commerciale et modèle pédagogique colonial. Les trois mesures annoncées ne répondent à aucun de ces maux.
Pour les organisateurs de colos, les problèmes sont ailleurs. Ils font tout ce qu’il faut pour que les colos soient sures et répondre aux attentes des clients, ils appuient leurs séjours sur l’idée que les colos sont complémentaires de l’école donc éducatives, ils se plaignent que les familles ne comprennent pas l’importance pour leurs enfants de partir en colos, qu’elles ne savent pas que les colos se déroulent en toute sécurité et que les équipes d’animations sont formées et contrôlées, ils trouvent que les enfants sont de plus en plus difficiles, que les téléphones portables sont envahissants et ingérables, que les animateurices embauchées ne sont pas assez engagées, etc… Bref que tout ce qu’ils font est bien que ce sont les autres qui posent problème. L’état partage cette faible analyse. Les voix dissonantes sont écartées de toutes les instances de discussion et des concertations. On est entre-soi, il faut agir pour chacun comprenne l’utilité des colos, il faut surtout agir pour maintenir le marché en place. Dans un marché qui s’érode depuis longtemps, leur idée est plutôt de récupérer des parts de marché détenu par d’autres plutôt que de penser à changer son produit ou d’analyser les raisons profondes de la diminution du nombre d’enfants qui partent en colo.
Les trois mesures prises ne remettent ni en cause le modèle pédagogique des colos, ni les logiques commerciales et touristiques des colos. Les leviers pour l’avenir sont pourtant là…
Changer de modèle
En 1983, le gouvernement socialiste fait le choix de la rigueur, le ministère du temps libre est moribond, les associations, notamment d’éducation populaire, doivent aller chercher des financements autres, spécifiquement sur les marchés. La rupture se déroule à cette époque, les grands organisateurs associatifs de colonie de vacances vont transformer la colo en produit. Aveuglées par les réussites du Club Med ou de VVF, c’est le modèle du tourisme qui sera choisi pour permettre de générer des revenus par la vente de marchandises et de services : les colos, les camps, les séjours à l’étranger ou linguistique, même le BAFA deviennent des produits de consommation. Le fait que les colos et le BAFA se basent sur un engagement bénévole, les marges sont importantes, les associations vivent de ses revenus. Les associations ne dépendent plus complètement de subventions publiques, elles dépendent de leurs clients.
Sauf que le libéralisme économique, la concurrence, la seule satisfaction du client, ne produit qu’individualisme, satiété immédiate, perte de sens et du collectif, rapport marchand et toutes les logiques technocratiques qui se réfèrent au libéralisme économique : démarche qualité, méthodologie de projet, labellisation, garanties commerciales, normalisation du produit, service après-vente, etc. Les colos basculent dans le monde du commerce mondial. Les coûts des colos augmentent, le bénévole est remplacé par le salarié qualifié, les normes imposent des coûts incroyables, la sécurité est le point central de toute colo, les services administratifs explosent, les catalogues et sites internet demandent des investissements. Tout change sauf une chose : les animateurices ont un BAFA, travaillent 24h sur 24 et sont payées l’équivalent de 2h de SMIC par jour. Les colos comme forme d’engagement militant et pédagogique sont devenues un job d’été normé par les marchés, identique à celui de vendeur de chouchous sur la plage ou d’animateurices de club en camping. Si le tourisme a su évoluer vers toujours plus de profit et de sensations permettant de satisfaire le client, la colo, par son histoire, sa structure et sa forme est incapable de s’adapter, sauf pour les catégories favorisées qui peuvent payer cher des séjours à l’étranger ou sportifs. Démocratiser les colos comme on a démocratisé le camping ou le village de vacances est impossible.
La colo comme engagement pédagogique a été son histoire du front populaire aux années 80. La colo a inventé un modèle pédagogique, appuyée sur l’éducation nouvelle et sur un concept : les besoins. Une colo est un endroit où tous les besoins des enfants sont satisfaits, l’enfant peut y jouer, manger, rencontrer, respirer un air pur, dormir, etc. À cette conception psychopédagogique, les organisateurs de colo ajoutent une dimension militante (politique, religieuse, philosophique), la colo cherche à construire le citoyen, le chrétien, le communiste, etc. de demain. Au tournant des années 80, le militantisme disparaÎt au profit du commerce, mais le modèle reste puisque sa force est d’être adaptable aux logiques commerciales. La colo ne construit plus des militants de demain, elle va éduquer à tout un tas d’objectifs flous et généraux : vivre en groupe, développer l’esprit d’équipe ou la motricité, découvrir le territoire. Le point central du modèle est qu’en colo tout est décidé par les adultes organisateurs avant même d’avoir rencontré les enfants concernés. Puisque l’adulte connaît les besoins et les souhaits des enfants, l’adulte peut construire une institution totale dont il maîtrise le cadre, les contenus, les activités, les repas, les heures, les manières d’être en relation, etc. C’est cela que les organisateurs vendent sur leur catalogue. À ce titre, les colos ont ouvert le marché de l’éducation.
Problèmes majeurs, le modèle n’est pas adapté à tous les enfants et les animateurices étant peu formées, les manières de faire sont inadaptés aux enfants en situation particulière (handicaps, carences éducatives, difficultés sociales, victimes de violences ou simplement solitaires). Le modèle pédagogique permet de vendre de la prestation sur catalogue, mais violent bon nombre d’enfants. Tant que les colos étaient vendues aux parents, l’obligation parentale d’aller en colo pouvait convaincre au départ. Dès lors que le client est devenu l’enfant, celui-ci peut exprimer son refus de partir dans un lieu où il ou elle est victime de violences en lien avec son genre, son origine, sa corpulence, sa couleur de peau, voire même la qualité de ces vêtements ou sa sexualité, où elle ou il est obligé.e de faire des activités qu’il ou elle n’aime pas, de vivre dans une chambre non-mixte sans copain, copines, frères ou sœurs.
Le modèle pédagogique impose, norme, dirige. Il s’est amendé en autorisant le choix, en individualisant les levers et en diminuant le nombre de lits dans les chambres, mais dans le fond le modèle est le même qu’il y a 50 ans : tout est décidé par les adultes, l’action des équipes produit des violences (éducatives, sexistes) sur les enfants vulnérables, interdit la singularité et il est incapable inclure des enfants hors des normes prédéfinies par l’organisateur.
Appliquant un libéralisme marchand, les organisateurs segmentent leurs offres : colos de riches (1500€ la semaine), de pauvres (colos dites généralistes), pour filles (danse, équitation), pour garçons (foot, mini-motos), pour vulnérables (séjours pour enfants HPI), pour enfants en situation de handicap (vacances adaptées), pour petits, pour grands (tranches d’âge), etc. Tout ceci s’explique parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Au-delà d’appliquer un modèle pédagogique violent pour les vulnérables, les organisateurs créent des séparations, des discriminations. Comment inscrire dans une même colo, son fils de 15 ans et sa sœur de 8 ans en situation de handicap ? Comment permettre à deux frères et sœurs de 6 et 13 ans de dormir dans la même chambre ? Comment accueillir dans un même séjour un enfant solitaire et un enfant sportif mais qui sont copains ?
Libéralisme et modèle pédagogique sont les deux points d’ancrage depuis 40 ans des organisateurs de colos, dit autrement, il faut gagner des sous et éduquer les enfants surtout ceux des pauvres. Les trois décisions prises pour aider les colos vont dans ce sens : en accordant un pass aux familles, on renforce la logique de marché, en augmentant les salaires, on ne remet pas en cause le contrat d’engagement éducatif et on espère attirer davantage de candidat.es animateurices, en créant une charte, on affiche un engagement sans contrainte.
Faire autrement... vite...
Comme en 1983, les crises produisent des évolutions. La NUPES l’a bien compris puisqu’elle s’est remise à travailler la question du temps libre. Le gouvernement l’a aussi bien compris puisqu’il agit de manière concertée avec les associations organisatrices. NUPES, gouvernement et organisateurs arrivent à deux conclusions communes : il faut créer un pass et il ne faut pas toucher au modèle pédagogique.
La NUPES porte dans sa proposition de loi un PASS colo (verte) et les collectivités locales gérées par la gauche s’engagent avec force dans les colos apprenantes (dispositif post-covid de colos à vocation éducative et scolaire à destination des publics ciblés, ruraux, banlieue, enfants de l’ASE, etc.). Étonnement, la NUPES ne propose pas d’action de changement du modèle des colos. Alors que l’Europe du Sud brûle, que de nombreuses régions souffrent du surtourisme et que le transport pollue toujours un peu plus, aucune réflexion n’est menée sur ce que devrait être une colo durable. Alors que le modèle pédagogique produit des violences sexuelles et sexistes systémique, les militant.e.s et élu.e.s de gauche et féministe n’envisagent aucune réflexion sur la remise en question de ce modèle. Alors que les enfants ont de plus en plus besoin de temps libéré d’activités contraintes et dirigées, aucune réflexion n’est menée sur le contenu des colos. Alors que nos démocraties sont en crise, aucun politique n’envisage de faire des colos un lieu de mixités et un lieu pour apprendre et éprouver la démocratie. La NUPES ne cherche pas non plus à changer les colos, elle accompagne un lent glissement vers toujours plus de libéralisme, d’inégalité et de séparation.
Faut-il voir dans cette absence de prise de conscience, l’absence des plus vulnérables et des plus pauvres dans les instances de réflexions ? Pour les organisateurs, le gouvernement et le comité de filière, c’est une évidence. Depuis l’origine de l’éducation populaire, la confusion entre travailler pour des pauvres et travailler avec des pauvres permet à beaucoup d’associations de se prendre pour le porte-parole des enfants ou de leurs familles. Appuyer toute réflexion pédagogique sur la théorie des besoins permet de maintenir l’adulte encadrant comme étant l’expert de l’autre vulnérable et de dénier à celui qui est vulnérable de savoir ce qui est bon pour lui. Affirmer avec force que le pass-colo est une victoire pour les enfants, c’est faire preuve de domination et/ou de cynisme.
Pour ce qui de la NUPES, plusieurs acteurs (dont le député B. Lucas) tentent de sortir de cette impasse notamment en associant des associations comme ATD-Quart-Monde, mais les propositions restent en deçà de ce qui pourrait être fait. La question des vacances des familles et des jeunes habitants les quartiers populaires est trop peu traitée, l’accueil inclusif et universel des colos et des structures touristiques n’est pas assez travaillé dans sa dimension concrète et pédagogique. Les freins, difficultés et rapport aux vacances pour les personnes en situation de vulnérabilité ne sont toujours pas accompagnés, les politiques publiques d’aides sont impossibles à comprendre et inégalitaires (notamment celle des CAFs). Le champ d’action est énorme… Faut-il que les décideurs publics acceptent de contraindre les organisateurs à des changements profonds, à écouter ce que disent les personnes exclus des colos aujourd’hui, à penser des politiques du care avant des politiques économiques.
Notre Terre et les personnes (de plus en plus nombreuses) en situation de vulnérabilité et/ou de pauvreté en ont rapidement besoin, à défaut nous continuons à creuser les fractures et inégalités, à défaut, nous continuons à exclure et à violenter ces personnes fragiles. C’est une question de dignité et d’humanité.