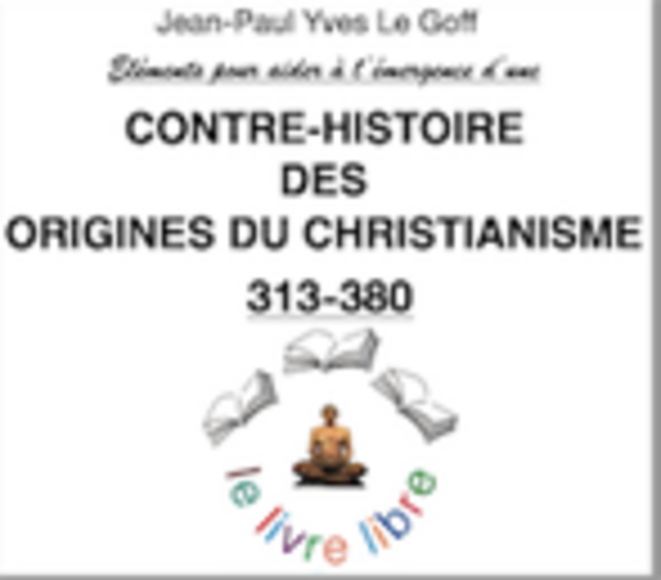Ici, même, au mois d'août, sous le titre "On ne convainc jamais personne" Jacques Dubois a présenté brillamment un livre du philosophe Marc Angenot, intitulé Dialogues de sourds, traité de rhétorique antilogique.
.
Je me permets de signaler à mon tour que le numéro de septembre de Philosophie Magazine a donné contradictoirement à la parole à ce philosophe et à l'avocat Thierrry Lévy. Angenot a donc redit les raisons pour lesquelles il pense que l'on ne convainc jamais personne et que les débats sont inutiles, tandis que son opposant Thierry Lévy, disait au contraire qu'il est possible de convaincre, ce qui est la moindre des choses pour un avocat.
Cette question me touche beaucoup et personnellement. C'est assez souvent que l'on m'objecte que je ne suis pas convaincant ou qu'on me met au défi de convaincre. (Par exemple, que la république française n'est pas une démocratie...)
Il n'est pas rare non plus que l'on me reproche de fuir le débat. (Du moins quand on est poli. Quand on ne l'est pas, on se contente de me traiter de con).
Cela n'est pas particulier à Médiapart, mais aussi dans différents endroits où il peut m'arriver d'en placer une.
J'ai renoncé depuis longtemps à essayer d'expliquer à tout le monde ce que les philosophes et les psychanalystes, c'est-à-dire que les contraires peuvent être également vrais. En fait, je veux et je ne veux pas convaincre. Je veux et je veux pas le débat.
Mais assez parlé de moi. C'était uniquement pour expliquer pourquoi j'ai trouvé cet échange entre Marc Angenot et Thierry Lévy dans Philosophie magazine assez intéressant pour en résumer, ci-dessous les grandes lignes.
jean-paul yves le goff
http://www.lelivrelibre.net
------------------------
Selon Angenot, dans une controverse, jamais un adversaire ne parvient à convaincre l'autre
parce que les parties opposées "thématisent différemment le monde" ce qui conduit au dialogue de sourd...
Il développe l exemple des anarchistes et des socialistes du XIXème sicèle...
Kropotkine et Jules Guesde, selon Marc Angenot ne peuvent pas s'entendre : "Parce que, dès les premiers mots échangés, ils s'aperçoivent qu"ils ne donnent pas le même sens à ces mots..." ( page 27)
Or, rien n'est plus insupportable que d'utiliser le même vocabulaire, sans donner chacun aux mots le même sens..., chacun pensant; nautrellement que le "bon" sens est le sien. Angenot appelle cela "rupture cognitive"...
Très vitre, dans le dialogue de sourds, chacun a l'impression que l'autre est "irrationnel, loufoque, voir fou..." on en arrive assez vite à l'invective... le dialogue est dès le début dans l'impasse...
(page 28)
Pour thierry Lévy, c'est peut être vrai dans la vie ordinaire mais il existe des situations où les querelles doivent trouver une issue - il pense à son monde : le prétoire "dans lequel une dispute ne peut être indéfiniement l'otage de controverses irrésolues"
ici, selon l'avocat, la rhétorique permet,en tant que technique, de révéler, d'expliquer, de convaincre...
Oui, dit Angenot, mais cette situation exceptionnelle se caractérise par le fait qu'il n'y a pas deux partis, mais trois, le troisième étant le juge...
-
Nouvel accord de Thierry Lévy : C'est, en effet, le juge et un certain nombre de caractéristiques particulières font quel'entente in fine est possible...
A quoi M. A. rétorque que oui, mais il y a dans la société une "multitude de secteurs ayant leur propre régime d'échange d'arguments. la conversation au café du commerce, le débat entre philosophes ou la situation du prétoire impliquent différentes stratégies rhétoriques."
Chacun de ces situation a ses limites et ses règles , au-dela desquelles, on ne s'entendre pas, au sens propre...
T. L. dit que la stratégie de l'avocat - ce qui fait, en somme l'art de l'avocat - c'est d'amener le juge à entendre ce qu'il ne veut pas entendre... "faire sortir le juge de la rationalité de la loi et de l'amner en douceur (...) sans jamais le dire, sur le terrain de la passion, c'est-à-dire de la transgression.Car interpréter la loi, c'est la transgresser. C'est très subtil ! Tout est dans le non-dit..."
Lévy va encore plus loin dans la subtilité... l'avocat doit savoir que le juge est un homme comme les autres, c'est-à-dire qu'il prendra secrètement plaisir à transgresser la loi...
La rhétorique, selon Angenot serait une science, (d'ailleurs inefficace); tandis qu'elle serait un art pour Lévy, donc efficace...
(page 28)
Page 29 : pour Lévy, les individus ne sont pas rationnels : "je ne pense pas du tout que la pensée humaine ait un si grand besoin de rationnel dans sa quête de vérité..."...
La rhétorique, pour lui, réussit quand elle s'adresse non à la rationnalité mais à la sensitbilité...de l'interlocteur (pathos), tout en faisant état d'écoute et de bienveillance (ethos).
Ce sont ces trois qualités, et non la rigueur argumentaire qui permettent de convaincre, c'est à dire "d'avoir une chance d'exercer une influence sur l'opinion de quelqu'un." "Je considère, dit-il, l'emploi de la rhétorique comme une forme de combat. Un combat ritualisé, où la violence physique est exclue. Ce qui en fait son absolue nécessité dans les relations entre les hommes".
Pour Marc Angenot, la rhétorique a son rôle dans le débat politique et permet "la démocratie", c'est-à-dire "un régime qui se caractérise par la mise en oeuvre de tous les moyens possibles pour empêcher les gens de se battre."
La rhétorique, reste malheureusement, dans la plupart des cas, inefficace. Le fait est que, partout, on se bat.
;
Utilisons là quand même, conclut Thierry Lévy, , car elle sert au moins à apaiser les tensions.
---