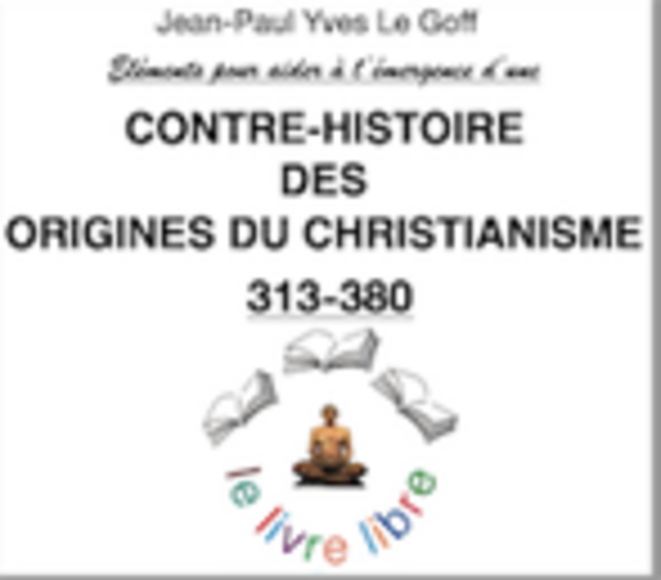Qu’ai-je voulu dire dans ma thèse quand j'ai proposé que l'on passe d'un paradigme historico-théologique à un paradigme hypothético-rationnel ?Je dois d'abord rappeler que cette thèse veux traiter des fondements historiques de la théologie chrétienne. Autrement dit, c'est une thèse d'histoire portant sur une question particulière la religion. Plus précisément encore le christianisme dans son origine. Encore faut-il définir ce qu'est, dans la circonstance, l'origine et c'est là un premier problème, à savoir qu'on peut entendre par origine aussi bien les 40 premières années de notre ère dite chrétienne que les quatre premiers siècle de cette ère.
Il faut ensuite rappeler que le terme de « paradigme » tel qu'il a été lancé par Kuhn concerne essentiellement les sciences (Rappelons qu’on peut le définir comme« ensemble de faits considérés à un moment donné par une communauté donnée comme l'explication de tel ou tel phénomène »). Même si ce paradigme émane d’une communauté scientifique, il se trouve que par des divers canaux de transmission , il évolue, e diffuse et gagne une sphère bien plus large qu'on peut appeler l'opinion publique.
J'ai rappelé l'exemple du paradigme géocentrique antérieur à Copernic. Ce ne sont pas seulement les astronomes, en ce temps-là, qui croient que le soleil tourne autour de la terre mais c'est tout le monde et si ce paradis fonctionne comme il fait, c'est que dans l'observation des astres les savants retiennent un certainde leurs mouvements et en élimine d'autres parce qu'ils sont incompatibles avec leurs théories générales. Ils font un tri.
J'aurais pu prendre aussi l'exemple de la révolution freudienne. Avant Freud, la psychologie est tout entière objet de conscience (perception, mémoire, imagination, raisonnement, etc.). Après Freud un champ nouveau de la psychologie s'ouvre parce que d'autres faits jusqu'alors ignorés tels que, par exemple, le lapsus et les rêves sont pris en compte et révèlent d'autres mécanismes jusqu'alors insoupçonnées (refoulement, instances psychiques, pulsions etc.).
Pour en revenir à mes deux paradigme le premier que je qualifie de « historico-théologique »consiste à soumettre l'histoire - en l'occurrence les faits supposés expliquer les débuts de cette religion – à des options théologiques – en l'occurrence le choix de la lecture de ces faits tels qu’elle est pratiquée par certaines catégories de croyants l’emportent sur d'autres lectures faites par d'autres catégories de croyants. L’histoire, telle qu’elle passe à la postérité résulte d’une option théologique qui sera perpétué de siècles en siècles et jusqu’à aujourd’hui, par la même option théologique.
Il y aurait lieu ici de développer pourquoi un tel tri ne peut pas être recevable par une méthodologie historique, c’est-à-dire affranchie des exigences de la foi. Je ne vais pas le faire maintenant, car encore une fois c'est le contenu historique des premières 40 années ou bien des premiers quatre siècles qui il y a lieu de revoir. Exactement comme le paradigme géocentrique faisait tourner le soleil autour de la terre, le résultat de ce paradigme historico-théologique,c’est que les origines du christianisme tiennent à un homme qui a en réalité la nature d'un dieu - c’est Dieu incarné - et avec l'histoire de cet homme-dieu se combine l'histoire de 12 autres hommes qui ont le privilège de l'approché et dont la foi est extraordinairement communicative. Tout est relaté dans les « quatre évangiles ». Pour les besoins de la théologie ce fait initial ne saurait être mis en doute sous peine de voir tout le reste de l'édifice s'écrouler. C’est la théologie qui dicte l’histoire.
Le paradigme hypothético-rationnel, au lieu de la foi place la raison en principe primordial. c’est-à-dire qu'il faut absolument mettre en suspend tout ce qui consiste en des a priori inspiré par la foi et ne pas tenir les conséquences possibles sur la foi telle qu'elle est pratiquée par les croyants actuel, des considérations qui pourraient la détruire. Ou l’affaiblir. Ou la modifier. Donc pour le second paradigme, l'explication du premier - c'est-à-dire un homme-dieu plus 12 missionnaires - cette explication est mise en suspend. Elle n'est nullement nié, mais elle devient hypothétique. Ce que le premier paradigme présentait comme une certitude parce que la foi l'exiger le second la considère comme une hypothèse parmi d'autres parce que aux yeux de la raison, les exigences historiques en matière de preuves sont incontournable et ce qui n’est qu’hypothétique doit être présenté comme hypothétique et non plus comme une certitude, quelles qu’en soient les conséquences ? La vérité historique de Jésus de Nazareth n’est pas impossible mais d’autres hypothèses sont à considérer, quitte à choisir « in fine » l’explication la plus probable. Quelles sont ces autres hypothèses qui expliqueraient le début du christianisme, je ne puis ici que renvoyer à ma thèse. Ce qui est sure c’est que - de même que le paradigme héliocentrique prenait en compte des observations physiques jusqu’alors rejetées e- le paradigme hypothético-rationnel prend en compte des contenus historique jusqu’alors rejeté par le paradigme précédent. Cela change énormément de choses. Finale