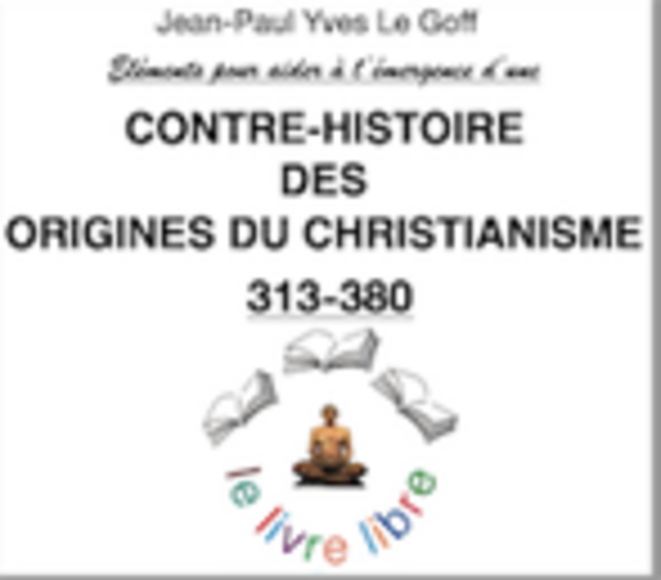Ernest Renan, en dépit de sa popularité, eut, au moins à un moment de sa vie, de graves difficultés avec le pouvoir politique pour les propos qu’il tenait – et qu’il voulait de nature scientifique – sur les origines du christianisme. Son aîné dans les sciences religieuses, l’Allemand D.F. Strauss, en avait eu avant lui. Voltaire en avait eu. Richard Simon en avait eu. Lessing, agissant pour Reimarus en avait eu.Spinoza en avait eu. Erasme en avait eu. Lorenzo Valla en avait eu.
.
C’était pour mettre un terme à cet abus de pouvoir multiséculaire qu’en 1885 les Républicains décidaient de mettre un terme à la longue existence de la faculté de théologie de la Sorbonne (ainsi que celles des universités de Rennes, Bordeaux, Lyon, Rouen et Toulouse), en s’appuyant, bien sûr, sur l’accord des parlementaires, puisque l’on était en république. (La faculté de théologie de la Sorbonne avait, entre autres performances, en 1762, prononcé la condamnation de l’Emile de Rousseau, à la suite de quoi, le Parlement à son tour décrétait la prise de corps de l’auteur qui prenait la fuite et mènerait une vie d’exil jusqu’à sa mort).
.
Mais en 1885, sous le gouvernement Brisson, ce sont les républicains qui sont au pouvoir et le ministre de l’Instruction publique est René Goblet, ancien adjoint de Jules Ferry et qui prendra lui-même la responsabilité de la troisième grande loi de laïcisation de l’enseignement primaire, de 1886. L’enseignement supérieur avait déjà été l’objet, dès avant la fin du Second empire de plusieurs mesures de laïcisation, notamment les deux membres du clergé siégeant de droit au Comité directeur de l’enseignement supérieur s’étaient vus remerciés, du temps de Victor Cousin.
.
La laïcisation de l’enseignement (à tous les niveaux) était la phase préalable et indispensable à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Dans tous les cas, il s’agissait de mettre un terme à l’influence plus qu’abusive exercée par la religion (catholique en l’espèce) sur tous les rouages de la société.
.
Précisément, en 1885, le doyen de la faculté de théologie, Mgr Maret, venait de mourir. C’est peut-être ce qui sembla aux républicains l’occasion propice pour mettre un terme à l’existence de cette faculté. Un long débat eut lieu à la Chambre des députés avant que soit entérinée cette décision, d’autant plus contestée par toute la partie cléricale de l’opinion publique que dans le même temps, et de toute évidence, pour remplacer cette faculté en voie de suppression, le projet était né d’adjoindre à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, organe semi-autonome au sein de la Sorbonne (créé en 1868), une cinquième section, qui devait prendre le nom de « Section des sciences religieuses » (et hériter du budget et des locaux de la Faculté de théologie).
.
C’est ce qui indigna l’un des députés les plus activistes de l’aile cléricale, Mgr Charles-Louis Freppel, qui avait un curriculum vitae bien fourni, ayant été lui-même pendant de nombreuses années « professeur d’éloquence sacrée » dans cette même Sorbonne, puis conseiller spécial de Pie IX à Vatican I (1870-1871) où il s’était montré un ardent partisan de l’infaillibilité. Fondateur à Angers ville d’où il était évêque de la première Faculté catholique d’Angers, bientôt suivie de celle de Paris, précisément pour pallier l’éviction des universités républicaines que l’Eglise voyait venir, il détenait enfin un mandat de député du Finistère (Brest), puisque cette époque fut l’âge d’or des évêques-députés. C’est ce qui lui vaut, le 29 juin 1885, de s’opposer à la création de la Vème section, en ces termes qui donnèrent lieu à de vifs échanges, notamment avec le ministre :
.
« On se propose, d’après le programme de M. le rapporteur, de soumettre les religions à l’examen, à la comparaison et à la critique, dans les chaires que l’on vous demande de créer. Eh, bien : de deux choses l’une : ou cet examen, cette comparaison et cette critique seront conformes à l’enseignement catholique, et alors pourquoi avoir supprimé l’enseignement théologique dans les facultés de l’Etat, si vous voulez en revenir au même but ? Ou bien cet examen, cette comparaison et cette critique seront contraires à l’enseignement catholique et alors vous sortez de la neutralité au nom de laquelle vous avez supprimé, de fait, sinon en droit, les facultés de théologie. Il n’y a pas de milieu ».
.
Ces quelques paroles sont d’une importance essentielle jusqu’à aujourd’hui. Si l’enseignement de l’histoire selon l’Université s’oppose à l’enseignement de l’histoire selon l’Eglise, peut-il se réclamer de la neutralité laïque ? En d’autres termes, l’histoire est-elle neutre ? Si elle ne l’est pas, l’histoire doit-elle se taire pour ne pas heurter la théologie ou bien la théologie doit-elle se modifier parce que l’histoire l’y contraindrait ?
.
« Je suis donc en droit de conclure, reprit l’évêque d’Angers et député de Brest, que votre section des sciences religieuses ne sera pas autre chose qu’un enseignement théologique retourné contre nous. Ce sera, purement et simplement, une faculté de théologie anti-catholique. » Le ministre de l’Instruction publique, Goblet, se leva pour répliquer : « Nous ne voulons pas qu’on y fasse œuvre de polémique, mais œuvre de recherche, de critique. Nous voulons qu’on y examine des textes et non qu’on y discute les dogmes. » « C’est la même chose ! » l’interrompit péremptoirement Mgr Freppel.
.
Mgr Freppel n’eut pas gain de cause et la création de la Vème section de l’EPHE fut votée. Elle fonctionne dès la rentrée universitaire de 1886 avec une dizaine de chaires. (Il y en a plus d’une cinquantaine aujourd’hui). Les craintes de Mgr Freppel semblent trouver une réponse qui se voulait apaisante dans un discours que le premier président de la Vème section, Albert Réville, chef de file en France du protestantisme libéral, titulaire de la chaire d’histoire des religions au Collège de France, auteur de nombreux ouvrages [1]tient trois ans après l’ouverture de la section, dans ce qui se présente comme un premier bilan : « Il est clair qu’il ne saurait être question d’un enseignement dogmatique ou confessionnel quelconque. A la seule condition de reconnaître le principe de l’autonomie de la science historique et critique, tous doivent pouvoir enseigner dans la section. Parmi ses directeurs et ses maîtres, on pourrait distinguer des catholiques, des protestants, des israélites, des adhérents de la tendance dite de la libre pensée. Mais à vrai dire, ces distinctions, dont nous n’entendons pas nier l’importance ailleurs, sont inconnues dans la section et disparaissent dans le culte commun de la vérité historique ».
.
Toute la question est de savoir s’il en sera effectivement ainsi et si la vérité historique pourra s’épanouir librement sans heurter la vérité théologique comme le redoutait Mgr Freppel. Ce qui est certain qu’un seul titulaire de la chaire des origines du christianisme depuis la création de la chaire jusqu’à aujourd’hui pourra se prévaloir d’une totale neutralité en matière d’engagement religieux. Cet honneur revient à un auteur aujourd’hui complètement oublié du nom d’Ernest Havet qui avait été un disciple d’Ernest Renan. Ernest Renan lui-même avait été pressenti pour occuper la chaire mais pour quelque raison que ce soit elle échut finalement à son élève qui était lui-même un homme déjà achevé qui devait d’ailleurs ne l’occuper que deux ans, puisqu’il allait mourir en 1889 (à 76 ans).
.
Ernest Havet était idéologiquement attaché à ce courant dit de la libre pensée, plus précisément à sa fraction tolérante et rationaliste, un autre courant se signalant par un anticléricalisme virulent. Ernest Havet s’était distingué par une contribution particulièrement originale à l’histoire des origines du christianisme [2], en démontrant l’importance de l’hellénisme dans la formation de la religion nouvelle. Selon lui, le christianisme était judaïque dans la forme et hellénique dans le fond. Certes, le Crhist est juif et vit au milieu des Juifs. Paul et les apôtres sont Juifs. La Pâque est une fête juive. Les premières Ecritures sacrées dont se servent les premiers chrétiens sont la Bible hébraïque. Pourtant, c’est à Antioche, qui est une ville de culture grecque qu’apparaissent, dit-on, les premiers chrétiens. Les premières Ecritures sacrées qu’utiliseront en propre les chrétiens, c’est-à-dire les textes réunis sous l’appellation de « Nouveau Testament » sont écrits en grec. C’est à des Grecs que Paul s’adresse. C’est dans l’Asie grecque que se trouvent les sept églises auxquelles l’Apocalypse est adressé. Dans toutes les grandes villes où le christianisme s’est développé, Alexandrie, Constantinople, Carthage, Lyon, Rome même, on parle grec. Dans les conciles des quatrième et cinquième siècle où sont formulés les dogmes chrétiens, on parle grec. Dogme lui-même est un mot grec, comme théologie, évêque, diacre, moine, mystère, symbole, catéchisme, etc.
.
Un philosophe en renom au XIXème siècle, Etienne Vacherot, auteur d’un livre très remarqué , intitulé « La religion, paru en 1869, écrit : « M. Havet a-t-il démontré sa thèse des origines helléniques du christianisme ? Nous croyons qu’il sera difficile d’en douter après l’avoir lu. Le christianisme a pour père le Christ qui est juif de naissance, de doctrine et de génie. Mais (…) au fond, le christianisme a plusieurs origines, parmi lesquelles la grecque doit être comptée (…) Ce n’est point un paradoe d’affirmer que le christianisme proprement dit est bien plus grec que juif et qu’il est plus facile de retrouver ses affinités naturelles avec l’hellénisme qu’avec le judaïsme. Quoiqu’il en soit, la thèse de M. Havet et bien grave pour l’orthodoxie catholique et chrétienne. Nos théologiens peuvent-ils laisser dire et surtout laisser prouver que le christianisme a ses principales origines dans la philosophie grecque ? (…) Nous ne serions pas surpris de leur répugnance à suivre un tel adversaire sur le terrain de la critique exacte et scientifique (…) Comment réfuter des conclusions fondées à ce point sur les textes ? En tout cas, la critique y attend la théologie (…)[3] »
.
En fait, bien longtemps avant la création de la Vème section – nous étions encore sous le Second empire, les propos de Vacherot devançaient la problématique posée par Mgr Freppel et Albert Réville et qui était rigoureusement celle énoncée aussi par Ernest Renan, à ceci près qu’elle se concrétisait dans une thèse nouvelle, à savoir les origines grecques du christianisme. « La thèse de M. Havet et bien grave pour l’orthodoxie catholique et chrétienne, demandait Etienne Vacherot . Nos théologiens peuvent-ils laisser dire et surtout laisser prouver que le christianisme a ses principales origines dans la philosophie grecque ? (…) Nous ne serions pas surpris de leur répugnance à suivre un tel adversaire sur le terrain de la critique exacte et scientifique ». Un siècle et demi après, nous disposons de la réponse : on continue à passer aujourd’hui sous silence la part essentielle de l’hellénisme dans le christianisme et bien d’autres données historiques incontestables concernant les débuts de la nouvelle religion. Non seulement les théologiens n’ont pas suivi les historiens sur le terrain de la critique exacte et scientifique, mais ils ont réussi à empêcher les historiens d’y progresser. Et c’est ce que nous montrerons plus loin en nous intéressant à l’évolution de la Vème section, après avoir consacré quelques pages à découvrir ce qui se passe du côté de la Faculté catholique de Paris où enseigne un certain abbé Alfred Loisy.
.
( à suivre )
.
jean-paul yves le goff
précédents envois :
6 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-1
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-2
7 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-3
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-4-0
_
8 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-5
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-6
.
9 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-7
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-8
.
11 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-9
[1] Parmi lesquels : Histoire du dogme de la divinité de Jésus-Christ (1869) ; Histoire des religions non-chrétiennes (1883) ; Jésus de Nazareth (1897)
[2] Ernest Havet, Le christianisme et ses origines, 4 volumes, (1871-1885)
[3] Etienne Vacherot, La religion, 1869 , page 108