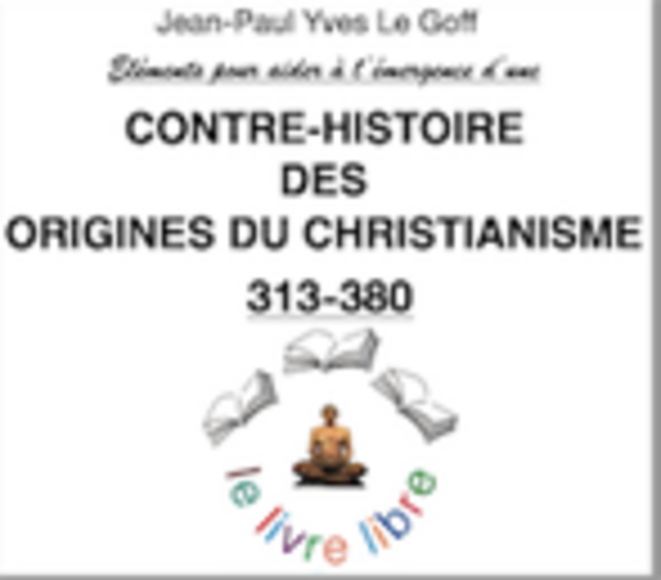Qu’il s’agisse d’histoire générale, d’histoire religieuse, d’histoire des religions, d’histoire du christianisme ou d’histoire de l’Eglise, c’est un fait sans précédent dans l’histoire tout court qu’un pape écrive et publie une « Vie de Jésus ». C’est ce qui s’est passé en 2007 avec l’initiative de Benoit XVI qui donna lieu à un fort battage médiatique. Non pas qu’il contînt grand chose de nouveau, et telle n’était pas non plus son intention ou, s’il avait quelque chose de nouveau, cela passa tout-à-fait inaperçu de la plupart des commentateurs.
.
C’était une petite phrase, dans l’introduction, disant, alors que l’auteur parle des transformations de l’histoire : « Et incarnatus est – et il s’est incarné – Si nous écartons cette histoire, la foi chrétienne est abolie en tant que telle et refondue dans une autre forme de religion ».
.
A cette occasion, parmi de nombreux autres exemples possibles, pourquoi ne pas examiner comment un hebdomadaire qui ne saurait être soupçonné ni de cléricalisme ni d’obscurantisme, traite l’information ? N’ayant pas, en interne, de journaliste suffisamment au fait des problèmes historico-théologiques pour pouvoir apprécier la prestation papale, le Nouvel Observateur fait appel à Daniel Marguerat, présenté comme
« Mondialement connu pour ses recherches sur le Jésus de l’histoire » et « professuer à la Faculté de Théologie de Lausanne » - ce qu’il est en effet , même s’il n’est pas que cela. (Pour le reste, ce sera au lecteur de se débrouiller s’il veut le savoir).
.
Le Nouvel Obs demande donc : pourquoi cet intérêt si vif pour l'homme de Nazareth .
Réponse de Daniel Marguerat : Plus que jamais, Jésus appartient à tout le monde, aux croyants comme aux incroyants. (…)Dans le même temps, Jésus est devenu l'objet de très sérieuses recherches. Jusqu'au XIX e siècle, à la question « Qui est Jésus ? », la réponse était dogmatique : « Lisez les Evangiles. » (…)Or Benoît XVI a beaucoup de mal à consentir à cette singularité des auteurs bibliques.
.
N.O. Quelle attitude l'Eglise a-t-elle adoptée vis-à-vis de cette approche critique ?
.
D. Marguerat. Les rapports de l'Eglise et de la recherche ont donné lieu à des bras de fer spectaculaires. Rappelons-nous comment Ernest Renan, avec sa sublime « Vie de Jésus », en 1863, a soulevé l'ire de l'Eglise, après avoir enflammé les foules (…)Il y eut entre 250 et 300 publications contre son seul « Jésus » ! Renan, lui, a été excommunié. En réalité, depuis qu'elle est née, à la fin du XVIII e siècle, avec l'Allemand Hermann Reimarus, la recherche du Jésus de l'histoire a toujours éveillé le soupçon, voire l'hostilité des Eglises, surtout catholique. La papauté l'a donc condamnée jusqu'au moment de la fameuse encyclique « Divino Afflante Spiritu » ( 1943 ) de Pie XII, qui a enfin autorisé les exégètes catholiques à y recourir. Aujourd'hui, Benoît XVI en admet la pleine légitimité. Grand érudit, il connaît la recherche académique, sans doute pas la plus récente, mais il dialogue avec elle, c'est très positif. Néanmoins, on pressent dans son texte le contentieux encore ouvert entre les théologiens de l'Eglise catholique et les chercheurs du Jésus de l'histoire. Si le pape se livre à une telle opération, c'est qu'il y voit un danger pour la foi. Son but est de rassurer les croyants, de donner une « version officielle » de la figure de Jésus.
N.O. - Renan disait que « ce que nous connaissons de Jésus tient en quelques lignes ». Qu'en est-il aujourd'hui ?
D. Marguerat. - Ce scepticisme radical n'est absolument plus partagé par personne. Nous n'en sommes plus à nous demander si Jésus a existé ou non. Et du personnage historique, le mieux attesté de toute l'Antiquité, nous en savons à la fois beaucoup et trop peu. Bien plus en tout cas qu'à l'époque de Renan !
N. O. - Le pape annonce d'emblée son projet de présenter « le Jésus des Evangiles » comme « le vrai Jésus », comme « le Jésus historique » au vrai sens du terme. D. Marguerat. - Sur ce point, son entreprise est indéfendable. D'un point de vue théologique, sa lecture est parfaitement équilibrée, intelligente, parfois brillante, mais elle va dans l'ensemble à l'encontre de ce que la critique historique met en avant depuis deux siècles. Benoît XVI lit la figure de Jésus comme les Pères de l'Eglise l'ont fait depuis le II e siècle. Je ne critique pas en soi cette option d'interprétation « canonique », sauf qu'elle ne peut pas prétendre à l'objectivité historique.
N. O. - Mais Benoît XVI a tenu à présenter ce travail comme le résultat d'une « recherche personnelle », celle de l'universitaire Joseph Ratzinger.
D. Marguerat . - Ambiguïté supplémentaire ! Qui parle ? Le professeur, le polémiste, le pasteur ? Le livre est hybride, et l'auteur, multifacette. Il prend la précaution de dire « libre à chacun de me critiquer » , mais quelle est la liberté des exégètes catholiques de se prononcer sur ce que dit le pape ? Ce livre, en tout cas, ne fera pas taire les chercheurs du Jésus historique.
.
Pour l’ambiguïté, Daniel Marguerat ne le cède en rien à Joseph Ratzinger, se présentant comme universitaire, ce que, de fait, il est. Notamment, à moins de mener sa propre enquête, le lecteur du Nouvel Observateur ne saura pas qu’outre sa qualité de professeur de théologie à la Faculté de Lausanne, Daniel Marguerat est aussi pasteur de l’Eglise évangéliste, c’est-à-dire une tendance du protestantisme qui ne passe pas spécialement pour libérale. Peu importe, d’ailleurs, les nuances de sa foi ; ce qui est intéressant, c’est qu’en tant que l’historien qu’il croit être, les nuances seraient bienvenues, là où il affiche des certitudes hasardeuses.
.
Certes, il n’est pas le seul à le faire. Le bien connu Frédéric Lenoir qui n’est pas davantage historien, mais très efficace médiateur de l’histoire, directeur du mensuel « Le Monde des religions » affirme dans un petit livre publié en 2008 : « « Et l’historicité du personnage, affirmée par des sources extérieures, même si elles sont ténues, ne fait plus aujourd’hui l’objet de doutes » [1]
.
Que s’est-il donc passé ? Quelles sont ces découvertes qui ont fait de Jésus, aujourd’hui, le personnage le mieux connu de l’antiquité, alors qu’en différents endroits de son œuvre, Charles Guignebert émettait des opinons comme celles-ci :
.
: « Si peu que nous sachions de sa vie, devons-nous considérer Jésus comme un personnage réel de l’histoire ou bien sa figure humaine ne nous représente-t-elle qu’une construction de la foi, une combinaison, animée par elle, de mythes et de légendes ? Tel est le problème que je me propose d’examiner ».
(...)
« Confessons donc que tous les prétendus témoignages païens et juifs ne nous apportent aucun renseignement utile sur la vie de Jésus, qu’ils ne nous donnent même pas la certitude qu’il ait vécu. »
« Je viens d’énumérer tous les renseignements que les sources vraiment antiques juives ou païennes, mettent à notre disposition, touchant les débuts du mouvement chrétien, au 1er siècle : autant dire que ce n’est rien du tout ».
(...)
« Le christianisme rapporte son origine à Jésus-Christ. La tradition orthodoxe prétend posséder son histoire humaine dans les Evangiles, mais nous savons qu’ils ne nous ont conservé que des témoignages lointaines, indirects, souvent contradictoires, toujours arbitrairement ordonnés, tout-à-fait étrangers au souci de la précision et de la vérité objective. Pris en eux-mêmes, d’ailleurs, ils sont très incomplets et laissent sans réponse quantité de questions que se pose l’historien le moins exigeant ».
(...)
: « Il serait très hasardeux d’accepter de tels écrits (…) pour des documents dignes de la confiance de l’historien ».
.
Même des historiens de sensibilité catholique affirmaient encore jusque dans les années 1950-1960, l’extrême ténuité des informations sur Jésus-Christ : par exemple Henri-Irénée Marrou, dans un article signé du pseudonyme d’Henri Davenson : « Ce que les hommes voulaient savoir de nous, c’était, par exemple, si oui ou non, le Christ Jésus était né à Bethléem de la Vierge Marie. Tout ce que notre science, en stricte rigueur, trouvait à leur répondre, c’était : « Nous confessions notre ignoranc, les témoignages ne sont pas suffisants pour conclure nécessairement par oui, mais naturellement nous ne pouvons pas davantage conclure par non ».[2] Pour sa part, Marcel Simon écrit dans son Que-sais-je ? de 1952 (réédité en 1960) : « Nous disposons (…) d’une documentation très restreinte et singulièrement délicate à manier. Du côté païen, elle se réduit à deux ou trois brèves indications de Suétone et de Tacite. Les quelques lignes que l’historien Flavius Josèphe, contemporain des événements, consacre aux premiers chrétiens dans plusieurs passages de ses Antiquités Judaïques trahissent des retouches et des interpolations chrétiennes tellement évidentes qu’il n’y a pas grand secours à en attendre. Si bien que nous en sommes pratiquement réduits aux seules sources chrétiennes, c’est-à-dire aux écrits du Nouveau Testament ».
.
Le célèbre Daniel-Rops écrit dans son « Jésus en son temps », réédité en 2965 :
« A s’en tenir aux documents romains seuls, il n’est pas rigoureusement démontrable que le Christ a bien existé ».
.
Il ne serait donc pas superflu que Daniel Marguerat et ses homologues – nous allons en découvrir quelques autres plus loin et même les trouver là où ne les y attendrait pas nécessairement, c’est-à-dire dans nos universités laïques – s’expliquent sur ce qui, en si peu de temps a transformé un quasi-inconnu, historiquement, en personnage antique le mieux connu qui soit.
.
L’explication serait d’autant plus utile, qu’il semblerait la connaissance – mais toujours sans que l’on puisse identifier les sources - continue à progresser. Ainsi, le même Daniel Marguerat est désormais en mesure – et il n’est pas le seul – de nous donner la date exacte de la mort de Jésus-Christ : Que s’est-il passé dans les jours qui ont suivi la mort violente de Jésus de Nazareth le 7 avril 30 ? Historiquement, les faits sont difficiles à reconstituer »[3]. Selon une technique bien établie, le « chercheur » affectant une grande prudence, pose une question concernant des événements postérieurs à un fait qui s’est produit à une certaine date et qui seraient fort incertains ; mais le fait évoqué, en l’occurrence la mort violente de Jésus, et de surcroit la date précise, 7 avril 30, ne sont , quant à eux, l’objet d’aucune question. Ils ne sont non plus l’objet d’aucune démonstration, d’aucune explication. C’est du donné. Exactement comme l’existence de Jésus elle-même. Exactement comme la validité historique des évangiles. C’est du sûr. [4]
.
(à suivre)
.
jean-paul Yves le goff
http :www.lelivrelibre.net
.
Précédents envois :
.
6 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-1
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-2
7 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-3
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-4-0
_
8 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-5
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-6
.
9 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-7
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-8
.
11 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-9
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-10
.
13 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-11
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-12
.
15 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-13
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-14
.
16 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-15
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-16
.
18 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-17
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-18
.
19 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-19
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-20
.
23 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-21
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/230709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-22
.
24 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/240709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-23
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/240709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-24
.
26 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/260709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-25
[1] Frédéric Lenoir, Petit traité d’histoire des religions, 2008, page 271
[2] Henri Davenson (H.I. Marrou, Tristesse de l’historien, Revue Esprit, n° 79, 1er avril 1939, page 32
[3] )Daniel Marguerat, Les Judéo-Chrétiens, page 24 le Monde des religions, novembre 2007
[4] Le choix d’une telle date est, évidemment arbitraire : il résulte d’un raisonnement tenu à partir de deux indices figurant dans les évangiles (la veille de Pâques et le jour du « vendredi »), les données calendaires de l’époque et les calculs astronomiques d’aujourd’hui permettent d’établir que le vendredi, veille d’une fête de Pâques juive , est repérable en 27, en 30 et en 33. Le raisonnement, c’est que 27, c’est tôt, 33, c’est tard, donc 30 est juste bien : et en cette année 30, le vendredi veille de Pâques était le 7 avril !