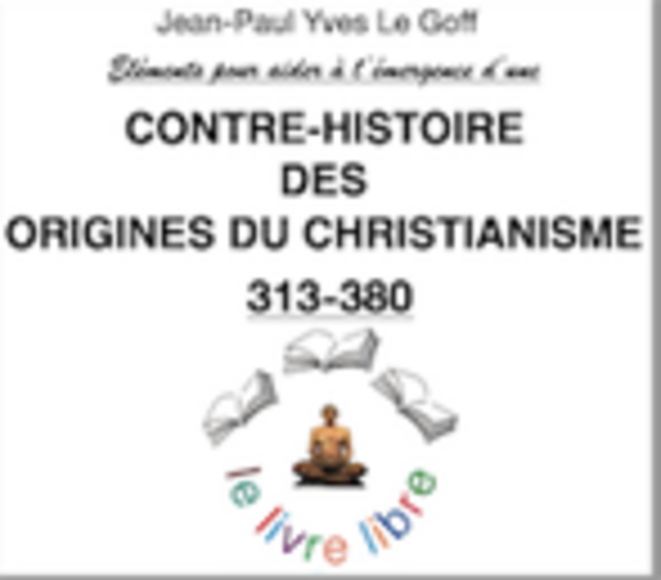.
En raison de la longue période pendant laquelle la chaire des origines du christianisme, à l’EPHE reste vacante, elle n’a connu que six titulaires dont l’actuel est Simon-Claude Mimouni (né en 1949), qui fut longtemps l’élève de Pierre Geoltrain avant de devenir son successeur en 1987. C’est loin d’être la seule chaire dans l’université française où l’on enseigne les origines du christianisme ; mais c’est la seule et unique à porter cette appellation, les autres se présentant sous des dénominations variées . [1]
.
Ne serait- ce que pour cette raison, mais il y en a aussi plusieurs autres – cet historien mérite la plus grande attention. L’une des autres, c’est que non seulement il se présente comme un historien des religions libre de tout engagement confessionnel, mais il est facilement enclin à dénoncer l’influence toujours existante de la théologie sur l’histoire et souhaiter qu’un jour il lui soit mis un terme. Fait-il, effectivement, tout ce qui serait en son pouvoir pour qu’il en soit ainsi ? C’est ce qu’il appartiendra à chacun d’estimer.
.
Dans le cadre d’une déjà abondante, matérialisée par de nombreux livres, articles et études dans différents journaux et revues, actes de colloques et communications diverses et variées, s’il ne fallait retenir qu’une seule citation – mais nous en verrons cependant quelques-unes - la suivante serait sans doute la meilleure possible pour illustrer à la fois l’audace et la timidité de cet auteur que l’on peut considérer comme la manifestation de cette gêne précédemment évoquée que les chercheurs en histoire des religions peuvent rencontrer face quand «l’objet de leur étude (est) une religion liée à notre civilisation occidentale. »
.
« Jésus ne saurait être compris en dehors de l’horizon de la religion nationale juive. Comme tel, il n’est pas le fondateur du christianisme, d’autant qu’il est erroné, anachronique de parler de christianisme avant le milieu du IIème siècle. En revanche, on peut considérer Jésus avec quelque assurance comme le fondateur d’un mouvement de piété aux tendances prophétiques et eschatologiques assez marquées. »[2]
.
Plusieurs historiens, dont Maurice Goguel, prédécesseur de Simon-Claude Mimouni dans cette chaire d’histoire des origines du christianisme avaient déjà écrit que Jésus n’avait « pas fondé le christianisme » ou, selon les cas, « n’avait pas fondé l’Eglise ». [3]Mais cela ne s’était guère répété depuis les années 1950, du fait de la restauration et il est significatif que cela ne puisse se faire encore, plus d’un demi siècle postérieurement, sans encore provoquer une manière de scandale. Scandale, d’ailleurs, que Simon-Claude Mimouni est assez habile pour désarmorcer d’entrée de jeu, d’abord en l’écrivant dans une revue à petit tirage, et omettant de renouveler l’audace dans le gros livre qu’il publie quelques mois plus tard [4] dans lequel, au contraire, à deux ou trois amphigouris près, il écrit dans un sens qui ne peut qu’enchanter Benoit XVI.
.
Pourtant dans une autre encore publication très érudite, à l’usage de ses homologues érudits , cette gêne qui est le lot des historiens travaillant dans le champ des sciences religieuses, il la décrit et la commente très bien : « L’historien du christianisme en ses débuts, quant à lui, éprouve toujours des difficultés à se départir des représentations historiographiques (…) Même s’il apparaît évident maintenant que le christianisme ne commence pas avec la naissance de Jésus, il n’en demeure pas moins, pour le grand public, engagé ou non d’un point de vue confessionnel, qu’il ne fait pas de doute que la religion chrétienne commence nécessairement avec la naissance de son fondateur, puisque le calendrier en usage utilise sa date de naissance comme point de départ, comme moment originel. De ce fait, affirmer, auprès des autorités religieuses, juives comme chrétiennes, ainsi que du grand public , qu’il est difficile de parler de christianisme avant 135, voire avant la fin du IIème siècle, tout au moins en tant que religion constituée, apparaît bien souvent comme saugrenu, pour ne pas dire plus – est pourtant, au risque de bouleverser profondément l’image qu’elles s’en font, comment pourrait-il en être autrement au regard des sources ? »[5] et [6]
.
Il apparaît donc clairement ici que qu’un siècle après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’historien à quelques difficultés à « se départir des représentations historiographiques d’origine ecclésiastiques », ceci qu’il soit « engagé ou non d’un point de vue confessionnel ». Si donc, à son corps défendant, l’historien non engagé d’un point de vue confessionnel se trouve gêné pour tirer les conclusions, ou les exprimer, qui ressortent de ses recherches, combien n’est-on pas en droit de craindre que l’historien engagé confessionnellement, n’adopte, consciemment ou non, celles qu’exige sa foi et son attachement à une institution ecclésiale ? Au demeurant, il est à noter que la pression que ressent l’historien « non engagé » provient aussi bien du « grand public » que de la part d’autorités religieuses, qu’elles soient juives, catholiques, ou protestantes. Enfin que celles- ci s’exposeraient à un grand risque de déstabilisation si elles devaient faire front à certaines de ces conclusions, pourtant incontournables « au regard des sources ».
.
Quand on suit l’évolution de ses écrits sur un certain nombre d’années, on est en droit de se demander si Simon-Claude Mimouni a aussi bien résisté à ces sortes de pression que lui-même le souhaitait en débutant sa carrière.
.
Toujours est-il qu’un certain scepticisme de type rationnel, se laissait percevoir dans le premier gros ouvrage qu’il publiait sur les origines du christianisme en 1998 :
.
« Il est courant de dire ou de lire que les origines du christianisme sont enveloppées d’ombres, sinon de légendes, qu’elles relèvent d’une véritable nébuleuse, plus proche du mythe que de la réalité. Les origines du christianisme sont, il est vrai d’autant plus difficile à cerner que les informations permettant d’essayer de les connaître ou de les reconstituer sont presque exclusivement chrétiennes, contenues dans des documents postérieurs aux événements de quelques décennies ou plus et, de ce fait, marquées par de nombreuses relectures interprétatives (…) Les représentations des origines du christianisme que développent la plupart des historiens engagés d’un point de vue confessionnel relèvent plus souvent de concepts théologiques que de réalités historiques (…) »[7]
.
C’est, à quelques mots près ce que disait Voltaire au début de son « histoire de l’établissement du christianisme « (1777)[8]
.
Or, voici qu’en 2006, dans un gros livre qu’il fait paraître avec Pierre Maraval, professeur émérite à Paris IV, Simon-Mimouni semble désormais en possession de certitudes, venues on ne sait, malheureusement, d’où. : « « Jésus est loin d’apparaître comme un personnage isolé de son temps et s’inscrit dans une série documentaire bien connue et bien identifiée », affirmation réitérée un peu plus loin : « Peu de personnages de l’antiquité bénéficient d’une attestation documentaire aussi riche d’un point de vue quantitatif comme qualitatif » [9] Les éléments de preuve qu’il donne peuvent laisser pour le moins dubitatif : « C’est ainsi, écrit Simon-Claude Mimouni, qu’on dispose du témoignage de Flavius-Josèphe, ce que l’on appelle le Testimonium Flavianum (…) qui, à lui seul, suffit à affirmer l’existence historique de Jésus- la question de son authenticité, pour l’essentiel, ne saurait être mise en doute, à la suite, notamment, de l’étude publiée par Serge Bardet »
. Il s’agit en l’occurrence, d’une thèse publiée en 2002 [10] qui ne conclut d’ailleurs et c’et fort heureux, qu’à la probabilité de l’authenticité de la thèse, ce qui n’engage que l’auteur et les membres du jury que celui-ci a su convaincre. Un tel travail, d’ailleurs intéressant, ne saurait mettre un terme à une controverse de cinq siècles, qui en fait l’une des énigmes les plus impénétrables de toute l’histoire littéraire et ne comporte rien de nouveau puisque, dès le début de la querelle, il y eut le camp des partisans de l’authenticité et celui des adversaires dont aucun ne put jamais triompher de l’autre.
La querelle n’a pas trouvé sa conclusion avec Serge Bardet.
.
L’autre preuve en matière d’existence historique certaine de Jésus de Nazareth, pour Simon-Claude Mimouni n’est autre que l’apôtre Paul : « « Ce témoignage, à lui seul, permet d’ailleurs d’affirmer que Jésus a bien existé et qu’il a laissé dans son entourage un souvenir extraordinaire ». Dans son problème de Jésus (1914) Charles Guignebert écrivait : « « Paul dit explicitement qu’il n’a pas vu Jésus autrement que par les yeux de l’esprit et, à la vérité, quant il nous parle de la connaissance qu’il en a, il ne s’agit que des apparitions ou des visions dont le Seigneur l’a favorisé. On ne saurait voir en aucune d’elles, alors même qu’on ne contesterait pas sa réalité, autre chose qu’une transfiguration céleste d’un Jésus ressuscité. En quoi la foi en un pareil Jésus suppose-t-elle l’existence d’un Maître des Evangiles ? (…)A celui-là, Paul, c’est lui-même qui le dit,, n’a pris aucun intérêt, ni à sa personne, ni à son destin, ni à sa doctrine ; (…)« La littérature paulinienne sue l’interpolation ; originairement, elle ne devait même pas renfermer une seule mention du nom de Jésus, dont elle ne sait rien ; il en va de même de la lettre dite de Jacques et de la Didachè ».
.
Le reste du livre est à l’avenant et mériterait un décorticage plus sévère. Par exemple, la question capitale de la datation des évangiles est traitée en 8 lignes ! pour rejoindre le consensus général dont on sait qu’il n’est autre chose qu’une variante de l’argument d’autorité, c’est-à-dire nul du point de vue scientifique, consensus qui consiste à dire que les 4 évangiles furent écrits les premiers et qu’ils étaient rédigés tous les quatre au plus tard à la fin du premier siècle.[11]
.
Mais l’historien devient cette fois tendancieux quand il écrit, après des théologiens comme Daniel Marguerat que « : « Jésus est loin d’apparaître comme un personnage isolé de son temps et s’inscrit dans une série documentaire bien connue et bien identifiée », affirmation réitérée un peu plus loin : « Peu de personnages de l’antiquité bénéficient d’une attestation documentaire aussi riche d’un point de vue quantitatif comme qualitatif ». [12]
En réalité, il n’y a pas lieu de s’étonner, puisqu’il suffit de réfléchir à ce qu’implique le titre, en l’occurrence : « Le christianisme, des origines à Constantin » pour savoir que les auteurs, Mimouni et Maraval, s’inscrivent délibérément dans le paradigme historico-théologique. Affirmer que le christianisme est institué à partir de Constantin est la preuve éclatante que l’on souscrit à la convention la plus générale, mais aussi la plus fragile de l’historiographie ecclésiastique.
.
jean-paul Yves le goff
.
précédents envois :
.
6 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-1
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-2
7 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-3
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-4-0
_
8 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-5
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-6
.
9 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-7
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-8
.
11 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-9
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-10
.
13 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-11
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-12
.
15 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-13
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-14
.
16 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-15
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-16
.
18 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-17
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-18
.
19 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-19
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-20
.
23 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-21
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/230709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-22
.
24 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/240709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-23
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/240709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-24
.
26 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/260709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-25
.
29 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/290709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-27
[1] Sous réserve de modifications d’intitulés et, sans prétention à l’exhaustivité, l’enseignement des origines du christianisme s’enseigne à :
- Lille III (mention sciences de l’antiquité, parcours, histoire du chrisianisme antique).
- Lyon II : Parcours, recherche histoire des religions
- Paris III, science des religions
- Paris IV : catholicisme, protestantisme, christianisme antique et médiéval, judaïsme, Bible.
- Aix-Marseille I
- Strasbourg est un cas particulier puisque, régime concordataire aidant, l’Université Marc Bloch abrite deux factultés de théologie, l’une catholique, l’autre protestante.
- Il existe également sous des statuts et des labels plus ou moins combinés avec des laboratoires du CNRS ou avec des universités, des instituts ou centres publics de recherche en sciences religieuses, tels que , rattaché à la Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme, le Centre Interdisciplinaire Paul Albert Février, consacré à a traduction et au commentaire de la Bible des Septante, l’Institut Européen en sciences des Religions, rattaché à l’EPHE, le Centre Société droit et religin en Europe, rattaché à l’Université Robert Schuman de Strasbourg, le Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux , dépendant de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
[2] Religions et Histoire, Numéro 6,janvier 2006 ; Judaïsme et christianisme, séparation ou rupture
[3] le Jésus de Nazareth de Maurice Goguel, de 1955 : « Jésus n’a pas créé l’Eglise, il ne s’est pas préoccupé d’établir des institutions ou de fixer des règles qui assureraient, après sa mort, le maintien du groupe constitué autour de lui, encadreraient et dirigeraient sa vie. Sa pensée est trop dominée par l’idée de la fin imminente de l’économie actuelle pour qu’il se soit soucié de l’avenir des siens sur la terre et ait songé à l’organiser. Jésus n’a donc pas été, au sens ordinaire du mot, un fondateur de religion ; il a voulu seulement annoncer et réaliser par ra venue l’accomplissement des promesses faites par Dieu à Israël. Son évangile n’implique aucune rupture avec la tradition religieuse de son peuple ».
[4] Le christianisme des origines à Constantin [Texte imprimé] / Simon Claude Mimouni,... [et] Pierre Maraval,...PUF. 2006
[5] Simon-Claude Mimouni, Les origines du christianisme aux XIXème et XXème siècles en France. Question d’épistémologie et de méthodologie, in L’Orient dans l’histoire religieuse de l’Europe, l’invention des origines ; pages 101 à 110. Paris 2000
[6] Dans le Problème de Jésus (1914), Charles Guignebert écrivait : Charles Guignebert le disait déjà en 1914 : « Les propositions qui consistent à considérer que le christianisme aurait pu naître, durer et se développer sans que la réalité de l’existence terrestre de Jésus (…) atteignent les fidèles des diverses confessions chrétiennes comme un intolérable outrage et ils les traitent de sacrilèges extravagances ; les critiques non confessionnels eux-mêmes ont bien du mal à ne pas les accueillir comme des paradoxes excessifs, tant l’atavisme leur a rendu familière et quasi indiscutable l’association de la personne de Jésus à l’origine de la religion ».
[7] Simon-Claude Mimouni, le judéo-christianisme ancien, 1998
[8] Voltaire : D'épaisses ténèbres envelopperont toujours le berceau du
christianisme. (...) (chapitre 1) Quiconque cherche la vérité sincèrement aura bien de la peine à
découvrir le temps de la naissance de Jésu et l'histoire véritable de
sa vie. (...)Les quatre Évangiles canoniques font mourir Jésu à trente
ans et quelques mois, ou à trente-trois ans au plus, en se
contredisant comme ils font toujours. Saint Irénée, qui se dit mieux
instruit, affirme qu'il avait entre cinquante et soixante années, et
qu'il le tient de ses premiers disciples.
Toutes ces contradictions sont bien augmentées par les
incompatibilités qu'on rencontre presque à chaque page dans son
histoire, rédigée par les quatre évangélistes reconnus.
chapitre 6)
[9] Simon-Claude Mimouni et Pierre Maraval : Le christianisme des origines à Constantin, PUF 2006
[10] Le "Testimonium Flavianum" examen historique, considérations historiographiques / Serge Bardet ; postf. de Pierre Geoltrain -Le Cerf, 2002
[11] JPY Le Goff : Le paradigme historico-théologique : (1) Les textes fondateurs.
[12] Op.cit. page…