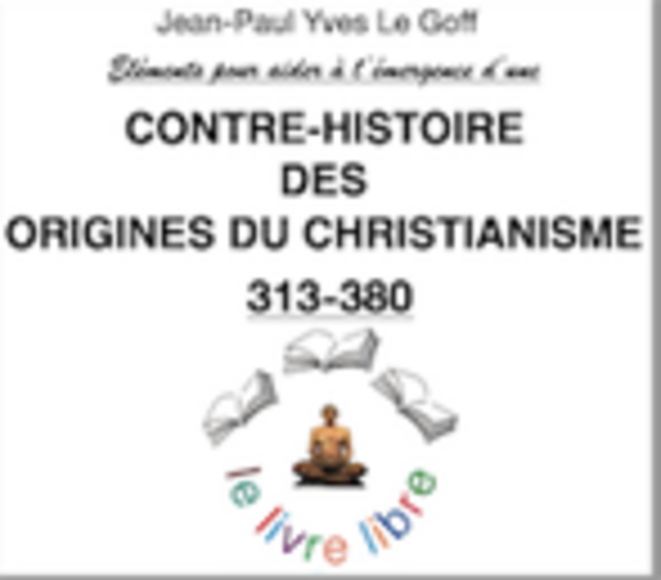La vérité en matière d'histoire des origines du christianisme a-t-elle été jamais dite ?
La vérité en matière d'histoire des origines du christianisme a-t-elle été jamais dite ? L'est-elle, peut-elle l'être, aujourd'hui ? Bien souvent, la difficulté d'une telle question est contournée par le recours à des généralités rassurantes, disant, par exemple, que les origines lointaines de toute histoire sont, par définition, incertaines, que la science historique atteint vite ses limites, etc.
.
On veut bien admettre aussi que l'idéologie politique et/ou religieuse ait pu exercer une certaine influence déformante sur la représentation du passé, qu'il existe une pratique que l'on appelle l'historiographie qui consiste à plier plus ou moins l'écriture à certaines exigences de l'actualité. Mais parallèlement, on voit à l'oeuvre tout un mouvement déjà bien ancien en sciences historiques qui laisse espérer que nonobstant les grandes difficultés existant pour toute une partie du passé - l'antiquité, notamment - une connaissance satisfaisante de ce qui a réellement eu lieu est possible.
.
Cette évaluation positive peut-elle s'étendre à l'histoire des origines du christianisme ? Ce n'est pas à cette conclusion qu'après dix ans de fréquentation des milieux de la recherche en sciences des religions, telle qu'elle se mène aujourd'hui en France, que je parviens.
.
Que, dans le cours des siècles, au temps où le christianisme fut l'idéologie structurante de la France, constitutive de son histoire et de son régime politique, il ait fallu que la représentation des origines de cette religion fut en tous points conformes aux exigences de sa théologie, on le comprend. Il est plus étrange que plus d'un siècle après la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'influence de la théologie chrétienne sur la manière d'écrire l'histoire du christianisme soit encore aussi forte. Une telle influence est loin de ne se manifester qu'en Franc, ce qui donnerait à penser que l'histoire du christianisme, (et de ses origines, tout particulièrement) est constitutive de la structure même de la civilisation occidentale. Il semblerait qu'il ne faille pas y toucher, sous peine que des fondements de nos cultures s'en trouvent ébranlées. Comme, autrefois, Socrate fut condamné pour, ayant selon le chef d'accusation introduit des divinités étrangères, pris le risque de mettre la vie de la Cité en danger.
.
Bien des tentatives ont été faites cependant, longtemps avant et longtemps après Voltaire qui, en 1777, publiait une "Histoire de l'Etablissement du christianisme", pour que toute histoire des religions fût traitée comme n'importe quelle autre histoire. Concernant les origines du christianisme, des oeuvres entières y furent consacrées. Celle d'Ernest Renan, bien entendu, celle de son élève, Ernest Havet, qui fut le premier titulaire de la chaire des origines du christianisme, à la création de la Vème section, dite des sciences religieuses, de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, création qui prenait la place, en 1886, (et le budget) de la Faculté de Théologie de la Sorbonne qui avait régné sur tout type de vérité, historique ou philosophique, des siècles durant. Celle de Charles Guignebert, qui enseigna également pendant des décennies les origines du christianisme à la faculté des lettres de la Sorbonne, Celle de l'ex-abbé Alfred Loisy, embauché en 1909 au Collège de France, un an après son ex-communication. Celle de Salomon Reinach. Celle d'André Bouché-Leclercq. Celle de Jean Baruzi. Et bien d'autres. Ces oeuvres mettaient gravement en danger un certain nombre d'affirmations théologiques, dans la mesure où celles-ci avaient la prétention de s'appuyer sur l'histoire.
.
Aujourd'hui, par suite d'un renversement étonnant dont je vais dans une autre publication retracer les épisodes, c'est l'histoire qui conforterait la vérité de la théologie. Que l'on s'informe dans les journaux précédemment cités, dans les ouvrages de vulgarisation, dans les manuels scolaires où dans les publications émanant des hautes sphères de la recherche, la concordance est à peu près parfaite.
.
Le ton général est donné par cet extrait, choisi entre mille possibles d'un ouvrage intitulé "Les origines du christianisme", publié chez Hachette en 2007 par Michel Rouche, professeur émérite de Paris IV-Sorbonne :
.
"Ce livre traite de la naissance d'une religion radicalement nouvelle qui va finir par bouleverser l'Empire romain lors de son apogée au IIème siècle et de sa crise au IIIème siècle et le transformer de fond en comble aux IVème et Vème siècles. Cette secte minoritaire, grâce à la révolution mentale qu'elle provoque, devient une Eglise majoritaire qui tente de créer une chrétienté englobant toute la civilisation. Cette expansion pacifique en quatre siècles est un phénomène d'autant plus unique dans l'histoire des religions qu'elle modifice et transforme les croyances romaines".
.
Pour le grand public, non sensibilité aux difficultés historiographiques, un tel résumé n'offre pas, a priori, matière à critique. Un esprit plus exercé pourra, en revanche, légitimement s'étonner d'expressions telles que "religion radicalement nouvelle", "transformer de fond en comble", "secte minoritaire", "révolution mentale", "expansion pacifique", etc. La date de 481, choisie par l'auteur pour marquer le terme de ce processus d'établissement du christianisme par la christianisation de l'empire pourra également surprendre, si on les compare à d'autres ouvrages qui, eux, préfèrent celle de 325 ou celle de 392. Mais nous verrons qu'en la matière le poids de ce qui est dit est bien peu de choses, comparé à ce qui n'est pas dit.
.
Ce qui peut étonner encore, par les temps actuels, c'est le nombre considérables de numéros spéciaux, dossiers, numéros hors série que les grands périodiques d'information générale consacrent à la queston des origines du christianisme, sans oublier les émissions de télévision en série, telle que la trilogie d'Arte de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, dont le troisième volet (après 1997 et 2008) ( ("Apocalypse") a été offert au public entre le 3 et le 20 décembre 2008.
.
Le 29 octobre 2008, le journal L'Express publiait un dossier intitulé "Le choc Jésus-Mahomet" qui allait lui valoir d'être interdit dans plusieurs pays arabes, mais n'allait nullement l'empêcher de récidiver, le 29 décembre 2008 avec un "dossier spécial" de 65 pages, intitulé "Juifs, chrétiens, musulmans, La grande histoire de la Bible et du Coran", tandis que, dans ce même mois de décembre où du 3 au 20 , douze émissions de cinquante minutes chacune sollicitaient l'attention, si ce n'est la foi, des téléspectateurs, l'hebdomadaire Le Point diffusait un hors série consacré à "Jésus".
.
.
Dans ce genre de publications, la parole (ou la plume ) est la plupart du temps confiée des personnes présentées comme des spécialistes de grande renommée, des experts internationaux, lesquels ont, effectivement, la caractéristique d'être des universitaires dans leurs pays respectifs. Ils ont aussi celle, - mais là-dessus, les publications sont beaucoup plus discrètes - d'être, pour la plupart, mais non pas tous, des professeurs de théologie, doublés tantôt d'un prêtre, tantôt d'un pasteur, tantôt d'un rabbin.
.
Une caractéristique très répandue de ce type de textes présentés au public est de se placer sous le signe d'une recherche, d'une réflexion essentiellement scientifique. Les questions pleuvent dans les "avant-propos" qui ouvrent ces dossiers et que rédigent, la plupart du temps, les chroniqueurs religieux responsables de la publication avant qu'ils ne confient aux historiens-théologiens le soin de la réponse. Par exemple, dans le hors série du Point, de décembre 2008-janvier 2009, la journaliste Catherine Golliau demande : "Que sait-on vraiment de la vie de Jésus?" Qui était celui que le christianisme considère comme le Fils de Dieu incarné ? Que nous disent vraiment sur Jésus les textes sacrés ? Comment le voyaient ses contemporains ? Etait-il un prophète de la fin des temps ? Un réformateur du judaïsme ? Le Messie libérateur d'Israël ? A-t-il été vraiment le fondateur du christianisme ?"
.
L'adverbe "vraiment" apparaît trois fois dans ces sept questions. Il apparaît également dans l'un des titres de la couverture :
-Ce que l'on sait vraiment.
.
On sait beaucoup de choses sur Jésus, si l'on en croit l'avant-propos de ce numéro spécial:
.
"Nous disposons, le concernant, d'une documentation rarement égalée pour un homme de l'antiquité (...) Dans l'immensité des incertitudes, sont apparues de "vraies" certitudes, qui rallient les scientifiques de tous bords. Oui, il a existé. Oui, il vivait en Galilée. Oui, il est mort sur la croix. Mais pour le reste? (...) Le point fait le bilan (...) Avec, comme toujours, l'aide des meilleurs spécialistes."
.
.
(à suivre)
.
jean-paul yves le goff