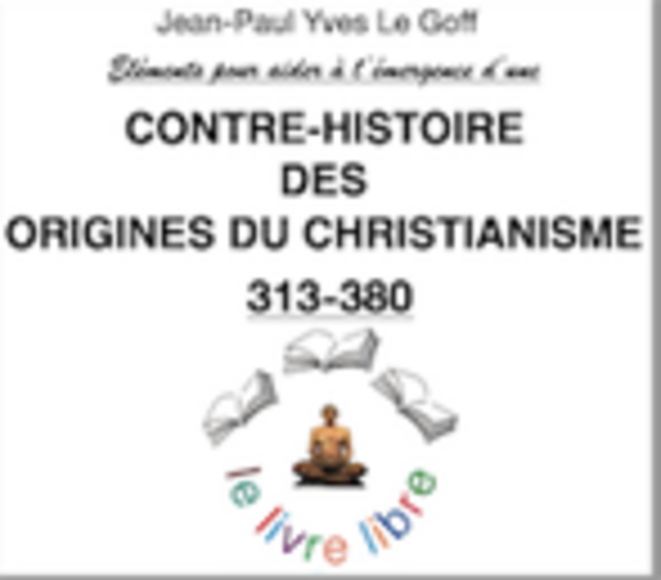Indépendamment de la question des méthodes en histoire qui ont beaucoup évolué depuis l’apparition de « l’école Méthodique », évolution qui continue, notamment du fait de la rencontre de cette discipline avec d’autres disciplines connexes, se sont posées aussi de nouvelles questions, comme la fonction de l’histoire et aussi celle de la liberté de l’historien.
.
Par exemple, dans les années 2000, à l’occasion de ce que l’on a appelé « Les lois mémorielles », [1]un débat s’est élevé dans lequel de la président de la République de l’époque, Jacques Chirac, a pris position[2]. A la suite de quoi, diverses associations d’historiens se sont créées.[3] Finalement, une commission d’enquête sur les lois mémorielles a été créée par l’Assemblée Nationale qui en a sorti un rapport, en attendant quelque loi. [4]
.
De toutes les questions évoquées en ces différentes occasions, la plus importante, qui résume les autres, est celle de la liberté de l’historien. Dans la mesure où il est enseignant-chercheur, l’historien est un scientifique et la recherche scientifique ne se conçoit pas sans une totale liberté. Mais l’historien n’a pas seulement comme devoir d’amener au jour la connaissance du passé, il a aussi pour but de transmettre cette connaissance et sur ce point précis, l’exercice de sa liberté est loin d’être aussi évident que sur le seul plan de la recherche, n’en déplaise aux intéressés. L’historien est (généralement) sous contrat avec l’Etat et l’Etat est tout sauf indifférent- quoiqu’il rechigne à le reconnaître - en matière d’idéologie et, par voie de conséquence, en matière d’enseignement. Voir à ce sujet l’étude de Louis Althusser , intitulée « Les appareils idéologiques d’Etat » (A.I.E), déposée aux oubliettes par le consensus général en raison de son intérêt majeur, subversif et vrai.[5]..
.
Dans les pages précédentes, il est clairement apparu que nombreux furent les historiens en particulier s’intéressant à l’histoire des religions qui eurent en d’autres temps de graves ennuis avec leurs Etats respectifs, tandis qu’il pouvait se faire que d’autres historiens , y compris en France, bénéficient d’honneurs et d’avantages dûs au fait que leurs travaux allaient dans le sens des valeurs qu’à un moment donné tel ou tel gouvernement entendait promouvoir.
.
C’est ainsi que nous soutenons que, si l’Eglise n’avait pas, avec 19ans de retard, en 1924, accepté de fait, la séparation, si les gouvernements successifs, dans leurs rapports avec Rome avaient dû conserver les orientations politiques et idéologiques qui étaient celles de Jules Ferry, Ferdinand Buisson, Emile Combes, Aristide Briand, les mêmes nominations n’auraient pas été faites dans un certain nombre de postes-clé de l’enseignement. La même histoire des origines du christianisme n’aurait pas été écrite, et par voie de conséquence, enseignée. Il ne faut pas oublier à ce sujet, que, via le subtil accord existant entre l’Inspection Générale de l’Education Nationale, les éditeurs et les enseignants du secondaire, l’histoire des origines du christianisme, aussi synthétique soit-elle, telle qu’on la trouve dans les manuels scolaires, donne davantage dans le « croire » que dans le « savoir ».[6]
.
Bref. L’historien est un homme comme les autres. Il peut avoir un idéal de liberté très élevé, mais les choses sont ainsi faites que l’exercice qu’il en a est, comme pour tout le monde, limité. En outre, pour être scientifique, l’historien, en effet, n’en est pas moins homme, c’est-à-dire, sujet comme tous les hommes à avoir des convictions, politiques, philosophiques, religieuses, idéologiques. Il peut y avoir tension entre celles-ci et les exigences de l’objectivité scientifique. Les convictions n’en sont pas moins présentes, d’une manière ou d’une autre dans son travail.
.
La difficulté est particulièrement aigüe dans le cas où l’historien des religions est un adepte. Quoique les intéressés s’en défendent, il est peu concevable que la croyance ne prédispose pas à la manière dont va se structurer la connaissance. C’est ce que Bultamann nommait la « précompréhension » qui, pensait-il, joue nécessairement dans un sens ou dans un autre, disposant le chercher à comprendre et à croire dans un cas, à ne pas croire et donc à ne pas comprendre, dans le cas contraire.
.
Indépendamment des manuels scolaires, les ouvrages de vulgarisation sur le thème des origines du christianisme sont assez nombreux, dus à la plume de spécialistes qui, comme ils se doit, font valoir leurs titres comme garants de la valeur de leurs ouvrages. Aucune ambiguïté n’est possible quand l’auteur se présente comme enseignant la théologie, voire l’histoire dans un institut confessionnel, qu’il soit de Paris, de Lyon, ou de Toulouse. Le lecteur le moins critique se doutera bien que les convictions religieuses de l’auteur ont dû quelque peu influencer sur les options épistémologiques qu’il est d’ailleurs impossibles de ne pas faire, sur des matières aussi délicates. Inversement, il est en droit d’espérer qu’un auteur se prévalant d’enseigner dans un établissement régi par les lois de la république laïque ne confondra pas dans un ouvrage d’histoire des religions ce qui relève de la foi – qu’il a le droit d’avoir en tant que personne privée – et ce qui relève de la science, qui se doit d’être neutre, comme veut le signifier le mot « laïque » qui est le label de l’institution où il travaille.
.
Cependant, beaucoup de ces manuels donnent à s’interroger sur la réelle neutralité de leurs auteurs, et partant, sur la valeur de la référence institutionnelle à laquelle ils font appel. N’en prenons qu’un, à titre d’exemple : Les origines du christianisme, de Michel Rouche.
.
Les origines du christianisme de Michel Rouche, lequel, devenu aujourd’hui professeur émérite, n’en est pas moins, comme légitimement il s’en prévaut, représentant de Paris IV-Sorbonne. [7]. Déjà, les dates accompagnant le titre constitue, même si cela ne saute pas aux yeux de l’acheteur potentiel, un choix épistélogique : ces dates sont 30-451. Cette année 451 correspond à la tenue du quatrième concile œcuménique, celui de Chalcédoine, dans lequel est défini le dogme de la Trinité. Pour mémoire, l’ouvrage de Simon-Claude Mimouni, intitulé « le christianisme » avait pour sous-titre (ou pour complément) des origines à Constantin, sans que soit mentionnée plus précisément la date de ses origines, mais le nom de Constantin, mort en 337 indique bien – à tort ou à raison - qu’en cette année le processus de formation du christianisme est considéré comme achevé. Qu’en est-il réellement ? C’est un point qui nécessiterait de plus amples développements. Le point de départ et le point d’aboutissement de la formation du christianisme est le problème le plus épineux de toute cette histoire.
.
Le lecteur en quête d’un ouvrage de vulgarisation n’aura, par définition, par l’œil suffisamment exercé pour s’étonner du court résumé de présentation figurant sur le dos de la couverture de l’ouvrage : « Ce livre traite de la naissance d'une religion radicalement nouvelle qui va finir par bouleverser l'Empire romain, lors de son apogée au IIe siècle et de sa crise au IIIe siècle, et le transformer de fond en comble aux IVe et Ve siècles. Cette secte minoritaire, grâce à la révolution mentale qu'elle provoque, devient une Eglise majoritaire qui tente de créer une Chrétienté englobant toute la civilisation. Cette expansion pacifique en quatre siècles est un phénomène d'autant plus unique dans l'histoire des religions qu'elle modifie et transforme les croyances romaines. » Pourtant , en réalité, bien des formulations, ne peuvent se justifier qu’en fonction de choix idéologiques particuliers, d’autant moins détectables qu’ils sont ceux dont sont constitués le paradigme historico-théologique produit par 1500 ans d’historiographie chrétienne, mais qu’une histoire libérée de l’influence de la théologie ne devrait plus autoriser : « religion radicalement nouvelle… bouleversement et transformation de l’empire, révolution mentale, phénomène unique, expansion pacifique, etc. ». Ce lecteur, en quête d’une histoire réellement scientifique, peut-être méfiant à l’égard d’un auteur qui se présenterait comme professeur de théologie et qui pour cette raison choisira peut-être cet ouvrage, dont la neutralité lui semblera, bien à tort, garanti par l’appartenance de l’auteur à l’université républicaine, ne s’étonnera pas de lire, dès la page 5 de l’ouvrage : « L’histoire du christianisme s’ouvre sur un désastre, la mort de Jésus le vendredi 7 avril 30. » N’a-t-il pas déjà entendu, ici ou là, que Jésus effectivement et mort le 7 avril 30 ? Ainsi donc, cela se confirme puisqu’un historien de Paris IV – Sorbonne le dit !
.
La question, précisément, est de savoir si c’est l’Université qui le dit ou si l’auteur peut le dire, quand il se présente comme un professeur d’université. Comment ne pas évoquer , une dernière, Mgr Freppel disant en 1885, ou bien votre enseignement est conforme à celui de l’Eglise, et alors pourquoi fermer les facultés de théologie ? Ou bien, il est en désaccord , et il ne peut pas prétendre à la neutralité ? Au moins, les choses étaient-elles dites clairement, en ce temps-là, tandis qu’aujourd’hui on s’ingénie à dissimuler le problème qui est que l’historien des origines du christianisme ne peut pas faire librement son métier sans risquer de se mettre en conflit avec le dogme théologique, ce par rapport à quoi, de son côté, l’Etat ne veut pour rien au monde avoir à connaître. L’Etat préfère, sans doute dans un but louable de paix des esprits, que l’exactitude scientifique souffre un peu.
.
Cette difficulté, dont on voit des manifestations dans les manuels scolaires, dans les ouvrages d’érudition et dans les ouvrages de vulgarisation, a pris une tournure très spectaculaire en décembre 2008, à l’occasion du dernier et troisième volet d’un ensemble d’émissions télévisées, diffusées tout au long du mois de décembre 2008 par la chaine de télévision Arte et et dus aux réalisateurs Jérôme Prieur et Gérard Mordillat.
.
Compte non tenu des deux précédents émissions, qui en leur temps, avaient soulevé un intérêt certain parmi un public très vaste et très varié[8] ce dernier volet intitulé « Apocalypse » se présentait sous la forme de 12 émissions de 50 minutes chacune, donnant la parole tour à tour à 44 spécialistes internationaux, ce qui rend toute possibilité de résumé impossible. Que peut-on en dire, dans ce cas, pour en indiquer l’intérêt majeur, si ce n’est que celui-ci se trouve moins dans les émissions elles-mêmes que dans la polémique, beaucoup plus discrète qui s’en est suivie ?
.
Celle-ci eut pour cadre toute une série d’articles émanant de journaux et revues d’information religieuse, à peu près unanimes pour condamner le travail des deux réalisateurs au motif, essentiellement, qu’il était partial, voire malhonnête, parce qu’il
Consistait à détourner la parole des experts pour faire valoir le point de vue des deux hommes, considérés comme incompétents en ce sujet si pointu.
.
Le point d’orgue de la polémique fut atteint dans un débat organisé par Le Monde de la Bible, se tenant le 6 novembre 2008 au Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme et qui mit face à face les deux auteurs-réalisateurs et un professeur d’histoire de Paris IV_-Sorbonne, Jean-Marie Salamito. Pour celui-ci, le travail de Mordillat et Prieur n’était pas « scientifique », ajoutant : « Moi, je suis historien de métier, alors que vous, vous êtes des hommes de télévision. C’est là la différence. Chacun son métier ». « Vous êtes chrétien », lui cria à un moment donné Jérôme Prieur. » « Cela n’a rien à voir », répondit Jean-Marie Salamito.
.
Le nœud du problème était peut-être la 11ème émission dont le titre était : « L’an zéro du christianisme ». On put s’apercevoir alors que les 44 experts qui sur la plupart des points abordés pouvaient paraître en relatif accord ne s’entendaient plus du tout sur le point de savoir quand commençait le christianisme.
…
jean-paul Yves le goff
.
.
.
précédents envois :
6 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-1
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-2
7 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-3
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-4-0
_
8 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-5
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-6
.
9 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-7
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-8
.
11 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-9
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-10
.
13 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-11
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-12
.
15 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-13
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-14
.
16 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-15
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-16
.
18 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-17
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-18
.
19 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-19
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-20
.
23 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-21
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/230709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-22
.
24 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/240709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-23
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/240709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-24
.
26 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/260709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-25
.
29 juillet :
.
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/290709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-28
[2] Elysée, 9 décembre 2005 : "L'histoire, c'est la clé de la cohésion d'une nation. Mais il suffit de peu de choses pour que l'histoire devienne un ferment de division, que les passions s'exacerbent, que les blessures du passé se rouvrent. Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'Histoire. L'écriture de l'histoire c'est l'affaire des historiens."
[3] Dont « Liberté pour l’histoire », présidée par Pierre Nora et le Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire » (CVUH) (Gérard Noiriel, Michèle Riot-Sarcey et Nicolas Offenstadt.)
[4] N° 1262 - Rapport d'information de M. Bernard Accoyer fait au nom de la mission d'information sur les questions mémorielles
18/11/2008
[5] Louis Althusser Idéologie et appareil idéologiques d'Etats Positions, ES, 1976,]
[6] Jean-Paul Yves Le Goff : Origines du christianisme (3) : Quel enseignement à l’école ?entre le croire et le savoir. Le livre libre. 2009
[7] Michel Rouche, les origines du christianisme, hachette supérieur, paris 2007
[8] En 1997 Corpus Christi et en 2003 l’origine du christianisme.