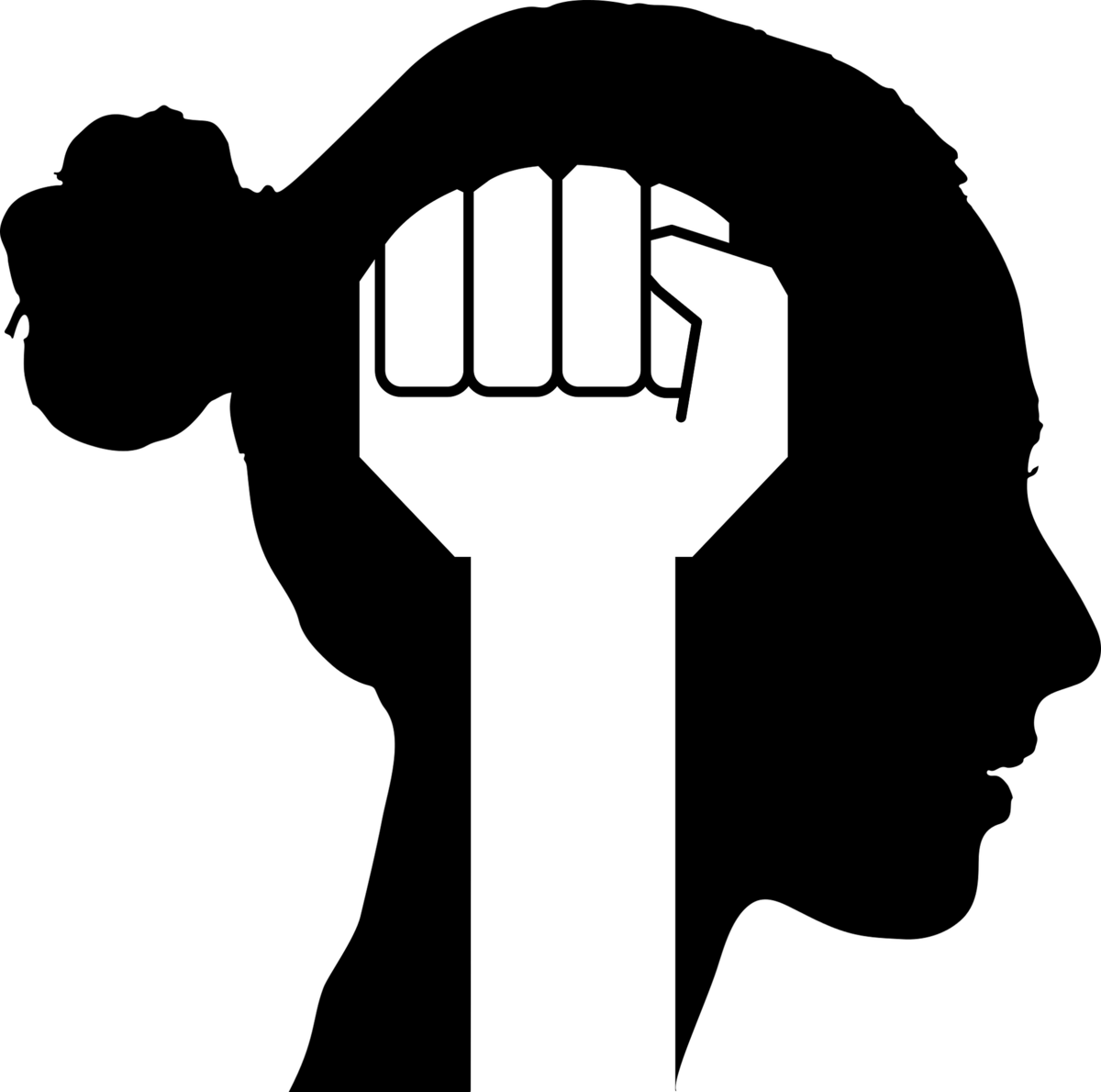
Agrandissement : Illustration 1
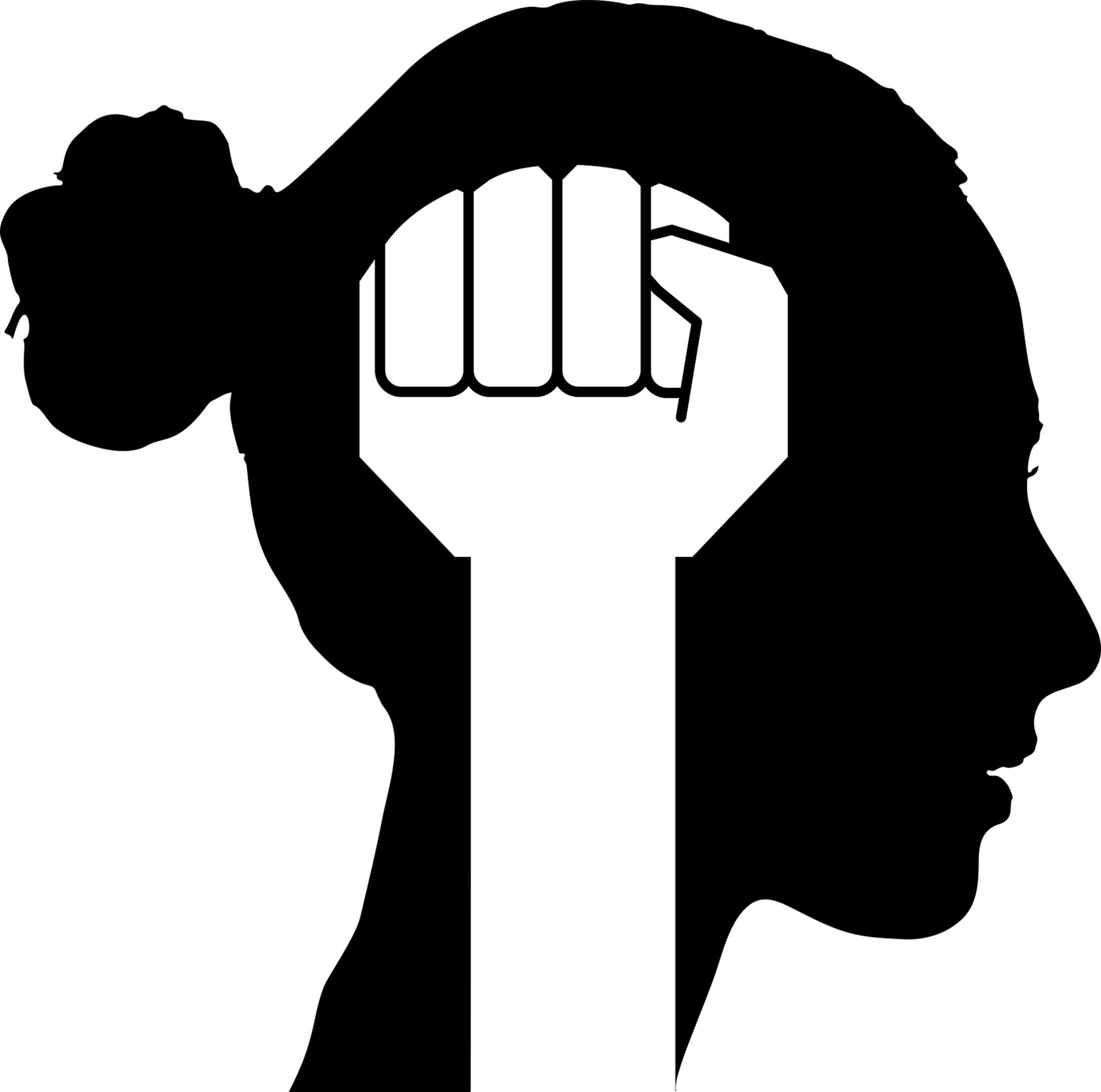
Bien qu’a priori en vogue, de grands médias ayant décidé de transformer chaque actualité du mouvement en pompe à fric et à polémiques, le féminisme continue à faire réagir bien des individus. Des masculinistes bien identifiés aux « not all men », en passant par les partisans du moindre effort et les silencieux du fond, les hommes cisgenres ont encore et toujours du mal ou l’absence de volonté à trouver leur place et leur intérêt dans ce mouvement. Brandi en frein majeur à leur adhésion, le refus de certaines à leur octroyer l’appellation « féministe ». « On me dit qu’il est sexiste de refuser cette appellation aux hommes cis, que cela divise, et ne nous met pas sur un pied d’égalité », explique Laura, militante de 28 ans, « je leur explique que pour répondre au mieux aux combats féministes, encore faut-il savoir de quoi on parle, et pour savoir, il faut de l’expérience, l’expérience de la discrimination de genre, ce que les hommes cis –par définition- ne peuvent pas connaître ». Face à ces propos, Laura reçoit bien des réponses véhémentes. « ‘Ce n’est pas comme ça que tu feras avancer ta cause’, ‘ça ne donne pas envie de vous aider’, ‘répondre au sexisme par le sexisme, ce n’est pas la solution’, voilà ce que je lis et entends chaque jour, c’est épuisant », poursuit Laura. Subir le sexisme et combattre les murs qui se dressent face à la pédagogie féministe, c’est là la double peine susnommée. « C’est une cause noble, mais également un fardeau », sourit la jeune femme. Comme elle, bien des militantes subissent cette double peine, légitimant le monopole de l’appellation aux seules femmes.
Subir le poids du passé
Lorsqu’un homme voit le monopole de l’appellation « féministe » aux femmes comme un privilège que celles-ci s’octroient, les militantes y voient la résultante d’une peine, d’un fardeau. Derrière ce simple mot, ce sont des années de discriminations, de harcèlements, d’agressions, de viols qui viennent dépeindre un tableau des plus sombres, et tracer en lettres d’or par-dessus un lourd combat joliment et simplement nommé « féminisme ». Vous y voyez l’or de ces lettres, nous subissons la noirceur de ses racines. Il ne suffit pas d’avoir vécu avec une femme pour pouvoir légitimer son propre discours sur le féminisme, lorsque l’on est homme. Quand une militante revendique le droit à s’exprimer sur un sujet féministe, elle le fait sous le prisme de son expérience propre, non d’une expérience par procuration.
« Les hommes cis peuvent porter notre voix, soutenir la parole des concernées, se faire alliés. Ce n’est pas une insulte, bien au contraire », soutient Laura, « on ne peut pas appeler ‘féministe’ quelqu’un qui ne peut pas comprendre les fondements même de ce mouvement, mais ne peut que les entendre ». A ceux qui souhaitent vraiment se regrouper sous un nom, Laura leur conseille de « rejoindre une association féministe, apporter leur soutien, leur énergie ». « C’est normal qu’on se méfie des hommes cis qui se revendiquent féministes, il y en a tellement qui le font pour intégrer des réseaux de femmes déjà brisées, parfois encore fragiles, ou pire : pour se donner bonne conscience suite à un viol, une agression, un harcèlement », explique-t-elle, « on subit le poids du passé, on ne peut plus se permettre de prendre les choses à la légère, on ne peut pas agir dans ce mouvement comme dans une colonie de vacances ».
C’est en ayant fait l’expérience de ces harcèlements, agressions, ou viols, et de leur motivation sexiste que l’on trouve les armes pour les expliquer, les combattre avec la force qu’ils requièrent. On ne change pas les choses avec de simples mots. Autrement, la loi se suffirait à elle-même, et les mots des militantes suffiraient à éduquer les récalcitrants.
Subir le poids des combats actuels et de ses détracteurs
« Être féministe, c’est se faire violence, et parfois recevoir des témoignages qui nous rappellent à notre statut de victime, à nos traumatismes, à nos angoisses quotidiennes », précise Laura, « être féministe, c’est se renseigner sur le mouvement, en apprendre davantage chaque jour, et avoir la rage au ventre à force de lire ou d’entendre toutes les horreurs infligées aux femmes, en France comme ailleurs ». Ces rappels au passé, ce poids douloureux du présent, bien des femmes affirment les vivre quotidiennement dans leur vie de militantes féministes.
« Si un homme s’exprime sur un sujet féministe, la tribune qu’il aura fera bien plus de bruit que celle d’une femme », soutient Sonia, 43 ans. Toutefois, la plupart des échos que l’on retiendra de ce bruit auront le goût amer du « not all men », une horde d’hommes cis qui viennent chercher une légitimité à ne pas se sentir concernés par la parole et les combats féministes sous prétexte que « pas moi, pas nous, ou en tout cas, pas tous ». Le problème, c’est que le silence que cela provoque vient éteindre toute possibilité d’éduquer leurs pairs. « Quand on me dit ‘moi je ne suis pas comme ça’, j’entends ‘comme je ne suis pas un violeur, je suis tranquille’ », explique Elza, 37 ans, « et moi j’ai envie de répondre ‘et tes potes ? Ton pote relou qui harcèle des meufs en soirée ? Celui que t’as pas stoppé ni réprimandé quand il a embrassé cette fille sans lui demander avant ?’ ». Et de poursuivre, « c’est précisément ça, le souci. On sait ce qu’est un viol, une agression, un harcèlement, on sait ce qu’est le consentement, mais lorsque la situation concerne quelqu’un d’autre, bien des hommes cis font la sourde oreille, refusent d’intervenir parce que ‘pas mon problème, je suis pas son père’, mais nous ne sommes pas non plus leurs mères, c’est à eux de s’éduquer, et d’éduquer leurs cercles d’amis ».
Quant au virilisme brandi par certains comme carte du « je subis également les revers du sexisme, je suis donc concerné par le féminisme, et peux me qualifier de ‘féministe’ en ce sens », Elza a bien son avis là-dessus. « Evidemment que le virilisme est un poids, mais c’est un poids qui, derrière, offre une certaine assurance de tranquillité en société. Si tu réponds à ces critères, tu gagnes ta place de privilégié », explique-t-elle, « ce n’est pas donnant-donnant du côté des femmes. Quoi que l’on fasse, quoi que l’on porte, quoi que l’on dise, on subira toujours le harcèlement, les agressions, les viols ».
Face aux détracteurs, encore une fois, la répartition des charges semble inégale. Bien militantes féministes font l’objet de harcèlements multiples, et de masse. Encore une fois, lorsqu’un homme s’exprime sur un sujet féministe, l’accueil de sa parole se veut majoritairement positif. A l’inverse, une femme revendiquant le droit à disposer de son corps comme elle l’entend recevra insultes, menaces de mort, menaces de viol, et autres joyeusetés. Lorsque la charge est aussi inégale, il semble normal d’entendre les réticences des militantes à octroyer une même appellation aux femmes féministes, premières concernées et impactées, et aux hommes cis, alliés.
« Au final, lorsque l’on me dit qu’en refusant l’appellation ‘féministe’ aux homme, je ne donne pas envie de rejoindre le mouvement et de soutenir les femmes, j’y vois un ‘red flag’ », explique Elza, « je ne vais pas perdre plus de temps avec quelqu’un qui s’arrête à une appellation, alors que tout homme doué de sensibilité devrait vouloir se faire allié du féminisme, un point c’est tout ». Un gain de temps considérable et non négligeable, lorsque l’on observe l’ampleur du temps passé par ces femmes à militer, tant le sexisme a pris racine dans chaque compartiment de notre société.
Être qualifié d’allié n’est pas une insulte, encore moins une marque d’inégalité. Au front, l’allié se tient aux côtés de celui qu’il soutient. C’est cela que l’on demande, c’est de cela dont on a besoin. Non pas que l’on nous brigue la parole, ou que l’on noie par la présence de non concernés des priorités entendues et connues des femmes sous prétexte d’une mixité nécessaire sous la coupe d’un seul et même mot. Si le féminisme lui-même connait de multiples branches pour ne plus noyer les priorités divergentes mais non moins importantes de chaque femme, il semble légitime d’octroyer une appellation différente à ceux qui ne subissent pas et ne peuvent qu’entendre, à défaut de comprendre par expérience, les discriminations subies par les concernées.



