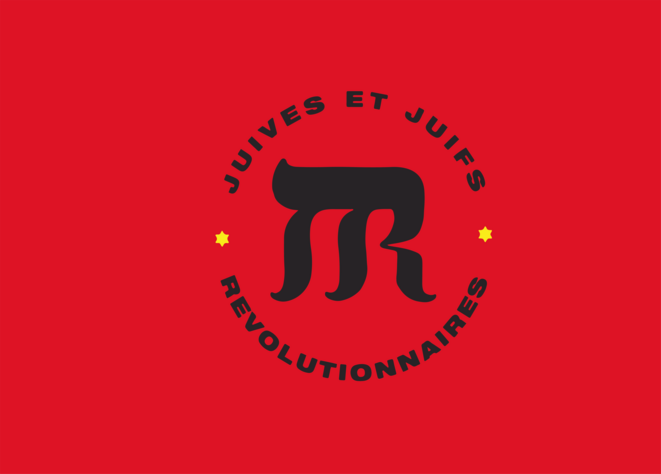Il y a 126 ans, le 7 octobre 1897, une poignée de Juif·ves se réunit clandestinement dans une cabane à Wilno (Vilna), en Lituanie. C’est ce jour que naît un des plus grand mouvements révolutionnaires juif de l’Histoire. Der Algemayner Yiddisher Arbeiter Bund in Russland un Poyln, traduit en l’Union générale des travailleur·euses Juif·ves en Russie et en Pologne, généralement connu sous le nom du Bund.
L’organisation se forme dans un contexte où la population juive de l’empire russe, au sein duquel se trouvent la Pologne et la Lituanie, vit dans la pauvreté et les persécutions. Soumis à l’obligation d’habiter dans les limites définies par la Zone de Résidence de 1791 (imposée par l’impératrice Catherine II de Russie), qui se trouve vite surpeuplée, les Juif·ves vivent le chômage, la faim, et la misère grimpe continuellement. Et cela sans compter les insultes, attaques, ou pogroms animés par un antisémitisme violent et répandu, monnaie courante à l’époque.
La population juive de l’Est, vivant sous l’autorité tsariste, a l’interdiction de posséder des terres. Iels sont donc exclu·es de tout un pan de l’économie. La plupart d’entre elleux se retrouvent ouvrier·es et artisan·es. Voyant leur avenir se déliter devant leurs yeux, les générations successives de la deuxième moitié du XIXe se tournent alors de plus en plus vers cette idéologie en plein essor que l’on appelle le socialisme.
"Les ouvriers juifs sont opprimés à la fois en tant que travailleurs et en tant que Juifs"
C’est donc en cette fin de siècle, que quelques Juif·ves, ouvrier·es, intellectuel·les, militant·es politiques et syndicalistes, décident de se regrouper sous une bannière commune, pour le socialisme et l’émancipation du prolétariat russe, ainsi que précisément, du prolétariat juif.
La ligne fondatrice peut être résumée par cette citation d’Arkadi Kremer, un des fondateurs du Bund:
« Une Union générale de toutes les organisations socialistes se fixera pour but non seulement la lutte pour les revendications russes en général, mais aussi pour défendre les intérêts spécifiques des travailleurs juifs, et avant tout le combat contre toutes les lois discriminatoires. Car les ouvriers juifs sont opprimés à la fois en tant que travailleurs et en tant que Juifs ».
Dès le début du XXe siècle, le nombre d’adhérent·es au Bund explose. L’organisation est présente partout en Russie, mais toujours avec le souci de la clandestinité. L’autorité tsariste voyant d’un mauvais œil des socialistes révolutionnaires juif·ves. Cependant, durant les dix premières années d’existence du Bund, l’organisation sert de squelette à un foisonnement de groupes politiques et syndicaux locaux. La capacité d’agir de l’organisation bundiste était une force conséquente du mouvement ouvrier de manière générale.
Cela se confirme lors de la Révolution russe de 1905. A ce stade, le Bund compte entre 30 000 et 40 000 adhérent·es. Dans la Russie bouillonnante, il semble être le moment de décréter la grève générale. En quelques jours, les effectifs du Bund passent à l’action et participent à un mouvement qui bloque une partie non négligeable de l’Empire russe. La grève est un immense succès de mobilisation, et témoigne de la force de frappe de l’organisation bundiste, ce qui contribue à sa réputation, notamment au sein notamment du POSDR (Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie) dont il est l’une des composantes fondatrices.
Cependant, bien que la grève éveille les esprits dans le pays, et que l’action du Bund rencontre un fort succès, la répression tsariste se fait d’autant plus terrible. Car en plus d’être des ouvrier·es révolutionnaires, les bundistes sont des Juif·ves. Iels assistent alors à une multiplications de pogroms dans tout le territoire, fomentés pour beaucoup par les mercenaires officieux du tsar, les Cent-Noirs, ainsi qu’à une vague d’arrestations massive pour être interrogé·es, torturé·es, et/ou assassiné·es par l’Okhrana (la police secrète du tsar).
Le Bund devient dans la foulée un des fers de lance de cette nouvelle identité yiddish séculaire, nourrie par les idéaux socialistes et démocratiques du parti.
C’est après cette violente répression que le Bund change assez radicalement. Le choix se présente entre continuer l’agitation révolutionnaire au détriment de la sécurité de toustes les militant·es, dans un environnement fortement hostile et surveillé, ou « faire profil bas ». L’organisation adhère majoritairement à la deuxième option, et démarre un nouvelle phase pour le Bund. On peut l’appeler grossièrement sa phase de développement culturel. Le Bund entreprend de se rapprocher des masses juives, d’être davantage présent et actif en leur sein, à l’écoute des vécus de ces derniers. C’est ainsi que le Bund devient un fervent parti yiddishiste.
Le yiddishisme est en quelque sorte, une forme de politisation de la langue yiddish elle même, une revendication nationale et culturelle de ce que beaucoup appelaient à l’époque, péjorativement où affectivement, le « jargon ».En évoluant au milieu des communautés juives polonaises et lituaniennes, le Bund devient dans la foulée un des fers de lance de cette nouvelle identité yiddish séculaire, nourrie par les idéaux socialistes et démocratiques du parti.
En 1908 a lieu la conférence de Czernowitz. L’évènement rassemble la plupart des tendances politiques juives est-européennes de l’époque, ainsi que des représentant·es d’institutions culturelles liées au yiddish. Une des résolutions majeures débattue à la conférence, est portée notamment par la militante bundiste Esther Frumkin, et peut se résumer en la demande de reconnaissance du yiddish comme langue nationale juive. Un des arguments principaux en faveur de cette résolution, est le fait que l’immense majorité des Juif·ves d’Europe de l’Est parlent plus le yiddish que le russe. Leur presse est en yiddish, leurs livres aussi. Et beaucoup ne parlent même pas le russe, ou bien très mal.
Le développement du yiddish n’est à ce moment aucunement un caprice chauvin, mais une nécessité partant du constat que la nation juive yiddishophone a besoin de pouvoir s’organiser et vivre en utilisant leur langue maternelle (le yiddish se réfère à lui même en tant que « mamèloshn » qui se traduit par « langue maternelle »). Esther Frumkin est une figure de proue du développement, dès 1907, d’un réseau grandissant d’écoles juives socialistes et laïques, qui enseignent donc le yiddish au sein des shtetls/shtetleh (bourgades juive d’Europe de l’Est) de l’Empire russe. L’enseignement yiddish prend alors sa place, centrale, dans l’idéologie du Bund.
Ce qui faisait nation pour le Bund, ce n’était ni le sang, ni la terre, ni la religion. C’était la langue, la culture, et la conscience collective.
Cette période du mouvement participe également à la construction progressive de leur théorisation politique de « l’autonomie nationale-culturelle juive ». C’est en militant au cœur des masses prolétaires de la minorité juive est-européenne que le Bund développe sa compréhension et son attachement à ce concept, se positionnant idéologiquement en faveur d’une forme de démocratie fédéraliste socialiste et multi-nationale.
Ce qui fait d’ailleurs la particularité de la revendication nationale juive bundiste, c’est spécifiquement son rapport à la territorialité.
A contrario d’autres minorités existantes dans l’empire tsariste, et aspirant à l’autodétermination, la nation juive avait la particularité de ne revendiquer aucun territoire délimité. Le Bund fut le parti qui développa le plus en profondeur cette idée, de « nationalité extra-territoriale ». Ce qui faisait nation pour le Bund, ce n’était ni le sang, ni la terre, ni la religion. C’était la langue, la culture, et la conscience collective. Être Juif·ve c’était une condition sociale et politique, une culture partagée sur la moitié d’un continent, et une langue populaire et vernaculaire qui produisait déjà de la littérature, de l’art vivant, et de nombreux journaux lus partout dans le Raïon (la Zone de Résidence).
Le refus de l’assimilationnisme par le Bund est moins un impératif idéologique, qu’un constat politique et social. Les Juif·ves d’Europe de l’Est (et pas toustes les Juif·ves du monde, ce qui différencie l’autonomisme bundiste de l’autonomisme doubnoviste) forment une entité nationale, qui doit alors être considérée comme telle. Le Bund dit même assez clairement que les Juif·ves pourraient tout à fait finir par s’assimiler au bout d’un certain temps si une Révolution socialiste venait à voir le jour en Europe.
Mais l’antisémitisme présent sur le continent, et l’état actuel de la condition juive rend, selon elleux, impossible et dangereux toute tentative d’assimilation obligatoire et forcée. Cela n’aurait comme conséquence d’engendrer que davantage de discriminations et d’aliénation envers les Juif·ves. C’est par ce constat que le Bund entreprend de renforcer, de solidifier et de chérir ce qui fait l’unité nationale juive yiddishophone, c’est à dire la langue, le maillage social, les revendications vis à vis de la condition juive, et la représentation politique de cette nationalité que personne à l’époque ne veut considérer ou prendre en compte. Le Bund représente la voix, d’une partie conséquente de la population juive d’Europe de l’Est, qui demande tout simplement le droit d’exister à l’endroit où iels se trouvent, en tant que Juif·ves.