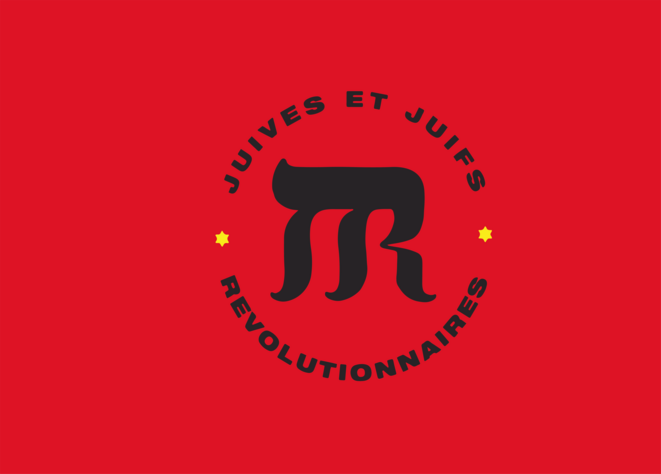Le Bund du début du XXe siècle s’organise et grossit. Il devient une force politique que le reste du camp révolutionnaire ne peut pas ignorer. Présent dès la fondation au sein du POSDR, il compte bien y faire exister une voix social-démocrate juive. Le Bund entretient cependant, depuis sa création, une relation très paradoxale avec le POSDR. Une forte tension cristallise les esprits, entre la position assimilationniste du POSDR et la position « autonomiste » ou « nationalitaire » du Bund.
Soutien de la Révolution de février 1917, le parti ouvrier juif ne voit cependant pas du même oeil l’initiative léniniste de prise de pouvoir en automne.
Le problème au sein du POSDR était le refus du parti de reconnaître les Juif·ves en tant que « nation », et que de ce fait, contrairement aux Polonais·es, aux Russes ou aux Ukrainien·nes, il n’acceptait pas de leur accorder une autonomie pleine et entière. Si le Bund acceptait les termes au POSDR, c’était en se désintégrant à l’intérieur de celui-ci, ce qu’il refusait catégoriquement.
La relation entre les deux partis a le temps d’évoluer jusqu’en 1917, avec des départs du Bund et des retours plus tardifs. Cependant, une chose ne change bel et bien pas, le Bund n’est pas aimé par le POSDR. Pas par les mencheviks, et particulièrement pas par les bolcheviks. C’était d’ailleurs tout à fait réciproque. Au moment de la révolution d’octobre de 1917, le Bund est secoué par les événements. Soutien de la Révolution de février 1917, le parti ouvrier juif ne voit cependant pas du même oeil l’initiative léniniste de prise de pouvoir en automne.
Les bundistes traversent alors la période de guerre civile russe, au sein des rangs de l’armée rouge où iels s’engagent contre les Russes blancs, pour défendre le nouvel état prolétarien qui semble se mettre en place, toutefois, non sans une certaine vigilance et méfiance envers Lénine et le gouvernement soviétique.
Après la 1ere guerre mondiale, et la guerre civile russe, le Bund en arrive au même point de désaccord critique que la majorité des partis socio-démocrates européens : s’affilier ou non au Komintern. Après de longs débats, il finit par se scinder en deux. D’un coté se forme le Kombund, qui rejoint l’Union Soviétique. Petit à petit, et surtout à partir de la mort de Lénine et de la prise de pouvoir de Staline, les membres éminents du Kombund se font assassiner ou arrêter et déporter en Sibérie les un·es après les autres. Celleux pour qui ça n’arrive pas (pas immédiatement en tout cas…) adoptent l’assimilation prolétarienne et tentent de se fondre dans la masse des ouvrier·es russes. Le Bund est liquidé définitivement en URSS en 1922, les persécutions contre ses membres durent jusque dans les années 30. De l’autre coté, se forme alors le Bund polonais, qui peut être considéré davantage comme le légitime héritier du Bund pré-URSS. Il continue le travail de l’organisation pour le développement du yiddish et l’organisation des masses juives prolétaires.
Beaucoup de choses se construisent alors en Pologne, notamment dans les grandes agglomérations comme Varsovie ou Lodz, composées à l’époque de près de 40% de Juif·ves. On y voit par exemple fleurir l’activité de l’organisation autour de la jeunesse. Le Tsukunft (Avenir), créé officiellement en 1915 à Varsovie, continue alors de former les jeunes générations au sein de sections professionnelles, mais aussi leur propose aussi une pratique sportive, ainsi qu’une éducation culturelle ouverte et assidue (arts, bibliothèques…etc). Le SKIF (Sotsialisticher Kinder Farband), lui, offre aux enfants dès le plus jeune âge, une structure au sein de laquelle sont organisés des camps de vacances par exemple.
Les militants du Bund ne conçoivent pas le parti comme un parti, mais davantage comme une grande famille. Car le fonctionnement du Bund, qui repose essentiellement sur l’activité de la base, de fait est un espace chaleureux et émancipateur pour ses adhérent·es. Entre l’activité politique, le travail culturel, et l’ancrage social, le Bund est perçu comme un représentant légitime par une grande partie des Juif·ves d’Europe de l’Est de l’époque.
Pour être clair, la doctrine du Bund, c’est la « Doïkayt ». Ce mot yiddish se traduit au mieux par le « la manière d’être là où l’on se trouve ».
Entre les années 20 et les années 30, le climat se ternit en Europe. L’antisémitisme est invivable pour la population juive, et de plus en plus de gens se tournent vers le sionisme. Le Bund n’apprécie pas les mouvements sionistes, quels qu’ils soient, les bourgeois comme les marxistes. Il les décrie et les attaque sur leurs idées, auxquelles le parti est fondamentalement opposé. Il se réclame d’ailleurs de très vive voix « antisioniste ».
Mais pour parler de cela, il convient de ne pas faire d’anachronismes. Bien que le Bund, dès le début du XXe, pose déjà comme contradiction interne au sionisme le fait que « le peuple sans terre n’atteignait pas les rivages d’une terre sans peuple », la principale raison pour laquelle le Bund est farouchement « antisioniste » est davantage son rapport à la Galout (Diaspora/Exil).
Le Bund considère tout d’abord l’idée de potentiellement déplacer les masses prolétaires juives extrêmement nombreuses de Russie jusqu’en Palestine, comme complètement irréaliste. C’est pour elleux, à l’époque, détourner les Juif·ves de l’objectif révolutionnaire en Europe, particulièrement en Russie. Les bundistes n’ont prévu·es de partir nulle part, car partout c’est chez eux.
Pour être clair, la doctrine du Bund, c’est la « Doïkayt ». Ce mot yiddish se traduit au mieux par le « la manière d’être là où l’on se trouve », ce qu’elleux expriment aussi sous le terme de « patriotisme de la Galout ». L’idéologie bundiste revendique donc une nationalité juive qui intègre positivement son caractère diasporique et extra-territoriale. Elle appelle à la révolution prolétarienne en Europe, aux cotés de toutes les autres forces progressistes et socialistes alliées qui poursuivent le même but émancipateur. Une façon pour les bundistes d’affirmer que les Juif·ves ont un avenir à l’endroit où iels se trouvent.
Ceci étant dit, à partir des années 30, la situation en Europe se dégrade en chute libre pour les Juif·ves. Les persécutions se multiplient, et l’Allemagne hitlérienne se présente comme un danger imminent pour les Juif·ves de l’Est et pour le Bund. Toutefois, l’organisation est déjà débordée sous le régime polonais indépendantiste de Josef Pilsudski, au sein duquel l’antisémitisme pogromiste s’exprime allègrement et régulièrement.
En septembre 1939, la guerre éclate, l’Allemagne et l’URSS se partagent la Pologne selon l’accord Hitler- Staline (ou Molotov-Ribbentrop). Dès 1939, le Bund s’engage dans une résistance active face à l’Allemagne nazie et l’URSS stalinienne. Le parti rebascule totalement dans la clandestinité et s’oriente de plus en plus vers la lutte armée. Les groupes d’autodéfense, les Boevie Otriady (créés depuis le début du XXe en réactions aux violents pogroms, notamment celui de Kichinev en 1903) s’organisent encore d’avantage en s’alliant principalement avec le LPZ (Linke Poale Zion), ainsi qu’avec tout civil sympathisant en capacité d’agir.
La résistance bundiste pendant la guerre ne se résume pas non plus uniquement à la lutte armée. La presse bundiste, active depuis la création du parti, continue de tirer ses numéros en cachette et de les distribuer aux communautés juives des ghettos. Des cellules éducatives secrètes sont maintenues pour permettre notamment aux enfants de continuer d’apprendre le yiddish où de faire du théâtre, même au milieu des ghettos.
Le Bund développe également un important réseau d’information qui leur permet, d’être au courant rapidement du sort réservé aux Juif·ves déporté·es dans les trains allemands. Nous pouvons par exemple parler d’Arthur Ziegelbaum, représentant du Bund au gouvernement polonais d’exil à Londres, qui dès 1942 alerte les puissances occidentales (autant qu’il le peut) sur le génocide des Juif·ves en cours. Il s’y suicidera en 1943 pour protester contre leur inaction totale.
On pourrait aussi ajouter que pendant que le Bund résiste face aux nazis en Pologne et dans tout l’Est européen, l’URSS de Staline prend, elle, l’initiative d’organiser l’assassinat des deux dirigeants Henryk Elrich et Victor Alter, après qu’ils aient proposé de créer un Comité Juif Antifasciste afin de mobiliser du soutien dans l’effort de guerre antinazi. L’exemple est parlant pour concevoir l’étau dans lequel se trouve alors le Bund, et les Juif·ves de manière plus globale, entre les SS d’Himmler d’une part, et le NKVD de Béria de l’autre.
Un des derniers moments forts du Bund fut évidemment le soulèvement du ghetto de Varsovie.
Les forces bundistes en présence dans le ghetto, et par delà ses murs, organisèrent, au sein de l’OJC (Organisation Juive de Combat) aux cotés des sionistes du Poale Zion et du Linke Poale Zion, une féroce résistance aux allemands. L’OJC ne fut pas non plus la seule organisation de résistance armée aux nazis. Le mouvement du sionisme révisionniste, de Vladimir Jabotinsky et du Betar, après un refus réciproque de s’allier avec les bundistes et sionistes (du PZ et du LPZ), forma de son coté l’Armée Juive Militarisée (ZOB/ZZW), opposant sa propre résistance à l’ennemi commun. Cependant, numériquement, l’OJC représentait la majorité de la résistance juive armée au sein du ghetto avant et pendant l’insurrection de 1944.
Au moment de l’insurrection, le combat fut tel que la seule solution qui restait aux allemands était de raser le ghetto, pour y rafler tout le monde, et les déporter au centre de mise à mort de Treblinka. Certain·es survivent aux combats au sein du ghetto, comme Marek Edelman, militant bundiste, dont les mémoires sur son expérience du ghetto écrites juste après sont réédités et disponibles. Ceci étant dit, le Bund fut assassiné par l’Allemagne nazie et par l’URSS stalinienne. Ces deux régimes politiques distincts ne laissèrent aucune trace du mouvement, politique autant que culturel. Les bibliothèques furent détruites, les livres brulés, les institutions démantelées, les sanatoriums pour enfants malades raflés, et les forces vivantes de l’organisation assassinées.