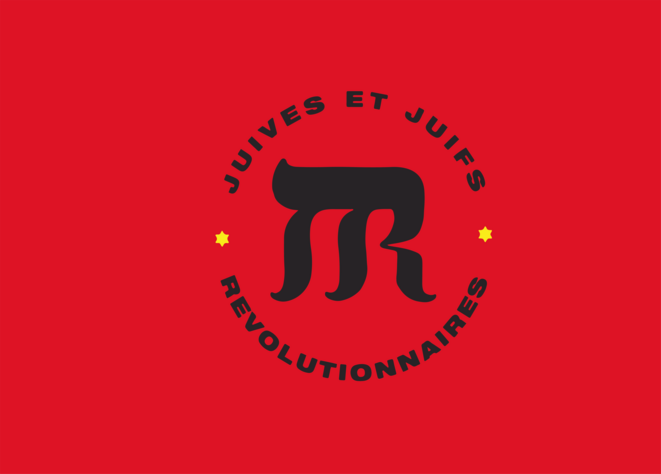Que reste-il donc aujourd’hui du Bund ? Que nous devons nous de garder en mémoire ?
Rappelons un aspect central du Bund. C’était plus qu’un parti politique (le Bund d’ailleurs ne se revendiquant pas comme un parti mais comme une union), c’était réellement une famille. C’était un réseau de personnes dans le besoin, révoltées, qui désiraient voir advenir un monde meilleur, dénué de ses injustices de l’époque, auxquelles les Juif·ves d’Europe de l’Est étaient confronté·es directement dans tous les aspects de leurs vies (discriminations sociales, pas de droits civils ou politiques, sous la menace constante des pogroms).
Le monde dans lequel le Bund est né, et dans lequel il a lutté, n’existe plus.
Le Bund, c’était dans le fond, un formidable et puissant mouvement à cheval entre l’espérance utopique et le pragmatisme révolutionnaire. La politique syndicaliste et révolutionnaire était tout aussi importante que l’acquisition du savoir intellectuel et l’activité culturelle et sociale.
Toutefois, parler du Bund, c’est aussi faire acte de souvenir. Car ce mouvement n’a pas disparu en raison d’une perte de souffle, il fut éteint, arrêté en route par la guerre, le nazisme, le stalinisme et la Shoah. Les masses juives prolétariennes ne sont plus, elles sont mortes. Le yiddish n’est plus une langue vernaculaire et populaire, c’est devenu une langue de souvenir et de deuil principalement. Et la doctrine bundiste, doit être replacée dans son contexte. Le monde dans lequel le Bund est né, et dans lequel il a lutté, n’existe plus. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas apprendre de lui, et continuer son combat d’une autre manière, non anachronique.
Car dans le fond, ce que l’on peut tirer de tout ça, c’est le constat d’un choix fait devant une question incontournable : Comment s’émanciper ?
Que leur choix ait été le bon ou pas n’est pas une question pertinente, on ne fait pas de l’Histoire avec des jugements de valeur en connaissance de l’avenir. Face à un avenir dérobé, le Bund s’est tenu debout, pour protéger ce qui lui était cher, tout ce que l’on disait avant. Il avait vocation à être le mouvement populaire qui pourrait émanciper les Juif·ves de leur condition opprimée, dans une Europe socialiste, fédéraliste, et multi-nationale. Ceci étant dit, on se doit également de se référer politiquement au Bund, sans en instrumentaliser son existence complexe et pleine de contradictions.
Nous revoilà sur un point essentiel : l’anachronisme dont le Bund fait les frais à maintes égards.
Ainsi, nous en venons au sujet très contemporain de l’antisionisme. Bien qu’il soit vite arrivé d’utiliser la carte « Bund » pour appuyer une légitimité quelconque envers un quelconque discours antisioniste, cela est tout autant une simplification extrême d’une histoire qui mérite mieux que cela, qu’un manque de respect absolu envers la mémoire de ce mouvement. Nous revoilà sur un point essentiel : l’anachronisme dont le Bund fait les frais à maints égards.
Il faut savoir qu’une partie du peu de bundistes encore en vie après la guerre partirent en Palestine mandataire. Ils y furent impliqués politiquement mais n’eurent pas d’influence majeure sur la construction du tout nouvel État. On pourrait même aller jusqu’à dire que, revendiquer une forme de légitimité antisioniste derrière l’image des « bons juifs bundistes », est une forme d’oubli du génocide, car quoi que l’on pense du bundisme et de leur refus de quitter l’Europe pour la Palestine, la réalité historique est que ces personnes sont mortes parce qu’elles étaient en Europe, par choix, ou non.
Les bundistes en étaient conscient·es, et lorsque des exils clandestins de Juif·ves eurent lieu sous la tutelle de mouvements sionistes pour les exfiltrer d’Europe en direction du proche-orient durant la guerre, le Bund ne s’y opposa aucunement, il les aida même quand il pouvait. Car le plus important avant tout, à la fois pour les sionistes que pour les bundistes, ce n’était pas de gagner la querelle idéologico-politique, mais de sauver toustes ces Juif·ves, qui était en train d’être exterminé·es. C’est aussi la raison pour laquelle, à chaque explosion de violence pogromiste depuis le début du XXe, le Bund finit toujours par s’allier avec les sionistes au sein des groupes d’autodéfense.
Leur désaccord était stratégique, et non dogmatique.
Et ce désaccord sur la stratégie de survie des Juif·ves avait lieu dans une Europe où existait encore plus de 10 millions de Juif·ves à l’Est, où il n’existait pas d’État juif en Palestine, où la Révolution russe n’était pas encore une désillusion totale. Ce désaccord avait lieu dans une Europe où les Juif·ves, spécifiquement le Bund, voyaient encore un avenir pour elleux.
Et c’est bien pour ça qu’arracher à leur époque les réflexions bundistes antisionistes, témoigne non seulement d’une connaissance inexistante de ce que fut réellement le mouvement, mais aussi d’un biais potentiellement antisémite qui cherche à trouver le « bon juif », qui pour le coup, se trouve être mort, assassiné par le continent duquel il refusait de partir. La Shoah, fait d’une Europe antisémite qui n’a pas permis aux Juif·ves de pouvoir exister en son sein, n’a laissée d’autres possibilités à de nombreux survivant·es que l’exil, y compris en Palestine.
Dans l’optique d’une lecture historique et politique honnête, il convient de considérer les Juif·ves d’Europe de l’Est, bundistes, sionistes, ou soviétiques, comme des produits de leur temps, de tous leurs contextes, et qui n’avaient aucunement conscience qu’à la moitié du siècle, iels seraient exterminé·es quasi-totalement. Leurs choix se sont fait en fonction des éléments contextuels à leur existence.
Et attribuer au Bund le « mérite » d’un discours antisioniste contemporain, de manière complètement anachronique, ne permet en aucun cas, ni de légitimer une parole qui n’était de toute façon pas la leur, ni de rendre hommage à la mémoire de ce mouvement, de toutes ses pertinences, et de toutes ses contradictions.
Pour finir, nous pouvons proposer les trois couplets de ce qu’était l’hymne du Bund, Di Shvue (le serment), écrit par Shalom Anski (auteur du Dibbouk et socialiste révolutionnaire) en 1902 :
"Frères et sœurs, tourmentés, révoltés,
De par le monde dispersés,
Rassemblez-vous, la bannière attend.
Elle flotte, furieuse, maculée de sang,
À la vie, à la mort, prêtez serment !
Témoins, Le ciel et la terre entendrons,
Et la lueur des étoiles au firmament.
De larmes et de sang ce serment,
Nous jurons, nous jurons, nous jurons !
Au Bund, éternelles dévotion et loyauté,
Lui seul pourra nous libérer.
Haut la bannière empourprée,
Flotte, furieuse, maculée de sang.
À la vie, à la mort, prêtez serment !"