
Agrandissement : Illustration 1

«Ya desde el 79 sabemos que Lima es la capital de América Latina más vulnerable»
Abimael Guzmán
Partie 1 : PCP-SL, Guérilla Révolutionnaire à Lima
L'objet de ces trois articles est consacré à la guerre révolutionnaire conduite par le Partido Comunista del Peru en el Sendero Luminoso, et plus spécifiquement au rôle assigné à Lima, la capitale, à leur stratégie militaire et politique, ainsi qu'aux tactiques pour organiser et développer la lutte armée et radicaliser les mouvements sociaux. Notre propos n'est pas d'interroger l'idéologie du Sendero Luminoso, ni de tenter de l'interpréter, mais bien de nous arrêter sur les faits ; cependant, il nous semble nécessaire, par un bref préambule, de présenter certaines particularités de cette guerre civile, ce conflit interne armé selon la terminologie officielle.
Un « Festival de ligatures des trompes »
Cette guerre, beaucoup le reconnaissent, n'est pas simplement un conflit armé entre le PCP-SL et l'État, mais plutôt l'aboutissement des contradictions d'une société, entre passéisme et modernisme, en état de désintégration du fait d'une crise économique exceptionnelle et extraordinairement longue. Une guerre qui est le produit, comme toutes les guerres révolutionnaires, de plusieurs décennies d'injustice sociale et dans le cas du Pérou, d'un racisme social et culturel exacerbé, hérité des conquistadors espagnols, contre les populations autochtones des Andes et de l'Amazonie, ces « indio de mierda » ou « cholo de mierda ». Mais ce conflit sera aussi la scène d'affrontements entre les partis politique de la gauche, au sein même de leur direction, contre les révolutionnaires, contre l'oligarchie ; un conflit divisant les populations pauvres, exacerbant le racisme, y compris entre les ethnies pour se disputer des terres, divisant des communautés jadis solidaires dans la misère, entre bénéficiaires des réformes agraires et « oubliés » de ces mêmes réformes, divisant la bourgeoise progressiste et l'oligarchie réactionnaire, les padres de l'Église, amenant l'État péruvien à critiquer ouvertement les formidables contraintes du Fond Monétaire International, de la Banque Mondiale, partageant même les militaires tortionnaires de ceux qui dénonçaient les méthodes inhumaines. Une guerre qui sera l'occasion de "régler des comptes", en-dehors de toute considération politique ou idéologique.
Le PCP-SL a allumé la mèche d'une situation explosive – qu'il ne soupçonnait pas ou envisageait différemment -, les militaires n'ont su que l'exacerber, déchainant les rancœurs, les amertumes qui couvaient depuis plusieurs décennies, voire des siècles pour les cholos. Certains observateurs évoquent ce conflit comme une sorte de dégénérescence de la violence qui semblait é
chapper, pendant un temps du moins, au contrôle de ceux qui l'avait provoqué, malgré les déclarations. Selon un ancien guérillero, la violence avait généré un processus incontrôlable, un ensemble d'actions/réactions, une spirale de la violence, qui a fini par submerger ses propres protagonistes bien au-delà de leurs intentions.
La presse, les médias et les auteurs de la pensée réactionnaire et bourgeoise n'ont de cesse de condamner et de dénigrer, en parfaite harmonie d'une symphonie internationale, la guerre menée depuis le 17 mai 1980 par le Partido Comunista del Peru en el Sendero Luminoso, présenté comme une organisation inhumaine, sanguinaire, voire génocidaire. Soulignons de même l'odieuse répression des gouvernements successifs pour l'exterminer, et rappelons ici ce crime d'État, parmi tant d'autres : 331.600 femmes stérilisées par force pour « lutter contre la pauvreté », des régions rurales les plus pauvres et des bidonvilles [des « festivals de ligatures des trompes » y étaient organisés], tandis que 25.590 hommes subissaient une vasectomie [estimation du 'rapport final' 2002, du Ministère de la santé (Minsa) *]. Une politique eugéniste [suggérée par le Fond Monétaire International], imposée par le président/dictateur Fujimori [1990/2000], qui est aujourd'hui en prison, jugé coupable de génocide et de crime contre l'humanité.

Agrandissement : Illustration 2

Concernant les déclarations, les articles de presse, les études plus sérieuses dénigrant le Sendero Luminoso, on peut s'interroger sur ces accusations qui contredisent la réalité : pendant un temps, l'«Ejército Guerrillero Popular» (EGP) était parvenue à sinon libérer mais à occuper le tiers du pays, à s'implanter dans toutes les grandes villes, a résisté aux forces armées pendant plus de vingt années [1980/2000]. Comment serait-il possible d'occuper un territoire aussi important sans le soutien d'une grande partie du peuple ? Est-il possible de croire qu'une population andine terrorisée ait été contrainte d'aider – et de se battre - sous la menace des armes d'une poignée de guérilleros ? Peut-on croire ces affirmations de territoires libérés organisés, administrés en goulags, véritables camps de concentration où régnait l'ombre de Pol Pot ? Était-ce vraiment l'oeuvre d'une extrême minorité fanatisée engendrant une terreur à l'échelle d'un pays ?
Il est reconnu que l'«Ejército Guerrillero Popular» a commis des actions peu glorieuses, parfaitement condamnables [nous reviendrons sur le fait que le PCP-SL reprend les mêmes procédés politico-militaires jugés inhumains, des révolutionnaires nord-vietnamiens pendant la guerre d'Indochine puis du Vietnam, une victoire considérée comme "héroïque" pour beaucoup : l'histoire ne pardonne pas aux vaincus...] ; mais il n'est même pas nécessaire de rappeler qu'historiquement, aucune force révolutionnaire ne peut se développer à ce point et aussi longtemps, si elle réprime la base sociale ou les populations qui l'appuie. À Lima, cette base était composée par les habitants pauvres qui survivaient depuis l'après seconde guerre mondiale, dans les plus misérables bidonvilles de l'Amérique du Sud : soit 1,100,000 de personnes, avant que se déclare la guerre civile en 1980. Pour les plus pauvres de Lima, les « cholo de mierda », et autres oubliés du progrès capitaliste, la guerre révolutionnaire représentait le seul espoir de sortir d'une misère absolue ; car l'un des détonateurs de la révolution aura bien été une crise économique sans précédent, qui débuta après la crise du pétrole [1974] pour se développer tout au long des années 1980 et entrainer la quasi ruine du pays en 1989 [cette année, le taux d'inflation atteint 2 700 %, perte de 50 % du pouvoir d'achat moyen de sa population, en 1991, plus de la moitié de la population était sous le seuil de pauvreté, etc.]. Une économie malade qui engendra une toute aussi extraordinaire corruption et un taux de criminalité – hors politique – exceptionnel.
LIMA : 1.100.000
Lima va occuper une place centrale dans les débats et dans la guerre civile menée par lePartido Comunista del Peru en el Sendero Luminoso. Une guerre révolutionnaire qui présente maintes analogies avec la guerre d'Indochine puis du Vietnam et du rôle de Hanoï et surtout de Saïgon occupé par les forces armées américaines ; la stratégie nord-vietnamienne sera de déstabiliser les structures de l'État et d'harceler les forces armées américaines, d'intimider et d'éliminer les opposants politiques et intellectuels, et ce, dans le cadre d'une vaste propagande devant assurer une vitrine internationale. Comme plus tard à Lima, la tactique repose sur l'organisation de cellules clandestines, mais également d'organisations de « façade » qui organiseront, assassinats, attentats à la voiture piégée, presse subversive, grèves et manifestations, etc. De même dans les campagnes, Ho Chi Minh sera confronté à des populations rurales, des ethnies, des chefs de village, à la bourgeoisie locale et aux fonctionnaires des villes, hostiles à la révolution, et n'aura d'autre choix que de les éliminer.
Une stratégie politico-militaire se basant sur certains préceptes de Mao, des stratèges vietnamiens, adaptés aux caractéristiques du Pérou, et à l'époque ; ainsi le rôle des médias, de la propagande occupent une place centrale et Lima aura cet objectif d'être la caja de resonancia del Partido, la "caisse de résonance du Parti", en tenant compte du fait que toute action à Lima, même minime, a un impact national et international.
Une guerre révolutionnaire commencée en 1980 qui à partir de 1988 présentera deux fronts, celui militaire des zones rurales de la Cordillère des Andes et d'Amazonie et celui de la métropole Lima. La capture des leaders du PCP-SL et du MRTA signera en 1992, le déclin inexorable de la lutte armée à Lima, qui continue cependant jusqu'à l'année 2000.
LES BARRIADAS : L'URBANISME DES EXCLUS
Lima, voit apparaître à la fin des années 1940, un phénomène spontané et commun à toute l'Amérique du Sud : les barriadas - bidonvilles durables - qui envahissent les pentes des collines entourant la capitale. De 660.000 habitants en 1940, la population de Lima était passée à 1.900.000 en 1960, 3.400.000 en 1972, près de 6.500.000 en 1990, 9,000.000 en 2000. Les causes de cette explosion urbaine sont d'ordre démographique, mais surtout provoquées par un exode rural massif des paysans pauvres venant des provinces déshéritées de la sierra pour trouver de meilleures conditions de vie. Cet urbanisme de la misère s'attaqua illégalement aux flancs des cerros [collines] proches du vieux centre de Lima : les cerros San Cristobal, San Cosme, El Agustino, ainsi que sur les rives du fleuve rio Rimac.
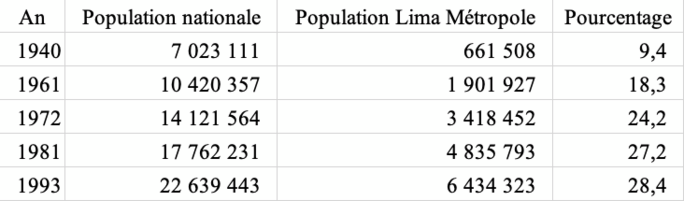
Agrandissement : Illustration 3
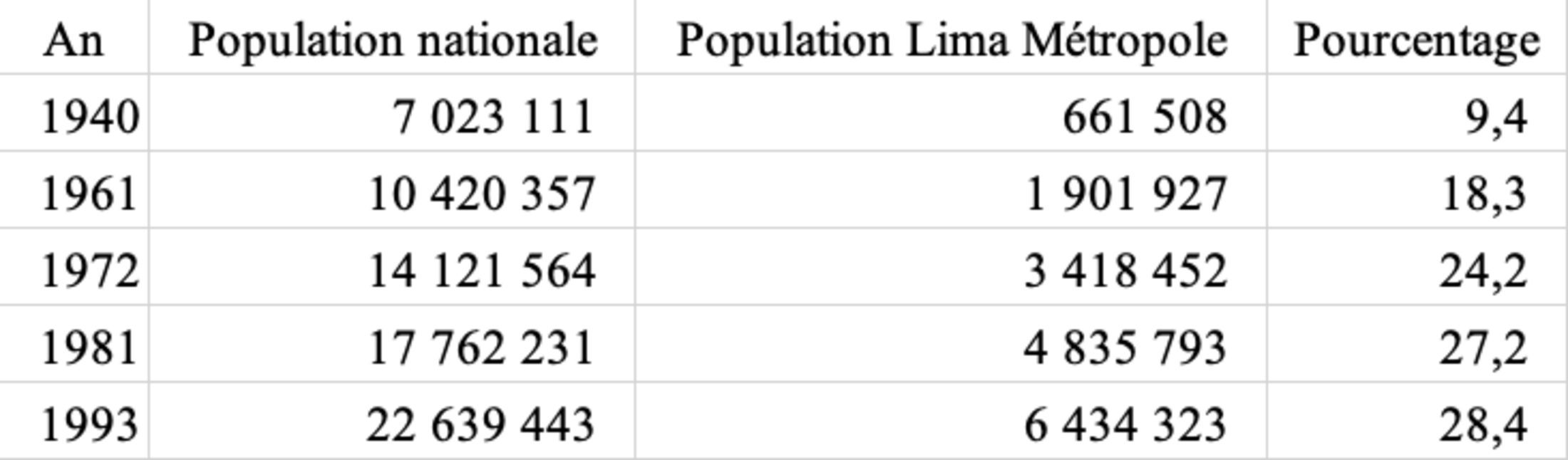

Agrandissement : Illustration 4
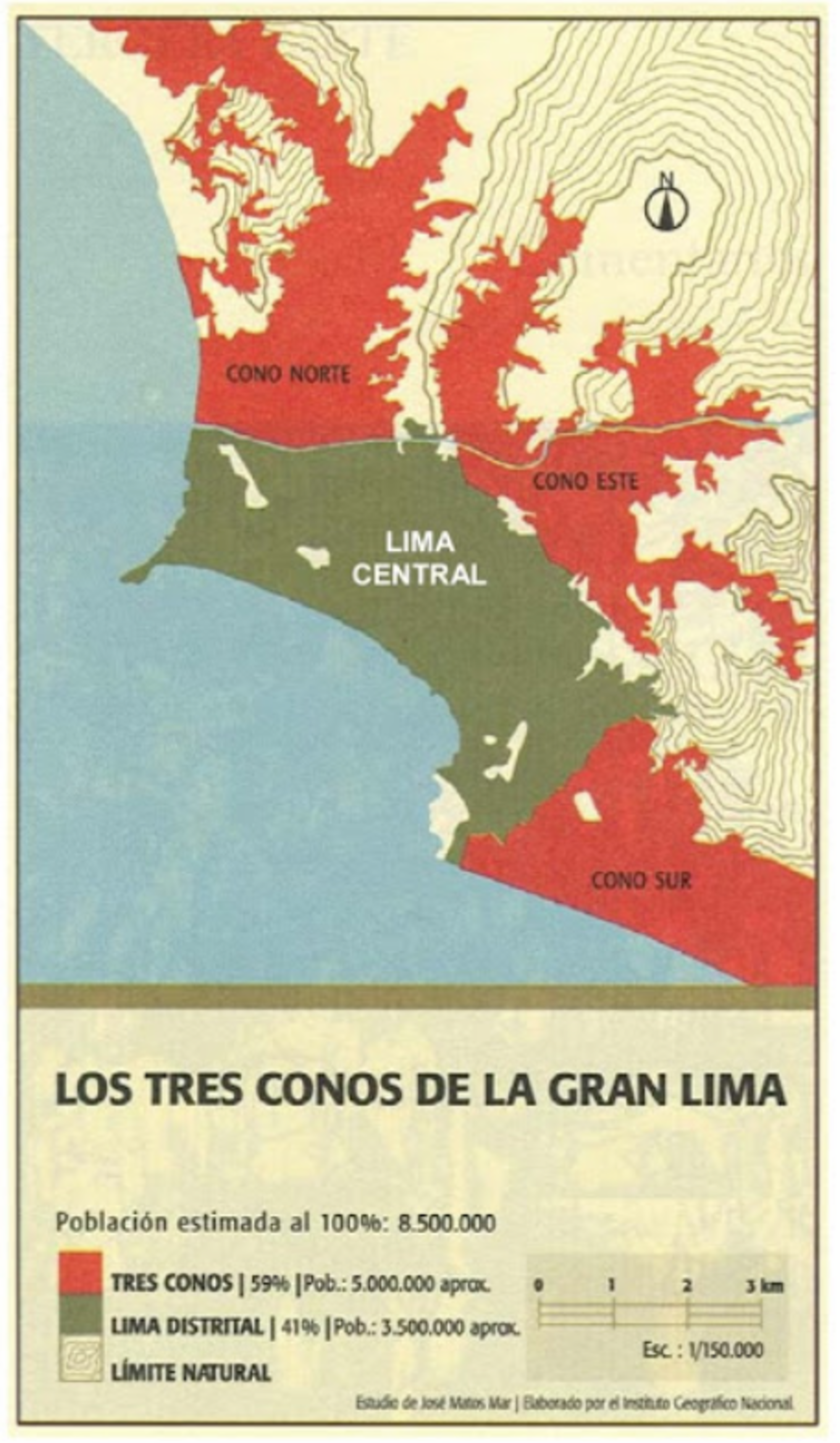
En 1950, des groupes familiaux et des associations communautaires s'emparaient illégalement de terrains libres et édifiaient sans autorisation des cabanes faites de planches, de pailles tressée ou de plaques de tôle, qui formeront d'immenses quartiers d'habitat précaire, dépourvus de voirie, sans eau ni électricité et sans réseau sanitaire. Vers 1960, cet urbanisme incontrôlé avait progressé vers la vallée du rio Chillon, le long de la route Panaméricaine nord, et occupait vers l'ouest et le sud les glacis pré-andins de Comas et de Villa Maria del Triunfo. Après des années de batailles juridiques et d'affrontements souvent violents avec la police, ces bidonvilles commencèrent à se doter peu à peu de quelques services publics encore bien déficients : eau, électricité, parfois éclairage public.
Mais selon le rapport de la Comisión de la Verdad y Reconciliación : « les différents gouvernements qui se succèdent de 1948 à 1968, ont été incapables de résoudre les problèmes de logement, des services de santé, de création d'emplois, qui incitèrent naturellement l'apparition d'un nouvel espace de lutte politique plus radicale »... et la venue des militaires dans le monde politique.
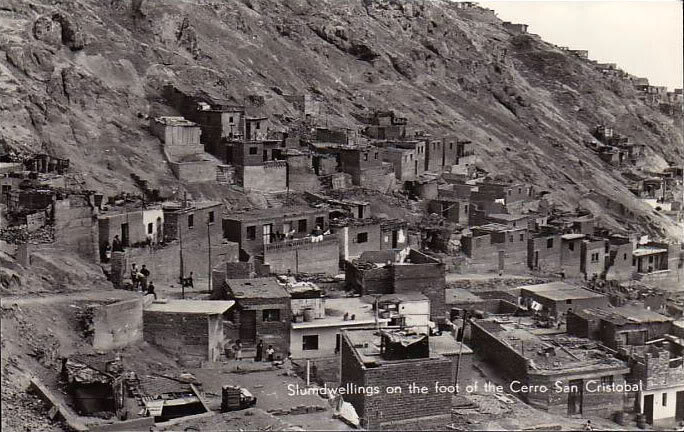
Agrandissement : Illustration 5

REVOLUTIONS : 1965/1966
En 1965, Alberto Gálvez, dirigeant du Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)(Mouvement de la gauche révolutionnaire) créé en 1962, initie une lutte armée. Il n'aura fallu que six mois pour les militaires pour éliminer la rébellion qui s'était isolé dans les régions montagneuses des Andes. De même, un groupe appelé Tupac Ameru, dirigé par Guillermo Lobatón, est éliminé en juin 1966 après six mois d'affrontements avec l'armée. L'Armée de libération, un groupe d'allégeance castriste, est pour sa part éliminé par l'armée en 1966. Cela étant, entre la montée et l'échec des guérillas, et le coup d'État militaire d'Octobre 1968, la gauche péruvienne a subi un processus de fragmentation et de confrontation entre "deux voies" possibles : la voie Pacifique, réformiste et électorale, ou celle de la Révolution et de la guérilla. La multitude et la diversité des partis politiques se réclamant du marxisme s'opposaient sur cette question, notamment durant la longue dictature 1968 – 1980, et les liens ne sauront jamais totalement rompu entre les uns et les autres, malgré une vive rivalité. Paradoxalement, la révolution du PCP-SL débute dès le premier jour du retour de la démocratie en mai 1980 ; leur défaite viendra confirmer cette règle, qu'aucune révolution n'a jamais vaincu une - véritable - démocratie.
LES MILITAIRES AU POUVOIR 1968 / 1980
L'attitude des autorités changea quelque peu avec l'arrivée du régime militaire "progressiste" du général Velasco en 1968. De nombreuses invasions furent légalisées et l'État dota ces quartiers d'écoles, de dispensaires et encouragea la formation d'associations représentatives, le plus souvent noyautées par des fidèles du gouvernement. On baptisa alors les bidonvilles, Pueblos jóvenes, [villes nouvelles], puis sous la dictature, Asentamientos humanos [établissements humains], par un euphémisme optimiste qui ne parvenait pas à dissimuler une triste réalité sociale : après la crise de 1973, le Pérou s'enfonçait dans la récession, le chômage et la délinquance de masse, sur fond de luttes politiques et syndicales de plus en plus violentes.
À Lima, en 1961, quelque 316.000 personnes vivaient dans des bidonvilles, 17 % de la population totale ; il est estimé qu'en 1970 un tiers sa population nationale soit 3,5 millions de personnes vivent dans des pueblos jóvenes. En 1981, presque un tiers de la population de Lima y a vécu ou vit encore, et les estimations faites une décennie plus tard annoncent entre 3 et 3,5 millions de personnes vivant dans des bidonvilles, près de la moitié de la population totale de la capitale. En 1993, plus de 50% de la population totale est urbaine et Lima concentre presque un tiers de cette population: 28,4 % contre 9,4 % en 1940. Selon le recensement de 1993, 38,8% de la population métropolitaine totale était d'origine immigrée.

Agrandissement : Illustration 6
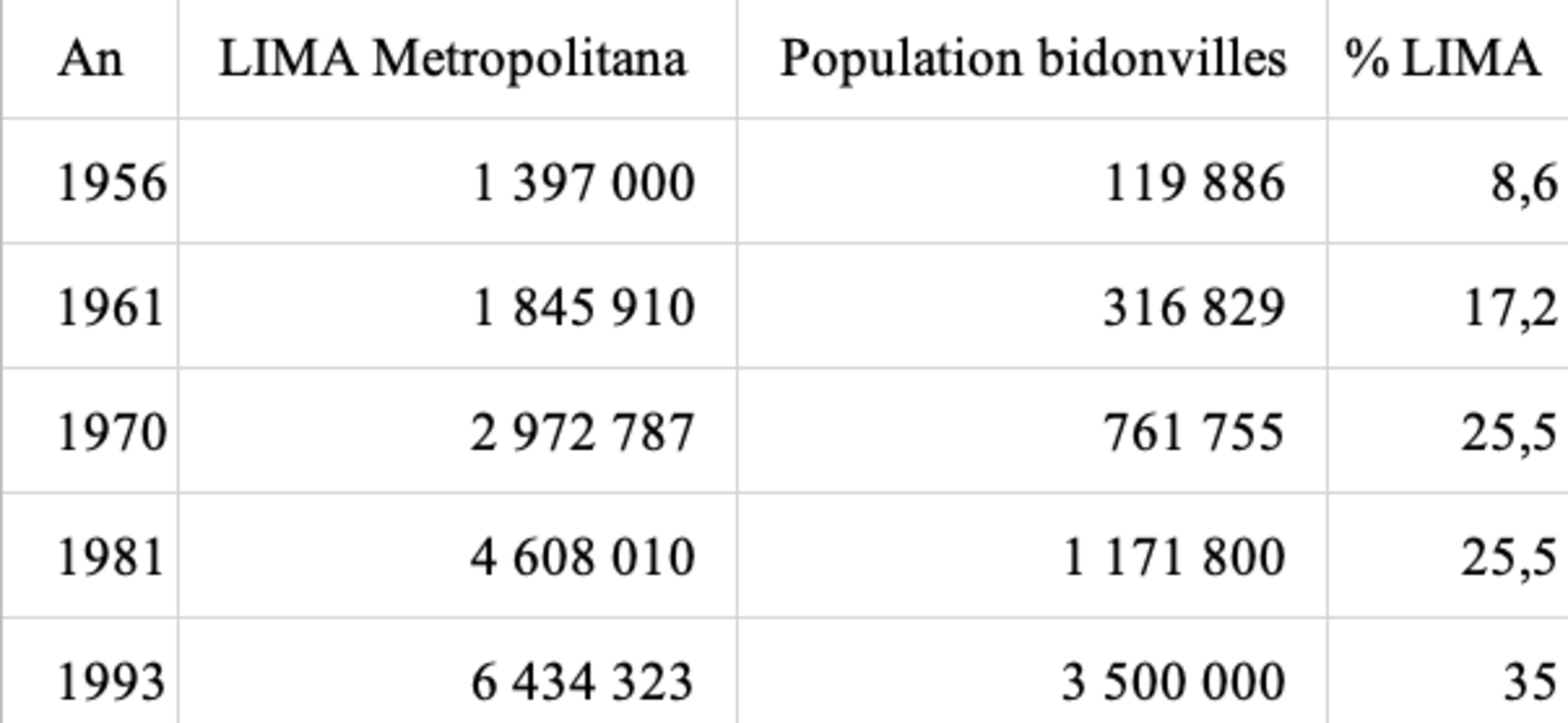

Agrandissement : Illustration 7

Avec le temps, les baraques des barriadas se sont consolidées, l'organisation collective s'est développée pour pallier l'inefficacité des pouvoirs publics en matière d'aménagement et d'équipement urbain (tels que voirie, électricité, eau potable, marchés alimentaires, etc.). Ainsi, les premiers transports collectifs se sont organisés à partir des bidonvilles sur la base de l'« informalité ». Après la réforme agraire de 1969, les attitudes des nouvelles générations de migrants se modifient. D'une part, les luttes entreprises par ceux qui sont établis depuis plus longtemps ont préparé le terrain. Les nouveaux arrivants ont souvent pu être accueillis dans des bidonvilles consolidés et obtenir des emplois par l'intermédiaire des parents ou amis qui les ont précédés. D'autre part, les motifs de la migration ont changé : nombre de petits producteurs n'ont pu bénéficier de la réforme agraire et ont quitté les campagnes. Désormais, c'est au nom d'une « intégration nationale » prônée par l'État, autour de valeurs acquises à travers le système éducatif, que les migrants en ville (les jeunes, surtout) ont le sentiment de changer de statut : ils ne seront plus paysans. Leur participation dans la société urbaine dépend néanmoins de leur capacité d'adaptation et d'intégration.
Cinturones de miseria
Dès le début des années 1980 – c'est-à-dire peu avant la guerre civile - Lima est complètement encerclée de barriadas, une véritable « ceinture de misère » [cinturones de miseria]. La capitale a changé radicalement et notamment dans la composition de sa population : le cholo occupe une place en nombre aussi importante. Une population immigrée, habitant les taudis - les tugurios - des quartiers anciens, les Pueblos jóvenes, ouAsentamientos humanos ou les barriadas plus récents, devant faire face à un flux régulier de pauvres paysans, occupant illégalement des terrains libres dans la périphérie de la capitale - les 3 cônes du développement urbain -, qui s'organisent ensemble pour la construction des cabanes et puis, qui luttent pour obtenir des services de base. En 1990, la moitié de la population de Lima vit dans les barriadas, soumise au racisme des citadins autant qu'aux épidémies qui sévissent régulièrement, faute d'infrastructures d'assainissement et d'eau potable suffisantes et d'un climat particulièrement chaud et sec en été.
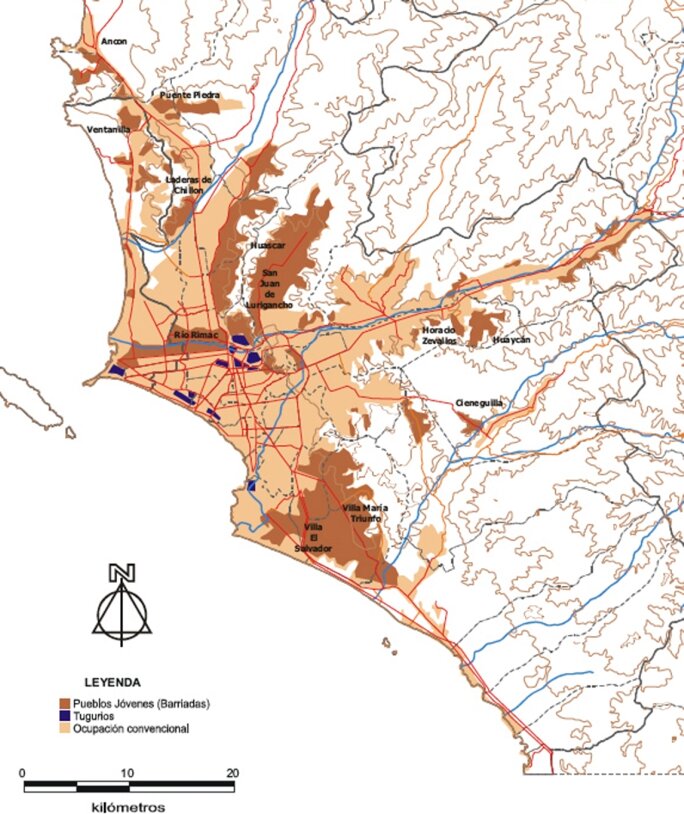
Agrandissement : Illustration 8
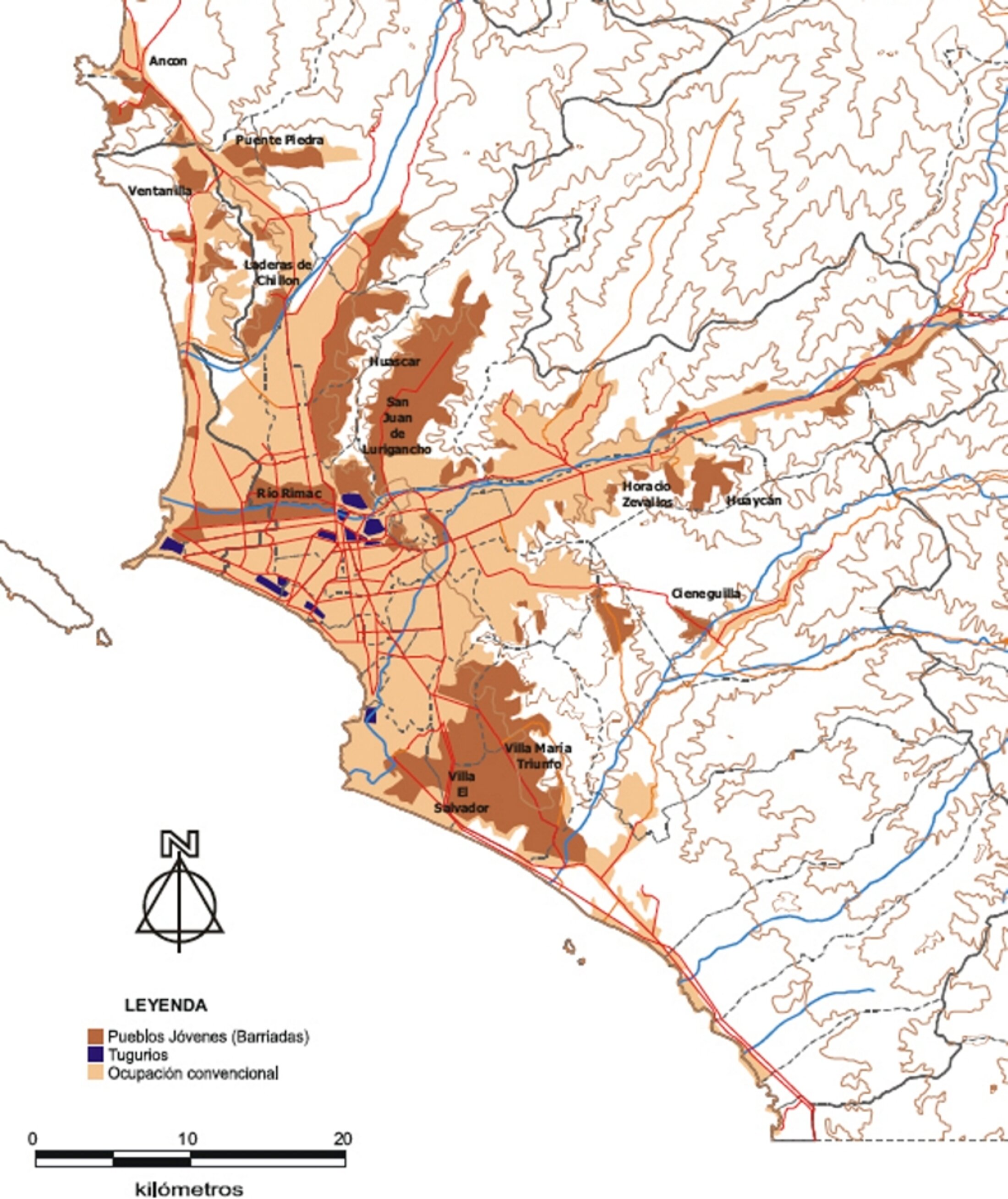
Luttes urbaines et sociales
Les années de régime militaire seront celles des protestations populaires qui s'articulent entre les revendications des habitants des quartiers pauvres et les demandes du mouvement syndical : manifestations et grèves se succèdent et le gouvernement décrète l'état d'urgence dans la capitale en 1976. Parmi les multiples manifestations, celle de mars 1976 constitue un bon exemple de solidarité, lorsque la population du quartier d'Ate-Vitarte se mobilise et porte appui aux ouvriers d'usine. On peut ajouter d'autres exemples comme les mobilisations exigeant la municipalisation de barriadas, ou bien protestant contre les sociétés fournissant des services d'eau, d'électricité et d'assainissement dans le quartier Comas et du Cône Sud, ou contre les projets urbains du Ministère du Logement à El Augustino, Callao et San Martin de Porres, ainsi que les multiples luttes engagées par les habitants de Villa El Salvador, exigeant des services publics.
La grève nationale du 19 Juillet 1977 a montré l'unité entre le mouvement ouvrier et citoyen, avec la participation massive mais spontanée de la population des barriadas (on estime que 43% des habitants des barriadas étaient des cols bleus). Celle du 22 et 23 mai 1978 a également démontré la force et l'importance des mouvements de quartier ; une mobilisation massive mais cette fois plus organisée. Les quartiers nord, sud et est de Lima deviennent des champs de bataille, recevant un soutien majoritaire des listes de la Gauche. Cependant, l'échec de la grève générale déclenchée en janvier 1979 et les conséquences désastreuses de la crise économique, mais aussi le processus de démocratisation en cours, seront à l'origine d'une forte démobilisation.
Cela étant, ces années de lutte ont favorisé la création d'une multitude d'organisations, d'associations, de réseaux, de personnalités, de militants, aptes à organiser des luttes sur le terrain et contre les administrations. Dans les années 1970 et 1980, d'autres formes d'entraide prendront le relais des organisations caritatives parrainées par diverses églises et ONG nationales et internationales, qui avaient émergé dans les années 1950, pour répondre surtout aux besoins alimentaires. Certaines cantines populaires de quartier organisées et auto-gérées par les femmes, d'autres comités de quartier en finiront avec l'apolitisme religieux et commenceront à s'investir dans des luttes politiques, et plus encore dans la vie politique locale.
La Gauche qui présente plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 1980 est quasiment certaine de l'emporter, les masses populaires en viennent à espérer des jours meilleurs...
RETOUR à la DEMOCRATIE
Organisations de quartier et politiques de la ville
Face à l'accroissement phénoménal de la population de l'aire métropolitaine de Lima, les autorités procèdent régulièrement à son redécoupage en districts : en 1940, la province de Lima était administrée en 23 districts, dont 15 formant la ville et le reste la périphérie, 7 nouveaux districts périphériques sont créés en 1961, puis 9 autres avant 1981, puis 4 autres en 1993 portant leur nombre à 43, produit de l'expansion physique de la ville et de la subdivision des vieux quartiers.
Pour comprendre le rôle de cette «ceinture de misère» il faut considérer qu'à partir de 1978 – période de transition de la dictature vers la démocratie -, les pueblos jóvenes forment des municipalités à part entière – ou luttent pour le devenir -, ou bien sont intégrés administrativement, donnant aux municipalités une importance politique sans précédent et le droit de vote aux habitants, y compris aux couches sociales pauvres issues de l'immigration intérieure. Les douze districts les plus pauvres de Lima seront l'enjeu d'une lutte entre les partis politiques parlementaires de la Gauche et l'APRA, qui ici, obtiennent le pourcentage le plus élevé de leurs électeurs.
Ce contexte sera la toile de fond pour l'élaboration de la stratégie subversive politico-militaire dans Lima, des groupes révolutionnaires, dans une période de crise économique qui depuis 1975, et l'hyperinflation de 1988-1990 déciment les budgets de l'État et municipaux, qui ont en charge les barriadas.
Hernando Do Soto, John Turner, et la Banque Mondiale
Dans les années 1970, les gigantesques bidonvilles du monde entier prennent une telle ampleur qu'ils constituent une offense pour la morale bourgeoise progressiste, une menace pour les forces de l'ordre et une opportunité d'enrichissement pour le capitalisme. Les États-Unis y voient notamment, dans sa zone de soumission sud-américaine, autant de foyers d'insurrection qu'il convenait sinon de résorber mais de contenir ; des programmes de financement et d'aides, sous l'égide d'organisations humanitaires et de la Banque Mondiale, seront ainsi développés pour venir en aide aux gouvernements. Quelques années plus tard, la Banque Mondiale ne pouvait faire qu'un vaste constat d’échec de ses premières expériences dans le domaine du logement des pauvres, qui affluaient toujours plus nombreux vers les villes. Ce sera un architecte américain John Turner (Housing by People), qui allait re-formuler et radicaliser une solution proposée par les architectes français des années 1950, s'occupant en Afrique du Nord, du développement urbain des villes : le bidonville n'était plus le problème mais la solution ; les pratiques spontanées imaginées par leurs habitants, d'auto-construction, d'auto-organisation, d'auto-gestion, leur inventivité et leur créativité, face à des situations d'extrême pauvreté, dans des conditions et des environnements urbains tout aussi difficiles, pouvaient être des éléments constituant le socle d'une politique conciliant l'économie du projet - contraintes financières et techniques - et les aptitudes des populations concernées. Plutôt que de tenter de remplacer les bidonvilles par des barres de logements sociaux, opération coûteuse et longue à mettre en oeuvre, autant financer leur amélioration et leur construction, par des aides minimum [don d'un terrain, services publics de survie, micro-crédit, etc.]. Cette idéalisation inspira la Banque Mondiale, et d'une certaine manière, imposa cet urbanisme de la misère en tant qu'idéal humain, et en tant que réponse économique, exploitée par le capitalisme via des banques offrant des micro-crédits et autres moyens de soumission tels que les ONG. En d'autre terme il s'agit de gérer la misère plutôt que de la combattre.

Agrandissement : Illustration 9
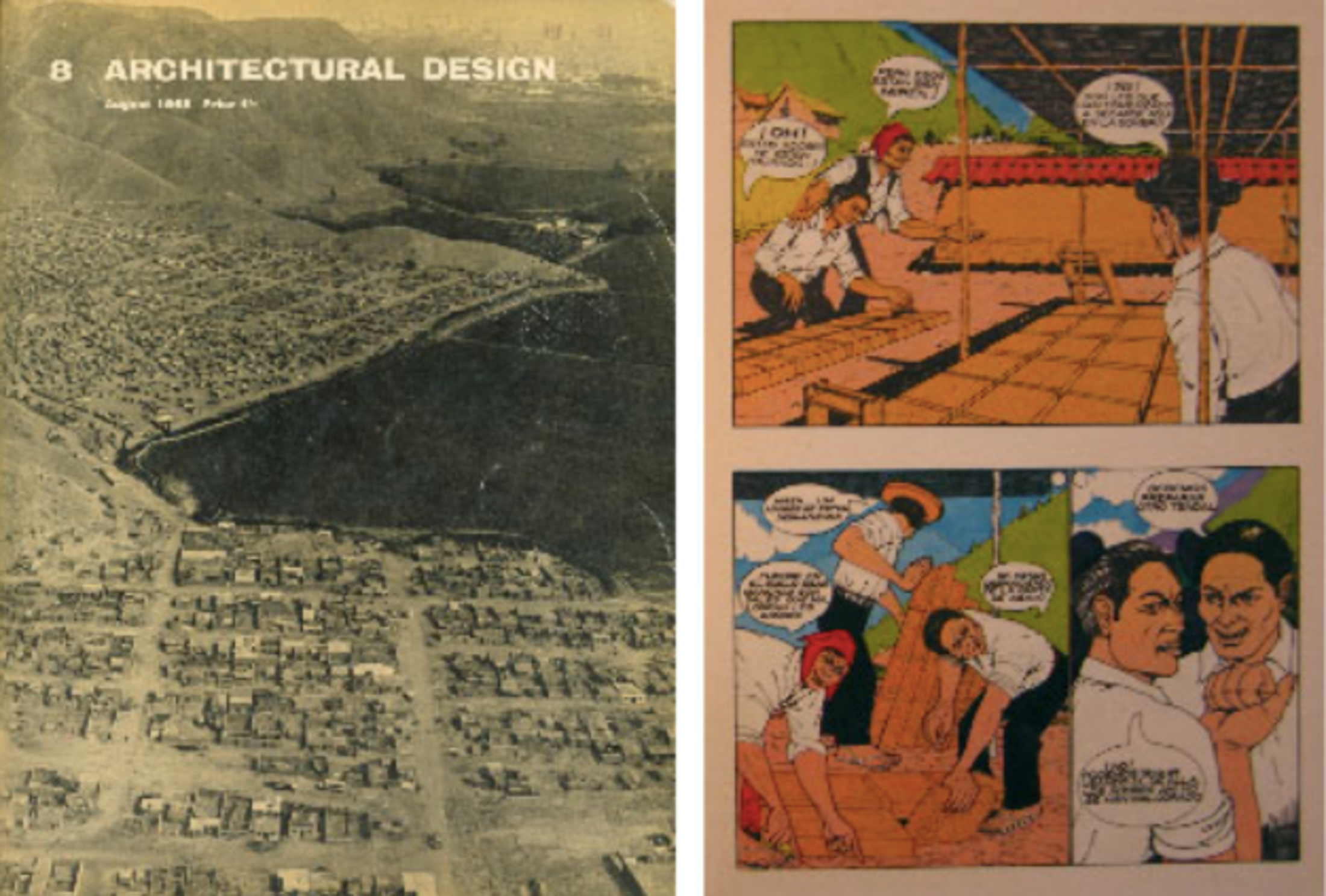
Un travail théorique qui sera pleinement partagé par Hernando de Soto, célèbre économiste ultra-libéral... péruvien et spécialiste de la pauvreté ; fondateur, en 1980, de l'Institut pour la Liberté et la Démocratie, à Lima, un temps gouverneur de la banque centrale du Pérou, conseiller particulier de nombreux dictateurs de pays en voie de développement dont le président/dictateur Alberto Fujimori. Il publie en 1986 : L'Autre Sentier, en référence au Sentier Lumineux, qui d'ailleurs tentera de l'éliminer. Dans son ouvrage, Le pire des mondes possibles, Mike Davis accuse Hernando de Soto – l'architecte John Turner également - d'être le porte-voix des politiques institutionnelles portées par la Banque Mondiale et le FMI qui, loin d'améliorer la situation des pauvres, ont conduit, via l'affaiblissement des États et la privatisation des marchés du logement, à une dégradation très nette des conditions de vie dans nombre de bidonvilles. Il va même jusqu'à qualifier Hernando de Soto de "gourou planétaire du populisme néolibéral". Tout un chapitre intitulé « La mise au PAS du tiers monde » est consacré à l'analyse des PAS, ces programmes d’ajustement structurel imposés aux États « aidés »par le FMI, programmes qui exigent une réduction drastique des programmes étatiques et bien souvent, la privatisation du marché du logement. Les ONG, qui jouent un rôle croissant dans l’aide au développement, sont elles aussi accusées : elles joueraient un rôle tout à fait relatif, de soupape, de bonne conscience, en saupoudrant de-ci de-là des programmes microéconomiques (microcrédit) quand aucune macrostratégie de lutte contre la pauvreté urbaine n’existe et usurperaient la voix des pauvres : Même s’il existe de très belles exceptions – incarnées par ex par le travail des ONG à l’origine des forums sociaux mondiaux – l’impact général de la « révolution de la société civile » et des ONG, comme le reconnaissent même certains chercheurs de la Banque mondiale, aura été la bureaucratisation et la déradicalisation des mouvements sociaux urbains.(...) Alors même que les ONG et les bailleurs de prêts pour le développement jouent avec les notions de « bonne gouvernance » et de réhabilitation des bidonvilles par apports successifs, des forces marchandes incomparablement plus efficaces repoussent la majorité des pauvres encore plus loin dans les marges de la vie urbaine.
Et en conclusion, Mike Davis affirme ainsi :
Mais les pauvres ne finiront-ils pas par se révolter si la voie de l’urbanisme informel se transforme en cul-de-sac ? Les grands bidonvilles ne sont-ils pas – comme le craignaient Disraeli en 1871 et Kennedy en 1961 – tout simplement des volcans prêts à exploser ? Ou est-ce que l’impitoyable concurrence darwinienne – à mesure qu’un nombre toujours plus grand de pauvres continue à se battre pour les mêmes miettes informelles – finira au contraire par donner naissance à une violence communautaire autodestructrice, forme ultime de l’ « involution urbaine » ? Dans quelle mesure un prolétariat informel peut-il posséder le plus puissant des talismans marxistes, l’ « effectivité historique » ?

Agrandissement : Illustration 10

Le PCP-SL et LIMA
Le PCP-SL pouvait ainsi trouver à Lima, des conditions véritablement exceptionnelles pour s'y établir : des quartiers pauvres et sous-équipés, favorisant un contexte de politisation élevée, des habitants menant activement des luttes populaires pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, une économie défaillante, une corruption et un clientélisme grandissants, symbolisés par les quartiers luxueux de la bourgeoisie. Au radicalisme populaire dans les districts pauvres correspondait les différends au sein et entre les partis politiques de la Gauche parlementaire, incapable d'assumer son rôle de proposer des projets de lois en adéquation avec la situation catastrophique du pays pour au contraire, se perdre dans des querelles partisanes, stériles, bien éloignées des préoccupations quotidiennes des classes populaires. C'est un point d'importance pour expliquer le développement lent mais constant du PCP-SL ; un ancien guérillero assurait que parmi les plus pauvres, certains étaient bien plus radicaux qu'Abimael Guzmán.
Au fur et à mesure de la montée en puissance et d'impact sur les populations de l'idéologie révolutionnaire, le rôle de Lima – et des villes - dans le développement de la lutte armée, sera l'une des pierres angulaires de la stratégie subversive. La stratégie PCP-SL concernant l'organisation et le développement de la lutte armée dans Lima n'est pas linéaire mais s'adapte au contexte politique et économique, à l'évolution des victoires, des échecs de la guérilla des zones rurales, à l'augmentation du nombre de ses militants et sympathisants dans la capitale, tout autant qu'aux déplacements forcées des populations rurales vers Lima, qu'à sa volonté de médiatiser au niveau international la guerre ; à l'importance que prendra Abimael Guzmán au sein du Comité dirigeant. Quatre périodes se succèdent : celle d'incubation de 1980-1984, celle de 1985-1988 donnant un rôle important à Lima, celle de 1989-1992, de l'« équilibre stratégique », de la plus grande activité, et enfin, celle de 1992-2000 correspondant au déclin entamé dès 1993.
La stratégie des « quatre C »
Du point de vue militaire, le PCP-SL applique la stratégie de la guerre populaire prolongée qui est conçue en trois étapes : défense stratégique, équilibre stratégique et offensive stratégique. Chaque étape correspond à une période spécifique de la révolution et est en relation avec les conditions objectives de la société péruvienne et en premier lieu avec la façon dont les masses incarnent le processus de guerre de libération. La révolution péruvienne se base sur la thèse maoïste de l’encerclement des villes depuis la campagne et de la création des bases d’appui. La stratégie initiale politico-militaire du Partido Comunista del Peru reprend en grande partie celle élaborée par Mao ; il s'agit d'encercler les villes et la capitale Lima, depuis les zones rurales. La stratégie des « quatre C » [«las cuatro C» : Camino de Cercar las Ciudades desde el Campo], les chemins de l'encerclement des villes par les campagnes, est présente depuis la création du PCP-SL, du moins depuis sa décision de mener une offensive armée.
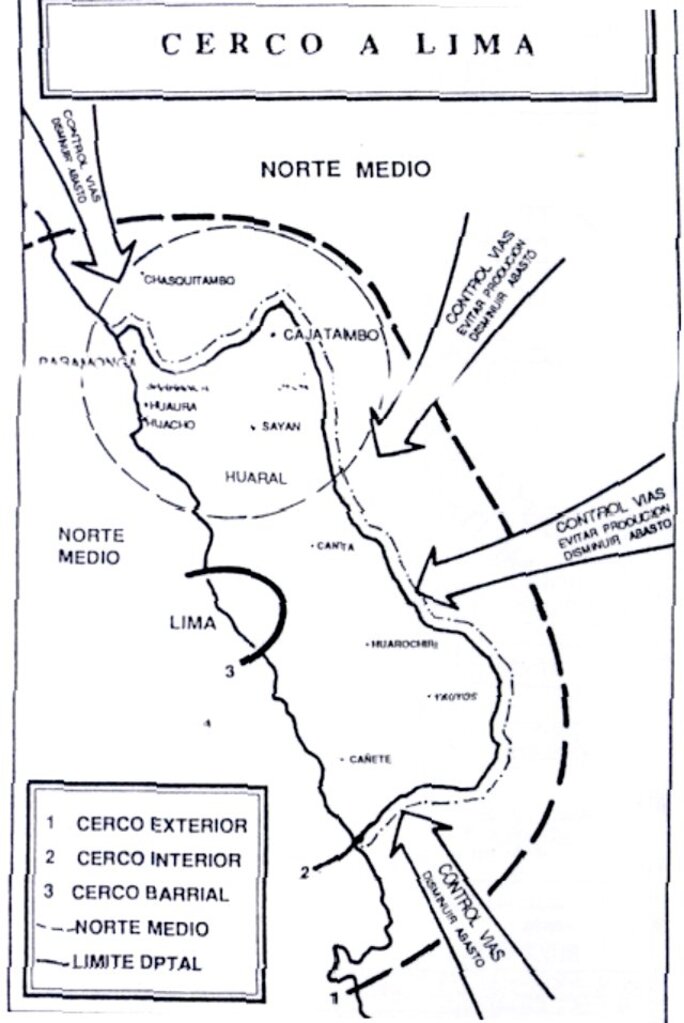
Agrandissement : Illustration 11
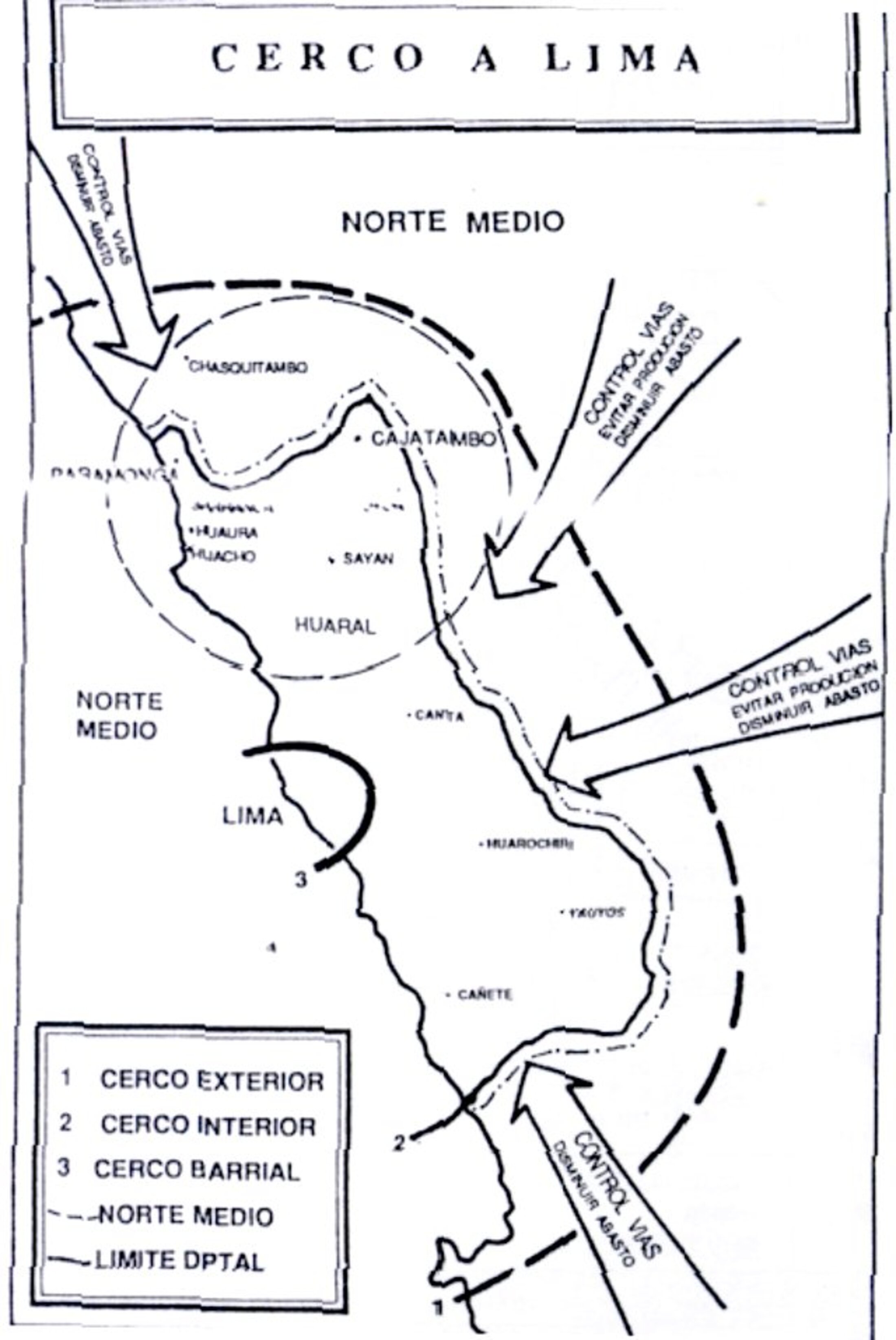
Dès 1980, Abimael Guzmán défendra une autre stratégie, qui paraît logique mais qui fut très critiquée par le Comité du PCP-SL : développer à Lima une activité de guérilla urbaine, des actions de déstabilisation du pouvoir, des partis politiques adverses, des institutions de l'État, des syndicats ouvriers et d'y mener parallèlement des actions, faites par des organisations politiques sympathisantes, des vitrines légales officielles, pour s'assurer de la prise de pouvoir au sein d'organisations citoyennes. C'est-à-dire, d'ouvrir un front de guérilla urbaine ; une tactique utilisée par les nord-vietnamiens contre les colonisateurs français et les occupants américains, ou dans une moindre mesure, par Fidel Castro à Cuba, qui disposait de milices urbaines.
Une stratégie défendue par Abimael Guzmán mais qui sera longuement débattue au sein du PCP-SL, car pour certains des dirigeants, elle s'éloignait, voire s'opposait, aux préceptes militaires élaborés par Mao et, suivant l'exemple cubain, divisait à la fois les forces et les commandements. Qui nous rappelle, par exemple, l'opposition de Che Guevara de mener une guérilla à La Havane, dans les centres urbains, pour au contraire, concentrer les efforts, le matériel et les hommes dans le massif protecteur de la Sierra Maestra. Fidel Castro tergiversera et après l'échec sanglant de la grève générale organisée dans les villes cubaines, privilégiera la guérilla en zone rurale. De même, la guerre révolutionnaire en Uruguay, utilisant exclusivement la guérilla urbaine n'aura été, dans les faits, guère convaincante.
Il faut savoir que lors de la réunion élargie du Comité central tenue du 8 au 24 août 1980, la proposition de Abimael Guzmán – qui n'était pas encore le Presidente Gonzalo - de déplacer le théâtre de guerre de la campagne vers la ville sera fortement critiquée, considérée comme « hoxhista » (Gorriti 1991, Jiménez 2001, Tapia, 1997) ; et lui-même sera accusé de s'écarter du maoïsme. Quoiqu'il en soit, au début des années 1980, les effectifs du PCP-SL à Lima ne permettaient pas l'ouverture d'un second front et d'autres organisations politiques aussi actives occupaient le territoire. Cela étant, plusieurs organismes de lutte et de propagande auront pour mission de faire de Lima, une caisse de résonance du PCP-SL, et un centre actif de recrutement. De multiples organisations - clandestines et légales - seront créées dans les villes, qui varient au cours des années et selon les besoins spécifiques, dans leur composition et leurs objectifs, mais l'accent sera mis sur l'activité subversive à Lima, où la combinaison de la crise économique et l'effondrement des mécanismes traditionnels de médiation État-société sont les plus marquants ; une capitale qui concentre l'ensemble des institutions de l'État, de l'armée, des sièges sociaux, des grandes entreprises nationales et internationales et du monde de la finance. Un contexte dans lequel le PCP-SL, le Mouvement révolutionnaire MRTA - et les forces de sécurité - exerceront leurs actions organisationnelles et opérationnelles, en particulier après 1988.
1988 : L'« équilibre stratégique », « equilibrio estratégico »
Puis de nouvelles configurations seront à l'origine d'un changement radical de tactique, notamment le déplacement forcé de populations rurales pauvres à Lima, s'entassant dans les barriadas, une économie nationale défaillante plongeant le pays dans la récession, le chômage de masse, la pauvreté et un taux de corruption augmentant au même titre que l'hyperinflation. Entre la fin de 1989 et la première moitié de 1992, Lima devint le principal théâtre d'actions subversives, en particulier du PCP-SL, par une fréquence plus importante, une variété d'actions subversives et d'attaques, et la consolidation d'une présence significative dans les secteurs populaires.
Pour certains historiens, la proclamation de “l'équilibre stratégique” par Abimael Guzmán – devenu le guide incontesté - représentait une sorte de fuite en avant. Car en effet, dans les zones rurales, les senderistas devaient faire face à la recrudescence des Comités de Autodefensa et rondas campesinas contrasubversivas, des milices paysannes, et nous l'avons évoqué, à la stratégie des forces armées de favoriser leur création, d'augmenter le niveau de répression mais aussi de gagner l'adhésion de la population par la distribution de terrains ou de vivres. Les territoires libérés par les senderistas se réduisaient, leur capacité de mobilité – un des points les plus importants – sera fortement affaiblie par l'action des rondas campesinas contrasubversivas. Face à ces nouvelles conditions peu favorables ou dangereuses, la réponse de Guzmán sera d'intensifier les actions armées dans la ville, d'ouvrir un nouveau front urbain et d'y accélérer la mise en place ou le développement d'organismes pré-insurrectionnels, clandestins et de « façade » [organismos de fachada].
Ainsi, Abimael Guzmán annonça dans l'«Interview du siècle » [Entrevista del siglo, El Diario, 1988 (journal des sentiéristes)], une nouvelle tactique dans le cadre d'un ré-équilibre stratégique entre les zones de combats. Le but, en bref, est de passer à une phase d'offensive stratégique pour la prise du pouvoir. Alors que les actions du PCP-SL avaient été concentrées dans les zones rurales du pays pendant une bonne partie des années 1980, vers la fin de cette décennie, l'organisation maoïste fait un changement de stratégie, en intégrant les villes, principalement Lima comme un « complément » à sa guerre rurale. Selon les documents du PCP-SL, la «guerre populaire prolongée» dans les campagnes était à ce point développé qu'il était temps, à présent, de préparer le terrain à l'insurrection urbaine, en vue de l'offensive finale. L'élément clé est de contrôler la «ceinture de fer» qui abrite presque la moitié de sa population : de fait, ce n'était pas le guérilla rurale qui devait encercler la ville, mais bien laceinture de misère formée par les barriacas, qui semblait être la cristallisation du siège de la ville. « Lima et les pueblos jóvenes constituent la scène sur laquelle aura lieu la bataille finale de la guerre populaire » affirme Abimael Guzmán [El Diario]. Dans l'Entrevista del siglo, Abimael Guzmán précise la stratégie qu'il convenait d'adopter :
La guerre populaire est universellement applicable, selon le caractère de la révolution, et est spécifique à chaque pays, ne peut se faire autrement. Dans notre cas, les spécificités sont très claires. C'est une lutte que se livre la campagne et la ville, qui a été établie en 1968, dans le schéma de la guerre. Ici nous avons une différence, une particularité, c'est le terrain et la ville. Nous pensons que nous devons faire avec ces situations spécifiques. En Amérique latine par exemple, les villes sont proportionnellement plus importantes que celles des autres continents. C'est une réalité en Amérique latine qui ne peut pas être ignorée, juste d'apprécier la capitale du Pérou qui a un pourcentage élevé de la population.
Le nouveau facteur démographique, sera pour Abimael Guzmán, un facteur stratégique :
Nous pensons que notre action dans les villes est essentielle et doit être encouragée de plus en plus parce que le prolétariat y est concentré et nous ne pouvons pas le laisser aux mains des révisionnistes et des opportunistes. Dans les villes existent les bidonvilles, une masse immense. Nous autres, en 1976, avions adopté une ligne directrice pour le travail dans les villes. Prendre les barrios et les quartiers comme bases et le prolétariat en tant que leader, c'est notre politique et la pratique va se poursuivre, maintenant, en termes de force populaires ... visent clairement à ce que la masse est. Il découle clairement de qui précède que les masses des quartiers et des bidonvilles sont comme des ceintures de fer vont piéger l'ennemi et qui conservent les forces réactionnaires.
L'« équilibre stratégique » correspond à une offensive qui doit également combattre l'hégémonie de la Gauche dans les circonscriptions et à «démasquer » la futilité du réformisme ou celui d'un changement social pacifique ; commence ainsi une confrontation frontale avec la gauche légale dans les districts : des campagnes de propagande de discrédit des dirigeants, des élus, des organisations sociales, menaçant et parfois éliminant des personnes opposées à la « guerre du peuple ». En radicalisant et en exacerbant les conflits sociaux dans les quartiers, les usines, les universités, le PCP-SL espérait provoquer une cruelle répression militaire, qui devait forcer le peuple à prendre position, à s'engager davantage dans la guerre.
TACTIQUES SUBVERSIVES
L'objectif final de toute guerre révolutionnaire est la prise de la capitale où se concentre l'ensemble des institutions de l'État, le centre des pouvoirs exécutifs, le centre névralgique de l'économie. La stratégie du PCP-SL concernant Lima, présente une logique de confrontation ouverte avec l'État, dont les actions doivent contribuer – dans le cadre plus général de la lutte armée nationale - à éroder et saper l'ordre ancien, à démontrer la faiblesse et l'impuissance de l'État, à désigner les injustices sociales comme une conséquence de la démocratie capitaliste parlementaire et, dans le cas du Pérou, d'une extraordinaire corruption. Pour cela, le PCP-SL, créera de multiples organismes distincts, chacun ayant une mission et une tache particulière pour effectuer :
la déstabilisation de l'ensemble des institutions de l'Etat, au niveau international, national et local [propagande internationale, boycott des élections (présidentielles ou municipales), élimination de ministres, d'élus politiques, etc.] ;
la déstabilisation de l'économie du pays [appel aux grèves générales, élimination des capitaines d'industrie, sabotage industriel, attentat contre des centres commerciaux, etc.] ; il est à noter que l'économie péruvienne était en crise depuis 1975, qui sera encore approfondie à partir de 1981 jusqu'au début des années 1990 ; le point culminant étant 1989 ;
la perturbation du fonctionnement des équipements et des services publics [attentat contre les infrastructures de transports (routes et matériel), sabotage du réseau électrique alimentant la ville, etc.] ;
la construction de la nouvelle société dans les zones libérées, ne sera pas un objectif en soi pour Lima, mais les nombreuses organisations de « façade » peuvent être considérées comme des hauts lieux de la subversion.
la propagande internationale, nationale et locale ; cette tâche peut être considérée comme une des plus importantes à Lima.
Propagande
En 1982/83, la guérilla menée par le PCP-SL n'occupe pas encore une place importante dans le paysage politique et médiatique du Pérou ; les actions en zone rurale pourtant nombreuses n'obtiennent guère d'écho dans la presse nationale et internationale ou sont inévitablement déformées par la censure du gouvernement. À l'inverse, les actions urbaines menées à Lima ont une répercussion et un impact national et international considérable.
Dès lors, et pour toute la durée de la guerre, le Comité Metropolitano aura pour objectif de faire de la capitale une "caisse de résonance du Parti" [caja de resonancia del Partido], «le tambour» [«el tambor»], en tenant compte du fait que toute action à Lima, même minime, a un impact national et international. Lima, sera le support privilégié de la propagande symbolique destinée à démontrer au Peuple, au monde, le degré d'organisation des révolutionnaires, leur volonté inébranlable et leur foi en la victoire finale.
La propagande par le fait est érigée comme la meilleure tactique pour capter de nouveaux militants et détourner les masses populaires des partis politiques traditionnels. Les actions symboliques – dont l'objectif est purement communicationnel - du PCP-SL et du MRTA seront nombreuses à Lima : les "feux de joie" allumés sur les collines représentant le marteau et la faucille visibles de toute la ville, la prise de stations de radio et la diffusion de messages et proclamations subversives – comme par exemple, celle de Radio Comas, le 8 le Octobre 1984, par un groupe du MRTA, célébrant le 17e anniversaire de la mort d'Ernesto «Che» Guevara –, l'enlèvement de personnalité avec pour rançon la diffusion de messages subversifs à la télévision, la destruction de pylônes privant les quartiers d'électricité [suivie généralement d'une série d'attaques contre des banques et des locaux d'entreprises privées ou bien lors de la venue du pape Jean-Paul II (1985)], la destruction de tours de communication, des actions massives commémoratives lors de date anniversaire [de révolution (Pérou, Chine, etc.), mort de héros historiques révolutionnaires, etc.], les parades armées dans les rues [plutôt en province], etc., participaient à entretenir l'espoir et mobiliser les militants.
Les opérations
La tactique élaborée par le PCP-SL se divise en trois grandes catégories basée sur les acteurs en présence – pauvre et classe ouvrière / bourgeoisie / forces policière et militaire :
générer une situation de confrontation permanente et radicale, entre l'Etat et les populations pauvres et ouvrières ;
terroriser les populations bourgeoises, la classe politique, et plus largement, les organisations, les entreprises internationales ;
harceler les forces de police et militaire par des opérations de guérilla urbaine – frapper et disparaître, sans chercher à engager le combat.
1. Terrorisme anti-bourgeois
Le PCP considère que le dialogue et les négociations du conflit armé, correspondent à une stratégie contre-révolutionnaire dessinée par l’impérialisme lui-même et dont le but est de fragiliser et mettre en déroute les forces qui luttent pour la libération. Le PCP rejette tout type de négociation relative à la conquête du pouvoir pour la classe ouvrière et la paysannerie : le pouvoir ne se négocie pas, et si l’ennemi veut négocier, il doit d’abord se rendre.
Ainsi, le PCP-SL ne sera jamais disposé à un quelconque dialogue, à la recherche d'un compromis politique, à des négociations avec les classes dirigeantes, libérale, progressiste ou socialiste. L'unique relation entre le PCP-SL et les classes dominantes du pays et étrangères a été la violence et le seul objectif, la terreur. Terroriser les classes dirigeante, bourgeoise et moyenne réactionnaire pour les intimider, les contraindre à s'isoler, à s'exiler, et au silence. Nombre de personnalités du monde libéral – dont le romancier et homme politique ultra-libéral Mario Vargas Llosa, et l'économiste Hernando de Soto – s'exileront tandis que d'autres choisiront un silence prudent, sous la menace constante d'une exécution. Notons qu'il en fut de même pour les intellectuels de la gauche qui sous la présidence de Fujimori seront menacés, intimidés, ou assassinés par les forces paramilitaires.
Le centre historique de Lima est le centre du pouvoir du pays, une cible de choix pour les attaques contre les institutions, les sièges d'entreprises privées, les délégations internationales, des ambassades, des banques, les centres commerciaux – la grande majorité pauvre de Lima n'y avait pas accès –, etc , et les quartiers résidentiels bourgeois seront considérés comme des espaces ennemis qu'il convenait de terroriser par notamment des attentats à la voiture piégée. Ces quartiers seront la cible principale à partir de 1989 où l'on y enregistre environ 70 % des attentats commis dans Lima.
2. Harceler les forces armées
Un des principaux objectifs du PCP-SL sera de sécuriser au mieux, et dans la mesure du possible, interdire ou rendre difficile – selon les cas - l'accès des barriadas aux forces de police, sinon par des raids massifs. Car en effet, la plupart des barriadas de Lima, véritables jungles urbaines, étaient aussi sous-équipés en routes, réseau d'eaux potable et usée, écoles, dispensaires, éclairage public, électricité, etc., qu'en postes de police et commissariats de quartier. Avant même la guerre civile, la présence des forces de police dans ces districts était pratiquement inexistante. Les patrouilles de police dans ces labyrinthes étaient rares, effectuées uniquement en journée, et la corruption permettait aux trafiquants de toute sorte un commerce florissant et protégé.
Le PCP-SL renforça encore davantage la séparation en éliminant les policiers isolés qui tentaient de patrouiller et par l'attaque des postes de police, situés le plus souvent à leur périphérie ; de même par l'élimination des délateurs et des traîtres susceptibles de fournir des informations à la police. Dans le quartier Canto Grande, les deux postes de police seront mitraillés ou dynamités plusieurs fois, les contraignant à fermer. De cette manière, les membres du PCP-SL pouvaient sans être véritablement inquiété, dans ce quartier, se déplacer librement, tenir conseil, distribuer des tracts, visiter des marchés, etc.. La police était alors contrainte pour pénétrer dans ce quartier, d'organiser des raids de jour – au petit matin, généralement -, comprenant plusieurs dizaines de policiers.
3. Engager la confrontation
La logique de toute guerre révolutionnaire devant libérer un pays du capitalisme est de se concilier l'appui des masses populaires, sans qui, rien ne peut être sérieusement envisageable. À partir du moment où le PCP-SL refusa toute négociation avec les classes bourgeoises dirigeantes, toute compromission avec les partis politique de la Gauche, les seuls appuis seront, dans un premier temps, la paysannerie pauvre des villages des Andes, les jeunes étudiants issus de cette catégorie et celle des villes de province qui, force de racisme, ne pouvaient socialement s'élever, voire même travailler dans des emplois correspondant à leur niveau de qualification. De plus, la crise économique renforçait les mécanismes du racisme à leur égard.
A Lima, le PCP-SL, nous l'avons évoqué, pouvait bénéficier d'une masse populaire pauvre considérable et d'une autre masse contestataire [chômeurs, étudiants, ouvriers exploités, exilés, etc.] tout aussi importante. Dans ses documents, le PCP-SL indique que dans la perspective historique du « Plan de conquistar bases » [Plan pour conquérir des bases], initiée en 1980, l'importance des « Organismos autogenerados », des organismes devant faire le lien entre le parti et les masses, au sein des syndicats, fédérations, associations, des soupes et cantines populaires, des comités de quartiers et des universités, etc. Une population urbaine à capter, décomposée selon trois entités :
- les étudiants ;
- les ouvriers ;
- les habitants des barriadas.
Le rapport rédigé en 1990 par Gordon H. McCormick pour le Département d'Etat, bureau du secrétaire à la Défense des Etats-Unis [publié en mars 1990 dans le Rand Publications Séries, sous le numéro R-3781-DOS/OSD], nous donne de précieuses indications :
«En 1985, Lima s'est étendue jusqu'à regrouper six des vingt millions d'habitants du pays. On estime que deux millions d'entre eux vivent dans les pueblos jovenes. Lorsque les populations de la campagne émigrent vers les villes, l'appareil local du Sendero Luminoso les accompagne. Sans perspectives d'emploi, aux prises avec une discrimination raciale importante et séparés de leur structure traditionnelle de vie villageoise, les nouveaux arrivants issus de la paysannerie ont souvent été plus faciles à recruter qu'ils ne l'auraient été chez eux. (...) La stratégie urbaine du mouvement a mis un accent nouveau sur des opérations politiques ouvertes ou à peine camouflées. Outre l'établissement d'un ensemble d'organisations de front, le PCP-SL semble avoir commencé un effort systématique pour pénétrer et radicaliser le mouvement ouvrier péruvien, les groupes étudiants existants et un éventail d'associations de quartier et communautaires. Dans le passé, Sendero avait vilipendé ces organisations pour leurs tendances «réformistes», «révisionnistes» ou «opportunistes». Elles étaient réputées être au service de la «gauche (légale) infantile». Aujourd'hui, par contre, Sendero appelle les masses «à développer la lutte pour les réformes comme une partie de la lutte pour la conquête du pouvoir». Le PCP-SL, ses cadres et ses sympathisants sont devenus un élément de base des grèves, des manifestations et des protestations, qui les auraient fait hurler, il y a quelques années seulement».
La tactique du PCP-SL sera, dans un premier temps, de créer de nouvelles structures, et d'investir l'ensemble des organismes et des institutions populaires : les syndicats d'ouvriers, les associations locales d'entraide et les comités d'habitants, les organisations « de survie » au sein des quartiers pauvres ; ainsi que les syndicats d'étudiants même si le PCP-SL disposait de sa propre structure ; des syndicats ouvriers, de fonctionnaires, d'employés municipaux, de professions libérales, des syndicats et associations d'étudiants, de quartier qui étaient déjà engagés dans de nombreuses luttes contre la crise économique du pays et de ses conséquences ; les grèves, les manifestations, et surtout à Lima, se succèderont tout au long des années 1980 / 1990, conduites ou non par le PCP-SL ou le MRTA.
La logique de la grève armée
Les «grèves armées» [paros armados] faisaient partie d'une logique d'intimidation et d'orchestration d'actions, avec le but de provoquer l'effondrement de l'Etat par une violence généralisée. Ces grèves armés naissent et se développent à Lima dans la phase de « l'équilibre stratégique » ; elles s'inscrivent dans le cadre de campagnes subversives planifiées, à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou du pays, et consistent à organiser et synchroniser un même jour, ou plusieurs jours, une série d'actions qui comprenait les différentes tactiques de la subversion : agitation dans les rues, propagande, sabotage, attentat, action armée, etc., avec un objectif politique clair :" isoler et affaiblir l'État et démontrer son impuissance". Par la suite, le PCP-SL invitera ou exigera d'autres formations ou organisations – voire la population - leur participation, par des actions solidaires : manifestation, grève, débrayage, etc.
La première «grève armée» à Lima, eut lieu le 19 Janvier 1989, organisée dans le but de rivaliser avec le parti de gauche Izquierda Unida. Les appels à la «grève armée» coïncident souvent avec des dates symboliques. Leur plus haut développement et la plus grande fréquence se situent entre novembre 1991 et février 1992. Après l'arrestation des leaders du PCP-SL, les grèves armées déclinent et, moins violentes, sont organisées avec concertation avec d'autres mouvements dans un esprit de conciliation et de dialogue. L'ultime grève armée d'envergure, semble être celle du 17 et 18 mai 1994.
LES UNIVERSITES
La prolifération des groupes radicaux au sein des universités entre les années soixante-dix et quatre-vingt s'explique, en premier lieu, par la dictature et son contrôle, par l'augmentation du nombre d'étudiants, de leur lutte contre les projets de loi de réduction des dépenses publiques d'éducation et contre le racisme.

Agrandissement : Illustration 12

Les étudiants seront la cible privilégiée pour le recrutement du PCP-SL et du MRTA. Avant les années 1980, il y avait une forte activité clandestine du PCP-SL dans les syndicats d'étudiants des universités du Pérou. À Lima, seront ciblées deux universités publiques, à San Marcos, La Cantuta et l'UNI, à proximité d'un bidonville. Cela étant, à Lima, les mouvements contestataires ne manquaient pas et la concurrence y était rude ; et de fait, de nombreuses jeunes recrues provenaient de collectifs anti-fascistes [Pukallacta] et des mouvements féministes ; elles occuperont d'ailleurs, au sein de la direction du PCP-SL et des commandos armés, une place aussi importante que les hommes. Des nouveaux militants/étudiants, devant assurer la propagande et par la suite, rejoindre les détachements militaires. Les étudiants offrent leur savoir à la révolution selon leurs compétences ; ceux de chimie, par exemple, fabriquent les bombes explosives, les littéraires assurent la rédaction des articles des journaux ou des tracts, les architectes assurent la planque du matériel, etc. Une des principales activités sera également d'assurer des cours dans les écoles des barriadas ; de plus, pour les adolescents de famille pauvre, les délinquants, des écoles techniques les forment à un métier dans les propres associations de "façade" créées par le PCP-SL. Cette activité d'aide peut également être un moyen pour infiltrer les barriadas et servir de centre de propagande et de recrutement. À Cantuta, les étudiants enrôlés sont entraînés à des tâches militaires, et l'université sera pendant un temps une cache d'armes et d'explosifs, de fabrication de tracts : une grave erreur qui permet à la police le démantèlement de réseaux.

Agrandissement : Illustration 13


Agrandissement : Illustration 14

Les universités seront considérées par les forces contre-insurrectionnelles comme des citadelles de la subversion, des nids de terroristes et feront l'objet d'une surveillance acharnée, de perquisition policière, de raids massifs ; la police n'hésitait guère à faire disparaître professeurs et étudiants par trop suspects. Depuis la fin des années 1980 et surtout après le coup d'État du 5 avril 1992, le « FujiChoc », une centaine d'étudiants et d'enseignants seront exécutés par des groupes paramilitaires. A Lima, l'exécution de neuf étudiants et d'un professeur à la Cantuta marque les dérives militaire et policière comme étant une preuve de la responsabilité du politique dans les violations des droits de l'Homme.
LE MONDE OUVRIER et SYNDICAL
Plusieurs phases délimitent les différentes stratégies adoptées par le PCP-SL concernant le monde ouvrier urbain et les syndicats. Avant le déclenchement de la révolution, en 1980, le principal objectif est, bien sûr, de faire connaître le PCP-SL – mouvement contestataire parmi tant d'autres – et de recruter de nouveaux militants/ouvriers. Pour cela, un organisme est créé par le PCP-SL en 1976, le Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas(MOTC), responsable du recrutement des ouvriers et de la conception des actions. Les premières actions sont la distribution de tracts à la sortie des usines.
Dans la seconde phase, à partir de 1983, le PCP-SL, dans le cadre de la réorganisation du parti, adopte une stratégie plus ambitieuse et se dote d'un nouvel organisme : le Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP).
La troisième phase, à partir de 1987, qui correspond à l'extension des zones de guérillas rurales, la stratégie du PCP-SL prend un virage plus offensif dont l'objectif est simple : prendre la direction des syndicats ; qui consiste dans un premier temps à s'infiltrer et à dénigrer les dirigeants, et notamment ceux de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en les accusant d'être des collaborateurs, des conciliateurs réformistes au service du gouvernement et du capitalisme, tout en cherchant à capturer de nouveaux militants ; puis, de proposer de nouvelles revendications, plus radicales, par un travail quotidien de propagande : distribution de tracts, discours à la sortie des usines, etc., exigeant une remise en cause de l'ensemble des accords signés entre les syndicats historiques et le patronat. Le succès de cette entreprise est très variable mais la nouvelle génération d'immigrants ruraux y sera sensible car la crise économique à cette période est particulièrement éprouvante : le chômage s'amplifie, les licenciements nombreux qui affectent l'ensemble des industries, de Nissan à Bata. Le PCP-SL privilégiera ainsi la confrontation directe, les manifestations, les grèves, les grèves générales illimitées, et tentera de radicaliser les mouvements de grève des syndicats. Le but était d'utiliser les syndicats comme des «pourvoyeurs» de la «guerre du peuple».
En avril 1988, le PCP-SL créé une « façade » - légale - syndicale, le Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC). En parallèle, le PCP-SL, infiltre massivement les syndicats des usines Nylon, FAM, Atlas, COPE, Tabacalera Nacional, Bata, Tejidos La Unión y Pelikán ; et tente de gagner la direction en alliance avec des groupes radicaux qui préconisent la grève générale. Dans ce contexte, le Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP) lancera à de très nombreuses reprises des appels à la grève générale illimitée, à des manifestations de masse et à la grève armée ; qui seront le plus généralement suivies par plusieurs syndicats mais sans jamais atteindre un grand nombre la population. Puis, par la suite, comme en Italie quelques années plus tôt, des opérations de sabotage sont organisées, destinées à arrêter la production d'une usine ; des contremaîtres sont menacés ou punis, des dirigeants d'entreprises et de syndicats sont intimidés ou assassinés.
Bilan
D'une manière générale, certains syndicats adopteront et seront sous l'influence directe du PCP-SL, par force ou par conviction ; tandis que d'autres s'en détourneront, préférant la conciliation plutôt que la confrontation, et la violence. De même pour les ouvriers qui élisent leurs représentants syndicaux. Le style autoritaire et conflictuel des CLOTCC, l'élimination physique de dirigeants syndicaux, ne lui assurent aucune victoire significative lors des élections. Par exemple, l'assassinat par le PCP-SL, le 31 octobre 1989, de Enrique Linares Castilla, leader de l'Union des travailleurs de l'usine de textiles L'Union, membre du PUM [Parti de la Gauche], opposé à la grève armée, ne sera guère apprécié par les syndicalistes et les ouvriers. Pire encore, l'élimination physique des dirigeants de cette usine, en juin 1991, finira de discréditer le PCP-SL, mettant ainsi en évidence la divergence totale entre les intérêts des syndicats et ceux du PCP-SL dans la zone Est de Lima.
Le résultat final semble avoir été la destruction du mouvement syndical, du tissu le plus contestataire et non-violent, par l'élimination des syndicalistes les plus actifs, sans avoir satisfait pour autant les revendications des ouvriers.
LES BARRIADAS
C'est à propos des actions du PSP-SL dans les bidonvilles que s'exprime au mieux la presse et les auteurs de la pensée bourgeoise et réactionnaire, qui insistent sur le fait que le développement exponentiel des bidonvilles de Lima est la conséquence directe de la guérilla rurale qui entraîna l'exode des populations – fuyant les sévices des révolutionnaires - vers la capitale... Oubliant intentionnellement les actions anti-subversives des forces armées concernant le massacre de population, son attitude soupçonneuse envers les jeunes des villes de province, et les déplacements forcés d'habitants de villages entiers vers les camps de réfugiés des villes ou les bidonvilles de Lima. Au-delà, des études démontrent également une migration accrue de jeunes ruraux désirant abandonner la – rude - vie paysanne pour intégrer les études universitaires – une des seules chances de réussite sociale au Pérou - ou pour simplement vivre en ville. On peut noter que la migration des populations rurales vers la capitale qui avait débuté bien avant la guerre, continuera même après la fin de la guerre.
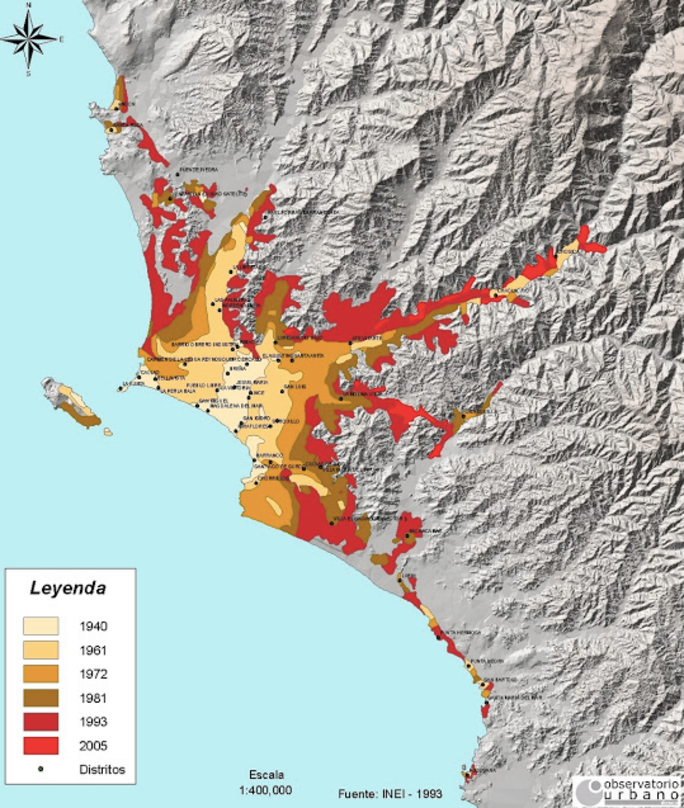
Agrandissement : Illustration 15
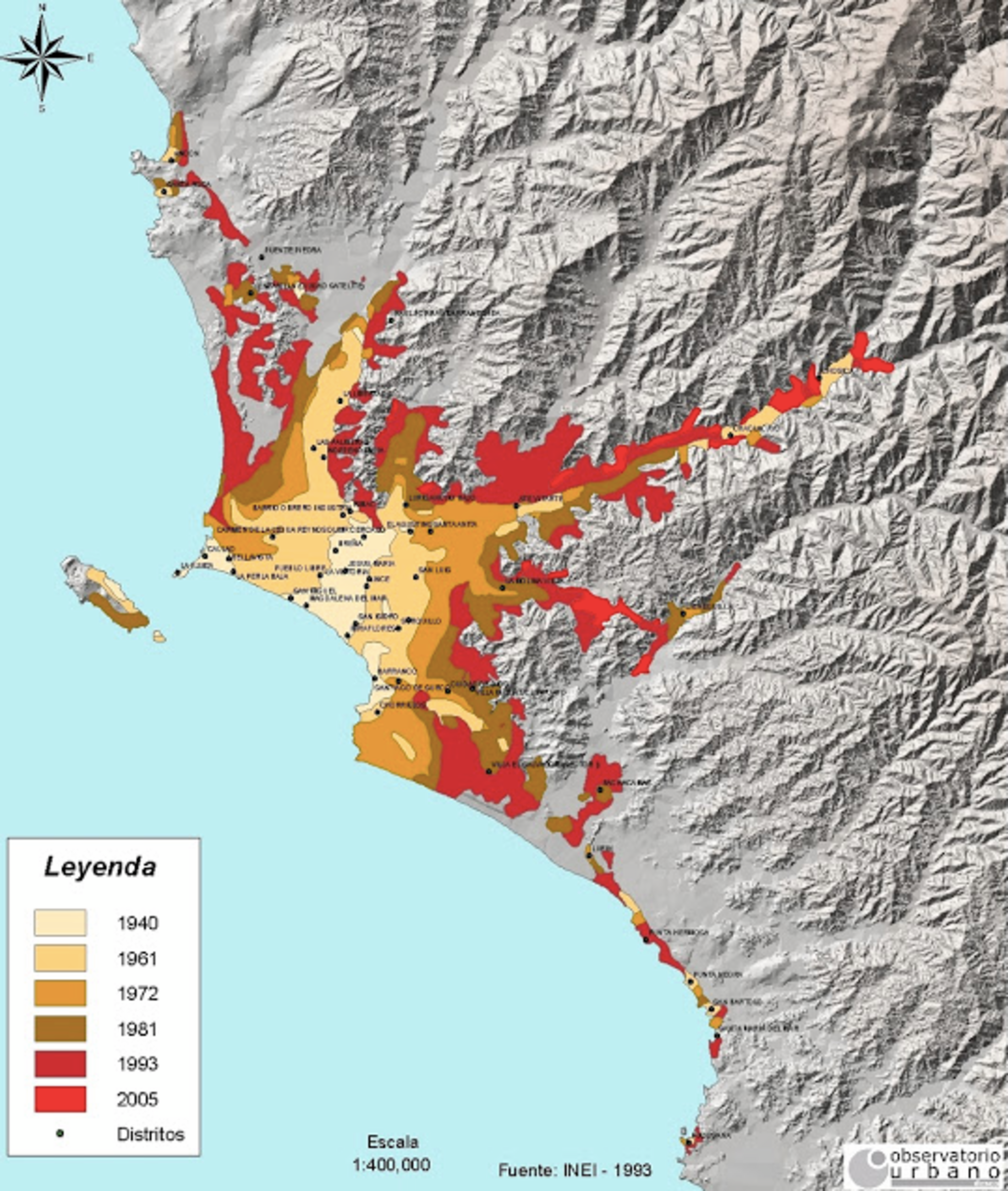
Rappelons ce chiffre : en 1981 – c'est-à-dire peu après le commencement de la guerre - le recensement de la population de Lima estime à environ 1,200,000 de personnes survivant dans les barriadas [ce terme englobe les Pueblos jóvenes et Asentamientos humanos] sur une population de 4,600,000 habitants.
Il n'y a pas de barriadas type : les plus anciens, proches du centre ville et des zones industrielles sont constitués de baraques consolidées enchevêtrées à des maisons ouvrières plus confortables, un chaos y règne mais le plus souvent, les habitants disposent de l'eau courante, de l'électricité voire des égouts. Les habitants ont le plus souvent un titre de propriété et bénéficient du droit de vote. Ce qui n'est pas le cas pour les plus récents, au contraire, qui ne disposent d'aucune infrastructure. L'invasion est une occupation illégale de terrains – public ou privés -, faite par plusieurs centaines de personnes, parfois aidées par des organisations ou orchestrées sous l’égide de "professionnels" spécialisés dans l’occupation illégale ; mais, dans certains cas, elle peut être décidée ou autorisée par les autorités municipales, de la Province ou de l'État, voire naître de la volonté du Président. Dans ce cas, les habitants peuvent obtenir rapidement un titre de propriété, être aidés dans leur installation, bénéficier de premiers services sociaux, médicaux [dispensaire sous tente], de survie [camion-citernes d'eau, par exemple] et de transport [une ligne de bus peut modifier son parcours]. De même, le plan général d'organisation spatiale peut être fourni par les urbanistes des services administratifs de la ville ; il consiste à délimiter les quartiers, les îlots, et les espaces réservés à la communauté : routes, places, parc et squares [projetés], décharges, etc. ; le quadrillage est le modèle idéal. Le cas le plus courant, reste cependant l'occupation illégale de terrains... et la venue de la police venant les expulser ; plusieurs invasores trouveront ainsi la mort tout au long des années 1980, lors des interventions policières.
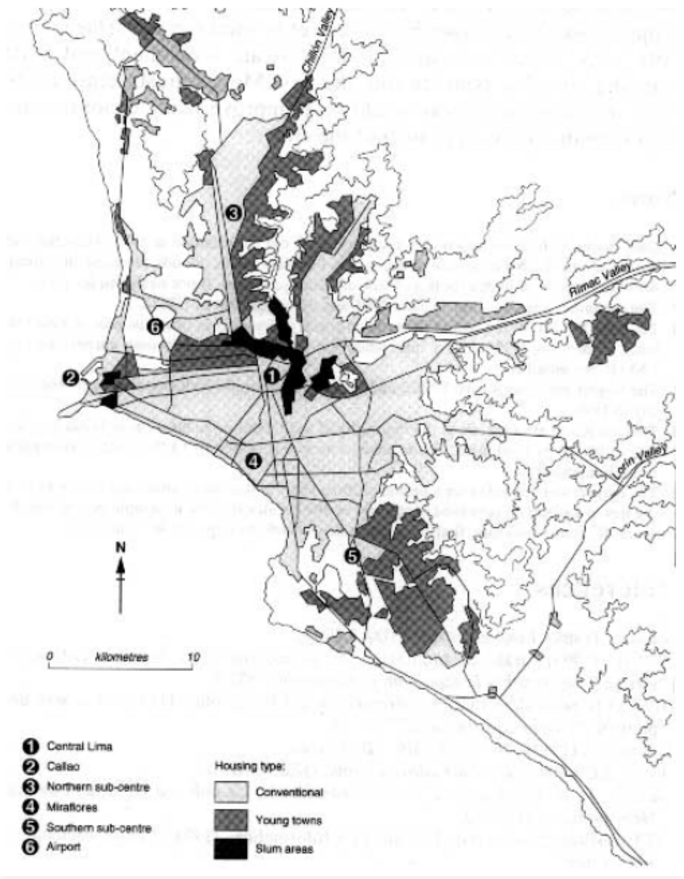
Agrandissement : Illustration 16
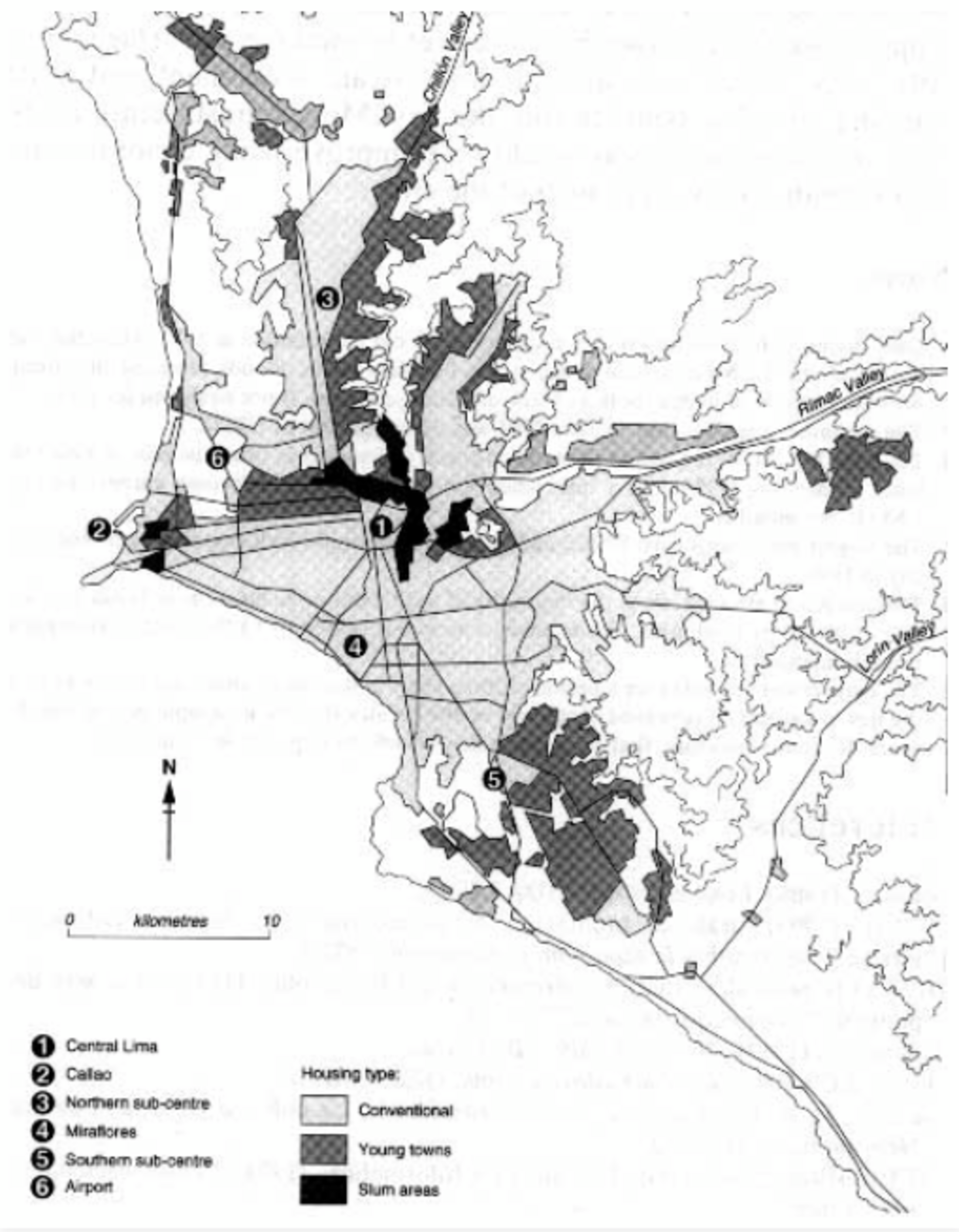
L'économie informelle
Des habitants pauvres qui dans leur grande majorité ne constituent pas – comme généralement dans d'autres pays – la main d'oeuvre de base du secteur industriel ; faute d'une industrialisation conséquente, d'une crise économique chronique et de la volonté – pour certains – d'échapper à une nouvelle domination salariale parfaitement injuste. Cela étant, certains barriadas les plus anciens, ceux situés à proximité des zones industrielles, étaient le refuge d'une population ouvrière que l'on estimait dans les années 1980 à environ 50 %. Les familles y accueillaient des parents venus faire fortune, fuyant les zones de combat ou désirant s'inscrire en université. Les nouveaux arrivants ont souvent pu être accueillis dans des bidonvilles déjà consolidés et obtenir des emplois par l'intermédiaire des parents ou amis qui les ont précédés. Ajoutons à cela que le système scolaire urbain absorbe une partie de plus en plus grande des jeunes ruraux et que la solidarité familiale trouve ici l'occasion de s'exprimer dans l'accueil des écoliers. Il faut savoir que les paysans se représentent l'instruction scolaire comme synonyme de " progrès " et d'ascenseur social. C'est pourquoi l'école constitue une revendication permanente au sein des communautés andines.

Agrandissement : Illustration 17
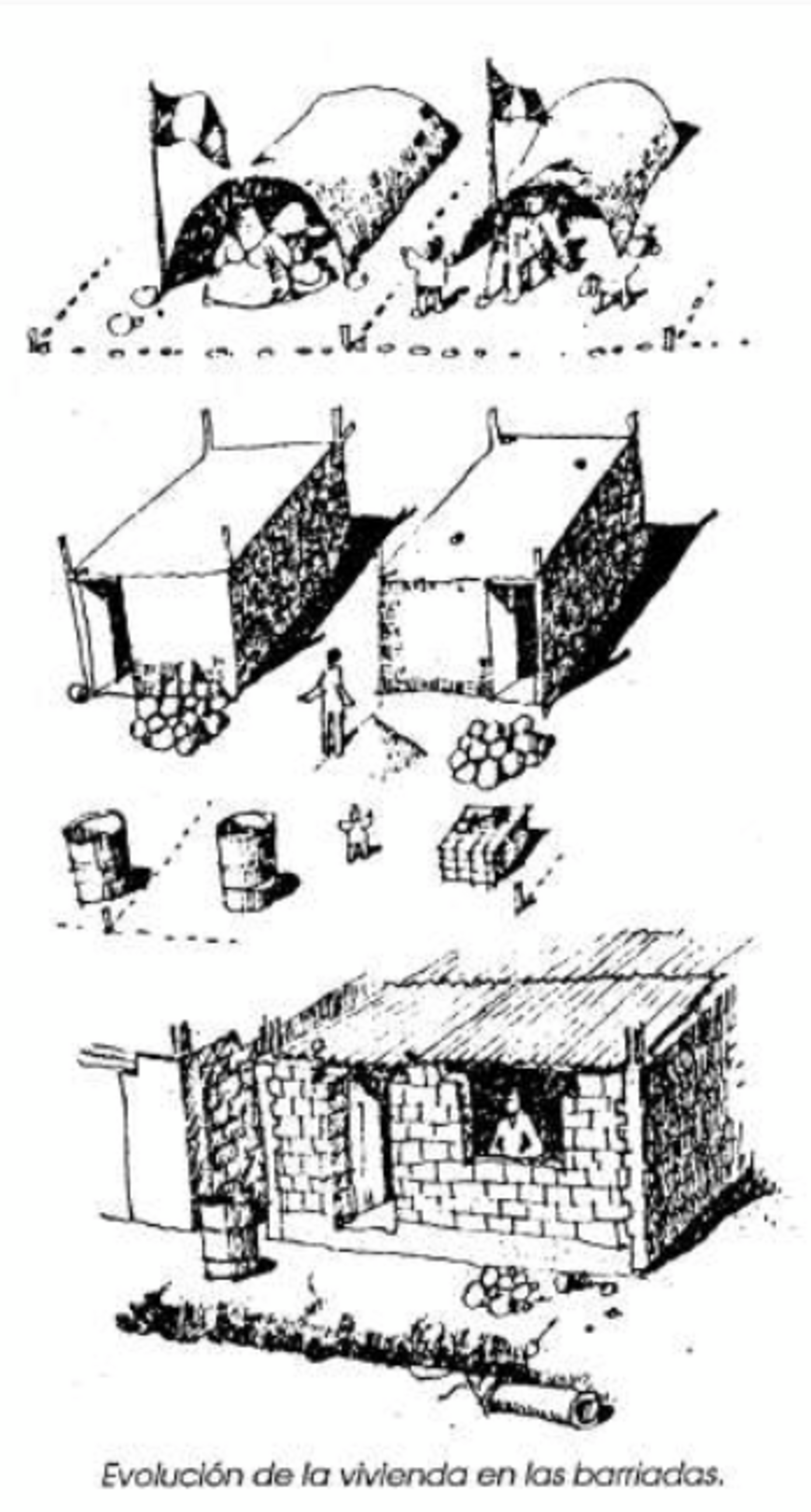
L'économie informelle est la seule solution de survie pour certains ; et pour d'autres une préférence par rapport aux conditions de travail salarié excessivement pénibles et au racisme des employeurs, à l'usine comme dans les bonnes familles bourgeoises. Selon la sociologue Marguerite Bey : "Malgré la précarité de leurs conditions de vie et de travail, dans l'économie informelle, les populations rurales immigrées en ville ne rentrent pas dans un processus de prolétarisation, mais cherchent plutôt à constituer des micro-entreprises individuelles ou familiales. En effet, la seule déficience du secteur industriel ne suffit pas pour expliquer cette détermination. Les motifs de l'exode rural fournissent une première explication : les paysans ne peuvent que rechercher en ville des conditions de vie et de travail qui ne reproduisent pas la domination subie dans les campagnes. De surcroît, la « mentalité paysanne » se caractérise avant tout par un esprit d'indépendance qui la rend peu apte à la prolétarisation. Enfin, les réseaux de solidarité et de clientélisme permettent souvent d'échapper à cette condition en offrant des emplois dans le secteur informel. Les vendeurs ambulants sont les plus nombreux. Dans une même famille (dont la taille moyenne est de cinq ou six personnes), il n'est pas rare de trouver le père occupant un stand de produits manufacturés dans un marché du centre, aidé de l'un de ses fils, le plus jeune vendant sucreries et cigarettes dans les artères commerçantes alentour, tandis que la mère confectionne et vend des plats cuisinés, des boissons ou des pâtisseries avec l'aide de l'une de ses filles, à moins qu'elle n'ait un stand de fruits et légumes dans le bidonville où réside la famille. Ces commerces alimentaires permettent en partie de nourrir la maisonnée à moindres frais, puisque les ingrédients sont achetés à prix de gros."
Luttes Urbaines
Les barriadas plus récents, éloignés du centre comme des zones d'activité, présentaient une population livrée à elle-même. Aucun miracle n'attendait les migrants en ville et l'accueil des populations urbaines fut plutôt hostile. Seule l'initiative des nouveaux arrivants pouvait surmonter des conditions défavorables, en reproduisant les méthodes et pratiques employées en milieu rural : occupation de terrains, édification de quelques logements précaires, défense commune de leur nouveau territoire et organisation des luttes urbaines. Elles seront ainsi nombreuses à Lima ; dans les secteurs pauvres de la capitale, elles engagent les habitants à revendiquer la construction de logements sociaux, à exiger la fourniture de services d'eau et d'égouts, d'électricité, de service des déchets, d'éclairage public, d'équipements publics notamment des écoles pour les enfants et des dispensaires. Des luttes qui consistent à organiser des manifestations, des actions légales auprès des administrations et à interpeller les élus municipaux ; notamment pour les revendications les plus importantes, qui concernent l'autorisation pérenne ou la légalisation d'occupations illégales, la municipalisation de barriadas et l'obtention de titre de propriété.
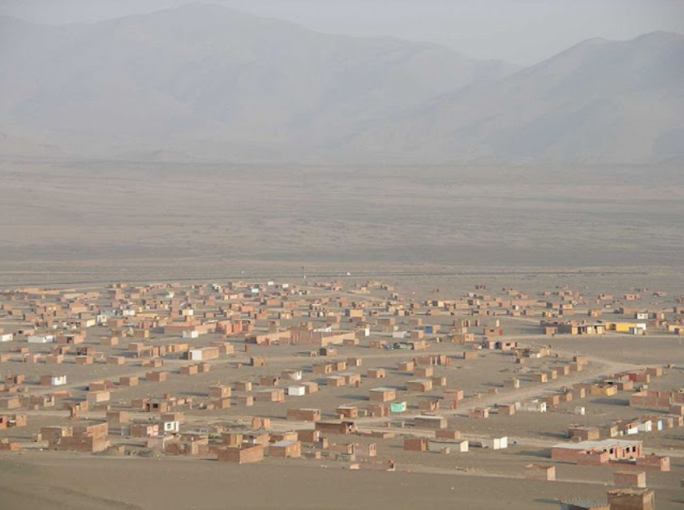
Agrandissement : Illustration 18
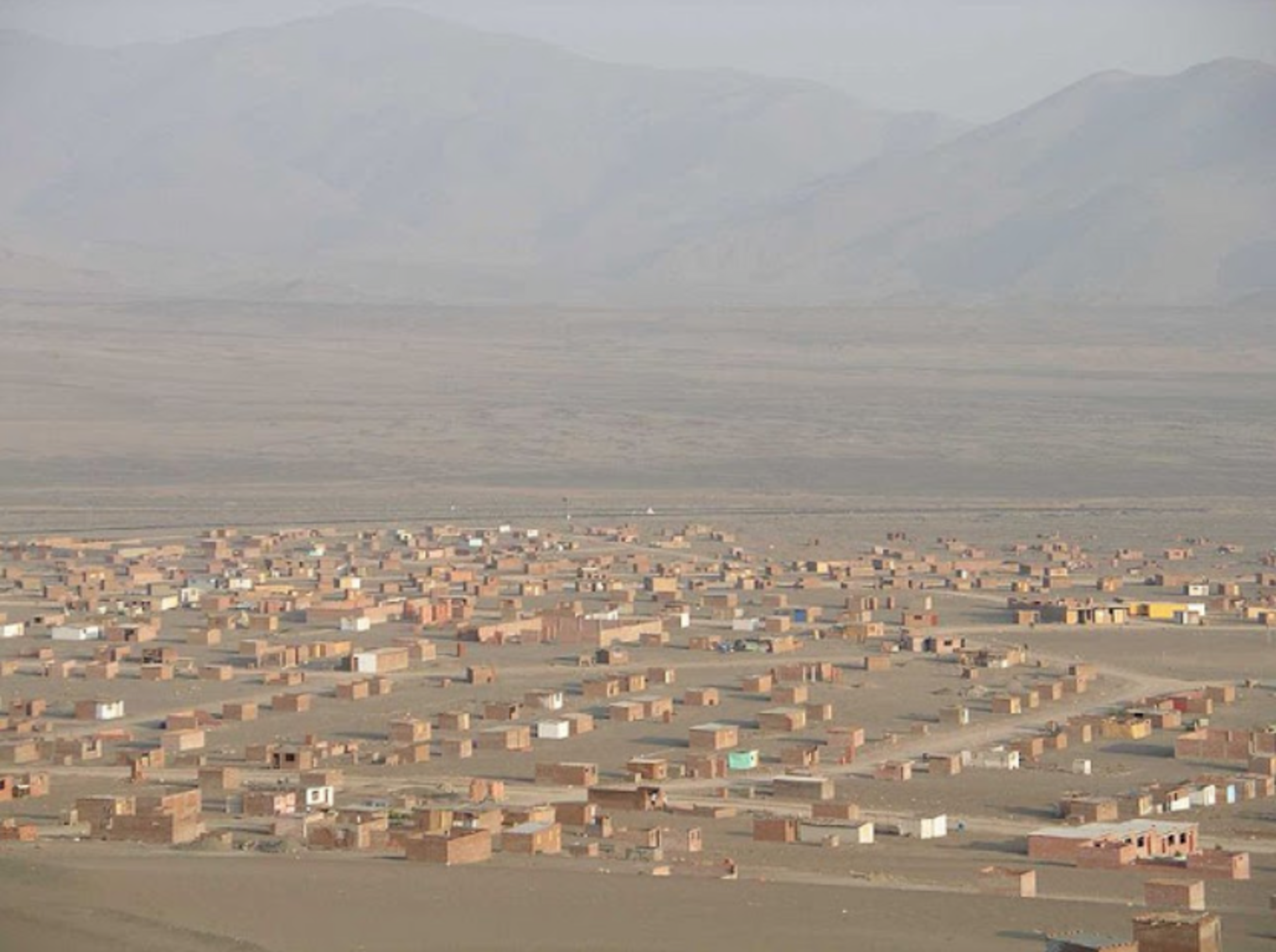
Parmi les nombreuses manifestations de masse, celle d'octobre 1980, engagent plus de dix mille habitants de 10 bidonvilles de San Juan de Lurigancho à défiler devant le Congrès, exigeant une solution immédiate au problème de l'eau et du réseau d'égouts ; celle de février 1981 parvient à réunir 20.000 manifestants sévèrement réprimée par la police, en blessant sept personnes.
Coopérative d'habitation
Les coopératives d'habitation correspondent à une des réponses faites par les gouvernements aux problèmes de l'urbanisme social ; elles s'inscrivent dans l'idéologie ultra-capitaliste de Hernando de Soto – que nous avons évoqué ci-dessus – des concepts urbain et architectural théorisés par l'architecte John Turner, et repris en partie, par la Banque Mondiale ; de même, l'auto-gestion, l'auto-construction, etc., seront les thèmes majeurs des partis politique de gauche.
Selon qu'elles soient issues et financées par le gouvernement, la municipalité, les organisations non gouvernementales, les partis politiques, les entreprises, les syndicats, etc, ou issues de la volonté d'un groupe d'habitants, les coopératives d'habitation prennent différentes formes organisationnelles, et les objectifs peuvent s'opposer. Mais l'idée commune est bien de mutualiser l'effort et les moyens financiers d'habitants, pour la construction de leur habitat et au Pérou, de leur barriada. Au Pérou, elles sont encore, d'une importance capitale et les partis politiques – de droite et de gauche – en font l'une des pierres angulaires de leur système clientéliste ; les coopératives – politisées, c'est-à-dire financées par un parti – sont le plus généralement créées dans le cadre d'une gouvernance – étatique, régionale ou municipale – et bénéficient d'avantages conséquents : octroi d'un titre de propriété, micro-aide financière, aide en nature, etc. Elles sont évidemment les plus recherchées des populations pauvres, mais pour pouvoir y prétendre, il doit s'agir de faire acte d'allégeance [vote, participation manifestation, propagande, etc.]. D'autres coopératives peuvent rassembler une population ayant les mêmes convictions politiques et le parti communiste organisera également ces propres coopératives, et peut obtenir les autorisations nécessaires, quelques avantages par le biais d'accords avec les municipalités dirigées par d'autres partis. De même pour les coopératives soutenues par des organismes religieux. Enfin, un groupe d'habitants peut juridiquement se constituer en coopérative, qui dépendra pour obtenir aides et autorisations, du bon-vouloir du politique.
Une coopérative d'habitation ne s'arrête pas à la construction de maisons mais à la construction de toutes les infrastructures d'un nouveau quartier, et par la suite, à la mise en place, au financement et à la maintenance des services de survie [eau, électricité, santé, etc.]. Le plus généralement, contre l'octroi d'une terre [100 m² en moyenne], l'habitant est obligé de participer à des travaux d'intérêt public : construction de routes, de puits d'eau, de réseaux d'électricité, de toilettes publiques ainsi que des équipements publics [centres communautaires, écoles, cantines populaires, dispensaires, etc.]. Des travaux obligatoires qu'il doit effectuer en plus de son activité professionnelle et dans le meilleur des cas, l'ouvrier bâtisseur peut recevoir un pécule ou, certaines compensations. De même pour les femmes qui doivent effectuer des travaux d'intérêt général [balayage des rues, nettoyage des toilettes publiques, cantines populaires, etc.].
Un système fragile qui repose en grande partie sur non pas l'Etat mais les partis politiques : les coopératives entrent dans le jeu clientéliste de leurs conflits, de leurs accords, de leurs luttes pour leur hégémonie et ce, notamment en période électorale, puis post-électorale. Le changement politique d'une municipalité peut ainsi avoir comme conséquences, pour une coopérative, la diminution drastique des aides accordées au fonctionnement des services, de la distribution de vivres, des tracasseries administratives concernant l'octroi d'un titre de propriété, l'arrêt d'une ligne de transport en commun, etc.
Les barriadas peuvent être ainsi constitués d'une juxtaposition de secteurs dépendant de coopératives d'habitations provenant de divers horizons sur lesquelles s'agrègent d'autres secteurs informels parfaitement illégaux, des invasions non autorisées qui s'implantent pour pouvoir bénéficier des équipements de survie. À partir du milieu des années 1980, l'exode rural provoqué par la guerre, par les déplacements de population imposés par les forces armées , sera à l'origine de la recrudescence des invasions pirates illégales, composées des populations rurales les plus pauvres du Pérou, n'ayant pour la plupart que leur misère à offrir, perturbant considérablement l'équilibre fragile des barriadas constitués de longue date.
Il se passera alors quelque chose de terrible dans la société péruvienne, l'attitude violente – et ce en dehors de toute considération d'ordre politique ou partisane ou idéologique - des premiers habitants des bidonvilles à l'encontre des nouveaux arrivants : les recevant à coup de pierre, attaquant des groupes de migrants à l'aide de gourdins, menant des opérations de destruction de leur campement, volant ce qui était possible de voler, leur interdisant l'accès aux puits d'eau potable... Un témoignage comparait ces migrants à une nuée de sauterelles s'attaquant aux cultures de la communauté et qu'il convenait de les chasser par tous les moyens possibles.
Une situation non véritablement anticipée par le PCP-SL qui escomptait plutôt sur la plus grande solidarité entre les classes les plus pauvres de la société pour la formation d'une armée devant mener la « guerre du Peuple ». Cela étant, ce seront ces derniers migrants, déferlant par vagues successives qui constitueront, dans certains barriadas, leur plus grande force (mais l'inverse est possible dans d'autres cas), comme ce fut le cas à Villa El Salvador.
Tactiques subversives
Le PCP-SL adoptera pour son établissement dans les quartiers pauvres de Lima, les mêmes tactiques que celles utilisées pour les syndicats : prendre la direction des organismes d'aide occupant déjà le territoire, dénigrer ou éliminer les dirigeants et les élus pour mieux chasser les partis politiques adverses, condamner la corruption des fonctionnaires des services municipaux. Ainsi, le PCP-SL semble rivaliser avec la gauche et l'APRA pour le contrôle des secteurs populaires, et utilise des méthodes violentes pour forcer le retrait des groupes politiques. À l'inverse, le PCP-SL organisera de nombreux services devant venir en aide aux populations. La principale occupation concerne l'éducation et de nombreux étudiants ou jeunes diplômés donneront des cours gratuitement au sein d'organisations et dans ses propres structures dans les quartiers pauvres de la ville.
Le PCP-SL, garant de l'ordre social
L'abandon manifeste de l'État pour la ceinture de misère de Lima, concernant la police et la justice, sera l'occasion pour le PCP-SL de se substituer aux obligations d'une démocratie, avec des méthodes redoutables de punitions, d'exécution de criminels, marchands de drogue, voire d'élus et de fonctionnaires corrompus, couvertes par un discours moraliste et vertueux. Nous avons évoqué l'absence de moyens policiers conséquents dans les barriadas et la tactique des senderistas à les chasser. Faute de police, et grâce aux fonctionnaires corrompus, la présence des trafiquants, et notamment de cocaïne, l'importance de la délinquance armée, des gangs racketteurs, plaçaient certaines zones en état d'insécurité permanente. Le PCP-SL, afin de rallier les habitants à leur cause, adoptera, comme dans les zones rurales libérées, des mécanismes de légitimation en tant que garant de l'ordre social. Dans la plupart des cas, le PCP-SL mettra un terme aux activités illégales, chassant des barriadas, trafiquants, gangs, voleurs... Ainsi, par exemple, dans le quartier de l'Huascar, le PCP-SL éliminera deux trafiquants de drogue et bannira une famille de criminels notoires ; ici aussi, dans ce quartier, le PCP-SL était considéré avec la plus grande sympathie par le peuple ; ses militants pouvaient tranquillement aller et venir, discuter et boire quelques bières avec les habitants. De même, le PCP-SL organisera des actions destinées à aider les jeunes drogués et à combattre l'alcoolisme, véritables fléaux.
Les élus et la corruption
Le paysage politique des années 1980 et 1990 est marqué, au Pérou, par le déclin des syndicats et des partis politiques traditionnels. La victoire d’un indépendant à la mairie de Lima en 1989, Ricardo Belmont, puis l’accession à la présidence de la République un an plus tard d’un quasi-inconnu, Alberto Fujimori, [le célèbre romancier et politicien ultra-libéral Mario Vargas Llosa, candidat favori des médias est largement battu : 32 % des suffrages] sont les signes de cette évolution. Les districts populaires de Lima n’échappent pas à ce phénomène : quasiment tous les pueblos jóvenes élisent des candidats indépendants lors des élections municipales de 1993. Les catégories populaires, déçues par la politique de l’APRA (parti d’Alán García, président jusqu’en 1990), lassées de la corruption d’un monde politique qui selon eux ne représente plus leurs intérêts, se tournent vers des hommes de la société civile, éloignés du système politique traditionnel.
Le travail politique de propagande, au sein des barriadas était avant tout, de faire prendre conscience aux habitants, par des discours moralisateur, de la pureté idéologique du PCP-SL, contre la corruption des fonctionnaires et des dirigeants politiques. Car ici, dans ces quartiers, le PCP-SL était confronté aux partis politiques de la gauche, qui y étaient depuis les élections municipales de 1978, bien établis, et de nombreux dirigeants étaient élus dans plusieurs municipalités. Nombre d'entre eux seront contraint à la démission, ou à la soumission par le PCP-SL, qui à partir des années 1990, multipliera les assassinats de maires et d'élus de différentes tendances, ainsi que des leaders de la gauche qui s'opposaient à leurs actions dans les quartiers. Car le PCP-SL n'exigeait pas d'eux de rallier leur camp idéologique, mais plutôt – selon les districts – de l'aider, de ne pas s'opposer à leur présence, d'organiser des actions de solidarité lors des grèves armées ; ce dernier point étant le plus contesté par les élus de la gauche. Les élus municipaux qui refusent forcent l'admiration des populations tant leur vie est en danger, menacée par les groupes révolutionnaires : leur meurtre, pour certains, en feront des martyrs populaires, ou au contraire, leur approbation contre ceux par trop corrompus.
Associations d'aide, ONG
La crise économique des années 1980 a sollicité une fois encore la créativité des populations pauvres. Le pouvoir d'achat a subi des restrictions drastiques, les faillites ne se comptent plus, aggravant le chômage, et l'on observe, dans les bidonvilles, une formidable recrudescence des maladies liées à la sous-alimentation et au manque d'hygiène. Faute d'infrastructures et de réseaux d'eaux potable et usée, le choléra y sévit régulièrement. Dans ces conditions, de nouvelles stratégies apparaissent, dont la base est la collectivité locale.
Le mécontentement des populations pauvres, les risques d'épidémie, faisaient d'une certaine manière, la meilleure propagande possible pour les groupes révolutionnaires et les partis de la Gauche radicale. Les gouvernements ne pouvaient laisser ainsi se dégrader la situation dans cette ceinture de contestation et s'engagèrent à venir en aide aux habitants des plus pauvres quartiers, en distribuant gratuitement de la nourriture, des fournitures pour les enfants et les personnes malades. Étroitement associée à ce phénomène, se développe, entre l’État et les catégories populaires, une forme particulière de relation qui renoue avec la tradition populiste. Les présidents successifs Alán García [1985/1990] et Alberto Fujimori [1990/2000], mettent en place des relations clientélistes avec les quartiers populaires, par l’intermédiaire de programmes sociaux spécifiques. Ainsi, le PAIT (Programme d’aide au revenu temporaire) d’Alán García ou le PRONAA (Programme national d’assistance alimentaire) d’Alberto Fujimori, présentent des caractéristiques qui contribuent à déstructurer l’action collective et la participation politique les districts populaires. En effet, ces programmes sociaux visent à assurer à leur promoteur un soutien populaire et un plus grand contrôle sur les gouvernements locaux (municipios). Le cas du PRONAA est révélateur : ce programme dépend directement du "ministère de la Présidence", sorte de secrétariat personnel d’Alberto Fujimori et deuxième ministère en termes budgétaires après le ministère de l’Economie. Ce ministère permet au chef de l’État d’associer directement son nom à la mise en oeuvre de projets, comme la construction d’écoles ou de routes. Le PRONAA, qui est l’un des nombreux programmes financés par le ministère de la Présidence, gère exclusivement le domaine de l’assistance alimentaire : il s’agit pour Fujimori de contrôler les milliers de « cantines populaires » (comedores populares) apparues dans le pays pendant la décennie 1980 en leur faisant parvenir directement des vivres, contournant les institutions qui faisaient auparavant office d’intermédiaires, et notamment les municipalités. Ces soutiens alimentaires reposent sur une organisation par quartiers, où sont apparues les « cantines populaires » et, à une échelle restreinte au groupe de voisins, les « marmites communes » (ollas comunes), ainsi que des systèmes de « tontines », connus par l'intermédiaire d'organismes d'appui au développement qui ont implanté diverses modalités de crédit. Les pouvoirs publics et les organismes non gouvernementaux valorisent le dynamisme de ces organisations et les utilisent comme des relais de l'action étatique ou internationale.
Une stratégie clientéliste et assistentialiste qui apportent cependant un soulagement aux familles, aussi maigre soit-il, de même que les petits déjeuners servis aux enfants scolarisés. Car ce programme devient rapidement une arme politique pour le chef de l’État, qui l’utilise comme moyen de pression sur les femmes travaillant dans les cantines populaires. Ces dernières sont fortement incitées à se mobiliser en faveur de Fujimori lors de manifestations d’appui au gouvernement ou lors de célébrations comme l’anniversaire du président, ou la distribution de vivres contre les votes.
Ainsi, l'État n'engage aucun programme d'envergure qui puisse les sortir de l'informalité et de la pauvreté ; au contraire même, les aides distribuées seront autant de preuves d'une politique d'assistanat social consistant à gérer la pauvreté plus qu'à la combattre efficacement. Le PCP-SL et le MRTA n'auront de cesse de critiquer cette politique plaçant les habitants en simples assistés sociaux – mendiant, quémandant pour survivre –, les relations clientélaires entre Etat et organismes, la corruption et le détournement d'aide par les fonctionnaires ou les élus ; ainsi que les organisations humanitaires qui de leur côté instauraient de même des relations clientélistes, distribuant parcimonieusement leur aide à qui savait faire allégeance – apolitiques, chrétiens, etc -, tandis que leurs entrepôts – fournis par l'ONU et autres organismes internationaux (Unicef, Caritas International, etc.) - bien gardés regorgeaient de denrées alimentaires et d'équipements de première nécessité.
Le personnel et les responsables des ONG internationales seront priés, par le PCP-SL, de quitter Lima, puis par le gouvernement, dans les régions en guerre. Le PCP-SL s'opposera bien évidemment à l'implantation des organisations de l'État : intimidation des responsables, destruction systématique des locaux, puis à partir de 1988, élimination des responsables et intimidation des populations. Sa stratégie concernant les associations d'entraide locales, les organisations caritatives, est, comme pour les syndicats, de les infiltrer, d'intimider leurs responsables afin de les contrôler ou de les placer sous leur influence. Une stratégie qui évoluera, à partir du milieu des années 1980, vers une radicalisation, par l'élimination des responsables s'opposant sinon à leur idéologie mais à leurs actions. Une tactique considérée par beaucoup, comme la plus grande erreur du PCP-SL.
Car la majeure partie de la population des barriadas ne pouvait approuver l'élimination de personnalités qui depuis longtemps, au sein d'organisations locales, l'aidait à améliorer leurs conditions de vie au quotidien, de même pour certains élus municipaux intègres ; le crescendo de la violence ne pouvait les convaincre tandis que d'autres exprimaient une certaine lassitude face au prolongement de la guerre. L'assassinat le 15 février 1992 par dessenderistas de Maria Elena Moyano, responsable de la Fédération Populaire des femmes de Villa El Salvador, sera condamné par la plus grande partie de la population du barriada, de Lima, du Pérou.
Programmes d'assistance
Pour le PCP-SL, l'aide apportée aux habitants ne pouvait que transiter par leur propre organisation ou par des organismes sympathisants ou sous leur influence. De fait, par conviction politique ou par contrainte, de nombreuses organisations et associations d'entraide accepteront.
Dans ce cadre, le PCP-SL organisait le détournement de camions de marchandises à destination des barriadas, et les distribuait gratuitement sur les marchés ; comme ce fut le 24 Janvier 1991, lorsqu'une colonne de la PCP-SL détourna un camion chargé de plus de 300 boîtes d'huile végétale qui seront distribués gratuitement dans un marché du quartier de Villa El Salvador. Des actions sporadiques, non véritablement planifiées, mais qui permettaient la distribution aux populations pauvres, de marchandises selon la cargaison des camions détournés : médicaments, fruits ou boissons gazeuses. Ce type d'action était surtout l'apanage du MRTA qui effectua de très nombreuses interceptions de camions et de redistribution gratuite et de propagande par le fait. Une activité très appréciée des habitants qui s'intensifia à partir du milieu des années 1980. Le MRTA pratiquera cette activité de manière plus organisée, par des attaques ciblées dans le choix des cargaisons des camions et des dates, comme ce fut le cas le 23 décembre 1985 lors de la redistribution de cargaisons de neuf camions dans les barriadas de Lima.
Parmi les autres actions du PCP-SL, des militants contrôlant les prix des marchandises dans les marchés des quartiers pauvres, en plus de leur mission de surveillance contre les délinquants et les voleurs. Les coupables étaient condamnés sur le champ à une "punition exemplaire" ; une sorte de justice populaire instituée, plutôt appréciée par la population.
Partie 2 : Lima : le PCP-SL et les barriadas
À Lima, les habitants des barriadas formant la « ceinture de misère » [cinturones de miseria] feront l'objet d'une attention particulière du PCP-SL. Trois exemples peuvent illustrer les différentes tactiques des senderistas pour parvenir à convaincre le Peuple de se soulever contre ceux qui les condamnaient depuis des décennies à vivre dans des conditions infra-humaines ; dans leur objectif de les conquérir, Villa El Salvador marque, pour un temps, un certain succès, Huaycán, un relatif échec ; mais l'expérience la plus emblématique est Raucana, un «Comité Popular Abierto» fondé en 1990 par le PCP-SL [!].
RAUCANA : Comité Popular Abierto
Aussi formidable que cela puisse paraître, en 1990, le PCP-SL décide de fonder unAsentamiento humano, dans le district de Ate-Vitarte à Lima ; un projet senderista, d'un « Comité Popular Abierto », que doit organiser le « Comité de lucha popular». Bien évidemment, cette colonie n'est pas destinée aux senderistas, voire même aux sympathisants du PCP-SL, qui dirigea les destinées de la nouvelle colonie, de l'extérieur. Les militants qui y résideront ne feront pas mention de leur conviction politique. Il a également été constaté que si Raucana était placé sous le signe PCP-SL, cela ne signifiait en aucune manière pour les habitants de faire acte d'allégeance avec le Parti, avec toutes les conséquences que cela implique ; ils devaient simplement se soumettre à quelques règles plus ou moins contraignantes concernant surtout l'aménagement du site et l'organisation politique. Les élus-habitants ayant accepté de participer à cette aventure audacieuse, proviennent dans leur grande majorité, des plus pauvres barriadas de la ville, d'autres sont des nouveaux urbains anciens provinciaux pauvres ayant fui des zones rurales pour échapper à la guerre. Selon le recensement national de 1993, la moitié des habitants sont des ouvriers non qualifiés, l'autre moitié déclare une situation d'emploi précaire, ou de survie. Une population composée en grande majorité de jeunes. En bref, une population n'ayant que peu de perspective d'avenir, à la situation instable, des marginaux immigrés débutant leur assimilation dans un contexte urbain où règne le chômage, le racisme, l'insécurité et la répression. Une population pauvre qui, pour le PCP-SL, serait le plus en mesure de promouvoir une forme de solidarité populaire, capable de cristalliser des formes d'organisation dynamique, participative et autonome.
Les motivations profondes du PCP-SL concernant Raucana restent mystérieuses, car Raucana n'est en fait, qu'une vaste opération de propagande, sans but militaire ou stratégique ; et cette communauté sera même présentée par des senderistas à des journalistes de la télévision [2TV Canal] à la stupéfaction de tous les citoyens et de la police. Par la suite, des journalistes du monde entier vinrent ici, apprécier, photographier et interroger les habitants. Raucana sera érigé comme l'un des symboles - par les médias - du PCP-SL. Le Journal El Diaro, organe du PCP-SL, dans un article daté du 29 août 1991, considérait Raucana comme un modèle de Comité Popular Abierto pouvant ensuite être étendu à toute la métropole, un modèle devant faire exemple ; mais Raucana sera le seul Comité Popular Abierto à Lima, le PCP-SL n'ayant pas prévu le degré de répression qui bientôt allait s'abattre sur la communauté, Lima et le Pérou. Une répression excessive, faut-il le rappeler, souhaitée par les dirigeants du PCP-SL.
Sa fondation, le 28 juillet 1990, coïncide avec le changement de gouvernement, jour où Alberto Fujimori prête serment pour devenir Président de la République. Ainsi, le 28 Juillet, un groupe de personnes envahit une propriété privée qui a été mise en vente, et le fait ne mérite aucune attention de la presse. L'opération d'invasion débute dans la nuit du 27 juillet, organisée par des militants : des camions emmènent les invasores, réunis dans leur quartier d'origine, ainsi que le matériel pour bâtir les habitations, des outils, de la nourriture, de l'eau et les équipements de survie nécessaires. Elle sera baptisée, Jorge Felix Raucana, à la mémoire d'un premier habitant tué le jour même de sa fondation, qui présageait un avenir bien sombre.
Au matin, les premiers habitants et des militants sont à l'oeuvre pour défricher et construire sous les directives des senderistas ; une des premières tâches sera d'équiper la colonie de défense : la barricader par un mur d'enceinte et des tranchées assez larges pour empêcher le passage des véhicules, contrôler la zone par la construction de miradors, organiser un comité de défense chargé de surveiller les approches. Toutes les tâches sont effectuées par la communauté, chaque habitant est tenu de participer aux travaux, et il était demandé aux enfants de constituer une provision de pierres pour les frondes. Le comité de défense surveille les entrées jour et nuit, pour prévenir de l'arrivée de la police et maintient l'ordre dans la communauté.
La plus grande méfiance s'appliquait pour les visiteurs qui représentait une menace : voleurs, trafiquants de drogue et d'alcool, indicateurs de la police, prostituées, etc. Dans un premier temps, la colonie était ouverte aux étrangers uniquement le dimanche, y compris pour ceux qui y avaient de la famille. Il faut savoir qu'à Lima, dans les années 1980/2000, la délinquance, le vol, les meurtres – autres que politique - étaient des pratiques extrêmement courantes à Lima. Ainsi, pour maintenir l'ordre au sein de la communauté, le code a imposé, contre le vol, la délinquance, les trafiquants – de drogue notamment -, des sanctions sévères et des peines qui ont été perçues positivement par les habitants, une sorte de justice populaire appréciée. De même, les violences conjugales, la prostitution, la bigamie, l'infidélité, voire même l'alcoolisme – avec plus de difficultés - seront sanctionnés. Le plus généralement, les punitions étaient publiques et s'exerçaient sous diverses formes ; la plus fréquente était des coups de fouet sur le postérieur du coupable, le rasage des cheveux, une promenade à travers les villages voisins avec un signe distinctif, etc. Dans certains cas, en particulier l'infidélité et les violences conjugales, un simple avertissement était administré en public, et des sanctions plus sévères en cas de récidive. Les fautes plus graves pouvaient conduire au bannissement ; les espions, au service de la répression, exhibés aux médias plutôt qu'éliminés.
Enfin, des senderistas assurent l'instruction et la formation continue à l'ensemble de la population (sur la base de groupes constitués de 10 personnes) concernant les techniques de défense : fabrication d'un cocktail molotov, choix de projectiles et utilisation des frondes, emploi des pneus incendiés, déplacements, etc., mais aussi des connaissances juridiques et de diplomatie “policière”. Une “université” dont les cours sont assurés par des étudiants de Cantuta, San Marcos, etc. Si les travaux collectifs étaient quasi-obligatoires, la participation à ces formations n'était pas imposée, chacun était libre d'y participer ou non. Mais en cas d'un raid de la police, chacun sait parfaitement où se trouver et quoi faire. En cas d'alerte, sur un signal, un coup de sifflet, et aux cris de “expulsion !, expulsion !”, certains assurent la défense du site, d'autres des secteurs, les adolescents d'agents la liaison entre les groupes, les adolescentes apporter les premiers soins aux blessés, les femmes doivent garder les pièces communes et regrouper les biens et les ustensiles, les enfants espionner et prévenir des mouvements ennemis, etc.
Mis à part les miradors, la construction d'éléments de défense était courant dans les colonies illégales, mais à Raucana, ces défenses seront particulièrement redoutables et sur-dimensionnées. Un tel système de protection n'était pas destiné à soutenir un siège de l'armée mais bien d'entraver au maximum une possible, voire probable, opération d'expulsion : résister le plus longtemps possible en dissuadant une expulsion rapide était un gage de réussite, un temps gagné pour engager des pourparlers avec les autorités, l'administration, les élus politiques, le ou les propriétaires.

Agrandissement : Illustration 19

Le PCP ne se concentre pas seulement sur les actions défensives contre le expulsions, mais a régi presque tous les aspects de la vie quotidienne des habitants en répondant à leurs attentes, leurs besoins quotidiens : approvisionnement en eau, les travaux agricoles, les cantines populaires, les questions de santé [les médicaments sont fournis par le PCP-SL], l'éducation et la justice.
Pour ce qui concerne l'organisation politique, Raucana se dote d'une direction temporaire – le Comité central - qui se compose d'un conseil d'administration de délégués et de sous-délégués de la colonie qui a été divisé en sept secteurs (augmenté à huit par la suite). Un second organe parallèle, clandestin ou extérieur, composé exclusivement de senderistas, prenait les décisions les plus importantes pour ce qui concernait la défense et la sécurité. Il existe plusieurs versions sur la façon dont les décisions se prenait mais tous reconnaissent que si les délégués transmettaient effectivement des ordres du haut vers le bas, le Comité central prenait en haute considération les avis, les suggestions des habitants et certaines décisions – à propos des cultures, des puits d'eau, etc. - étaient prises à l'unanimité. On peut dire que la conception de l'organisation était verticale et centralisée, mais avec le consentement des habitants et l'on se demande d'ailleurs dans quelle mesure les senderistasauraient pu imposer leurs règles sans en être autrement. Ce type organisationnel était à l'opposé des villages et hameaux de la Cordillère des Andes, de l'Amazonie, des zones libérées par le PCP-SL, où les senderistas contrôlaient le comportement de la vie quotidienne des villageois, imposaient des règles strictes sans rapport – souvent – avec les aspirations ou les coutumes locales, sans concertation, dans une tentative de fusion des besoins des habitants avec leurs objectifs politique et militaire, en légitimant le recours à la violence ou à l'absence de démocratie – directe – au nom de l'idéologie marxiste. Il en était tout autrement à Raucana, où chaque citoyen était considéré avec respect et ce, même s'il ne partageait pas leur idéologie. À ce propos, les senderistas organisaient fréquemment – avant l'arrivée des militaires – des réunions d'information expliquant les bases de l'idéologie du PCP-SL, la nature de leur lutte armée et des conséquences de la victoire finale.
En bref, les témoignages des habitants de Raucana donnaient une toute autre image des senderistas, très différente de celle qui émanait de la presse, des médias et, pire encore, des services de police. Ce n'était pas les combattants de fer du communisme, stigmatisés par la presse, dirigeant un territoire par la peur d'un peuple asservi, par des actes prétendument imposée par les rebelles.
Les aménagements urbains, décidés par le PCP-SL, pour organiser l'espace, se démarquaient des autres colonies ; à Raucana, les senderistas avaient renoncés à l'aménagement de l'habituelle « plaza de armas » ou grande place – c'est-à-dire un espace laissé libre - délimité par le marché, l'église, l'école, et autres services publics ou communautaires. De même, le plan urbain ne découpait pas les secteurs – les quartiers – selon le traditionnel quadrillage rigide et au contraire, le paysage de Raucana tenait davantage du chaos, un patchwork de huttes, disséminées au hasard, donnant l'impression de l'absence de tout ordre. La raison de cette alternative spatiale est liée davantage au fait que la colonie n'était pas assurée de pouvoir résister à une expulsion, les aménagements urbains étaient donc considérés comme provisoires. D'autre part, les aménagements urbains organisaient les secteurs en fonction de la meilleure défense possible, en privilégiant l'aspect combatif.
A peine installés, les habitants seront confrontés à trois ennemis redoutables : au froid humide de l'hiver, à une invasion de puces du fait de la présence de chevaux, ainsi qu'aux premières actions en justice du propriétaire qui intenta un procès pour expulser les indésirables. Cette situation a duré un an et demi, et l'expulsion était une possibilité toujours présente qui devint le centre de leur préoccupation. Le plus généralement, lors d'une “invasion” illégale – une pratique courante au Pérou -, le-s propriétaire-s déposaient une plainte à la police et au tribunal ; selon le nombre d'invasores, la situation et la nature du terrain occupé, la position sociale et la richesse du propriétaire, le degré de corruption, la présence d'organisation humanitaire ou d'entraide, de coopératives, le bon-vouloir d'un politicien, d'un élu municipal, l'occupation pouvait être éphémère par l'intervention quasi-immédiate de la police ou au contraire pouvait bénéficier de la mansuétude des autorités. Le réseau du PCP-SL mobilisa des avocats sympathisants auprès des tribunaux, engagea des recours auprès de l'administration publique, y compris le Congrès et, simultanément, fit appel à la municipalité d'Ate-Vitarte pour obtenir un soutien politique.
Mais, il ne faisait guère de doute que la communauté de Raucana serait expulsée même si elle avait pu bénéficier d'un long sursis judiciaire ; et sans aucun doute, grâce aux menaces faites par les senderistas contre le juge Ruben Mansilla. Il fallait donc passer à l'offensive avant l'ordonnance d'expulsion, ; et le 7 août 1991, un an après l'invasion, les senderistas mobilisent les dirigeants et villageois de Raucana. Un groupe, estimé à 2.000 personnes, comprenant les habitants d'autres villages défilent devant la mairie, tandis que d'autres groupes bloquent la route centrale, avec des arbres, des rochers et des pneus en feu. La police arrive et tente de dégager la route mais est attaquée par des hommes masqués, armés de pierres et de frondes. Il faudra l'intervention de renforts, la police nationale et l'armée, pour leur assurer le contrôle de la route. Quatre heures plus tard, entourés de quelques personnes, les dirigeants tiennent une conférence de presse pour justifier leur action ; un moment crucial pour l'histoire de Raucana, car pour la première fois, après un an d'existence, le public pouvait savoir ce qui se passait là-bas. Mais ce n'est pas tout. A 19h50, une voiture piégée contenant 30 kilos de dynamite explose à proximité de l'usine de textile Pertegada S. A., où travaille le propriétaire du terrain, laissant quatre ouvriers blessés. Pour le gouvernement, une offensive immédiate et frontale contre les manifestants pourrait créer de nouveaux martyrs et obliger la concentration de ressource importante en hommes, qui sont nécessaires dans d'autres quartiers de Lima.
Incroyablement, la victoire est acquise et le tribunal procédera par la suite à la légalisation de l'occupation illégale par un arrangement à l'amiable avec le propriétaire. Mais, comme nous le verrons par la suite, les forces armées avaient d'ores et déjà envisagé une nouvelle destinée pour Raucana.
À partir du moment où Raucana n'était plus sous le coup d'une éventuelle expulsion, débutèrent des travaux importants : la construction de puits profonds pour l'alimentation en eau pour chaque secteur, des toilettes publiques et le système de l'assainissement, des édifices publiques. L'ensemble de ces travaux, décidés par la communauté, seront effectués collectivement, chaque habitant devant y participer selon ses possibilités ; ceux qui avaient un emploi, par exemple, pouvaient travailler les week-end. Des travaux considérables – financés par le PCP-SL - pour une petite communauté qui s'étaleront sur plusieurs mois, [l'eau des puits se situait à une profondeur de 17 à 18 mètres]. Le comité décida également de la création de jardins et de mini-fermes collectives.
Quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Fujimori, les premières conséquences de sa politique anti-sociale et de répression, sont la désorganisation complète et la refonte de l'appareil d'Etat pour l'aide aux plus pauvres. Les distributions de vivres sont restreintes aux barriadas et aux quartiers qui étaient considérés comme non-subversifs, et aux occupations légales, ou autorisées ; ce qui n'était pas le cas de Raucana et de bien d'autres colonies. Les habitants n'ont alors d'autres choix que de subvenir à leurs besoins alimentaires ; ainsi les anciens ruraux vivant à Raucana organiseront les plantations des jardins potagers “privés”, et le travail collectif pour la culture des terres communes. Les cantines populaires, une pour chaque secteur, organisées dès les premiers jours, prendront une place importante au sein de la communauté. Des édifices sont construits pour abriter cuisine et salle à manger. Les citoyens mettent en commun les produits de leur culture et des cultures communes tandis que les femmes assurent la préparation ; tout est gratuit, si ce n'est une cotisation alimentant une caisse commune permettant d'acheter le riz, le sucre et l'huile. Des « écoles populaires » sont construites et les habitants récusent les accusations de la presse qui plus tard affirmaient qu'elles étaient utilisées par le PCP-SL pour l'endoctrinement politique des enfants.
Bref, la vie était difficile à Raucana comme dans tous les quartiers pauvres de Lima, même si l'entraide, la solidarité y étaient peut-être plus fortes qu'ailleurs et la sécurité, la justice populaire permettaient une relative quiétude. Ce fut la période la plus heureuse de Raucuna car le 6 Septembre 1991, les forces militaires et paramilitaires l'investissent : un important contingent de soldats entoure le village, un cercle menaçant se rétrécissant graduellement.
Une base militaire
Les soldats entrent enfin dans le village et leur première action est de distribuer gratuitement des vivres, tandis que des médecins procèdent à des examens médicaux des enfants. C'était la nouvelle approche tactique des militaires pour se faire tout simplement apprécier des populations, de "gagner le cœur et l'esprit des population civiles." En effet, après avoir tenté d'apaiser les craintes de la population par la distribution des vivres, des médicaments, des vêtements, des couvertures et des cadeaux, tandis que des musiciens faisaient résonner des accords rassurants et que la presse invitée photographiait et interrogeait, le commandant de l'opération de cette action civique entama un discours exhortant les habitants à aider les forces démocratiques du pays à combattre le terrorisme.
Tout s'est passé comme prévu ; le drapeau national est hissé, “ Vive le Pérou” est crié, avant la retraite des dirigeants militaires et derrière eux des journalistes ; mais les soldats commencent à préparer un campement dans ce qui était considéré comme le futur parc de loisirs. Rassurés par autant de bienveillance, les habitants ne comprennent pas immédiatement que les soldats dressent non pas un parc de loisir mais une base militaire. Une tactique non prévue par le PCP-SL, qui envisageait plutôt l'expulsion des habitants et la destruction des infrastructures ; qui aurait pu faire l'objet d'une excellente propagande contre les autorités. Ainsi, les senderistas Valentin Capcha, et «Santiago», le représentant de la population y seront envoyés et chargés d'imaginer une nouvelle stratégie capable d'affronter les militaires, sans blesser ou impliquer les civils. Mais le PCP-SL n'aura d'autre choix que d'abandonner Raucana à son nouveau sort militarisé.

Agrandissement : Illustration 20

Peu de temps après leur arrivée, l'action civique des forces armées se termina aussi vite qu'elle était apparue : réduction des livraisons de nourriture, fin de toute assistance, etc. Les témoignages affirment même que la nourriture distribuée était pourrie : la viande infestée n'était pas consommable, de même pour le riz et les fruits... Privés de l'aide du Sentier Lumineux, des aides des associations humanitaires, les plus pauvres des pauvres n'avaient aucune autre alternative que de bouillir ses aliments et de les consommer.
La troupe a remplacé le PCP-SL au sein de la communauté, qui restera à Raucana pendant près de dix années sans interruption. La base est sous le commandement d'un capitaine qui se succèderont et qui s'avèreront être, selon des témoignages “des fils de pute” ; qui pour échapper à des attentat-représailles, cachent soigneusement leur identité : on ne connaît pas leur nom. Les militaires sont ici pour surveiller et terroriser : les seuls contacts institués sont les contrôles, les perquisitions et les assassinats. La première action de l'armée a été de faire un recensement de la population et de procéder à un interrogatoire au cours duquel, selon un témoin « est pris en note votre nom, où vous vivez, d'où vous venez, etc., rien n'a échappé, tout a été analysé ...». Cette pratique est réalisée périodiquement. Après l'identification des personnes, des militaires interdiront la venue d'autres colons – une constante au cours des neuf années de sa présence -, de capturer les immigrants illégaux et de les expulser, après interrogatoire. Les sans-papiers sont pour la plupart conduit en ville pour un interrogatoire plus poussé, torture y comprise. Les réunions du Comité n'ont pas cessé, mais les décisions sont prises ou doivent faire l'approbation des militaires ; qui ont remplacé les enseignants bénévoles par des soldats.
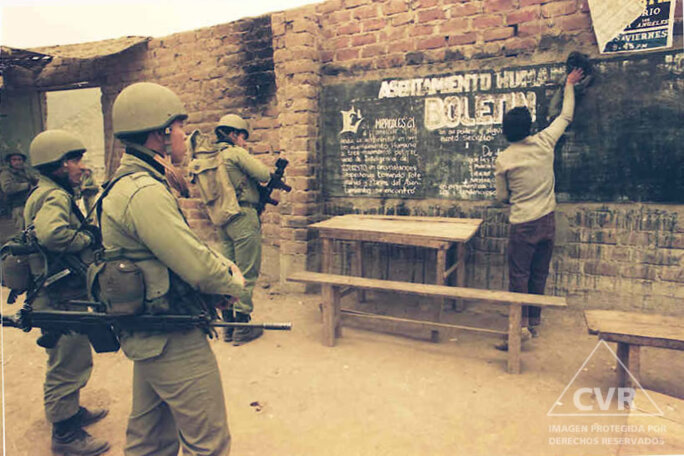
Agrandissement : Illustration 21
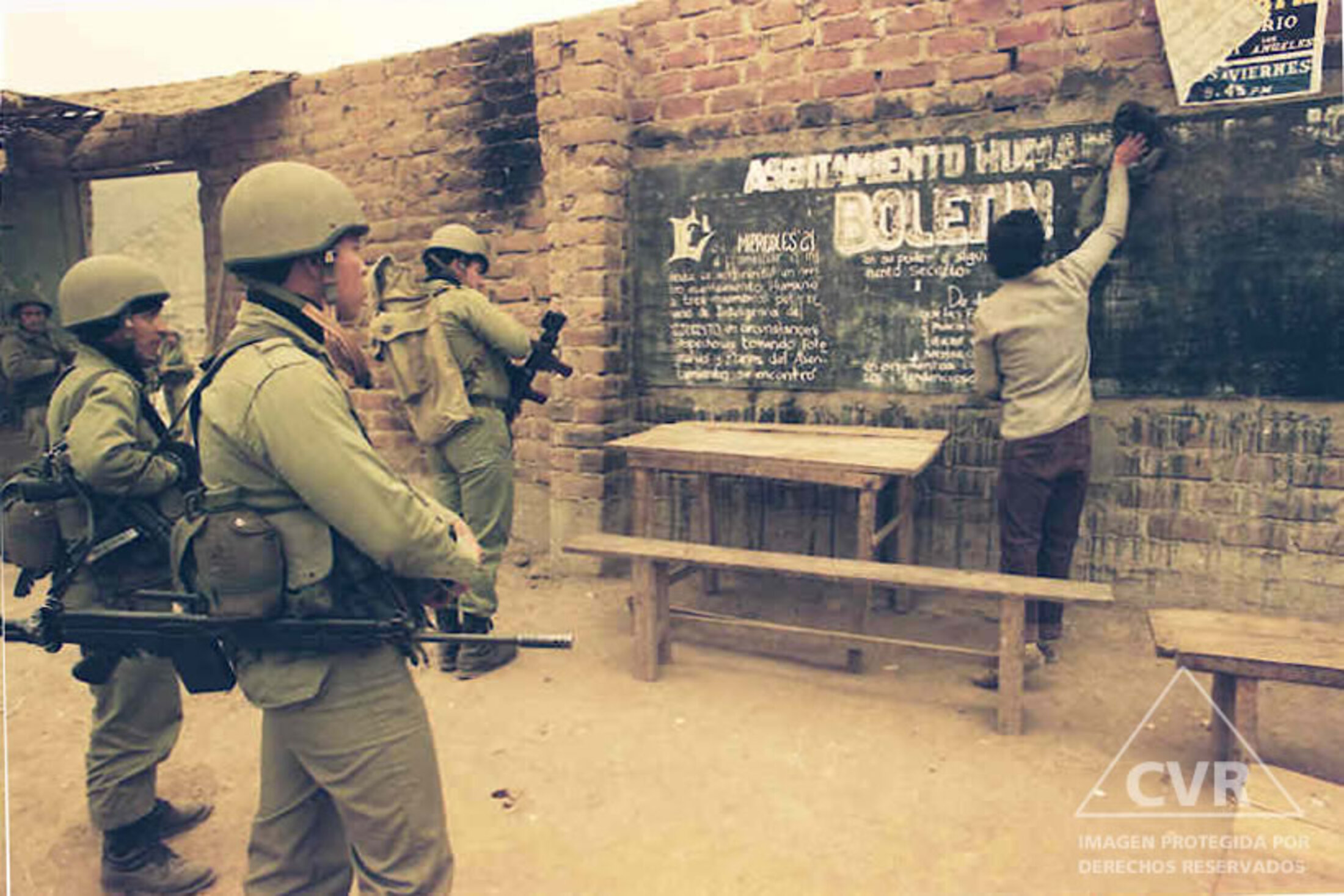
Les cas plus difficiles sont d'être ou avoir été délégué d'un secteur ou responsable de quoi que ce soit, qui est synonyme d'être un senderista, les plus suspectés sont interrogés, torturés ; les disparitions se multiplient. Prendre le poste de délégué de secteur équivaut à un acte de vaillance et de grand courage. En cas d'innocence manifeste, la libération n'était pas pour autant immédiate qui exigeait de l'argent... Pour les militaires, la logique de ces arrestations semblait être que les habitants de Raucana étaient coupables d'être des agents ou sympathisants du PCP-SL, jusqu'à preuve de leur innocence.
Le raid était une pratique régulière de l'armée, au petit matin ou en pleine nuit. Tactique psychologique destinée à effrayer la population plus qu'à contrôler ou perquisitionner, les soldats en profitent démolir au passage objets personnels, planchers susceptibles de cacher armes ou tracts. Si une famille est suspectée, il n'est pas rare que les soldats disposent eux-mêmes un objet, un document compromettant, prouvant leur culpabilité ; une des plus craintes de la population, car avec l'armée, arriva la délation. Il y avait d'autres façons d'instiller la terreur parmi la population ; des fusillades ou une série d'explosions en pleine nuit sans motif, autre que d'effrayer ; des exercices d'entrainement militaire dans les rues du village ; des parades au cours desquelles étaient proférer des menaces contre les colons, le plus souvent par des chants patriotiques anticommunistes, etc.

Agrandissement : Illustration 22

L'ancien propriétaire déclara avoir été spolié de ses terres, et une nouvelle procédure judiciaire s'engagea contre la communauté, malgré le premier verdict du tribunal leur accordant le droit de propriété. Les 590 chefs de famille n'avaient d'autre choix, sous la contrainte d'une expulsion, d'accepter les conditions de négociation du propriétaire : payer 280.000 dollars pour avoir la propriété d'une parcelle de 120 m², constituer une asociación de vivienda, une coopérative d'habitat ; en outre, les salariés de l'écurie privée du propriétaire se voyaient assignés une parcelle par famille.

Agrandissement : Illustration 23
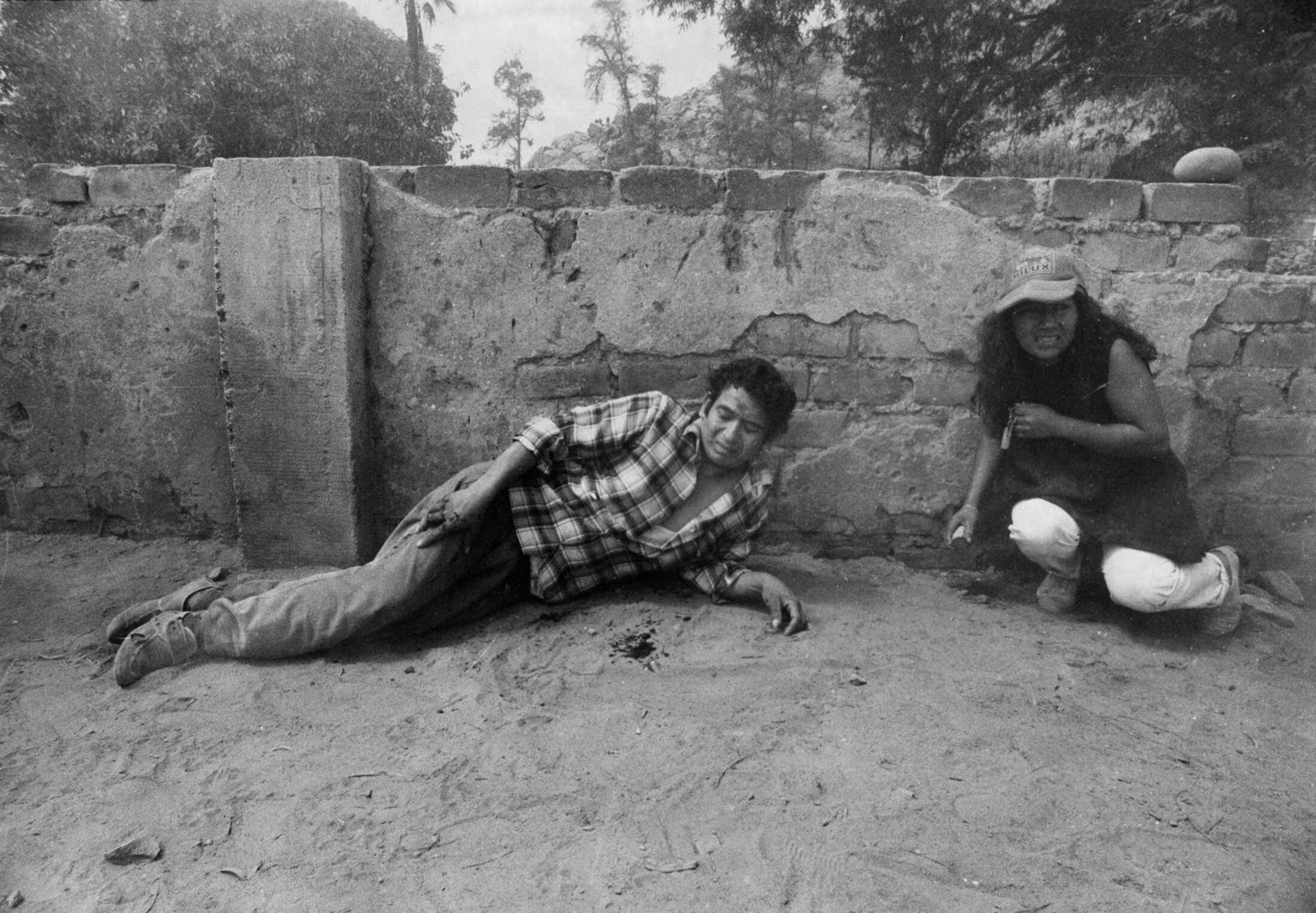
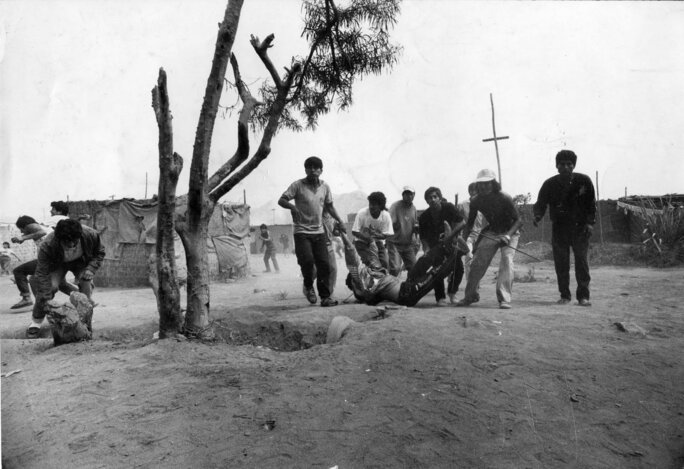
Agrandissement : Illustration 24

Il y eut bien évidemment des situations où, la population excédée par les agissements des soldats, les disparitions de dirigeants, manifesta son mécontent ; dans ces, les soldats sous les ordres de leur capitaine n'hésitent pas : ils tirent sur la foule : 6 morts le 28 avril 1992, après que la population se soit rassemblée pour savoir pourquoi tous les membres du Conseil avaient été arrêtés. L'Etat major pour justifier son intervention militaire et l'arrestation des dirigeants de la communauté, affirma qu'un de leurs membres était en possession d'une carte de la colonie où figuraient avec précision les emplacements du camp militaire.
Cette guerre psychologique cessera au fur et à mesure du déclin militaire du PCP-SL à Lima puis dans les campagnes ; mais jusqu'au départ des militaires en 2000, Raucana sera considéré comme une « zone rouge » à isoler.
Raucana, aujourd'hui
À Raucana, aujourd'hui, les murs et les tours de guet ont été conservés, véritables vestiges d'un passé que tous veulent oublier. Il y a maintenant longtemps que le PCP-SL a abandonné Raucana, qui s'oriente vers la vie « normale » des barriadas confrontés à la pauvreté, à la précarité, à l'alcoolisme, à la drogue, à la délinquance, à des situations de survie. La communauté organise et forme avec d'autres, des réseaux de solidarité avec l'extérieur ; elle utilise les aides des organismes publics et humanitaires. Une de ses caractéristiques est le grand nombre d'enfants handicapés qui vivent dans ce lieu. Les habitants y sont toujours aussi pauvres qu'avant, ils sont seulement assurés d'un emploi stable dans cette période d'économie stable.
Aujourd'hui, Raucana, dispose de l'électricité, des réseaux d'eau et d'égouts ainsi d'une clinique de santé qui dessert également la région et une chapelle. Mais rien n'empêche cette étrange impression de l'extrême pauvreté de ses habitants dont les plus anciens attendent encore leur titre de propriété.
VILLA EL SALVADOR

Agrandissement : Illustration 25
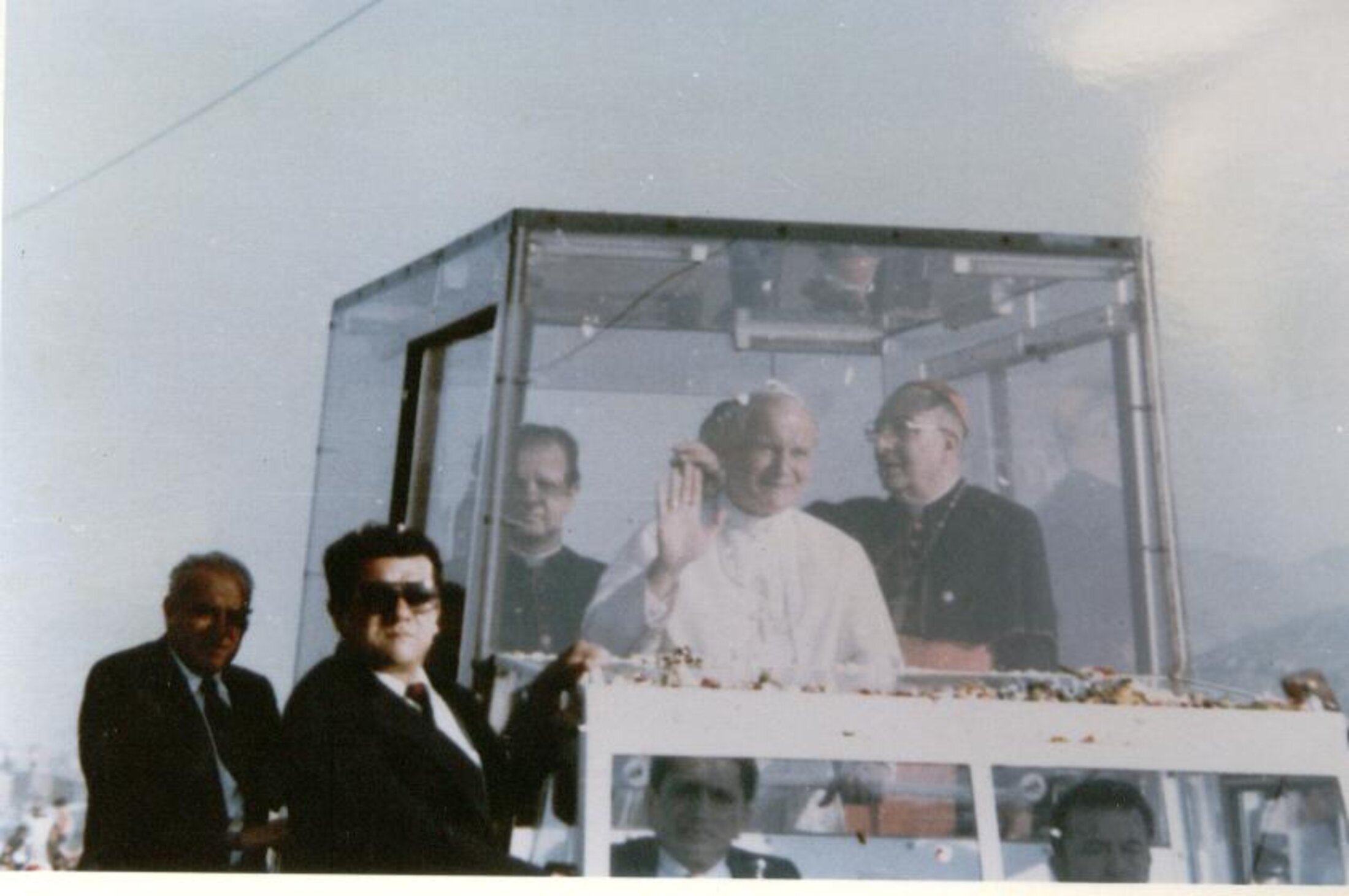
Le 1er mai 1971, 20 000 familles de sans-logis occupent illégalement des terres vacantes à Pamplona, le long de la route Panaméricaine Sud, qui appartenaient à des propriétaires privés. Le 5 mai, les forces de police interviennent pour les expulser et offrent à la communauté son premier martyr : Edilberto Ramos Quispe y trouvait la mort, tandis que le régime militaire emprisonnait Mgr Luis Bambarén, l’évêque des « pueblos jovenes » qui s'était permis de les défendre. Le 11 mai, une partie des pobladores était déporté par l’armée, dans une zone désertique à trente kilomètres du centre de Lima, que leur cédait le gouvernement "réformateur" militaire de Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Juan Velasco Alvarado décide en personne de leur accorder un droit de propriété dans la nouvelle colonie, qui allait devenir la ville-vitrine de la «révolution» Velasco. Après cette annonce, ce seront des milliers de familles venant de la campagne, de bidonvilles et de taudis de Lima qui, sans autorisation, viendront s'y établir, espérant un titre de propriété.
Les fonctionnaires de l'État auront pour tâche de transformer cette invasion en une première communauté urbaine "modèle" planifiée au Pérou. Un modèle promu par le régime de Velasco, qui doit contribuer à développer les initiatives communautaires, la participation populaire, un réseau dynamique d'organisations sociales et l'autogestion. Pour cela sera créé en juillet 1973 , un organe central de direction auto-géré : la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES) [Communauté urbaine autogérée de Villa El Salvador], pour superviser le développement de la communauté et représenter le gouvernement et les autres organismes non gouvernementaux. L'Assemblée générale est composée de groupes de délégués des différents secteurs résidentiels, parmi lesquels est élu un conseil exécutif composé de dix dirigeants.

Agrandissement : Illustration 26


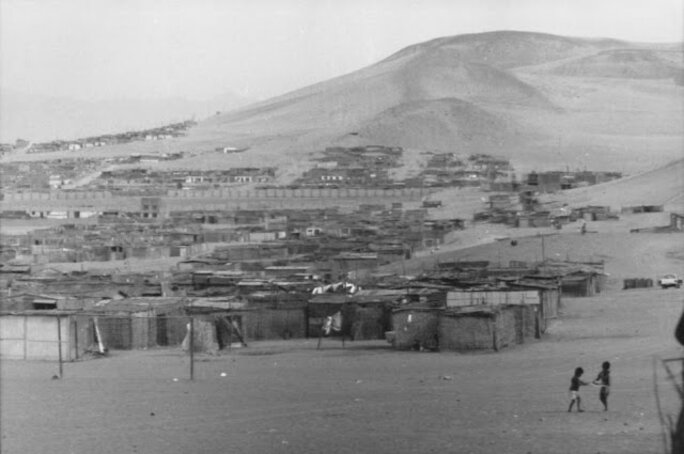
Agrandissement : Illustration 28
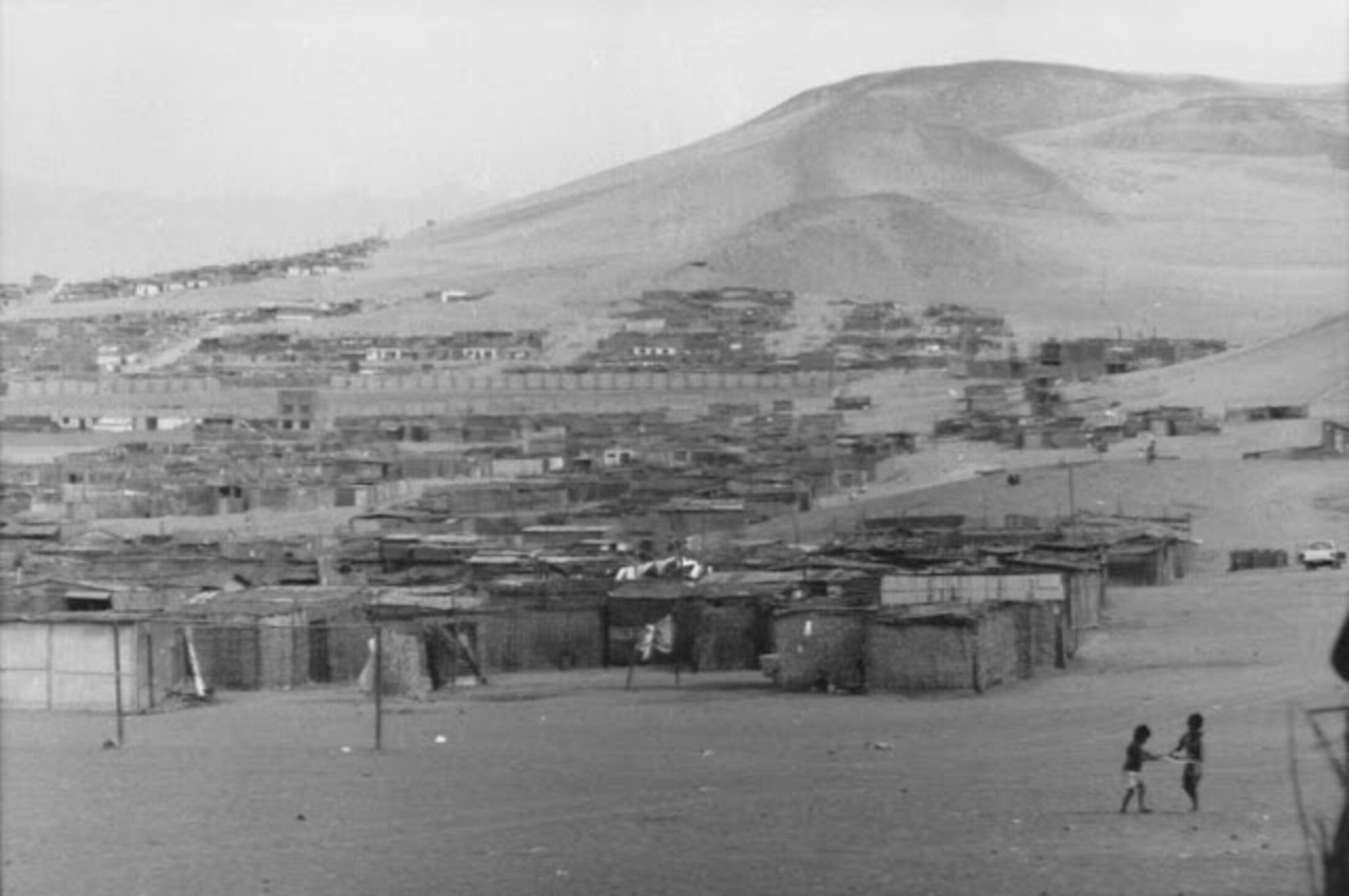
L'aide de l'État s'arrête ici, les nouveaux habitants doivent auto-construire leurs masures, et s'auto-organiser pour tenter de construire ou obtenir auprès de l'État, les services de survie minimum nécessaire à leur maintien dans cette zone aride : approvisionnement en eau, électricité, égouts, transports publics vers la capitale, etc. Ainsi, à Villa El Salvador, va se dérouler une véritable bataille engageant les organisations caritatives des militants chrétiens, des militants de mouvements politiques de gauche et de professionnels d'ONG du Pérou, puis plus tard internationales ; une formidable concentration non pas d'aide généreuse, mais d'organisations luttant pour leur hégémonie et n'ayant de cesse d'instaurer des relations clientélistes avec les habitants, les membres du conseil, les politiciens puis les élus lorsque ce bidonville accédera au statut de municipio.

Agrandissement : Illustration 29


Agrandissement : Illustration 30

En 1971, lors de la fondation de Villa El Salvador, les fonctionnaires du gouvernement Velasco avaient élaboré un plan de développement axé d’abord sur la mise en oeuvre d’une infrastructure de services. Il prenait également en compte le développement économique par le biais d’un parc industriel et d’une zone de production agricole et d’élevage, du moins selon le zonage de l’époque. Villa El Salvador se dote d'une forme particulière d'organisation sociale de son espace en faisant du groupe résidentiel l'unité de base de l'organisation de son territoire. Le groupe résidentiel – sorte de quartier - comprend en moyenne 384 familles, soit entre 2000 et 2500 personnes. Les familles disposent de maisons regroupées autour d'une place commune réservée aux services de base qu'elles ont en commun : l'école maternelle, le centre de santé, le local communal, le terrain de jeu. Villa El Salvador planifie son développement en créant en quelques années cent vingt places communes. Le développement des groupes résidentiels a commencé dès l'arrivée des premiers groupes de familles sur des terrains où n'existaient aucun service : ni eau, ni électricité, ni voies de circulation. Avec la collaboration des ONG, en fait avec leur apport en services légaux et leur expertise d'installation de services, les nouveaux occupants se sont rapidement regroupés pour obtenir de la municipalité de Lima qu'elle leur fournisse des services.
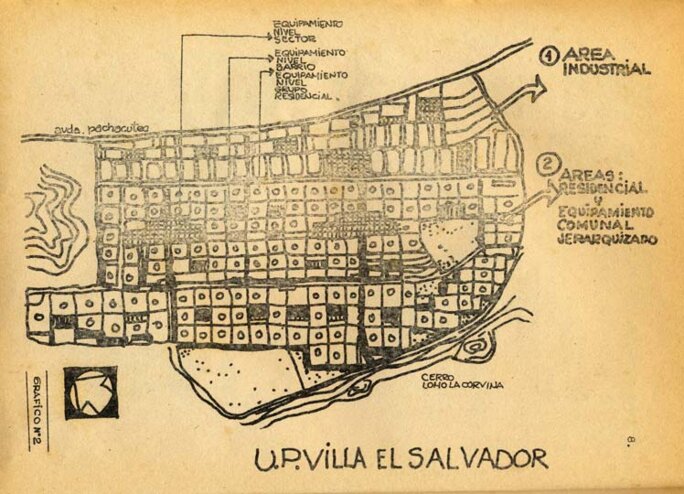
Agrandissement : Illustration 31
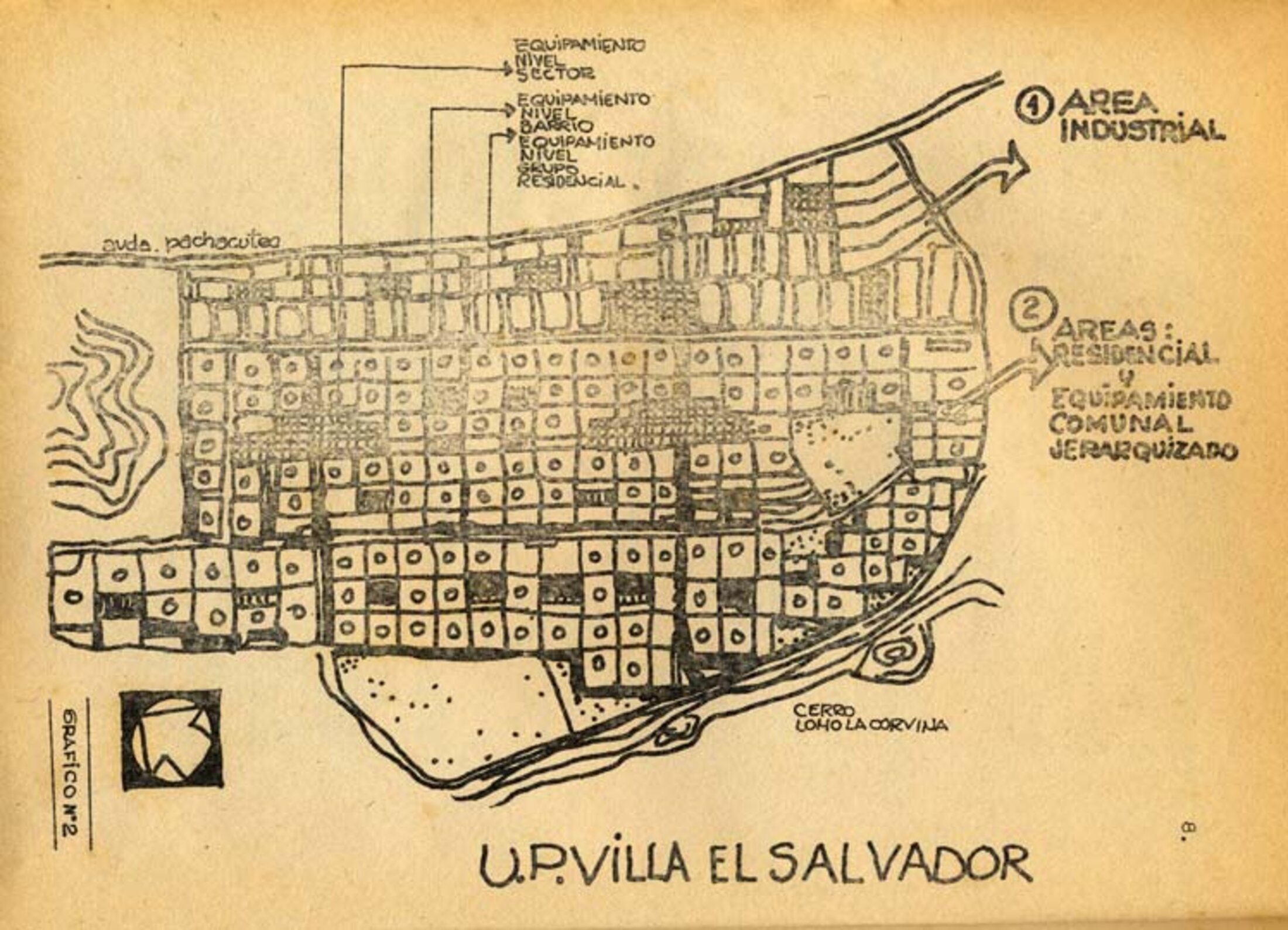
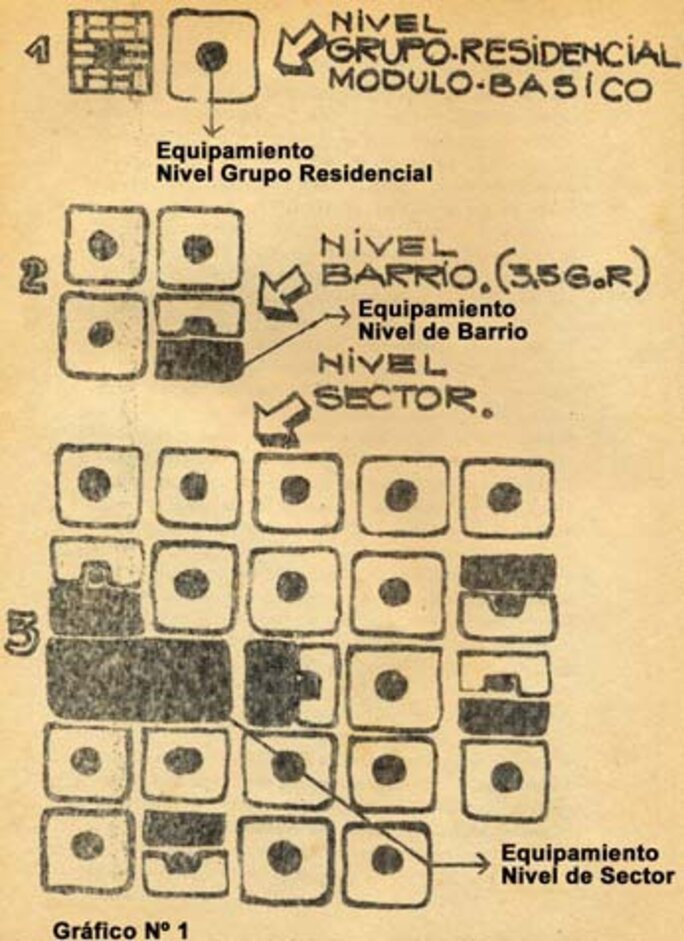
En 1975, l'éviction de Velasco et la prise du pouvoir par le gouvernement du général Morales Bermudez (1976), marquent un tournant : les aides de l'État et de la municipalité, déjà faibles, diminuent encore et la CUAVES, perdant sa principale source de revenus se voit contrainte d'abandonner nombre de ses projets, comme, par exemple, un projet de logement communautaire. Cette situation est aggravée par des conflits entre factions parmi les partis de gauche au sein de la CUAVES qui contribuent à la délégitimer. Les relations avec l’État central passent de la coopération à la revendication et au conflit ouvert. D’une part, il y a répression des dirigeants, surtout ceux qui occupent des postes de secrétaire au niveau des groupes résidentiels et de la direction générale.
Les luttes urbaines se succèdent tout au long de la période de la dictature qui empiètent largement dans le domaine politique d'une vague de contestation nationale contre les militaires. En avril 1976, 30 000 pobladores, dirigeants, mères de famille, maîtres et étudiants, marchent sur le Palais du Gouvernement à Lima pour exiger des réponses aux problèmes d’éducation. En juillet 1977, Villa El Salvador prend part à la grève générale contre la dictature militaire. Second martyr de la communauté, un jeune y trouve la mort. D’autres grèves nationales, en 1978 et 1979, ponctuent l’existence de la jeune cité.
Tout ceci se termina avec le retour à la démocratie en 1980.

Agrandissement : Illustration 33

En 1983, Villa El Salvador devient une municipalité et doit élire son conseil municipal, Michel Azcueta - un prêtre basque naturalisé - du parti Izquierda Unida [Gauche Unie] est élu maire en 1983 et 1986 ; une municipalisation qui sera à l'origine d'une concurrence politique et de conflits entre l'Izquierda Unida [Gauche Unie] et l'APRA, se radicalisant après l'élection d'Alan García [APRA], élu président en 1985. La CUAVES n'a plus un rôle aussi important étant donné le rôle exercé par la municipalité sur le plan du développement local, mais elle continue, comme organisation fondée sur la solidarité de proximité, à être la source et l’inspiration d’initiatives socio-économiques novatrices.
Les programmes sociaux du gouvernement entretiennent, nous l'avons évoqué, des relations clientélistes et les aides sont distribuées en fonction du degré de sympathie et de mobilisation des populations en faveur de leur parti ; les élus de Izquierda Unida procèdent de même. Le meilleur exemple étant les cuisines collectives qui ont toujours reçu des subsides en vivres et en argent de la part de partis politiques, de l’Église, par l’entremise de CARITAS, ou du gouvernement central. Lors des campagnes électorales, les candidats faisaient pression sur les femmes organisant les cuisines collectives en jouant sur les subsides pour assurer leur participation dans des assemblées, pour recruter des votes, placer des affiches, faire la propagande, etc. A Villa El Salvador, les femmes des cantines populaires n’échappent pas à ce chantage. La relation directe instaurée par l’État, le politique en général, avec elles a, en outre, d’autres conséquences directement visibles sur le tissu social de Villa et qui remettent en cause les relations entre certains acteurs de la communauté.
Car des associations tentent de se dégager de la tutelle de l'Église, des relations clientélistes et notamment les associations féministes. Dès la création de Villa El Salvador, des clubs de mères ont été créés en lien avec des programmes d’aide alimentaire publics et privés (gouvernement central, églises catholique et protestante). Mais au début des années 1980, apparaissent les premiers clubs de femmes dont la FEPOMUVES, qui contrairement aux clubs de mères, fondés sur une approche assistantialiste et instaurés "par le haut", les clubs de femmes sont plus revendicateurs, politisés (à gauche) et se définissent sur une base autogestionnaire. Ainsi en 1982, en réaction aux clubs de mères trop dépendantes du clientélisme politique, se crée l’AFEDEPROM, qui regroupe des cuisines collectives se voulant autonomes sur le plan politique. Des groupes d’organisations qui s'opposent : d’un côté, les clubs de mères, organisant des cantines populaires aidées par l'Etat ; de l’autre la FEPOMUVES, associée à la municipalité du district, notamment dans le cadre de la gestion d’un autre programme lancé par la mairie de Lima : le Verre de Lait. Ce programme a été instauré en 1984 par le maire de Lima, Alfonso Barrantes, du parti de gauche Izquierda Unida, et consiste à donner un verre de lait par jour à un million d’enfants. L’initiative, qui connaît un grand succès, permet aux gouvernements locaux, c’est-à-dire les municipalités de districts, de gérer directement le programme.
L'apparition du PCP-SL
Le PCP-SL a commencé son activité ici de manière clandestine et souterraine ; en fait, nous avons enregistré un nombre relativement faible d'actions armées entre 1981 et 1986, uniquement dirigées contre des entités gouvernementales, le poste de police du district, les banques et le dynamitage de pylônes électriques ; s'y ajoutent, les premiers tracts, les graffitis et l'illumination par des feux de joie, du symbole de la faucille et du marteau sur les collines environnantes. Le premier organisme de « façade » qui s'implante concerne un groupe d'étudiants de l'université San Marcos venant donner des cours bénévoles, leur permettant également un travail politique de recrutement au sein de la population et des organismes d'aide. Nelly Evans, par exemple, enseignante au sein de l'organisation Foi et Joie [sic], rejoindra le PCP-SL ; qui patiemment tisse son réseau avec pour principal objectif : la direction de la CUAVES qui s'oppose maintenant à la municipalité.
L’une présente un caractère informel, puisqu’elle ne s’appuie sur aucune loi existante, alors que l’autre permet d’officialiser la barriada en l’intégrant au système politique et administratif du pays. Apparaît alors un système de cogestion inédit au Pérou, qui repose sur l’association des deux autorités gouvernant le district par le biais de commissions mixtes composées de représentants de la CUAVES et de la municipalité. Un "Acte d’engagement" est signé par lequel le conseil municipal reconnaît non seulement la légitimité de la CUAVES et le système participatif sur lequel elle repose, mais également son droit à gérer la communauté, et par conséquent à lever des impôts. Cet âge d’or ne dure qu’un temps, et bientôt les conflits de pouvoir apparaissent. La coexistence des deux autorités devient selon un témoin "une relation étrange, faite de négociations, d’accords et de conflits", dans laquelle les conflits prennent vite le pas sur les accords, une joute politique pour le contrôle de la communauté. Ainsi, par exemple, en 1988, la CUAVES organise une invasion de terrains en construction, qui met bientôt fin au lotissement de cette zone par la municipalité. Tandis qu'une grande communauté de réfugiés cubains, anti-communistes ayant fui le régime de Fidel Castro, est autorisée à s'implanter dans un district...
C'est dans ce contexte que le PCP-SL et le MRTA ont commencé à s'investir plus fortement dans le quartier. Les rivalités entre les partis de gauche, habilement manipulées par le PCP-SL, l'aideront à forger des alliances avec certains secteurs pauvres de la CUAVES. Établir un partenariat avec les "cuavistas" (en dépit de leurs sympathies avec le MRTA), contre un ennemi commun, les «révisionnistes» de la municipalité, permettait aux senderistas de délégitimer l'Izquierda Unida, d'exacerber les «contradictions majeures» dans le district, et de les dénoncer, contribuant ainsi à achever l'icône de l'alternative urbaine et sociale d'un modèle de ville, au fond, parfaitement injuste. Les associations locales – plusieurs centaines dans les années 1990 - seront la seconde cible du PCP-SL, en sachant qu'en 1984, d’après le recensement réalisé par la CUAVES, 75 % de la population avait moins de 25 ans, l'age idéal pour faire la révolution. D'autant plus que les jeunes participent activement au mouvement social populaire et aux organisations nées dans ce contexte : CUAVES, organisations féminines, sportives, chrétiennes, culturelles, sanitaires, organisations de défense des droits humains…
Le développement du PCP-SL
A partir de 1987, le PCP-SL décide d'affirmer sa présence à Villa El Salvador car les accusations qu'il formule contre la corruption, les malversations et le clientélisme ont un écho favorable auprès des marginaux, des jeunes, des déçus du système politique, et des plus pauvres migrants. Les sabotages se poursuivent, l'infiltration de la CUAVES également, tandis que des organismes de « façade » se créent dont des cercles, des groupes d'étude, des associations culturelles, etc. Des écoles techniques sont également organisés par dessenderistas-étudiants ou jeunes diplômés, formant des jeunes pauvres ou marginaux qui avaient peu de chances de poursuivre leur étude et qui cherchaient à se préparer puis à intégrer un marché du travail morose. À partir de 1988, les activités d'agitation et de propagande du PCP-SL deviennent plus visibles. Par exemple, de jeunes senderistas en contingents participent à des activités et des marches de protestation contre le chômage, les mesures économiques du gouvernement, les violations des Droits de l'Homme, etc.
Préparer l'insurrection
Le premier objectif du PCP-SL est de s'emparer une fois pour toute de la direction de la CUAVES, qui s'opposait à la progressive hégémonie de la municipalité. Pour cela, il suffisait de créer des organismes de façade, tels que les «Comités d'Action de district», et que soit élu des délégués de secteur, chose bientôt faite, qui rendit le PCP-SL maître de la CUAVES, déjà sous son influence et celle du MRTA depuis 1991. La 6e Convention du CUAVES, qui s'est tenue en août 1992, a été essentiellement pris en charge par le PCP-SL. De fait, délégitimé, la CUAVES, ne sera plus d'aucun poids mais restera une référence symbolique non négligeable ; une victoire symbolique pouvant faire modèle pour d'autres barriadas de Lima.
Dans le même temps, les militantes – nombreuses – du PCP-SL tentent de prendre la direction d'une des plus importantes associations de femmes : la FEPOMUVES ; une mission difficile car à sa direction, Maria Elena Moyano, après une longue période attentiste, critiquera sévèrement les attentats contre des équipements publics de Villa El Salvadore, refusera certains arrangements et organisera une Marche pour la Paix. Elle est éliminée ; le cortège funèbre qui accompagne Maria Elena Moyano représente pour beaucoup la démonstration irréfutable et éclatante du rejet populaire du PCP-SL. Certes, de nombreux dirigeants se sont déplacés pour y assister malgré le climat de peur et de terreur, dont l'ancien président Fernando Belaunde Terry ; toutefois, de nombreux observateurs ont fait la remarque que la participation des dirigeants et des résidents de Villa El Salvador était minime, et que la plupart de ceux qui ont participé à l’évènement était venu de l'extérieur. Certains affirment même que certains secteurs ont approuvé la "punition" du PCP-SL, accusant l'ancienne dirigeante de favoritisme politique, de corruption, et de s'éloigner de la base populaire. Au contraire, d'autres assurent que cet assassinat a largement contribué à éloigner certains responsables, délégués de secteurs et autres personnalités du radicalisme du PCP-SL. Les témoignages recueillis suggèrent ainsi deux interprétations des faits qui ne sont pas nécessairement contradictoires, qui démontrent la complexité de la situation. L'objectif principal du PCP-SL par l'assassinat de Moyano, avait été atteint : générer la peur et supprimer toute forme résistance. Les dirigeantes refusaient d'être nommées à la direction ou démissionnaient, sous la pression de leurs familles, par crainte d'être la prochaine victime ; ce seront ainsi les militantes-senderistas ou proche du PCP-SL qui assureront la direction de la FEPOMUVES .
Le PCP-SL s'attaquera également à la direction de l'association gérant le parc industriel : l'APEMIVES. En février 1992, un petit entrepreneur de la région, Maximum Huarcaya, est élu président de l'association, apparemment avec le soutien de la PCP-SL via le président de la CUAVES. Tel un effet domino, de nombreuses associations acceptent, bon gré mal gré, des accords avec le PCP-SL ; certains observateurs notent également l'opportunisme - plus que la peur - de certains responsables à s'engager avec le PCP-SL à des fins toute personnelle.
Attentats
A partir de 1989, le PCP-SL augmente ses activités de sabotage et de propagande, en s'attaquant aux infrastructures et équipements communautaires de Villa El Salvador : incendie d'autobus, attaques sur les infrastructures d'électricité et d'eau, des locaux de ravitaillement de vivres des organismes de l'État, etc. Mais à l'inverse, les senderistas détournent plusieurs fois des camions de vivre et distribuent gratuitement les vivres ; de même que le MRTA.

Agrandissement : Illustration 34

Le poste de police locale est attaqué à maintes reprises ou mitraillé ; de même que les locaux du parti politique Cambio 90, de Fujimori au pouvoir. Il s'agit d'une escalade de la violence destinée à créer un vide du pouvoir et à éliminer les opposants trop critiques, d'intimider les dirigeants locaux. Le premier 23 juin 1991, les senderistas éliminent Alexander Gomez, gouverneur du district et membre de Cambio 90.
Au début de 1992, les senderistas procèdent à une série d'attentats, et d'assassinats. Le 13 Janvier 1992, une colonne de onze senderistas attaquent trois sous-officiers de la police générale, qui étaient en surveillance près du marché central. Le même jour, un indicateur est éliminé. Le 10 février, un habitant est tué, accusé d'être un indicateur au service de la police. Pour les mêmes raisons, deux jours plus tard, Juan Huaman Valley, un chef de quartier, est abattu par le Sentier lumineux. Les efforts faits pour organiser des milices populaires anti-subversives, s'avèrent inutiles, toute tentative est vouée à l'échec faute de volontaires : les senderistas avertissent la population en menaçant de mort les organisateurs potentiels. Au contraire, ils débarrassent littéralement le barriada des problèmes de la criminalité, de la délinquance armée, des trafiquants de drogue en organisant une véritable chasse à l'homme ; les habitants, dans leur grande majorité, les félicitent.
Déclin
Comme à Raucana et Huyacan, les forces armées décident d'implanter une base militaire à proximité du barriada. Les forces de police tentent de s'allier avec les autorités du district et de certains dirigeants menacés par le PCP-SL. Mais selon les témoignages, la plupart refuseront cette proposition, tant la menace de représailles était grande qui démontre la forte présence des senderistas au sein de la communauté. Certains jugent cette situation par le sentiment de vulnérabilité ressentie par les dirigeants et la population. Avec les forces armées du camp militaire arrivent également les agents de renseignement de la police, et les forces paramilitaires qui, procéderont à intimider les sympathisants du PCP-SL : arrestations arbitraires, menaces, disparitions de travailleurs sociaux et d'instituteurs, etc. Beaucoup de militants de base se sont ainsi détournés de la vie publique au sein des associations, et par prudence, ont évité de participer à toute activité qui pouvait les compromettre.
Un bilan
Ainsi, en radicalisant et exacerbant les conflits sociaux à Villa El Salvador et dans l'ensemble des barriadas de Lima, le PCP-SL a cherché à provoquer, à radicaliser la répression militaire, devant forcer les habitants à prendre position contre les méthodes du gouvernement, et par réaction, les entrainer à participer à la guerre. Cependant, la majeure partie de la population refusa les méthodes des uns et des autres, la violence aveugle distillant la terreur ; de même, détruire systématiquement les services et équipements publics – la démolition des bus assurant la navette avec le centre ville lieu de travail des habitants, les attaques sur les infrastructures d'électricité et d'eau, contre les locaux d'approvisionnement de vivres, etc. - a été hautement préjudiciable au PCP-SL ; tout ceci a contribué, au contraire, à les éloigner de la population. Le PCP-SL était en 1992, à Villa El Salvador, admiré par beaucoup d'habitants, mais plus nombreux encore, sont ceux qui maintenaient une distance, le considéraient avec une certaine appréhension, sans comprendre leurs actions de démolition. La «guerre du Peuple» se termina sans le Peuple, qui déserta même le monde associatif par prudence, et par peur aussi, des représailles de la police et des groupes paramilitaires.
Cela étant, les partis politiques historiques, les ONG ne représentaient que peu d'espoir ; ou celui seul de gérer la misère dont le principe essentiel peut se résumer par : "Aide-toi et l'État t'aidera" puis par la suite par “Aide-toi et la coopération internationale t'aidera”. Ce principe forme aujourd'hui la pierre angulaire de l'organisation sociale de Villa El Salvador ; placée sous transfusion assistencialiste des organisations de solidarité internationale, des humanitaires qui tentent vainement depuis des générations, de relayer un État national défaillant qui, à partir des années 80 et sous la pression des programmes d’ajustement structurel du FMI, a déserté sa fonction de régulation par le service public. Certes, aujourd'hui, de grands équipements publics modernes - hôpitaux, transports publics, parc naturel, etc. - ont amélioré la vie et l'image de Villa El Salvador, des maisons confortables et des immeubles se construisent, des bars et discothèques animent les quartiers centraux, des entreprises s'implantent offrant de nombreux emplois aux habitants, et un vaste complexe commercial, financé par une ONG, assure aux masses consommatrices, le meilleur symbole de post-modernisme.
Mais, certains font la désobligeante remarque, que la concentration des considérables efforts financiers fait par la municipalité, se répercute au contraire et au détriment d'autres secteurs du Grand Lima. Car en effet, Villa El Salvador est encore le symbole d'une prétendue réussite urbaine-sociale, l'icône d'expériences exemplaires de la solidarité populaire, de l'auto-gestion et de la participation citoyenne, de l'économie solidaire et de subsistance communautaire au sein des coopératives de survie, etc., qui seront récompensé par diverses distinctions, parmi lesquelles le titre de "Cité messagère de la Paix" décerné par l’UNESCO en 1987 ou le Prix "Príncipe de Asturias" attribué par l’Espagne la même année, ou bien encore la visite de très nombreux chefs d'Etat du monde entier, et du pape Jean-Paul II en 1985. Ainsi, Villa El Salvador est très probablement aujourd’hui le bidonville le plus connu du Pérou, une véritable vitrine de l'aide humanitaire, un placement financier assurant aux contributeurs étrangers une excellente publicité ; qui offre à l'Etat et la municipalité, l'opportunité de prouver sa soi-disant volonté de combattre efficacement la pauvreté urbaine.
Comunidad Urbano Autogestionaria de Huaycán
Huaycán, selon les uns, un asentamiento humano auto-géré, auto-construit, un bidonville aménagé sous perfusion pour les autres, a été initialement conçu et planifié par les services de la Municipalidad de Lima Metropolitana (MLM), sous l'impulsion du Parti politiqueIzquierda Unida [Gauche unie]. Il devait être un véritable modèle urbain et social, une réponse cohérente et concrète face aux problèmes d'habitat des populations pauvres de Lima et à la violence du PCP-SL. Les grands thèmes de la Gauche s'y inscrivent : auto-gestion, auto-organisation, auto-construction. Les principales caractéristiques du projet de la Comunidad Urbano Autogestionaria de Huaycán, dirigé par le Programa de Habilitación Urbana del Área de Huaycán (PEHUH), et conçu par l'Equipo Técnico (ET) étaient principalement :
1) Les propositions de planification doivent être concertées avec toutes les familles au sein des assemblées générales. L'urbanisme des secteurs résidentiels, les Unidades Comunales de Vivienda (UCV) – chaque UCV se compose de 60 lots / 60 maisons ; 200 UCV sont programmés à long terme - et l'architecture, avec une densité nette entre 420 et 550 habitants par hectare, devaient renforcer les liens de voisinage par l'utilisation optimale de l'espace des rues et des lieux de rencontre plutôt que de la circulation.
2) La forme de propriété, forme un système qui combine les lots uni-familiales privés ou coopératifs et la collectivisation des parties communes, ainsi que des services tels que les parcs, centres de santé etc.
3) Les habitants sont contraint de construire collectivement, un certain nombre d'édifices collectifs et d'équipements techniques : un centre communautaire polyvalent ; un réservoir d'eau ; des toilettes dans chaque secteur ; des micro-décharges pour chaque secteur ; l'électrification du secteur, etc.
Les services municipaux assistent les habitants/constructeurs : conseils juridiques et financiers, assistance technique, formation, etc ; offrent gracieusement les matériaux mais uniquement pour les équipements communautaires, et les ONG internationales sont mis à contribution, ainsi que la générosité internationale : les toilettes publiques sont financées par Amsterdam, les canalisations offertes par le maire de Paris, telle cantine par Caritas, une autre par le conseil municipal de Toronto, le bois de l'école par l'Unicef, etc. : un formidable carnaval de bonnes et généreuses intentions.

L'occupation de Huaycán n'était pas uniquement due à l'initiative de la municipalité car dès 1982, des invasores tentèrent d'y implanter une colonie, mais en vain, expulsés sur décision de la municipalité de district Ate Vitarte. Une terre convoitée à plusieurs reprises qui décide la municipalité à autorise l'invasion, mais sous certaines conditions. Le 5 Juillet 1984, une réunion engage les autorités municipales et 23 organisations - dont l'Asociación Horacio Zevallos, organe du Partido Comunista del Perú-Patria Roja - et coopératives d'habitat [Cooperativa de Vivienda] qui s'engagent à respecter le plan global d'aménagement, les conditions générales, les quotas d'habitants, etc. Le 15 Juillet, 1984 s'installent près de 2000 familles, en août, 4000 familles occupent ce coin désertique tandis que les services sociaux, les organisations viennent en aide aux premiers habitants.

Agrandissement : Illustration 36
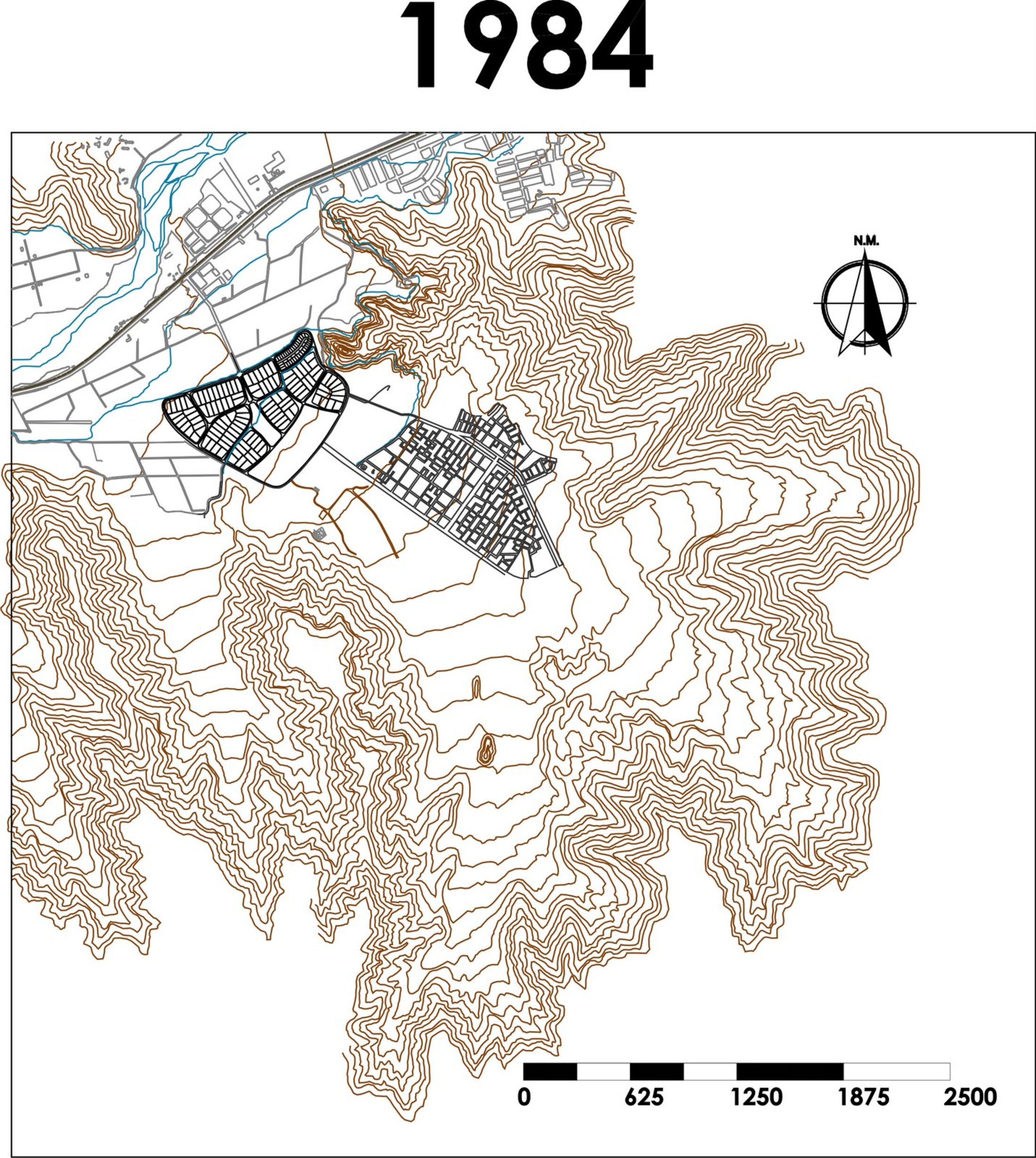
Le 23 Juillet 1984, survient le premier incident, une échauffourée éclate à Huaycán entreinvasores légaux et des membres de l'Asociación Horacio Zevallos, qui viennent occuper des terres. Car en effet, l'association avait d'abord participé au projet puis décidé de se retirer et de procéder à sa manière à l'invasion d'un terrain hors projet mais contigu. Une méthode fréquente permettant ainsi de largement dépasser les quotas d'invasores imposés par les autorités, ici, la Comunidad Urbano Autogestionaria de Huaycán ; et de pouvoir bénéficier de quelques uns des services. Un des dirigeants de l'association sera assassiné plus tard, et personne ne saura vraiment qui était le commanditaire, le PCP-SL n'ayant aucun intérêt dans cette affaire. De fait, ce seront bien deux asentamientos humanos qui s'établissent : Huaycán et Horacio Zevallos [cette nuance apparaît dans les documents du PCP-SL qui marque bien la différence]. Un exemple caractéristique des manigances des partis de la Gauche car le Partido Comunista del Perú-Patria Roja, - responsable de l'Asociación Horacio Zevallos- était en accord tacite avec l'Izquierda Unida, initiateur du projet. Ce sera bien pire encore lorsqu'en 1985, l'Izquierda Unida devra céder la municipalité perdue aux élections à son grand rival, l'APRA.
Une des premières tâches de la nouvelle Comunidad est d'organiser la défense et la sécurité qui doit comprendre deux niveaux : la sécurité extérieure contre l'arrivée d'invasoresillégaux, la sécurité intérieure pour le contrôle et l'ordre au sein de la communauté, notamment contre la délinquance, le vol, constituée de patrouilles. Puis, après la délimitation des secteurs, des rues et des places, des lots à bâtir dans les Unidades Comunales de Vivienda (UCV), les habitants seront en mesure de construire leurs baraques, puis de désigner les délégués de chaque secteur UCV. Les problèmes surviendront dès cette phase car certains secteurs mieux placés que d'autres – proche de la route principale, en terrain plat et non à flanc de collines, etc. - feront la convoitise des uns et des autres. Pour répondre aux exigences des besoins de base ou de survie de la population, la Municipalidad de Lima Metropolitana (MLM) organisera les premiers services publics : une ligne de bus est déviée de son itinéraire pour desservir Huaycán, des compagnies de camion-citernes sont mandatées pour transporter l'eau, un poste de santé est installé et plusieurs médecins bénévoles y assurent les soins. Les cantines communes, fournies en vivre par la Municipalité, assurent les repas. La vie quotidienne y est très difficile du fait notamment de la rareté de l'eau, d'absence d'électricité et de réseau d'assainissement. Le 15 août, l'école construite, accueille les premiers instituteurs bénévoles et les élèves de la communauté.
Le bidonville prend forme, baraques et huttes s'implantent selon le plan, laissant libre les espaces dédiés aux futurs équipements communautaires, aux places, parcs et jardins. Mais dès cette époque est créé le Frente de Defensa de Huaycán, remplacé par la suite par l'Asociación de Pobladores, pour s'opposer aux directives imposées et non concertées ainsi qu'au plan urbain conçu par l'Equipo Técnico.
Le PCP-SL à Huaycán
Dès l'annonce du projet de la Municipalité en 1984, le PCP-SL s'intéressera à Huaycán ; quelques militants sous couvert de l'anonymat réussiront à se faire admettre en tant que colons. Mais ici, l'implantation sera très difficile en raison des liens étroits clientélistes entre les partis politiques, les coopératives et la population, en raison de sa récente création ; infiltrer – comme de coutume – les organismes de direction dont le Congrès des Pobladores n'était pas chose aisée.
En 1985, avec l'élection de Alan García Pérez à la présidence de la République, du PAP, parti rival de l'Izquierda Unida, les tensions entre les partis politiques augmentent ; de même en 1987, après l'élection de Jorge del Castillo Gálvez (PAP) à la Municipalité de Lima, des rivalités sur fond de clientélisme agitent la communauté de Huaycán : les partis de Gauche entament un déclin qui bénéficie au parti du Président Alan García. Profitant de ces divisions, en 1987, le PCP-SL lance une première offensive d'intimidation des dirigeants des organisations présentes à Huaycán et tente de radicaliser les mouvements de protestation : une partie de la population y est sensible mais la majorité refuse de s'engager dans le radicalisme politique. Cela étant, les mesures du gouvernement et la crise qui prend une ampleur considérable obligent à présent la création de Comités de autosubsistencia, et progressivement le mécontentement gagne les esprits autant que les ventres.
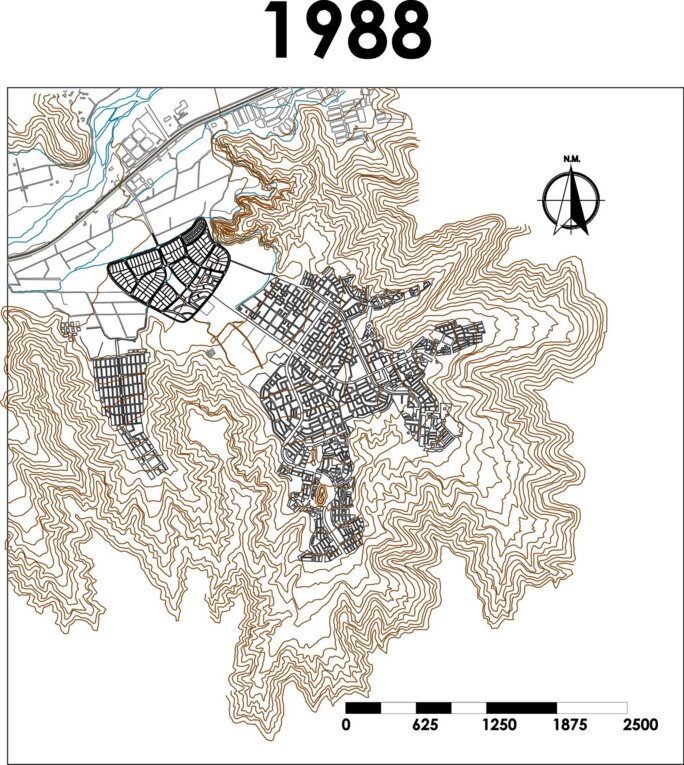
Agrandissement : Illustration 37


Agrandissement : Illustration 38

C'est à cette époque qu'arrive à Huaycán une vague de migrants des zones rurales, fuyant la guerre, s'installant illégalement dans des camps de fortune ; ils sont pauvres, d'une extrême pauvreté et pour échapper aux expulsions, ils dressent leurs huttes sur les hauteurs des collines, des zones difficiles d'accès : le relief accidenté constitue leur unique moyen de défense. Les relations entre la population des terres basses et celle nouvelle des terres hautes sont conflictuelles, la solidarité y est totalement absente, le racisme social prévaut. Une situation quasi inespérée pour le PCP-SL qui à présent peut compter sur un possible allié et peut profiter d'une vaste zone non surveillée permettant de nombreux refuges et des déplacements facilités. En Février 1989, le PCP-SL s'attaque à un producteur agricole d'origine italienne du district qui emploie – pour le maigre salaire du soleil et une partie de la récolte, selon le PCP-SL – de nombreux habitants de Huaycán et d'Horacio Zevallos, en organisant leur mobilisation pour le soulèvement de la récolte de pommes de terre, qui doit être redistribuée gratuitement. Les sacs de pommes de terre chargés sur des camions sont ainsi réquisionnés par l'Ejército Guerrillero Popular – en personne -, lorsqu'un contremaître surgit pour s'y opposer : “sa mort – selon les archives du PCP-SL – sera célébrée joyeusement par la population. (...) Et les masses ont montré leur engagement en faveur de la guerre populaire, pour toujours, et sa décision de se battre pour le communisme.”
Militarisation
En 1990, le nouveau président ultra-libéral Alberto Fujimori prend ses fonctions et assigne aux forces armées, l'éradication complète et définitive du PCP-SL jusqu'au moindre de son plus humble sympathisant. Il peut bénéficier pour cela, des crédits que lui accorde le FMI.
Les forces armées décident d'une nouvelle stratégie dont une des tactiques sera d'implanter dans les zones « rouges » de la capitale des citadelles militaires surveillant à chaque instant les habitants. Un premier poste de police est ainsi implanté à Huaycán, puis une base militaire en septembre 1991, ainsi qu'à Raucana. De même, comme dans d'autres bidonvilles du Pérou, la tactique est la création d'une milice urbaine, appuyant les forces de répression.

Agrandissement : Illustration 39


Les militaires pourront s'appuyer sur le « Corps de défense » créé quelque temps plus tôt par la Comunidad de Huaycán, qui devait faire face, dans un contexte de pauvreté absolue – 70 % des habitants - à une terrible menace : la formidable recrudescence de vols, de délinquance armée, d'une épidémie d'alcoolisme et de toxicomanie générant la plus grande insécurité, le chaos. Le Corps de défense est destiné et limité à lutter contre la criminalité et la toxicomanie, mais lors d'une cérémonie publique, le président Fujimori personnellement, lui assigne une autre tâche : la lutte contre la subversion. Pour cela, des habitants sont recrutés - selon leur degré d'anti-communisme et leur aptitude physique - pour rejoindre le Comité d'auto-défense, après une formation rémunérée de 20 jours leur enseignant le maniement des armes, sur le modèle des milices paysannes. Ces milices de ronderos seront chargées de surveiller le territoire, la population, les mouvements suspects, les routes d'accès, etc. ; et associées aux raids massifs et irréguliers de l'armée, intervenant jusque dans les zones les plus reculées et haute des collines, à la recherche de senderistas, de « subversifs » de la Gauche radicale et d'opposants au gouvernement, elles contraignent les senderistas à quitter cette zone. La zone étant sous contrôle, la base militaire sera convertie en centre d'aide sociale comprenant des services médicaux, dentaire, un centre de distribution de vivres, etc. Par représailles, le PCP-SL intensifiera l'élimination de personnalités emblématiques collaborant avec la dictature, même après la capture d'Abimael Guzman en 1992 : le promoteur de l'ONG Ideas, Zacharie Magellan (1992), les ronderosJosé Galindo et Erasmo Rojas (1993) et des responsables, David Chacaliaza (1994) et Pascuala Rosado (1996).
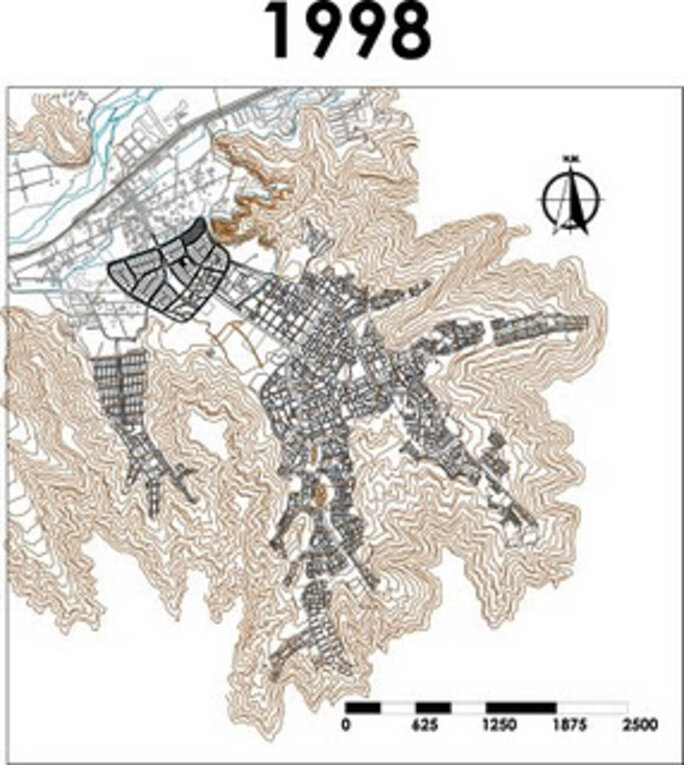
Ainsi, la Comunidad Urbano Autogestionaria de Huaycán, représente une défaite pour le PCP-SL qui ne parviendra jamais à s'y implanter ; les actions des senderistas, au contraire d'autre barriadas – comme Villa El Salvador -, ne seront pas en mesure de créer des structures de “façade” leur permettant d'engager des relations sérieuses avec la communauté, ou de sérieusement intimider les dirigeants malgré les attentats et les assassinats. Plusieurs raisons peuvent être évoquées ; la géographie du site d'une zone enclavée [une route d'accès] contraignant les mouvements, la création récente du bidonville et le faible nombre d'habitants avant 1989, et surtout, la longue tradition et l'expérience des dirigeants et des responsables des organisations communautaires. Enfin, l'échec des senderistas à former ici un véritable mouvement subversif peut être expliqué par le rôle de l'Église catholique, qui dès les premiers jours de la fondation du barriada, y envoya nombre de prêtres et agents pastoraux. D'ailleurs, un des premiers édifices construit sera un centre paroissial comprenant une chapelle, augmenté par la suite d'une cantine, d'une bibliothèque et d'une station de radio. Sermons, vivres et équipements de survie y étaient généreusement distribués contre allégeance.
D'une certaine manière, certains affirment que ce n'était pas la contre-insurrection qui a vaincu le PCP-SL à Huaycán, mais la volonté même de ses habitants, au prix de nombreuses vies humaines. D'autres précisent que l'installation de la base militaire, les actions anti-subversives [raids, perquisitions, assassinats, disparitions, détention arbitraire et notamment d'enfants, etc.] et civiques [distribution de nourriture, les travaux publics, etc.] ont contraint les senderistas à abandonner la zone. Au plus fort de la crise économique, en 1990, les pobladores étaient sensibles aux distributions de vivres, malgré la corruption, le clientélisme ou le pragmatisme de certains responsables ; ainsi, l'expansion de l'aide sociale financée avec l'argent public a été appréciée par les bénéficiaires comme une concession et non comme un droit acquis.
Les fanatiques et les adorateurs de l'auto - auto-gestion, auto-construction, etc. - et de la participation citoyenne considèrent l'expérience de Huaycán comme un véritable succès, oeuvre en grande partie de la politique socialiste de l'Izquierda Unida qui a jeté les bases d'une communauté solidaire. Ce qui n'est pas tout à fait exact, car la solidarité populaire s'est exprimée progressivement contre le politique : contre la bureaucratisation et l'administration qui s'opposaient aux pratiques dynamiques de la population, et davantage contre la corruption et le clientélisme des partis politiques, même s'ils en étaient les bénéficiaires. Des méthodes qui affaibliront considérablement la vie associative, les pobladores refusant d'être ainsi manipulé ; une critique que certains adressaient en même temps au PCP-SL.
Enfin, la solidarité populaire tant évoquée, sera balayée par la crise économique des années 1980, puis par les réformes ultra-libérales du gouvernement Fujimori : à Huaycán, la violence n'est pas seulement l'oeuvre de la guerre politique mais, dans une large mesure, celle de la délinquance armée – apolitique – liée à la misère : les vols, la criminalité violente, le trafic de drogue, la prostitution, l'alcoolisme, les violences conjugales seront en telle augmentation que la communauté décida de l'organisation d'un Comité de Défense, non pas destiné à lutter contre le PCP-SL, mais contre les criminels, la multitude de voleurs. La suite logique de cette situation est tout simplement la peur, un facteur qui a génèré des niveaux très élevés de méfiance, qui a joué un rôle décisif de confinement et d'entrave à la socialisation au sein de la communauté, comme avec son environnement extérieur.
Aujourd'hui Huaycán est un vaste bidonville, sponsorisé par les aides humanitaires venant du monde entier ; la peur y est moins forte qu'autrefois, comme la délinquance, mais la misère toujours aussi grande. Un romancier péruvien affirmait que s'il existait un enfer sur terre, il pourrait être à Huaycán ou Raucana...
Partie 3 : La défaite du PCP-SL à Lima
Dans une interview accordée en 1991 au quotidien péruvien El Diario – organe du PCP-SL - Abimael Guzmán évoque le rôle des villes et de la capitale dans la guerre révolutionnaire :
« Quel problème nous pose la ville ? Nous avons développé un travail dans les villes et à la campagne; oui, depuis plusieurs années, nous l'avons fait. Il y a eu un tournant et un changement avec la guerre populaire, c'est sûr. Maintenant, notre situation nous amène à voir comment préparer la ville ou les villes pour généraliser la guerre populaire. Tout cela est lié au développement du travail de masses, mais pour et dans la guerre populaire, ce que nous avons fait et continuons à faire; le fait est que nous avons commencé à le développer davantage. Nous pensons que notre action dans les villes est indispensable et qu'elle doit être impulsée chaque fois plus loin, parce que dans les villes se trouve concentré le prolétariat et parce que nous ne devons le laisser aux mains ni du révisionnisme ni de l'opportunisme.
Dans les villes, existent les quartiers populaires, les immenses masses populaires. Depuis 1976, nous avons une ligne directrice pour le travail dans les villes. Prendre les quartiers populaires et les bidonvilles comme base et le prolétariat comme dirigeant, c'est notre ligne directrice et nous continuerons à la mettre en pratique, aujourd'hui, dans des conditions de guerre populaire. On voit clairement vers quelles masses nous nous dirigeons. De ce qui a été dit auparavant, découle nettement que les immenses masses des quartiers populaires et des bidonvilles sont comme des ceintures de fer qui vont encercler l'ennemi et qui retiennent les forces réactionnaires.
Nous devons gagner de plus en plus la classe ouvrière jusqu'à ce que celle-ci et le peuple nous reconnaissent. Nous comprenons bien qu'il faut du temps et des faits répétés pour que la classe voit, comprenne, et soit sûre de son avant-garde, et que le peuple réalise qu'il a un centre qui le dirige. Ils en ont le droit. Combien de fois les masses, le prolétariat, les habitants des quartiers populaires, la petite bourgeoisie, les intellectuels, ont-ils été abusés ! Tant d'espoirs frustrés ! Il faut savoir qu'ils ont tout à fait le droit d'exiger; nous avons l'obligation de travailler, de leur montrer et de leur démontrer que nous sommes leur avant-garde afin qu'ils la reconnaissent.
Nous faisons la différence entre être avant-garde et être avant-garde reconnue. La classe a ce droit et personne ne peut le lui refuser, le peuple a ce droit et personne ne peut le lui refuser; nous pensons ainsi. Nous ne croyons pas que du jour au lendemain, le prolétariat et le peuple vont nous reconnaître comme leur avant-garde et leur centre unique; en effet nous devons l'être pour pouvoir accomplir la révolution comme il se doit. Par conséquent, nous devons travailler avec opiniâtreté et imprimer au travail de masses des formes différentes, des formes variées, pour que les masses apprennent la valeur de l'arme, l'importance du fusil. Le Président Mao nous dit que la paysannerie doit apprendre l'importance du fusil, c'est une réalité; nous travaillons donc de cette façon, nous instaurons de nouvelles formes et nous développons le travail de masses, dans et pour la guerre populaire. Tout cela a un rapport avec cette autre circonstance, avec cette autre situation, avec le Mouvement Révolutionnaire de Défense du Peuple, puisque le Centre de Résistance est l'essentiel du MRDP, nous le disons clairement ; la guerre populaire a besoin d'emprunter d'autres formes organiques, d'autres formes de lutte, qui ne peuvent être en aucune manière les formes usuelles. Elles sont différentes, c'est un fait concret. Nous développons par conséquent le Parti, l'Armée Populaire de Guérilla et le Mouvement Révolutionnaire de Défense du Peuple, ainsi que d'autres organismes créés pour les divers fronts de travail.
Nous avons besoin de stimuler la combativité, nous avons besoin que s'exprime la potentialité de la masse, la potentialité de la classe. Voyons une question: il y a aujourd'hui de fortes hausses de prix, alors pourquoi n'y a-t-il pas de contestation populaire ? Qui immobilise les masses ? Lénine nous disait que la marche fait trembler la réaction, que quand la classe marche dans les rues, la réaction tremble ; c'est cela que nous cherchons à appliquer, c'est ce que nous enseigne le marxisme-léninisme-maoïsme.
La classe naît et se développe en combattant; le peuple aussi. Ce dont nous avons besoin c'est de faire la synthèse des expériences propres à la masse, au peuple, d'établir ses formes organiques, ses formes de lutte, pour qu'ils se saisissent de formes de lutte de plus en plus développées qui s'accroissent à la ville. C'est ainsi qu'elles se forment.
Que pensons-nous ? La chose est claire. Le centre est la campagne mais pour l'insurrection, le centre se déplace et devient la ville. Pour cela, on procède de la même manière qu'au commencement, où les combattants et les communistes se déplaçaient des villes vers la campagne; maintenant ils se déplacent de la campagne vers la ville. Nous déplaçons ainsi nos forces et nous préparons l'insurrection. Nous devons étudier les conditions qui permettent la convergence de l'action de l'Armée Populaire de Guérilla avec l'insurrection dans une ou plusieurs villes. C'est ce dont nous avons besoin.
L'insurrection vise à s'emparer des villes pour faire culminer la guerre populaire dans tout le pays; mais elle doit chercher aussi à préserver les moyens de production que la réaction tentera de détruire; à protéger les révolutionnaires prisonniers de guerre, ou les révolutionnaires connus, que la réaction voudra anéantir, et d'autre par capturer les ennemis pour les mettre en lieu sûr. C'est ce qu'on nous a enseigné et c'est cela une insurrection. Lénine nous a enseigné comment organiser une insurrection et le Président Mao nous enseigne comment se présente une insurrection dans la guerre populaire. C 'est ainsi que nous la voyons et la préparons. C'est la voie que nous devons suivre et que, d'ailleurs, nous sommes en train de suivre.
Une chose doit être bien claire : l'insurrection n'est pas une simple explosion spontanée. Non, ce serait dangereux. Mais cela peut arriver, et c'est pour cette raison que nous devons nous soucier dès aujourd'hui de l'insurrection, et nous le faisons. Nous pensons que certains chercheront à utiliser la guerre populaire à leur profit. Dans une réunion du Comité Central, il y a un bon moment de cela, nous avons déjà analysé certaines possibilités. Et l'une d'elles est que le révisionnisme, ou d'autres, provoquent des «insurrections» soit pour gagner des positions et servir leur maître social-impérialiste ou tout autre puissance qui les commande, car plusieurs centres de la réaction mondiale chercheront à nous utiliser. »
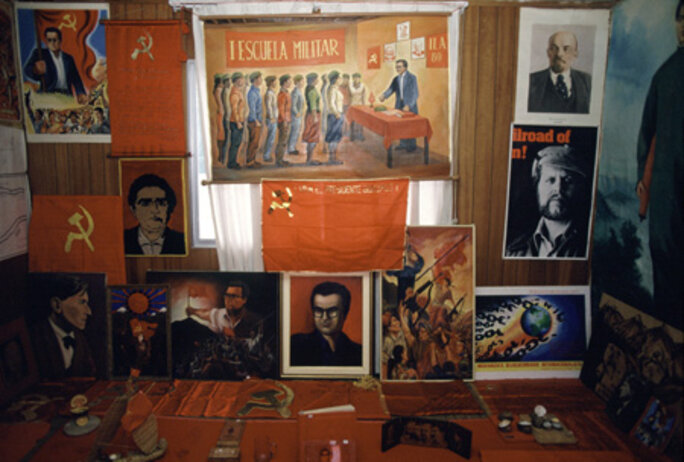
ORGANISATION de L'APPAREIL du PCP-SL
L'organisation de l'appareil du PCP-SL est d'une extrême complexité, car composée de dizaines de cellules clandestines et d'organisations de « façade » [organizaciones de “fachada”], ainsi que d'autres organisations, associations, collectifs, sympathisants ou contraints, placés sous son influence ou son autorité. Tenter de démêler avec précision les fils de cette multitude de réseaux – qui se croisent le plus souvent - est de cette complexité qui dépasse les limites de cet article. D'autre part, il s'avère bien difficile de pouvoir appréhender cette nébuleuse organisationnelle car les témoignages et les études concernant les activités pacifiques de ces organismes ont été largement occulté par l'organisation de la lutte armée, de la violence en général.
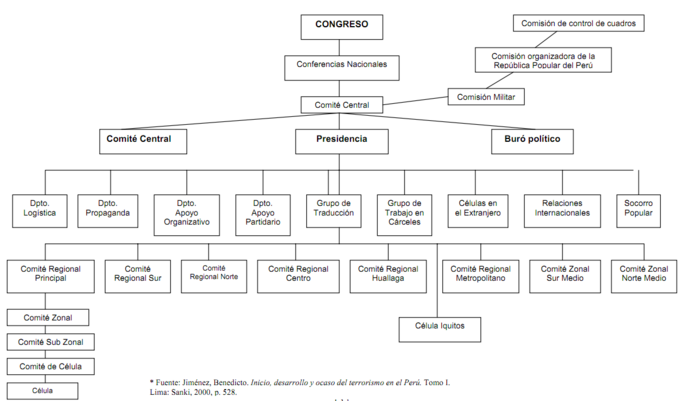
Agrandissement : Illustration 43
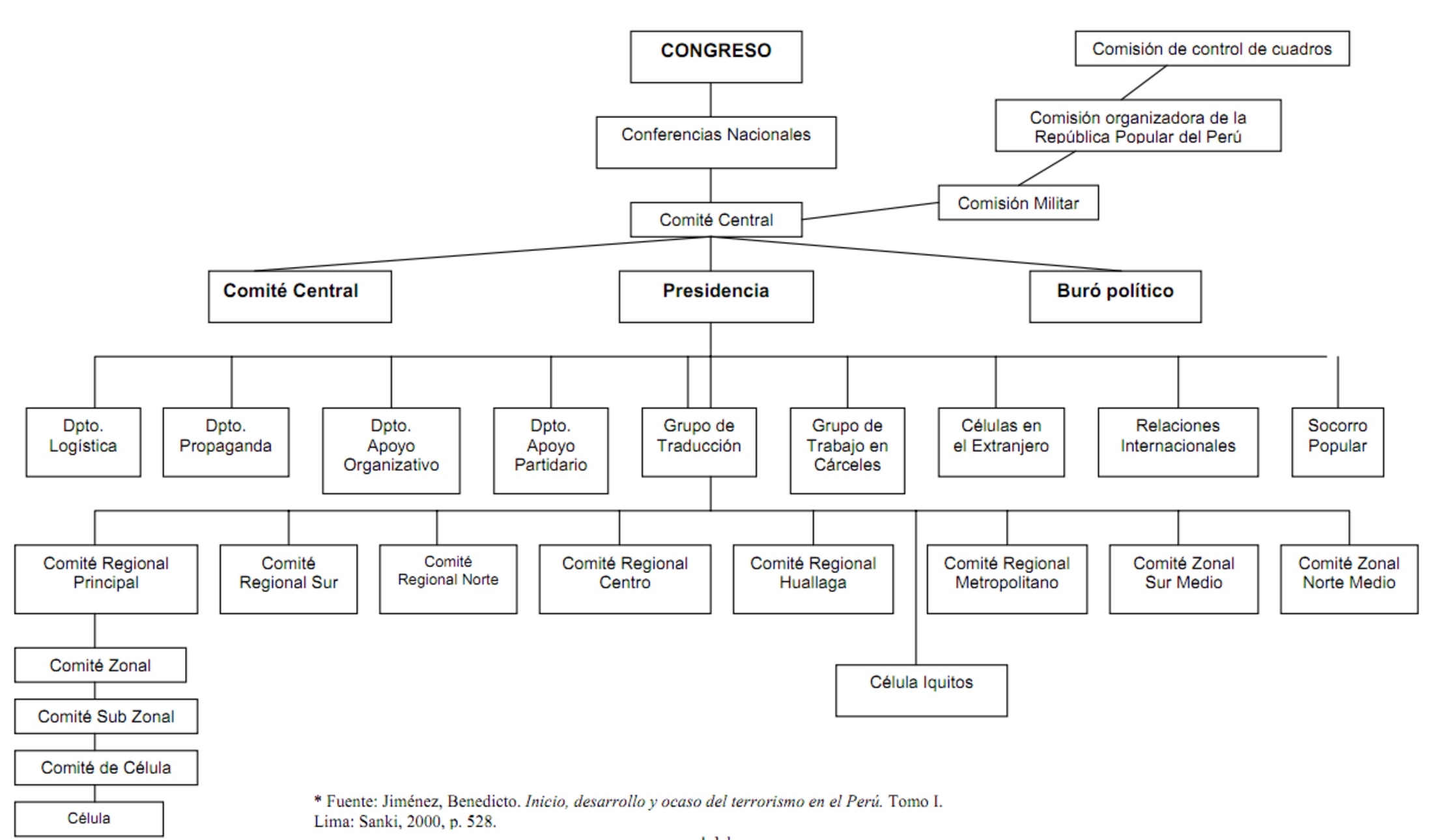
Dans l'historiographie officielle du parti, en 1973, sont créés le Centro de Trabajadores Intelectuales Mariateguistas (CTIM), Comité Femenino Popular (CFP) [renomméMovimiento Femenino Popular (MFP)] , et le Centro de Auto educación Obrera (CAO) ; ce dernier assume la responsabilité de la diffusion, à Lima, des principes du syndicalisme de classe auprès des travailleurs des différentes branches de l'industrie, et par extension auprès des mineurs de La Oroya. D'autres organes se créant au fil du temps, vont renforcer la coopération et relier les luttes du monde syndical, rural, étudiantes, féministes, etc., dont notamment les :
- Movimientos Clasistas Barriales;
- Movimiento Juvenil et Movimiento Intelectual Popular;
- Sección de Obreros;
- Barrios y Trabajadores (OBT);
- Movimiento Femenino Popular (MFP);
- Movimiento Juvenil del Peru (MJP);
- Movimiento de Artistas Populares (MAP);
- Movimiento Estudiantil Clasista (MEC / Univer-superior, etc.);
- Movimiento Clasista Magisterial (MCM);
- Movimiento Intelectual del Peru (MIP);
- Movimiento Popular Peru (MPP);
- Grupo de Apoyo Partidario (GAP);
- Grupo de Trabajo Especial (GTE).
De même, le PCP-SL tentera de s'implanter dans les comités de quartier [asambleas de los barrios] déjà constitués pour tenter de radicaliser les positions et les revendications des habitants ; ou bien en favorisant leur création. Des «organismos generados» destinés à intégrer la société civile afin de "conquérir" les différentes couches, les masses populaires, dans le cadre général de la stratégie du «Gran Plan de Conquistar Bases». Le développement et la multiplication des Comités Populaires (ouverts ou clandestins) sont l’expression de l'État démocratique et populaire, prenant appui sur le principe marxiste de guerre populaire : " les masses font l’histoire, (...) aucun fait historique, aucun mouvement transformateur, aucune révolution ne peut se faire sans la participation des masses ". Ces organismes doivent ainsi capter [captación de pobladores] et éduquer les masses. Il existe, à notre connaissance, peu de témoignages ou de récits présentant les activités quotidiennes de ces organismes de "façade" (outre ceux connus des syndicats ouvriers et étudiants), et leurs méthodes pour tenter d'approcher et de convaincre la population.
A Lima, où réside Guzmán pendant toute la durée de la guerre, les organismes importants pour l'organisation de la guérilla urbaine sont : en haut de la pyramide, le Comité Metropolitano et le Socorro Popular, les organisations de façade, Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC), le syndicat ouvrier Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC). D'autres organes sont également créés pour la gestion financière, pour la collecte de l'impôt révolutionnaire, pour l'intendance et la logistique, pour les missions de renseignement, etc.
Des organes qui parfois, s'opposent ou sont en rivalité mais qui se doivent de travailler ensemble pour mener des actions collectives ou synchronisées, dont notamment les « grèves armées ».
Le Comité Metropolitano
En 1974, se déroule le 4e plénum du Comité central du PCP-SL, dont un des sujets sera de penser le développement de la guerre populaire dans la capitale, et se profile alors une approche catégorielle en fonction des caractéristiques du monde ouvrier et syndical mais également des quartiers pauvres. Lors de cette réunion, il sera décidé de la création du Comité métropolitain [Comité Metropolitano] (connu sous le nom «Metro») à Lima, dont l'objectif est d'être le centre de commandement de Lima ; une structure organisationnelle pyramidale divisant la capitale et son agglomération en grands secteurs, se subdivisant en quartiers puis se ramifiant en cellules ou commandos armés.
En 1976, est créé le Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC), qui organise les premières distributions de tracts à la sortie des usines ; ainsi que la première action révolutionnaire à Lima, le 13 juin 1980, en incendiant la mairie de San Martin. Le SL organise la formation du Frente Revolucionario Democrático Popular, qui réunit les différents organismes de lutte, l'axe de résistance et central du Mouvement populaire démocratique révolutionnaire (MRDP) [Movimiento Revolucionario Democrático Popular], qui sera créé à cet effet. avant ou peu après 1980, est créé également le Socorro Popular, devant initialement prendre en charge la santé des guérilleros blessés et le servie de soutien juridique aux militants emprisonnés [sur le modèle du Secours Rouge].
Cette organisation se dote par la suite évolue dans le temps en fonction de la situation militaire, des arrestations, etc. ; et de la prise de pouvoir par Abimael Guzmán, devenu fin 1983, le Presidente Gonzalo : du Comité Central, de la Comisión Nacional Militar, de la Comisión Organizadora de la República Nueva Democracia. À l'un des sommets, le Bureau politique et le Comité permanent [Buró Político / Comité Permanente] ; la Direction centrale était responsable de l'élaboration des directives du parti et des Plans de campagne militaire.
LIMA : UNE ARMEE SANS ARMES : 1980 - 1984
La « guerre populaire prolongée » initiée par le PCP-SL débute le 17 mai 1980. Le théâtre principal de la guerre se situe dans la province d'Ayacucho, dans les Andes, qui va par la suite se développer à toutes les régions de la Cordillère des Andes et une partie de l'Amazonie. Les efforts en hommes et matériels se concentrent dans ces zones rurales. À Lima, le 13 Juin 1980, un groupe d'environ 60 jeunes appartenant à la MOTC (Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas) lance leurs premiers cocktails Molotov et incendient la mairie d'un quartier, San Martin de Porres. On suppose que le PCP-SL a initié ses activités armées dans la ville sous le nom de MOTC, pour donner l'apparence d'un vaste mouvement populaire. Le 15 juin 1980, la tombe du dictateur Juan Velasco Alvarado est dynamitée. Le 14 décembre 1980, plusieurs attaques simultanées à la dynamite sont organisées contre trois ambassades et quatre agences bancaires causant des dommages matériels. Le 26 décembre, plusieurs dépouilles de chiens sont accrochés aux lampadaires dans le centre de Lima, portant l'inscription : « Deng Hsiao-ping, fils de chien ».

Agrandissement : Illustration 44

Sa plus grande activité à Lima, dans un premier temps, se concentre au sein des universités, hauts lieux du recrutement de nouveaux militants. Pour financer la révolution les senderistas multiplient les hold-up. Les explosifs sont fabriqués par les étudiants en chimie ou proviennent du vol des dépôts des mines de province. Les sabotages visant le réseau électrique - dynamitage des pylônes tension - destinés à couper l'alimentation des quartiers de la ville, font la une des quotidiens et deviennent de fait récurrentes : pylônes démolis en 1980, neuf en 1981, 21 en 1982, 65 en 1983, 40 en 1984 et 107 en 1985. Par la suite les forces armées mineront les abords des pylônes. En septembre 1981, Lima connaît son premier Black-out total.

Agrandissement : Illustration 45

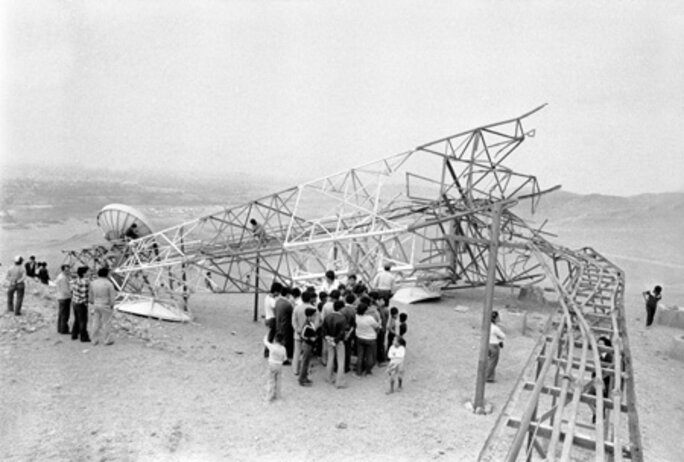
En décembre 1980, le ministère de l'Intérieur enregistre 200 attentas attribués au PCP-SL, sur tout le territoire. À Lima, le PCP-SL dispose, selon un rapport de ses archives, d'une armée sans armes. L'effort de guerre est consacré à la guérilla rurale, et des militants de la capitale rejoignent les zones de combat dans les Andes.
Puis, à partir de 1981, les opérations se succèdent : attaques à l'explosif contre les institutions (ministères, bureaux gouvernementaux, postes de police, etc.). La première attaque d'envergure, à Lima, survient le 4 mai 1981 : une série d'explosions coordonnées prennent pour cible le siège d'institutions, de postes de police, de locaux de parti politique. Dans la soirée du 18 mai 1982, un groupe de senderistas illumina l'une des collines de Lima d'un “feu de joie” représentant la faucille et le marteau. 15 juin, une charge de dynamite explose la porte de la maison de Louis Roy Freire, l'un des auteurs du décret législatif 046, concernant la "loi anti-terrorisme." En août, quatre senderistas investissent les studios de la radio et diffusent un message appelant le “Peuple à la lutte”. Le même mois, l'Ambassade des États-Unis et la résidence de son ambassadeur connaissent leur première charge de dynamite.
Lima : caja de resonancia del Partido
En octobre 1981, la direction du PCP-SL adopte le deuxième Plan Militaire, dont un des objectifs est de collecter des armes. e comité métropolitain de Lima a pour mission de renforcer la position du PCP-SL dans les universités, de développer le recrutement, d'élargir son rayon d'action, notamment dans les bidonvilles, en infiltrant, dans un premier temps les comités de quartier et les associations populaires.
En 1982, la situation économique se dégrade et les quatre syndicats historiques appellent à des manifestations ; les travailleurs de l'industrie pétrolière déclarent une grève illimitée, de même que les ouvriers de l'industrie textile.
En 1982, la guérilla menée par le PCP-SL n'occupe pas encore une place importante dans le paysage politique et médiatique du Pérou ; les actions en zone rurale pourtant nombreuses n'obtiennent guère d'écho dans la presse nationale et internationale ou sont inévitablement déformées par la propagande du gouvernement. À l'inverse, les actions urbaines menées à Lima ont une répercussion et un impact national et international considérable. Dès lors, le Comité Metropolitano pour de faire de la capitale une "caisse de résonance du Parti" [caja de resonancia del Partido], en tenant compte du fait que toute action à Lima, même minime, a un impact national et international.
De même jusqu'en 1982, à Lima, les cibles des attentats du PCP-SL étaient symboliques plutôt que militaires, et l'activité subversive était peu conséquente, en tout cas par rapport à celle de la guérilla des zones rurales. Le PCP-SL est considéré comme un mouvement d'expression régionale, établi et actif dans la lointaine province d'Ayacucho et sans ramifications majeures au niveau national. Mais l'attaque d'envergure du 29 Mars 1982 modifiera cette vision ; qui débute par le dynamitage de pylônes à haute tension privant, pour la première fois Lima de courant pendant plus de deux heures, qui est suivi d'une série d'attentats synchronisés.
En juillet 1982, le PCP-SL adopte sont 3e Plan Militaire placé sous le signe de : " Battre l'ennemi, battre les forces vives et saper l'ordre réactionnaire." Dans cette troisième étape, les villes de Province occupent une place importante qui font l'objet d'attaques et de raids contre les postes de police et les casernes de l'armée. Le 2 août 1982, le dynamitage de cinq pylônes de haute tension prélude les attentats contre les ministères de l'Économie, de l'Industrie, le Palais de justice, la Chancellerie. Le 20 août 1982 le gouvernement décide d'imposer l'état d'urgence à Lima et Callao.
En décembre, le PCP-SL, célèbre l'anniversaire d'Abimael Guzmán avec des attaques simultanées à Lima et Ayacucho ; alors que Lima était privée d'électricité, des senderistasilluminent la colline [cerro] San Cristobal d'un “feu de joie” représentant une faucille et un marteau. En province, l'armée procède aux premiers déplacements massifs de population et notamment des habitants ayacuchanos ; l'exode vers Lima débute.
Les problèmes au sein du Comité métropolitain
Pour les dirigeants du PCP-SL, Lima constituait un problème à résoudre, car malgré un début prometteur, jusqu'en 1985, le nombre d'actions menées par le Comité métropolitainétait très inférieur par rapport aux autres régions en guerre. En 1980 il y avait eu deux attentats ciblés faisant une victime ; en 1981, deux attaques sélectives, aucune victime ; en 1982, 46 attaques faisant 57 victimes ; en 1983, 33 attaques et 37 décès ; en 1984, le total était de 25 attaques et 29 victimes ; en 1985, 38 attaques faisant 37 victimes.
Dès 1982, un vent de soupçons souffla sur les responsables du Comité métropolitain, et Guzmán considérait avec suspicion leur engagement selon lui, insuffisant dans la lutte armée. D'autre part, de graves erreurs seront commises révélant le peu de préparation et l'amateurisme des commandos. Les aspects opérationnels à Lima, en plus de l'organisation, posaient d'énormes difficultés pour les responsables du Comité métropolitain. En 1981, lors de la troisième session plénière du Comité Central, les représentants de la «Metro» exprimèrent leurs problèmes à l'égard de la formation de groupes de travail (la «force principale» dans le cas des villes). Les erreurs se multipliaient, ainsi, par exemple, les connexions entre les militants assignés à des zones distinctes, qui facilita grandement la tâche de la police pour la capture de plusieurs réseaux ; ou bien, autre exemple caractéristique, l'attaque contre un poste de police, le 5 Juillet 1982 ; malgré l'élément de surprise, le manque de préparation des guérilleros fait que l'attaque échoue, et plus grave, deux assaillants blessés ont été abandonnés sur place. Qui permettent à la police de capturer dans un court laps de temps, 38 guérilleros. Après cet incident, les commandos urbains de Lima seront pour un temps inopérants.
En fait, la situation à Lima démontrait que la conception de la guérilla urbaine ne reposait pas sur les mêmes principes que celle des zones rurales : dans la ville des années 1980-90, la militarisation des partisans et leur rôle n'avaient ni la clarté ni la même nature politique qu'auprès des populations rurales. Conscient de cela, le Comité décida de privilégier les actions de recrutement - appelé “l'incorporation des masses” - d'implantation et de propagande, de limiter les attentats militaires, en attendant la constitution d'un corps armé efficace. C'est à cette époque que le PCP-SL concentra son attention et ses efforts sur les barriadas de Lima. Ainsi, le Comité Metropolitano commença à développer son rayon d'action et conjointement le recrutement, dans un effort et un travail purement politique d'extension de son réseau dans les bidonvilles de Lima, les universités et les quartiers ouvriers.
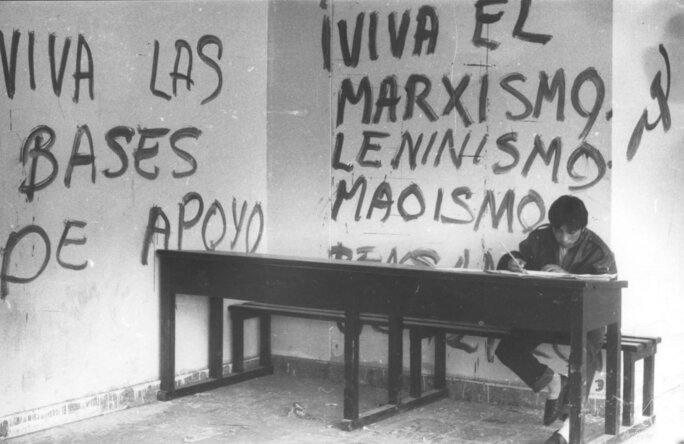
Agrandissement : Illustration 47
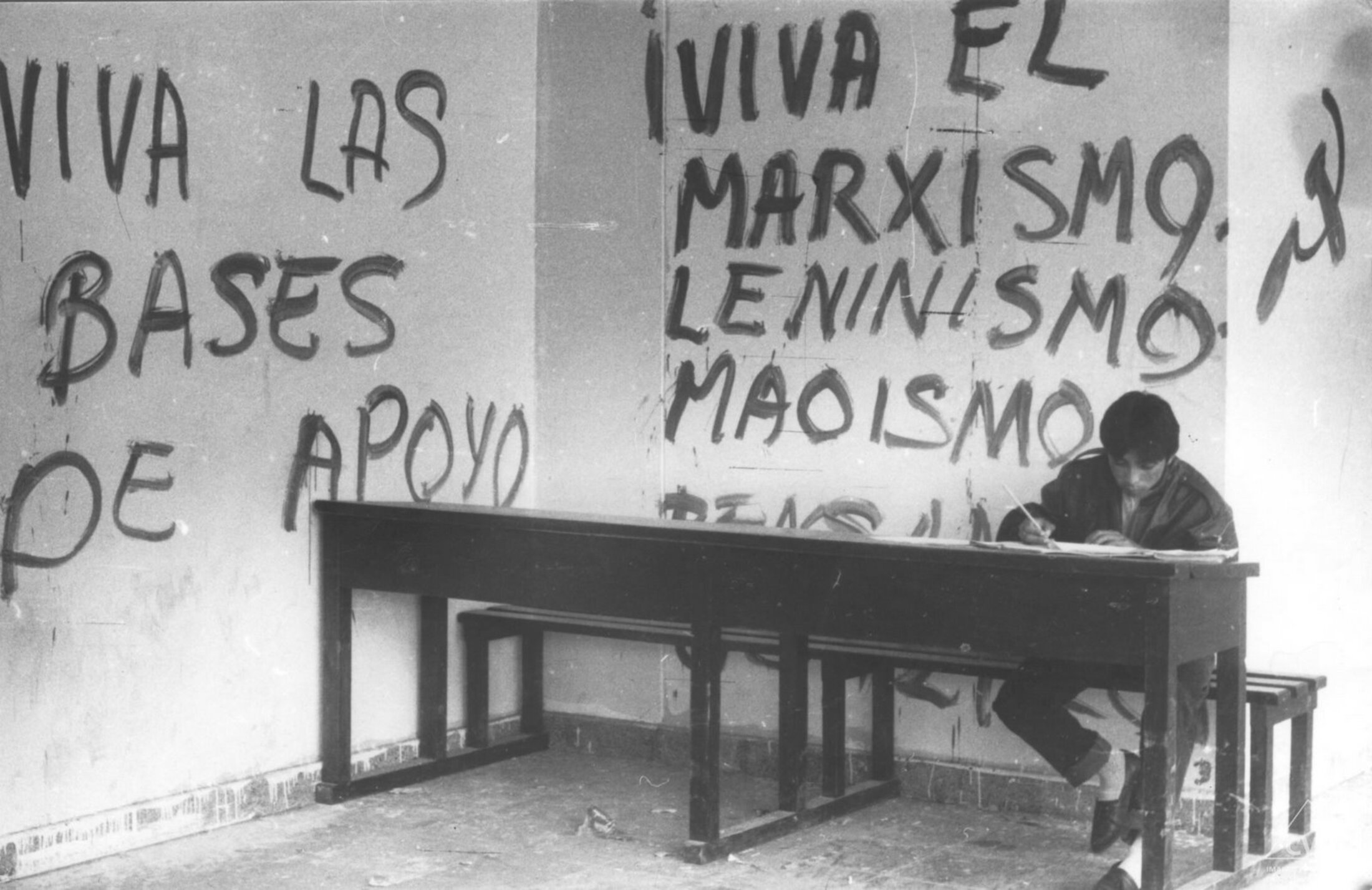
En mars de l'année 1983, les centrales syndicales, pour protester contre les réformes du gouvernement, décident d'une grève générale nationale qui paralyse le pays ; en juin les enseignants décident d'une grève nationale ; à nouveau, une grève nationale des syndicats en septembre.
En mai, des senderistas dynamitent 10 pylônes de haute tension et lancent une série d'attentats contre des banques, des sièges d'entreprises privées internationales, d'un poste de l'armée, tandis qu'un « feu de joie » illumine d'une faucille et d'un marteau le cerro San Cristobal.
Les premiers mois de 1984 sont marqués par les manifestations étudiantes et la répression policière qui culmine en février. En avril, les grèves se succèdent dont celles des professions médicales, des camionneurs et des employés de la Municipalité de Lima. Le 22 janvier, un commando du MRTA [Comando Armado del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru]signe son premier attentat contre le poste de police de Villa El Salvador.
En 1984, le Comité métropolitain du PCP-SL se réorganise et subdivise la capitale en trois zones : Est, Ouest et Centre. Il organise des attentats contre des personnalités politique et militaires ; le 25 Mars, le peloton Luis de la Puente Uceda attaque la résidence du ministre de l'Économie, Carlos Rodriguez Pastor. Pour l'anniversaire de la révolution, le 16 juin, une série d'attentats à la dynamite est organisée à Lima.
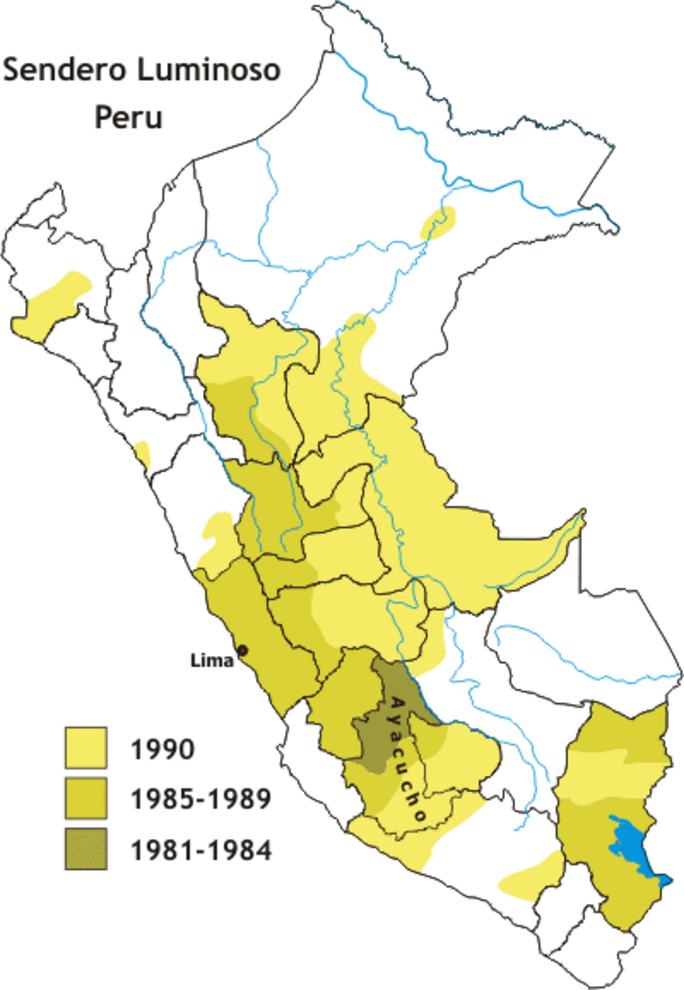
LIMA : COMPLÉMENT NÉCESSAIRE À LA GUERRE : 1985 – 1988
Alan García Pérez est élu président de la République en 1985. Pour le PCP-SL, c'est une période clé, de transition, qui marque une nouvelle étape pour Lima dont le rôle est maintenant d'être une zone de « complément nécessaire » de la guérilla rurale. Cette promotion change radicalement la tactique, le type des attaques et des sabotages, leur nature, leur fréquence. A ce stade, outre les actions de propagande, le PCP-SL combat pour son hégémonie dans la société civile de la capitale et n'hésite plus à procéder à l'intimidation ou l'élimination ciblée de dirigeants politiques, de syndicalistes, de responsables d'ONG et d'associations d'entraide, de chefs de quartier. Autres faits marquants de cette période : l'apparition du MRTA en 1984 qui s'engage activement à Lima, le meurtre de prisonniers politiques en 1986, et la même année, l'organisation plus ou moins spontanée, des premières Rondas urbanas : des milices urbaines anti-subversives qui n'auront pas le même impact et l'efficacité que les comités de autodefensa campesinos des zones rurales ; et cette activité reste toutefois extrêmement risquée pour ceux qui tentent de l'organiser.
Les attentats se poursuivent dans Lima et leur fréquence augmente avec les actions armées du MRTA. La venue du pape en 1985 est l’occasion d’une longue panne électrique dans plusieurs secteurs de Lima ; de même en juin de la même année pour la visite du président argentin Raul Alfonsin, panne suivie d’un attentat à la voiture piégée sous les fenêtres du Palais du Gouvernement. Des militants du MRTA réussissent à diffuser un message télévisé, appelant à la lutte armée, à annuler la dette du pays, exige l’augmentation des salaires et une amnistie générale.

Agrandissement : Illustration 49

1986 sera l'année de ce qui est considéré comme le plus grand massacre dans l'histoire de ce conflit : l'assassinat après une émeute de 124 prisonniers politiques dans la prison de Lurigancho, de 150 prisonniers dans le Fronton à Callao, et de 3 détenus à Santa Barbara. Un massacre dont une des conséquences est la recrudescence des attentats. Après le pic atteint en 1986, les actions du PCP-SL diminuent continuellement jusqu'en 1988, ainsi nous pouvons dire que ce fut la période de déclin du Sentier Lumineux à Lima. Un déclin qui révèle le danger de la guérilla urbaine et la fragilité des systèmes de sécurité des réseaux clandestins qui culmine avec la capture de Morote Barrionuevo, leader du PCP-SL (le 11 Juin 1988) à Lima. Une période qui prit fin entre Novembre et Décembre 1988, par une série d'attaques commémorant l'anniversaire de Mao et de Guzmán qui ouvre une nouvelle étape.
En 1988, le Comité Metropolitano sera composé de cinq comités de zone (Est, Ouest, Centre, Nord et Sud). Le Socorro Popular (Sopo dans des documents PCP-SL), une structure très complexe, est venue à supplanter depuis 1986 le Comité Metropolitano, à prendre une importance inhabituelle dans l'activité à Lima, tout en respectant ses fonctions initiales dans les domaines médical [soins aux blessés et malades], juridique [Association des juristes démocrates et Comité des familles des prisonniers politiques] et, éventuellement de propagande. En cinq ans, sous la direction de Yovanka Pardavé, cette organisation est devenue un appareil central « clé » du PCP-SL à Lima ; et une grande partie du succès du PCP-SL à Lima entre 1986 et 1988, était due au Socorro Popular. L'importance du SOPOcommence à se faire sentir à partir de 1985 qui devient une organisation partisane : la direction est militarisée et sont créés leurs propres détachements armés. Un organisme, subordonné à la direction centrale, mais qui ne respecte absolument pas l'organigramme général du Parti, qui reflète la méfiance de Guzmán envers les cadres dirigeants du Comité Metropolitano, et l'importance grandissante de la capitale en tant que zone de guérilla urbaine.
Lima dans “l'équilibre stratégique” : 1989 - 1992
En 1989, le gouvernement ordonne aux forces armées de prendre en charge la sécurité, en parallèle des forces de la police, de Lima et Callao, placées en état d'urgence. La répression s'intensifie et les forces armées opèrent des raids massifs dans les barriadas, comme celui de mars 1989 dans le quartier Barrios Altos où quinze mille personnes sont emprisonnées. En 1990, un inconnu, d'un parti politique indépendant créé quelques mois plus tôt, Alberto Fujimori, remporte l'élection présidentielle avec 62% des voix. Son programme prévoit la fin de la crise économique, de la guerre et de la corruption. Il instaurera une dictature en mai 1992 avec l'appui des forces de la police et militaire.
Cette période est celle de la plus grande activité militaire du PCP-SL à Lima, dans le cadre de la nouvelle stratégie dite de “l'équilibre stratégique” qui avait été décidé en 1988. Lima passe du statut de “complément nécessaire” à celui d'une zone majeure d'opérations militaires. Entre avril 1989 et Décembre 1992, sont recensés à Lima 907 attentats, soit 47% des attaques faites dans le pays ; pratiquement un attentat par jour. Les commandos urbains multiplient les attaques ciblées, la propagande et le PCP-SL poursuit activement son développement dans les barriadas proches du centre et son implantation dans ceux des “cônes” périphériques. Les patrouilles et les postes de police sont ici particulièrement visés, afin de faciliter les mouvements des guérilleros, et dans une certaine mesure, intimider les opposants qui auraient tentation d'organiser des rondas urbanas. De son côté, le MRTA met l'accent sur les attaques ciblées et multiplie le détournement des camions dont les cargaisons sont redistribuées aux populations des barriadas.
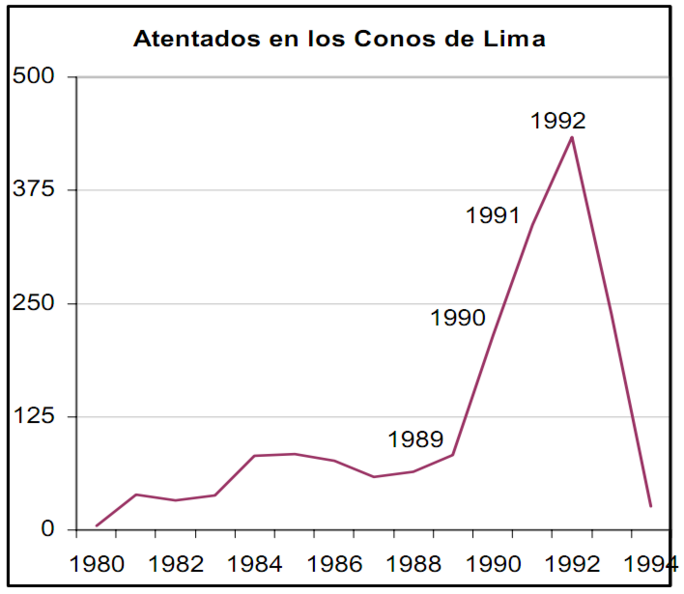
Agrandissement : Illustration 50
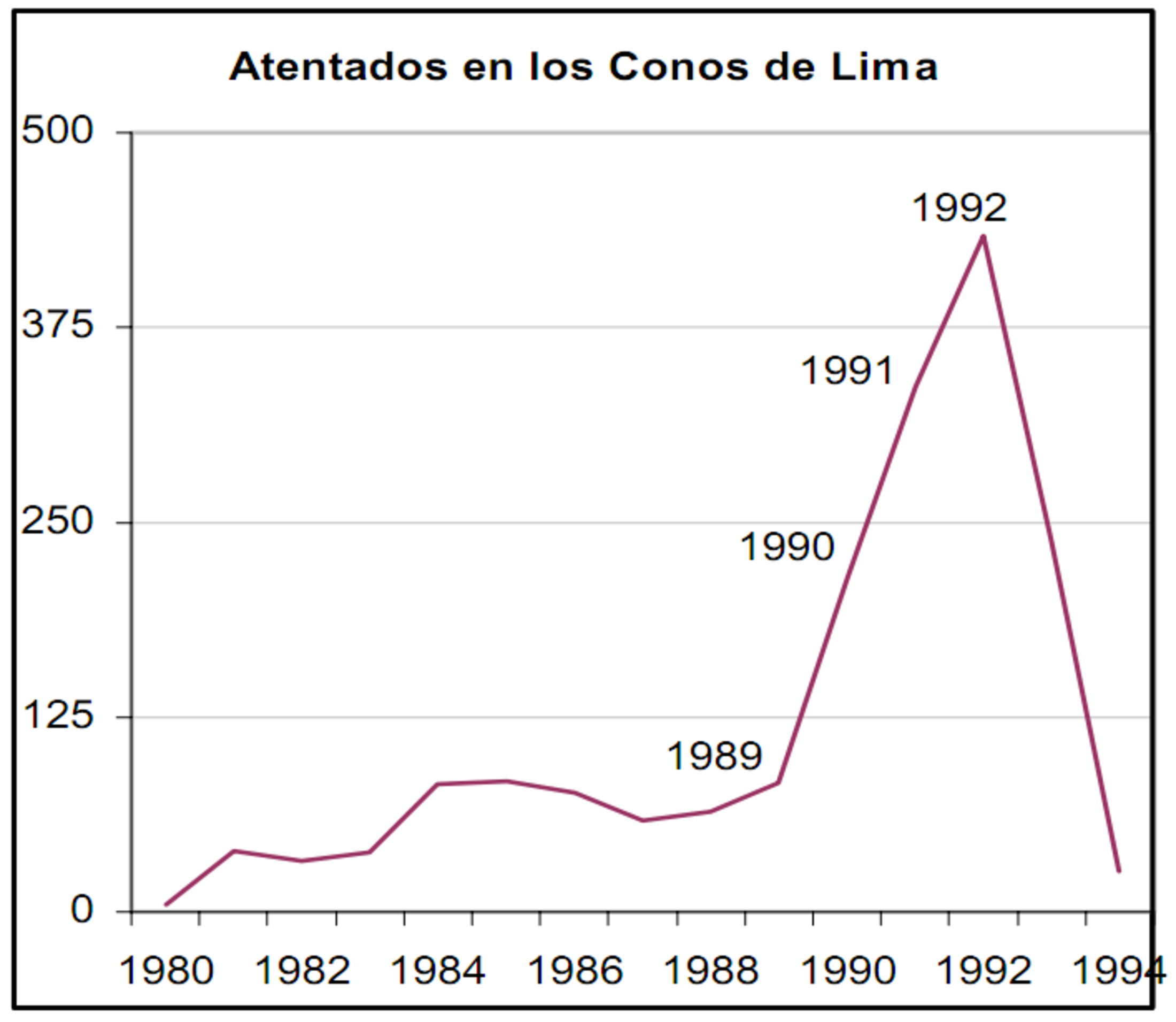
La grève armée
C'est en 1989 qu'est instituée dans les villes, la grève armée qui consiste à organiser le même jour, dans un quartier, une ville, ou le pays, une série d'actions coordonnées impliquant toutes les techniques de la subversion et de l'insurrection : de la simple manifestation à l'attentat armé. Les grèves armées étaient planifiées, organisées et exécutées par les organes qui composent le MDRP, dont le SOPO était le corps de base ; les organisations syndicales, les associations d'entraide, et notamment les services publics de transport, se voient invités, sous la menace si besoin, à y participer par des actions pacifiques à leur mesure, grèves, débrayages, manifestations, commerces fermés, etc.
Le centre ville
À la différence des autres périodes, les attentats se concentrent dans les zones centrales de Lima, centre économique et politique de la nation, des représentations étrangères, des centres commerciaux, et les quartiers résidentiels bourgeois. Pour le PCP-SL, les actes de sabotage et les attaques sur les entités publiques et privées avaient pour objectif de saboter le bon fonctionnement de l'État ; en 1991, entre 60 et 70% des attaques qui se sont produites dans la région métropolitaine de Lima se situent dans ces quartiers, devenus la cible centrale de la stratégie de «caisse de résonance». En juillet 1992, l'attentat à la voiture piégée de la rue Tarata, soufflant un immeuble d'habitation dans le quartier chic Miraflorès, faisant 15 victimes civiles, sera le point culminant de ces attaques ; peu apprécié, du reste, par la population.
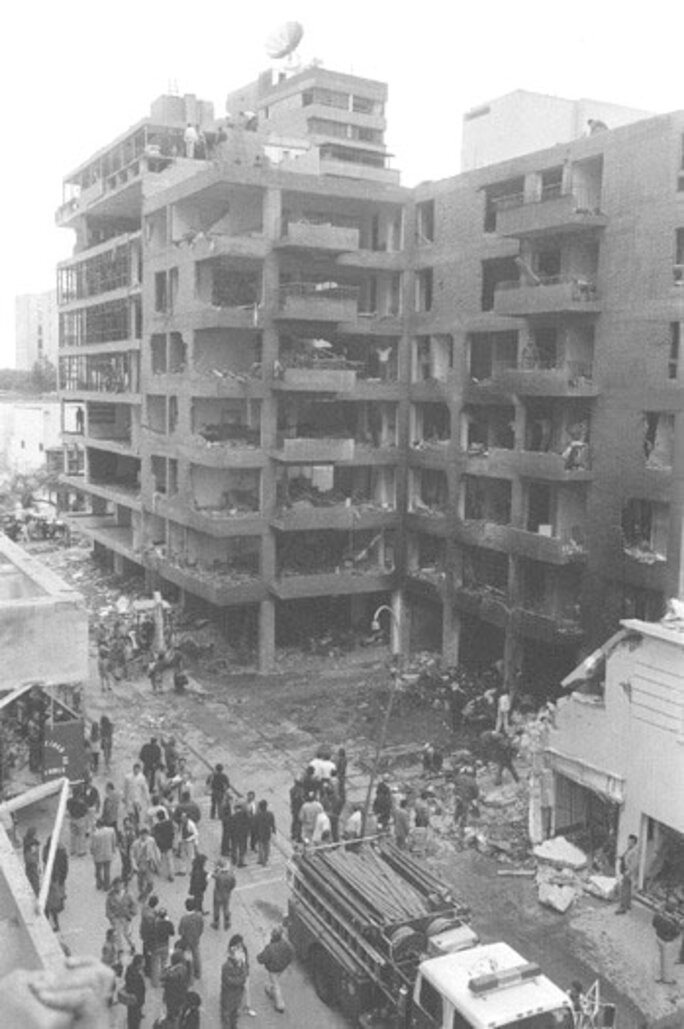
Les barriadas
Le plan de l'«équilibre stratégique», outre les attentats des quartiers centraux devant terroriser la classe dirigeante et réactionnaire et assurer une propagande internationale, donne également une importance stratégique à la ceinture de misère de la capitale. Dans les bidonvilles des cônes d'expansion de Lima, le PCP-SL augmente les actions, diversifie les lieux d'attaque et de propagande publique, et développe une forte pression (intimidation, assassinat) sur les chefs de quartier, les responsables des organisations et des associations d'entraide ou de survie.
Les militants senderistas au sein des organisations de « façade », dans les assemblées de district, tentent d'influencer les habitants, de radicaliser leur position et leurs actions. En 1989/1990, le contexte économique leur était plus que favorable : les conséquences del'hyperinflation des dernières années du gouvernement du président Garcia et de l'ajustement imposé par le nouveau président Fujimori seront désastreuses pour l'ensemble des classes moyennes et plus encore pour les populations défavorisées ; en 1991, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Arrestations
A partir de 1990, les captures de leaders du PCP-SL et du MRTA se multiplient à Lima ; en janvier 1991, la police arrête huit membres du MRTA dont Jésus-Maria Alberto Gálvez Olaechea, leader du MRTA, avec Rosa Luz Padilla ; les 22 et 23 Juin 1991, la police capture plusieurs dirigeants du PCP-SL, Titus Travezaño Valley, et Victor Catano Zavala ; en avril 1992, une offensive policière permet la capture de 23 senderistas dont Jorge Luis Araujo Durand et Danilo Blanco ; et de, Peter Schulte Cardenas, leader du MRTA, condamné à la réclusion à perpétuité ; le 21 Juin 1992, sont capturés 18 senderistas des services de la logistique et de l'économie ; auparavant en mai 1992, 35 prisonniers accusés de terrorisme sont tués, dont des leaders du PCP-SL : Deodato Cruzatt Hugo Juarez, Yovanka Pardavé Trujillo, Tito Valle Travezaño, Elvia Sanabria Nila Pacheco. L'épilogue de cette séquence a été, comme nous le savons, la capture d'Abimael Guzman, en septembre 1992, avec Elena Iparraguirre et Laura Zambrano ; en octobre 1992, Martha Ruiz, chef du Comité du Secours Populaire est capturée.

Agrandissement : Illustration 52

De très nombreux signes alarmant indiquaient, peu avant la capture des leaders du PCP-SL, la dégénérescence de la guerre révolutionnaire dans les zones rurales et à Lima : le refus de populations andine ou d'Amazonie de se plier aux contraintes, aux règlements stupides du PCP-SL, la recrudescence des milices paysannes anti-subversives, les succès militaires des forces armées, des actions anti-subversives de la police, et selon témoignages de militants, la désorganisation du Parti qui avait érigé le culte d'une personnalité : Abimael Guzmán.
La fin de la violence: 1993 – 2000
Avec la capture de Guzmán et des principaux leaders, les actions du Sentier lumineux se poursuivent, mais les attaques à Lima, progressivement s'espacent. Ces captures constituèrent un apport fondamental pour obtenir la défaite stratégique du PCP-SL et du MRTA et profitèrent pleinement au régime de Fujimori qui a gagné en crédibilité ; qui en profite pour adopter une série de lois liberticides, une législation antiterroriste dans la perspective de donner le coup de grâce aux révolutionnaires. Un changement s'opère dans la stratégie contre-insurrectionnelle des forces armées, donnant dorénavant une importance accrue aux activités de renseignement, encourageant la délation, la création de milices urbaines anti-subversives généreusement récompensées. Une loi sur le Repentir est promulguée en 1992. Les anti-communistes, les farouches opposants à la révolution, parents ou proches de victimes, maintenant moins vulnérables aux représailles du PCP-SL et du MRTA, commencent une chasse aux guérilleros et à leurs sympathisants. Les groupes paramilitaires – notamment le Colina - multiplient les assassinats et les disparitions tandis que les centres de torture questionnent et tuent.

Agrandissement : Illustration 53
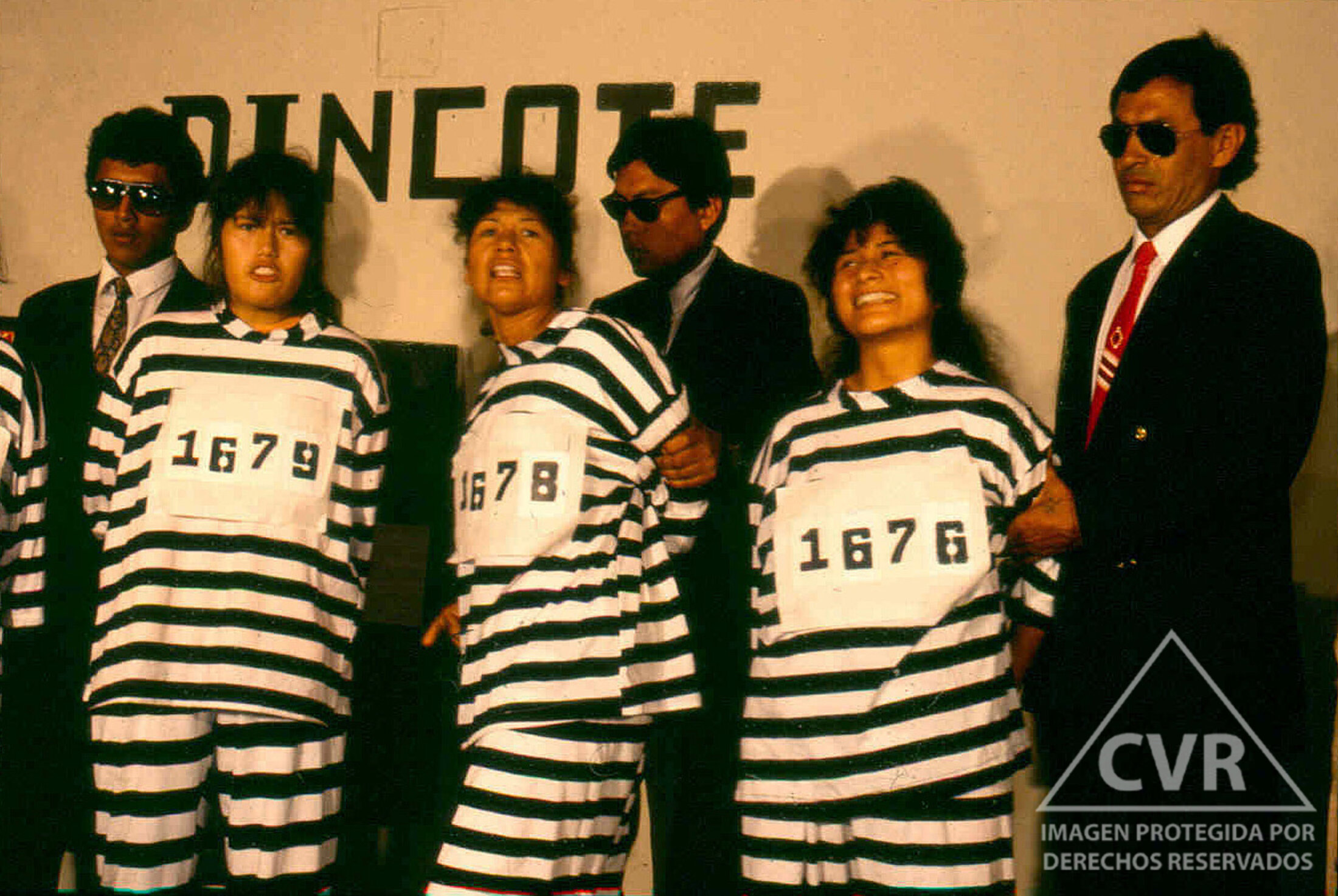
Le pire est à venir en novembre 1993, après les déclarations de Guzmán qui accepte, depuis sa prison, un accord de paix, demandant au PCP-SL d'arrêter la lutte armée. Si certains guérilleros contestent cet accord, et maudissent l'ancien Président Gonzalo, nombreux sont ceux qui abandonnent la lutte [300 prisonniers acceptent la paix] tandis que les populations sympathisantes, face aux représailles, démoralisées accusent le choc et les coups. Feliciano, nouveau leader du PCP-SL, continue la lutte armée et lance le VIe plan militaire. Néanmoins, en 1993, la lutte armée à Lima est quasiment terminée, mis à part des actions sporadiques, sans véritable conséquence. D'autre part, à partir de 1993, certains commandos de senderistas commencent à agir pour leur enrichissement personnel ; d'autres se détachent du PCP-SL pour former des factions adverses.
Cela étant, à Lima, se reforment des cellules clandestines, comme celle du quartier de Chosica, exécutant divers actes de sabotage, d'attentats, etc. Ainsi, les 17 - 19 mai 1993, est organisée une grève armée, suivie par les camionneurs. Cette période de déclin prend fin le 17 décembre 1996, avec la prise d'otages de l'ambassade du Japon, conduite par le MRTA, sa dernière action ; la «crise des otages » se termine en avril 1997 par une intervention militaire et la mort de 14 membres du MRTA, certains blessés, sont achevés après s'être rendus.
La poursuite de la lutte armée
À partir de 1993, les senderistas abandonnent les villes et Lima pour se replier vers leur sanctuaire des Andes. Les organisations sont dissoutes, faute de militants, par l'arrestation des leaders. Cela étant, après la période de répression du président Fujimori, et l'arrivée d'un nouveau président, des senderistas, des militants réinvestissent l'espace social de la vie politique, et plus particulièrement l’activité syndicale, notamment les syndicats d’enseignants et étudiants ou locaux. À la fin des années 2000, la « Dircote » direction anti terroriste de la Police, identifia 18 membres du « Comité de Direction métropolitain de Lima » assurant un travail juridique et politique pour obtenir la libération de camarades emprisonnés. Des députés ont dénoncérent l’attitude de certains enseignants, utilisant leurs cours pour encenser la pensée de Mao Tsé Tung et de ses disciples péruviens. Le PCP-SL eut même recours à Facebook pour sa propagande, des dizaines de comptes ayant été ouverts par le « camarade Netzel Lopez » pour glorifier la lutte armée des senderistas.
STRATÉGIE DE CONTRE-INSURRECTION

Torture, meurtres, disparitions
Dès le début des hostilités, l'armée et la police utilisèrent les techniques conventionnelles de la contre-guérilla et anti-subversives : massacres de population et de prisonniers, vols et viols dans les villages, torture de suspects, disparitions de sympathisants, guerre psychologique, etc. ; des lois d'exception seront votées, des couvre-feu dans les villes instaurés, la justice mise au service des forces de la répression, les médias seront, en partie, censurées et diffuseront une formidable propagande pour couvrir l'inhumanité des actions de la répression.
Les pratiques de la torture et de l'assassinat, de disparition et des détentions abusives sont dénoncées par l'ensemble des institutions internationales dont Amnisty International ; qui , en mai 1982, évoque dans un rapport, la violation des Droits de l'Homme contre les “terroristes” politiques. En 1985, le Movimiento Internacional de Juristas Católicos affirme que les autorités péruviennes violent systématiquement les Droits de l'Homme et soutient que 92 % des détenus politiques - les terroristes - ont été victime de torture. Ces pratiques vont évidemment s'intensifier pour culminer peu avant et surtout après l'élection présidentielle de Fujimori ; les groupes paramilitaires, notamment l’escadron de la mort dénommé Colina, utiliseront des tactiques éprouvées, comme celle, par exemple, d'assassiner des personnalités de gauche – intellectuel, homme politique, syndicaliste, etc. - en se faisant passer pour des militants du PCP-SL ou du MRTA. Les syndicalistes, les universitaires et les étudiants seront les principales victimes et ils seront nombreux à disparaître.
Un ensemble de dispositifs se complétant parfaitement et ayant fait ses preuves dans d'autres pays en révolution. Mais malgré cela, le PCP-SL maintenait une pression extraordinaire et semblait, de jour en jour, se renforcer, même si dans certaines régions, les senderistas étaient en repli.

Militarisation de la société
Ce n'est véritablement qu'à partir de 1989, que les Forces armées établirent une “véritable” stratégie contre-subversive, en distinguant trois types de population : les amis, les neutres et les ennemis. Un contingent fut chargé d'éliminer les ennemis militaires, les milices civiles rurale et urbaine seront renforcées et encouragées, tandis que les groupes paramilitaires parachevaient l'ensemble du dispositif. Puis, à partir de la présidence [1990] et de la dictature [1992] d'Alberto Fujimori, ce système déjà perverti engendra une militarisation de la société. Dès les premiers temps de la présidence Fujimori, les crédits – directs et indirects - concernant l'action sociale diminuent, tandis que le budget destiné aux Ministères de l'Intérieur et des Armées augmente en conséquence : en 1991, entre autres, plus de 200 millions de dollars sont prévus pour la modernisation des équipements militaires ; une somme considérable pour un pays sur-endetté proche de la faillite [il est à noter que le FMI au chevet de l'économie exsangue lui en accordera les crédits].
A. Fujimori, aujourd'hui condamné à 25 ans de prison, assuma comme sienne la stratégie anti-subversive des forces armées et le tribunal qui l'a jugé disposait de preuves raisonnables pour affirmer que le président Alberto Fujimori, son conseiller Vladimiro Montesinos et de hauts fonctionnaires du Service de renseignement ont une responsabilité pénale dans les assassinats, disparitions forcées et massacres perpétrés. Cependant de nombreuses voix au Pérou, aujourd'hui, réclament davantage de Justice car il est singulier que Fujimori soit le seul responsable politique jugé pour les excès de la lutte antiterroriste, et ses prédécesseurs sont également accusés d'avoir autorisé le massacre de civils : en 1982, le président Belaunde Terry fit déployer des « rangers » et fusiliers-marins dans la « zone rouge » du département d’Ayacucho. Le bilan de leur action fut de 2.282 morts, 371 blessés, et 245 disparus. De même pour Alan Garcia Perez, qui au début de son premier mandat le 18 juin 1986, fut confronté aux mutineries des prisonniers politiques détenus dans deux pénitenciers de Lima : le bilan de la répression fut sanglant : 124 morts et aucun survivant à Lurigancho ; et, au terme de 20 heures de combats à l’arme lourde, 119 morts et 29 survivants au Fronton. Des témoignages policiers suggèrent que nombre de détenus furent sommairement exécutés à la fin des opérations, ces excès résultant d’ordres reçus du Conseil des ministres présidé par Alan Garcia. Le fait que Fujimori soit le seul président péruvien d'origine étrangère, à « l’establishment » politique, explique peut être qu’il n’ait pas bénéficié de l’impunité dont ont joui ses prédécesseurs.
Au fur et à mesure que l’offensive militaire progressait, les forces armées appliquèrent une stratégie qui dans un premier temps fut une répression indiscriminée contre la population suspectée d’appartenir au PCP-SL ; et en certains lieux et moments du conflit, le comportement de membres des forces armées non seulement donna lieu à des excès individuels de la part d’officiers ou de troupe particulière, mais encore à des pratiques généralisées et/ou systématiques de violations des droits humains qui constituent des crimes de lèse humanité ainsi que des transgressions des normes du droit international humanitaire.
Programa de Asistencia Directa
Le président Fujimori, dans un discours à propos des organisations des droits de l'Homme, les considère comme les «idiots utiles» de la subversion, les accusant même d'être des "terroristes infiltrés" (24 septembre 1991). Néanmoins, dans la nouvelle classification militaire de la population, les populations « amies », rurale ou urbaine, pourront bénéficier des largesses financières de l'État – notamment par les programmes d'aide directe [Programa de Asistencia Directa], au détriment des zones « rouges », c'est-à-dire des régions ou des quartiers considérés subversifs, donc ennemis. Ce sera le temps de la stratégie simpliste mais de la plus grande efficacité de « Diviser pour mieux régner » opérant ici à travers la tactique de « gagner les coeurs et les esprits de la population [amie ou neutre] ». Cependant, si dans les campagnes, elle s'avéra particulièrement efficace – comment un village pauvre des Andes pouvait résister aux récompenses offertes contre leur soumission : des tonnes de vivres, de matériels, de médicaments, etc., que ne pouvait proposer le PCP-SL ? -, cette tactique, en ville, ne pouvait compenser les multiples réseaux d'entraide, ainsi que les réseaux de parenté entre les campagnes et les villes.

Agrandissement : Illustration 56

Guerra sucia
Les forces militaires adopteront une stratégie parfaitement adaptée à la mesure du radicalisme des habitants des barriadas et du PCP-SL : à partir du début des années 1990, après l'élection du président Fujimori, la répression militaire et policière devient sanglante ; les tactiques des opérations de terreur effectuées dans les zones rurales seront importées dans les villes, un transfert de la «sale guerre» de la campagne vers la ville, avec une militarisation croissante au sein des quartiers. L'importation de la « sale guerre » [guerra sucia] des campagnes en milieu urbain, comprend la formation de milices civiles, dont l'objectif est de surveiller les mouvements et les activités des guérilleros ou suspectes, d'opérer des missions d'espionnage, de protéger certains secteurs, de procéder à des arrestations, etc. Des missions qu'assureront à Lima, les rondas urbanas, les milices urbaines organisées par quartier, composées d'habitants hostiles aux révolutionnaires. Des milices nommées également « Comité de Défense Urbaine » ou Defensa Civil Antisubversiva équipées par l'armée, recevant des autorités maintes compensations pour leur dévouement. Si certaines en abusent, la majorité exprime une opposition totale à l'idéologie révolutionnaire et se considèrent investies d'une mission de salubrité publique [ou de vengeance, notamment des familles ayant eu un proche victime d'un attentat]. C'était faire acte de grand courage, car les responsables de ces milices, rares, risquent une mort certaine ; les cadavres de ceux qui s'y sont essayé sont ornés de tracts : “ Mort aux milices urbaines”, “Mort aux indicateurs”, “Mort à ceux qui soutiennent l'armée”... Mais après la capture des principaux dirigeants du PCP-SL et du MRPA en 1992, et de la désorganisation qui suivit, ces milices connaîtront, comme la délation, un formidable développement qui, alliées aux opérations répressives des forces armées, constitueront un moyen efficace contre les révolutionnaires.

Agrandissement : Illustration 57

En 1995, alors même que les actions armées baissent d'intensité, le président Fujimori, décida de ne pas désarmer les «Comités de Defensa Civil» qui collaboraient activement avec le gouvernement dans la lutte contre-subversive et de promulguer la loi n° 26479 (juin 1995) exonérant de toute responsabilité pénale et civile les membres des forces de sécurité militaires ou civiles qui feraient l'objet de dénonciation. Les membres de ces comités, ne seront jamais inquiétés, bien que certains commandos se soient rendus responsables d'actes criminels ; en outre, ils continuent d'exister sur la base du statut légal qui leur a été octroyé au plus fort du conflit. Bien plus encore, les miliciens tués ou blessés dans le cadre de ces activités peuvent bénéficier d'indemnisations, consacrant leur statut de "vétérans". Tout ceci contribue à la création de véritables contre-pouvoirs au sein de la communauté ; car en effet, dans un pays où les relations sociales se caractérisent par une forte discrimination des populations d'origine rurale et indigène, l'institutionnalisation des milices civiles dépasse le simple fait militaire : elle témoigne d'une certaine reconnaissance de secteurs sociaux généralement marginalisés par un État dirigé par une élite blanche et urbaine. La participation aux milices civiles est ainsi devenue un moyen d'accéder à une citoyenneté dont il est historiquement exclus. En devenant rondero, il voit s'ouvrir les portes d'un imaginaire national auquel il n'a traditionnellement pas accès.

Militarisation des « zones rouges »
Le gouvernement de Fujimori procèdera à la militarisation des "zones rouges", c'est-à-dire les barriadas considérés comme investis ou dirigés par le PCP-SL, en diminuant les programmes d'aides sociales pour au contraire y développer des structures militaires, en encourageant la création de milices urbaines, par un contrôle accru des populations estimées « dangereuses ». Les responsables des programmes sociaux mis en place par les gouvernements précédents sont suspectés ; avec la tendance ultra-répressive du gouvernement Fujimori, les travailleurs sociaux et volontaires sont remplacés au mieux – ou assassinés ou menacés par les paramilitaires - par les militaires ou certaines catégories depadres apolitiques.
Les postes de police qui avaient été évacués sont réouverts et sécurisés par les militaires, qui deviennent, pour certains, également des centres d'aide distribuant gratuitement de la nourriture ou fournissant gratuitement des soins. Des casernes, des campements et des bases militaires sont implantés provisoirement ou pour plusieurs années. Les quartiers sont quadrillés de barrages permettant les contrôles d'identités, les fouilles, et au-delà assurent une mission de propagande. En 1991, sont créées les bases militaires à Raucana, à Huaycán, à San Juan de Lurigancho, à Villa El Salvador et dans bien d'autres barriadas de Lima. Les témoignages d'habitants de zones « rouges » évoquent l'extrême brutalité des militaires lors des raids, faits au petit matin ou la nuit, comprenant des centaines d'hommes armés, destinés à ratisser/perquisitionner chaque masure, à contrôler l'identité des habitants et au-delà à instituer un climat de terreur. Lors de certains raids, des centaines d'habitants sont arrêtés et emmenés par camions dans les casernes en vue d'un interrogatoire ou, pour les plus suspects, les sans-papiers, à une séance de torture. Les vastes barriadas de Lima, labyrinthiques qui avaient jusqu'alors protégés les habitants devenaient au contraire, les principales cibles de la contre-insurrection.
CONCLUSION
D'anciens guérilleros emprisonnés – certains à vie - ont pu consacrer leur temps à réfléchir et à analyser les causes qui ont conduit à la défaite des groupes révolutionnaires. Ces témoignages s'inscrivent dans deux visions opposées, celle – larmoyante - des repentis et celle, plus convaincante, de ceux, qui sans renier la révolution, analysent avec discernement les erreurs commises, condamnent la spirale de la violence aveugle initiée par les forces armées ayant entrainé les senderistas, la structure organisationnelle du PCP-SL, et pour certains, la stratégie du guide suprême : Guzmán. Sans doute, faudra-t-il analyser la dérive du PCP-SL, qui érigea un culte malsain de la personnalité à Guzmán, qui à partir du Congrès de 1988, est le seul a pouvoir décider ; a changer le nom même du PCP-SL en « Partido Comunista del Perú, marxistaleninista-maoísta, pensamiento Gonzalo ».
Les principales raisons évoquées pour expliquer la défaite sont les circonstances politiques nationales et internationales extrêmement défavorables de la période : celle, au Pérou, du retour de la démocratie, de l'effondrement des lambeaux du communisme, de l’URSS, de ce qu’il était convenu d’appeler « le camp socialiste », et de la déroute électorale du sandinisme au Nicaragua. La révolution contre un gouvernement démocratique, la Gauche parlementaire, laissaient les groupes révolutionnaires sans la nécessaire supériorité morale indispensable pour une quelconque victoire révolutionnaire. Son fonctionnement a agi comme un pare-choc et ses alternatives pour traiter les réclamations, les conflits et construire des représentations politiques convenant tant bien que mal à la majorité des Péruviens. Cela est particulièrement vrai pour le MRTA, vaincu par ses propres contradictions internes. En outre, pratiquement, l'existence d'une gauche morale qui a été la deuxième force électorale pendant longtemps, limitait les espaces de recrutement par les groupes subversifs.
La Gauche
La classe moyenne « urbaine » cultivée et progressiste – instituteur, professeur, universitaire, profession libérale issue du prolétariat, etc. - luttait avant tout, pour maintenir ses avantages – salaires, retraites, etc. - et préférait le réformisme plutôt que la révolution communiste ; le mur écroulé de Berlin en 1989 interrogeait les uns et les autres. Cela étant, le monde intellectuel de Gauche, face à une économie défaillante, véritable fabrique de pauvreté, face à un niveau de corruption extraordinaire, au contact dans les universités d'une nouvelle génération d'étudiants issue de l'immigration andine et/ou des classes pauvres urbaines, ne pouvait condamner ou s'opposer véritablement, par conviction, à leur élan révolutionnaire ; la moitié de la population de Lima vivant dans des barriadas leur rappelait que la démocratie parlementaire n'est pas synonyme de Justice sociale. Tant de pauvreté dans les barriadas de Lima, les villages de pêcheurs de la côte Pacifique, dans les villages, les hameaux de la Cordillère des Andes, de l'Amazonie : pour certains, il était admis que les actions d'un gouvernement démocratique même socialiste se réclamant du capitalisme, seraient incapables de résoudre les contradictions de la société péruvienne, d'effacer les inégalités, de redistribuer les richesses, d'amoindrir les conséquences de l'héritage, de changer véritablement le cours des choses. Dans le monde intellectuel de Gauche, les rapports entretenus avec les groupes révolutionnaires sont ambigus, entre rejet et interrogation, entre fascination et condamnation : nombreux sont ceux qui se convertiront à leur idéologie, nombreux sont les guérilleros déçus qui s'en détourneront. Enfin, le gouvernement de Fujimori, qui considérait entre autre les intellectuels, les étudiants, les travailleurs sociaux et les défenseurs des Droits de l'Homme comme des sympathisants du PCP-SL, engagea une répression impitoyable, massive et générale contre ces catégories socio-professionnelles ; les assassinats, disparitions, intimidations, vexations eurent raison de leur engagement en faveur du peuple.
Aristocratie ouvrière et Classe moyenne
Finalement, un des plus grands freins à la révolution – outre la bourgeoisie, les classes dirigeantes - sera la classe moyenne, y compris l'aristocratie ouvrière et les paysans bénéficiaires des nombreuses réformes agraires. En effet, une des armes contre-révolutionnaires des gouvernements, après les rébellions de 1965 et depuis la dictature de 1968, sera une meilleure redistribution des richesses, d'accorder des avantages aux uns et aux autres, en vue d'une paix sociale : une des conséquences, et non des moindres, est l'apparition d'une classe ouvrière aristocratique, peu nombreuse mais unie, qui grâce aux réformes et à l'action syndicale a vu s'élever son niveau de vie : les ouvriers agricoles des grandes plantations de sucre et de coton, les ouvriers du pétrole, devenus en quelque sorte des « privilégiés » du monde du travail, ainsi que les paysans ayant obtenu gratuitement quelques hectares de terres cultivables, tiennent-ils à conserver les avantages arrachés de haute lutte ; d'où leur action prudente et leur peu d'enthousiasme pour une politique plus radicale, voire même en faveur des déshérités et des minorités ethniques. Abimael Guzmán déclarait en 1988 : « En ce qui concerne le poids du Parti à la campagne, ce que nous pouvons dire concrètement, c'est que la majorité de notre force militante est paysanne, l'immense majorité; et notre limitation est le nombre insuffisant d'ouvriers. Nous avons là une limitation sérieuse mais nous faisons et nous ferons plus d'efforts pour la surmonter parce que nous avons besoin de communistes prolétaires, d'ouvriers. En effet, ils nous transmettent cette résistance, cette fermeté d'acier qui les caractérisent en tant que classe. »
Classes populaires urbaines
Pour ce qui concerne les classes populaires, les raisons qui ont propulsé certains habitants pauvres dans la guerre contre-révolutionnaire, s'expliquent en grande partie par le niveau de répression des forces armées et contre-insurrectionnelles, mais également en réaction contre l'extrémisme ultra-radical du PCP-SL : éliminer des travailleurs sociaux, des syndicalistes, des responsables d'organisations d'entraide, de cantines populaires, des élus de Gauche, des personnalités appréciées, non soupçonnées de corruption ou d'abus quelconque, refuser à ce point le dialogue ou l'infime compromission, toute cette stratégie de la violence, opérant contre les défenseurs des plus pauvres, ne pouvait être comprise et admise ; de même pour ce qui concerne la destruction d'équipements publics – déjà rares – dans les barriadas, ajoutant encore une charge supplémentaire à la misère humaine. Cette désapprobation populaire, large, massive, limitera le capital-sympathie, et sera certainement, une des conditions de la défaite du PCP-SL.
Forces obscures
D'une certaine manière, la lutte armée a permis à ce que les forces les plus obscures et rétrogrades de la société utilisent la révolution pour donner une légitimité à leurs propres projets anti-démocratiques et à leurs forfaits, avec la prétention d’entrer dans l’histoire en tant que « héros de la pacification » et « sauveurs du Pérou ». Ainsi, dans les campagnes, les ronderos des Comités d’autodéfense ont joué un rôle central dans la défaite stratégique du Sentier lumineux et en certains cas, ces milices civiles armées ont outrepassé leur rôle d’autodéfense et ont été responsables de crimes contre les senderistas mais également contre les populations civiles. Certains observateurs notent que cette violence extra-politique est sans doute le fait de la réactivation de vieux conflits intra et intercommunaux dont l'origine est à trouver dans les réformes agraires de 1968 et des partages des terres.
Dans les villes de province et plus particulièrement à Lima, c'est tout un secteur de la population de la société péruvienne, qui a approuvée la stratégie anti-subversive et la répression des forces armées. Les populations urbaines des couches sociales moyennes, blanches, instruites, bénéficiaires des services de l’État et vivant dans des régions éloignées de l’épicentre du conflit, apportaient tout leur soutien aux gouvernements, pour une solution militaire sans contrôle civil. Une population qui acceptait avec indifférence ou réclamait une solution rapide, disposée à troquer la démocratie pour la sécurité et à tolérer les violations des Droits de l'Homme comme prix nécessaire pour en terminer avec la guerre.
Le radicalisme du PCP-SL
Il faut savoir que parmi les plus pauvres habitants des bidonvilles, la violence du PCP-SL était reconnue comme légitime, et nous l'avons évoqué, un guérillero assurait que leur radicalisme dépassait celui des dirigeants du Parti ; ainsi pouvaient-ils approuver l'élimination de tortionnaires, de généraux, de para-militaires des escadrons de la mort, de personnalités politiques du gouvernement et d'élus municipaux coupables de corruption, et de responsables civils d'organisations d'entraide et de survie. De même de l'élimination ou des actions punitives et de justice populaire, dans l'enceinte des barriadas, des trafiquants, des délinquants, des voleurs. À partir du milieu des années 1980, les formes de violence dans les nouveaux barriadas, qu'elles soient politique, idéologique, issue de la délinquance ou liée à la survie, y était extrême ; la vie d'un pauvre cholo ou d'un indio y était considérée sans valeur, la solidarité n'imprégnait guère les consciences, et les pauvres volaient ou tuaient les pauvres.
Ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980 que la nouvelle stratégie des forces contre-insurrectionnelles, de « conquérir le coeur et l'esprit des masses populaires », mais aussi leur ventre, leur assura une emprise dans les bidonvilles de Lima : la distribution [par tonnes via la « solidarité » internationale] gratuite de vivres et de produits de première nécessité – de survie – opéra un changement radical dans l'attitude des plus pauvres populations. Les zones de barriadas considérées comme non subversives pouvaient recevoir des vivres tandis que les zones « rouges », atteintes par la subversion, ou suspectées de l'être, étaient condamnées à l'auto-subsistance. Le PCP-SL, face aux arguments d'une tactique particulièrement efficace, ne pouvait rien lui opposer, ni la combattre, ne serait-ce qu'en dynamitant quelques entrepôts ou en interdisant à la population d'accepter cet assistanat contre-révolutionnaire. Dès lors, face à une situation dangereuse, où les efforts de persuasion révolutionnaire n'opéraient plus autant sur les consciences et les ventres affamés, où la délation anti-subversive se développait, il est apparu nécessaire au PCP-SL d'engager des actions contre les responsables civils des organisations de survie, contre les élus municipaux profitant des aides de l'État pour asseoir leur légitimé. Abimael Guzmán évoque en ses termes la violence révolutionnaire :
« En ce qui concerne la violence, nous partons d'un principe établi par le Président Mao Tsétoung: la violence est une loi universelle, sans aucune exception, je veux dire : la violence révolutionnaire; c'est cette violence qui nous permet de résoudre les contradictions fondamentales, avec une armée, et à travers la guerre populaire. Pourquoi partons-nous de la thèse du Président Mao ? Parce que nous croyons qu'avec lui, le marxisme s'est réaffirmé et a réussi à établir qu'il n'y a aucune exception. Marx, déjà, nous parlait de la violence accoucheuse de l'histoire, ce qui reste pleinement valable et grandiose. Lénine, à propos de la violence, nous parlait du panégyrique de la violence révolutionnaire, fait par Engels. Mais ce fut le Président Mao qui nous dit que c'est une loi universelle sans aucune exception. C'est pour cela que nous nous basons sur cette thèse. C'est une question essentielle du marxisme parce que sans violence révolutionnaire, une classe ne peut pas se substituer à une autre, ne peut pas renverser un vieil ordre pour en créer un nouveau, en l'occurrence aujourd'hui un nouvel ordre dirigé par le prolétariat au moyen de partis communistes. Le problème de la violence révolutionnaire est une question qui revient de plus en plus sur le tapis. C'est pourquoi nous, les communistes et les révolutionnaires, devons nous réaffirmer dans nos principes. Le problème de la violence révolutionnaire est dans la concrétisation de la guerre populaire. Pour nous, le Président Mao Tsétoung, en établissant les principes de la guerre populaire, a doté le prolétariat de sa ligne militaire, de sa théorie et de sa pratique militaire, de valeur universelle, donc applicable partout, selon les conditions concrètes. Le problème de la guerre, nous le voyons ainsi: la guerre a deux aspects; l'un de destruction, l'autre de construction, l'aspect de construction étant le principal. Et ne pas voir les choses ainsi, c'est saper la révolution, c'est l'affaiblir. D'un autre côté, dès que le peuple prend les armes pour renverser le vieil ordre, la réaction cherche à l'écraser, à le détruire, à l'anéantir; et elle utilise tous les moyens à sa disposition, allant jusqu'au génocide. Dans notre pays nous l'avons vu, nous sommes en train de le voir et nous le verrons plus encore, jusqu'à ce que nous ayons démoli l'Etat péruvien caduc.
En ce qui concerne la soi-disant guerre sale, je préfère simplement dire qu'on nous impute le fait que la force armée réactionnaire a appris de nous cette guerre sale. Cette accusation est l'expression claire de l'incompréhension de ce qu'est une révolution, de ce qu'est une guerre populaire. La réaction applique, au moyen de ses forces années et de ses forces répressives en général, sa volonté de nous balayer et de nous faire disparaître. Mariategui disait déjà qu'on ne peut engendrer un nouvel ordre social qu'en détruisant, qu'en démolissant le vieil ordre. Nous jugeons, finalement, ces problèmes à la lumière du principe essentiel de la guerre, établi par le Président Mao: l'anéantissement des forces de l'ennemi et la préservation des siennes. Et nous savons très bien que la réaction a appliqué, applique et appliquera le génocide. Sur ce point nous sommes extrêmement clairs. Et, en conséquence, se pose pour nous le problème du prix à payer: pour anéantir l'ennemi, préserver nos propres forces et plus encore pour les développer, il faut payer le coût de la guerre, payer de notre sang. Le sacrifice d'une partie est nécessaire au triomphe de la guerre populaire. En ce qui concerne le terrorisme. On nous qualifie de terroristes. Je veux seulement répondre de cette manière pour que tous, nous réfléchissions. N'est-ce pas l'impérialisme yankee, et particulièrement Reagan, qui a accusé de terrorisme tout mouvement révolutionnaire ? Oui ou non ? C'est ainsi qu'ils cherchent à discréditer et à isoler pour mieux écraser; c'est ce dont ils rêvent. (…)
Mais il serait très utile de nous rappeler ce que Lénine écrivait : «Vive les initiateurs de l'Armée Populaire Révolutionnaire ! Ce n'est plus un complot contre un quelconque personnage haï, ce n'est pas un acte de vengeance, ce n'est pas une sortie poussée par le désespoir, ce n'est pas un simple acte d'intimidation, non: ceci est le commencement bien médité et préparé, calculé, du rapport de forces, c'est le commencement des actions des détachements de l'armée révolutionnaire.» Heureusement les temps sont révolus où, par manque d'un peuple révolutionnaire, la révolution "était faite" par des terroristes révolutionnaires isolés. La bombe a cessé d'être l'arme du "poseur" individuel et est devenue l'élément nécessaire de l'armement du peuple.» Déjà Lénine nous enseignait que les temps avaient changé, que la bombe était devenue l'arme de combat de la classe, du peuple, qu'elle n'était plus une conjuration, une action individuelle isolée, mais l'action d'un Parti, avec un plan, avec un système, avec une armée. Les choses étant ce qu'elles sont, où est le soi-disant terrorisme ? Ce n'est que pure infamie.
En fait, on doit avoir très présent à l'esprit que dans la guerre contemporaine en particulier, c'est précisément la réaction qui utilise le terrorisme comme un de ses moyens de lutte, et comme cela a été prouvé mille fois c'est une forme de lutte quotidienne des forces armées de l'Etat péruvien. Au vu de ce qui précède, nous pouvons conclure que ceux qui jugent la situation avec désespoir parce que la terre tremble sous leurs pieds, crient au terrorisme dans le but de cacher la guerre populaire. Mais c'est un tel choc qu'eux-mêmes reconnaissent sa dimension nationale et reconnaissent que c'est devenu le problème principal qu'affronte l'Etat péruvien. Et quel terrorisme agit ainsi ? Aucun; et pire encore, ils ne peuvent plus nier qu'un Parti Communiste dirige la guerre populaire. Mais en ce moment certains commencent à réfléchir. Il ne faut condamner personne d'avance, il y a ceux qui peuvent progresser. D'autres, comme Del Prado, n'avanceront jamais.
Lima : l'erreur ?
Pour ce qui concerne la stratégie militaire du PCP-SL, les avis divergent : pour certains observateurs et anciens guérilleros, ouvrir un front à Lima était une erreur : mieux aurait valu concentrer tous les efforts, c'est-à-dire le matériel et les hommes, dans les zones rurales de combat. Selon eux, la transition de la guerre de la campagne vers la ville comme scène principale, est associée à un développement d'un travail politique et militaire préalable dans les campagnes : “l'encerclement des villes” [cerco de las ciudades] et leur prise sont l'extrême phase finale de la guerre, le prélude à la victoire finale, seulement après la conquête des campagnes. C'est schématiquement, ce qui est arrivé en Chine, en Indochine et au Vietnam. Mais les conditions de réussite de ces guerres, tiennent à une situation plus que favorable de domination ou d'agression étrangère qui a permis de mobiliser les couches les plus larges autour d'un objectif à la fois national et social. Une des conditions de réussite d'une guérilla est une organisation et par-dessus tout son infrastructure politique clandestine en liaison avec la population ; c'est cette dernière qui par la suite permet à la guérilla proprement militaire de se développer (recrutement) et de durer.
Ces deux caractéristiques auront, pour l'essentiel, manqué à la guérilla péruvienne. De telles conditions – politiques et militaires – n'étaient pas réunies lorsque Guzmán décida d'intensifier la guérilla urbaine à Lima ; au contraire, en 1988, l'activité des Comités d'autodéfense [Comités de Autodefensa], des rondes et milices paysannes, et la nouvelle stratégie de l'armée qui cherchait à gagner l'adhésion de la population, améliorant sans cesse le travail de renseignement, tout en augmentant au plus haut point la répression, signifiaient que les campagnes n'étaient en aucun cas des zones libérées, ni même des sanctuaires sécurisés pour l'Ejército Guerrillero Popular (EGP) du PCP-SL. Ainsi, La décision de Guzmán de concentrer les efforts sur Lima, par une évaluation totalement subjective de la situation, devait avoir des conséquences graves.
Concernant les conditions d'agression étrangère qui peuvent permettre de souder un peuple contre un ennemi commun, Abimael Guzmán déclarait en 1993, que les «offensives» à Lima, en février et juillet 1992, étaient une tentative de solliciter l'intervention américaine sur le sol péruvien ; cela étant, ses attaques aveugles à la voiture piégée avaient pour cible la classe bourgeoise, actions qui contredisent une quelconque tactique de vouloir unir les couches sociales d'un pays... Dans ce fantastique avenir, Guzmán avait même proposé de renommer des organismes et des structures clés du PCP-SL : l'Armée de guérilla, devenait par exemple, l'Armée populaire de Libération Nationale, prête à combattre les Américains qui inexorablement allaient envahir la "République de la Nouvelle Démocratie”. Étranges propos en fait qui seront contestés par plusieurs dirigeants.
Les médias et la propagande anti-révolutionnaire
Le Partido Comunista del Peru en el Sendero Luminoso sera confronté à un ennemi redoutable - outre les forces militaires - : la formidable campagne de propagande menée à l'échelle planétaire qui l'accusait – encore aujourd'hui - d'avoir été une organisation sanguinaire, inhumaine, pillant, tuant, s'appuyant sur le commerce de la cocaïne, et martyrisant notamment les populations andines et d'Amazonie ; une organisation du malcomparée à celle de Pol Pot. Une campagne médiatique de dénigrement dont la perfection et l'amplitude fera même douter les groupes politiques extra-parlementaires de la Gauche en Europe de son bien-fondé et de sa moralité. Ainsi dans un article, Michel Mommerency, en appelle à la solidarité internationale « et du devoir de tous les communistes et progressistes de combattre activement les campagnes de désinformation et de mensonges de la part de l'impérialisme et de l'anticommunisme. » ; et d'ajouter : « Les critiques de ces derniers ne visent jamais les erreurs, mais toujours l'essence même de la ligne révolutionnaire. Toute organisation révolutionnaire sera sans exception combattue comme «dogmatique», «terroriste», «sanguinaire», comme «secte, coupée des masses populaires». Masses populaires, de qui, chacun le sait, l'impérialisme se soucie profondément. »
Ce sera à nouveau le gouvernement de Fujimori qui est accusé par la Comisión de la Verdad y Reconciliación, d'avoir manipulé les moyens de communication du pays, d'avoir occulté la répression pour au contraire exagérer le « terrorisme », discréditer les opposants politiques de l'ensemble des partis de la Gauche – y compris parlementaire - et justifier ainsi l’autoritarisme du régime.
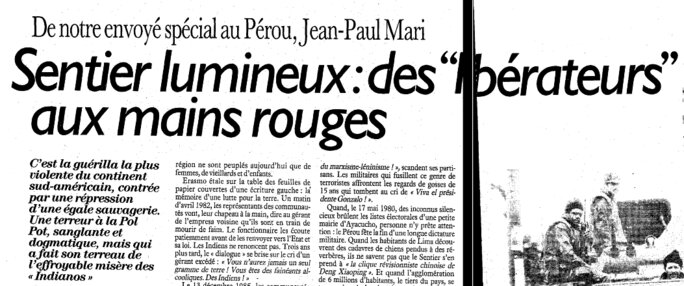
Agrandissement : Illustration 59
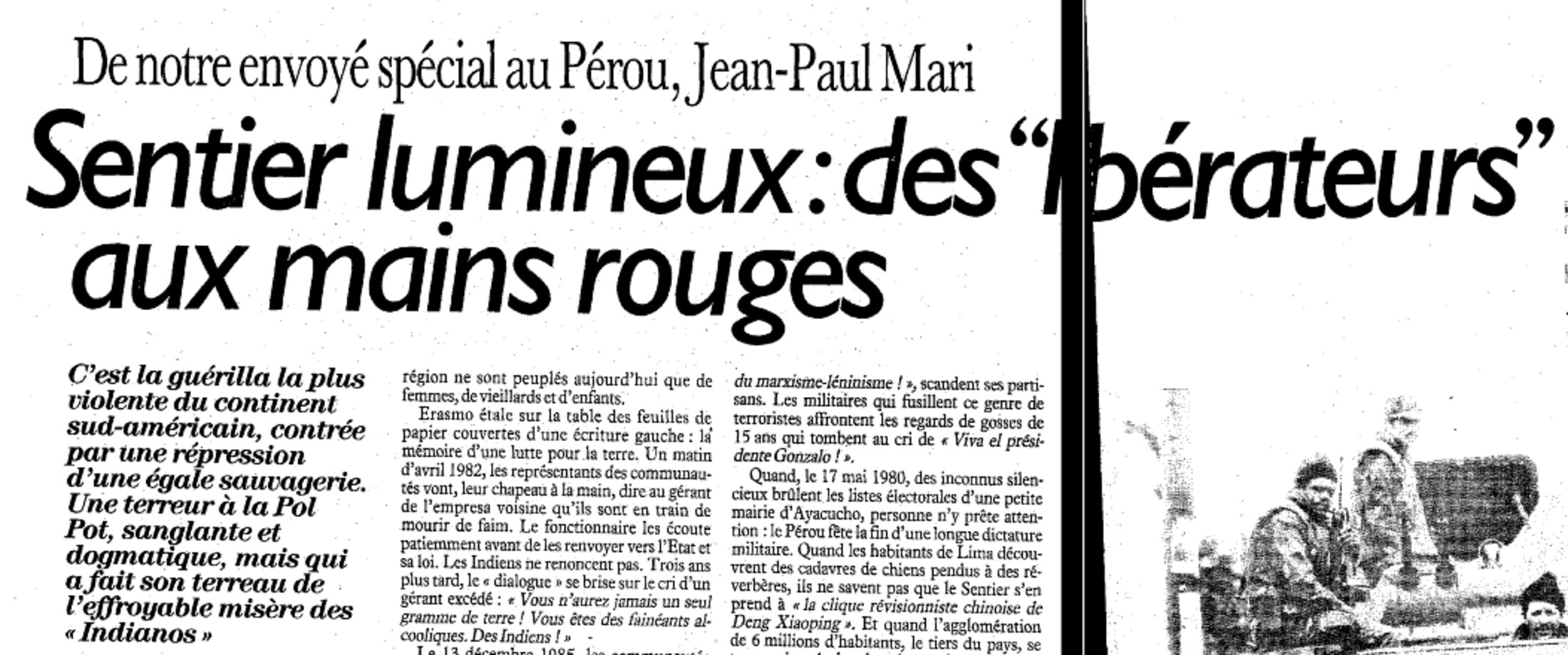
Dans le vaste concert international de la propagande bourgeoise et réactionnaire qui s'attache aujourd'hui encore, plus que jamais, à présenter le PCP-SL comme une organisation génocidaire, n'ayant que la violence à proposer aux masses populaires soumises à leur idéologie, les témoignages des responsables d'organisation non gouvernementale [ONG] internationales, atteignent le summum ; en nous présentant les barriadas du Pérou comme des expériences historiques d'auto-gestion, de participation citoyenne, d'auto-organisation, de solidarité populaire, etc., et leurs habitants comme des pauvres êtres « pris en étau » entre la violence des forces anti-subversives et celle des senderistas. Une population qui, selon eux, s'était engagée massivement dans les mouvements en faveur de la Paix et de la Réconciliation nationale, contre le terrorisme aveugle du PCP-SL. Des affirmations qui selon Guzmán :
« Pour moi, elles sont sans fondement et montrent l'incapacité à comprendre une guerre populaire. Pour moi il est évident que les ennemis de la révolution ne pourront jamais la comprendre. Sur le fait que nous plaçons les paysans entre deux feux, c'est une pure élucubration, parce que ce sont précisément les paysans qui forment l'immense majorité de l'Armée Populaire de Guérilla. Le problème est de comprendre que l'Etat péruvien avec ses forces armées répressives veut noyer dans le sang la révolution. Voilà comment nous comprenons le problème et nous conseillons à ces messieurs d'étudier un peu la guerre en général, la guerre révolutionnaire et principalement la guerre populaire et le maoïsme, même si je doute qu'ils comprennent parce que pour cela, il faut avoir une position de classe. En ce qui concerne les accusations de «terroristes génocides» de M. Villanueva, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une vulgaire imitation et d'un plagiat. Ils veulent nous coller le terme de bouchers, qui leur va comme un gant. Aux yeux du pays et du monde entier, il est clair que ce sont eux les génocides, que c'est le gouvernement de l'Apra qui dirige cet Etat réactionnaire, que ce sont les forces armées réactionnaires, les forces de répression. Ce sont eux les vils bouchers. Les beaux discours ne changeront jamais les faits, l'histoire est déjà écrite. »
Beaucoup d'anciens guérilleros le reconnaissent, le PCP-SL a toujours été confronté, dans ses propres rangs, au sein de même de sa direction comme dans les cellules de base, entre deux lignes : l'opportunisme de droite qui s'opposait à la lutte armée – même après une épuration en 1980 – et l'opportunisme de gauche appelant à une guerre totale ; mais aussi au radicalisme excessif dans l'action de senderistas davantage assoiffés de vengeance que d'idéologie révolutionnaire. Les leaders et Abimael Guzmán, auraient ainsi entrepris des efforts systématiques pour contrôler les «excès» de violence et les débordements bien compréhensibles pourtant de la part de paysans des Andes, véritables esclaves modernes soumis depuis des siècles à l'oppression, au racisme et aux humiliations de l'État et des élites blanches. Pour autant, ces considérations ne doivent pas occulter le recours à la violence révolutionnaire et certaines méthodes qui ont finalement éloignées le PCP-SL du Peuple. Les successeurs d'Abimael Guzmán ont su opérer «l'autocritique» et critiquer les méthodes les plus controversées de l'histoire du PCP-SL, tout en prenant en compte les vagues de répression décidées par les gouvernements, qui occupent une place importante pour expliquer cette violence que l'on peut associer, parfois, à des actes de vengeance personnelle.
Le Pérou, aujourd'hui
Depuis 2002, le Pérou a connu un cycle d’expansion soutenue, affichant une croissance annuelle moyenne de près de 7% jusqu’en 2010. La hausse des cours des produits miniers et agricoles, liée à la vigueur de la demande étrangère, a été le moteur de cette performance, unique en Amérique latine. Pendant la crise de 2008 - 2009, le Pérou a bien résisté à la crise et connu l’un des meilleurs résultats de la région, et la croissance péruvienne a atteint 8,8% en 2010. Mais les problèmes sociaux restent importants. Le chômage (8,9% en 2009) et l’emploi informel (estimé à 60% de la population active) persistent. La pauvreté s’est réduite mais reste élevée (elle touche 34,7% de la population) et touche 70% de la population d’origine indienne. Les conflits sociaux, nombreux, peuvent prendre des formes violentes, comme lors des affrontements survenus à Bagua (Amazonie péruvienne) entre forces de l’ordre et populations indiennes, les 5 et 6 juin 2009, qui ont fait 34 morts (24 policiers et 10 civils), provoquant une importante crise politique et sociale.

Agrandissement : Illustration 60

Contrairement aux déclarations du gouvernement concernant la bonne santé de l'économie, les bidonvilles de Lima se développent. Certains observateurs affirment qu'il s'agit maintenant d'une nouvelle génération de jeunes, décidés à quitter le foyer familial pour fonder une famille, n'ayant aucun autre moyen pour se loger que d'auto-construire, non loin du barriada familial, une baraque. La classe moyenne blanche urbaine, qui a pu bénéficier de la croissance économique a su entretenir un racisme radical à l'encontre des indigènes ; et l'absence remarquable de solidarité marque de son empreinte la vie quotidienne au Pérou. D'une certaine manière, les écarts se creusent entre les plus riches et les plus pauvres, au risque d'augmenter les tensions sociales.
Ce racisme s'est parfaitement exprimé lors des récentes élections présidentielles qui a opposé lors d'une campagne très disputée, le candidat de la gauche Ollanta Humala etincroyablement, Keiko Fujimori, fille de l’ancien Chef d’Etat Alberto Fujimori condamné à 25 années de prison. Ollanta Humala a finalement remporté le deuxième tour de l’élection présidentielle péruvienne, avec 51,5 % contre 48,5 % pour Keiko Fujimori. Le Président élu a fait appel à l’unité nationale, promettant le changement tout en cherchant à rassurer les milieux d’affaires : il ne remettra pas profondément en cause le modèle de croissance péruvien, mais souhaite mettre l’accent sur la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté. Ancien militaire, M. Humala, dont la proximité avec le président vénézuélien Hugo Chavez avait compromis les chances d’être élu en 2006, a depuis fortement modéré son discours. Il s’inspire désormais du modèle de gouvernance de l’ancien président brésilien Lula. Investi le 28 juillet 2011, il a notamment annoncé la mise en œuvre de réformes sociales. Ollanta Humala a constitué un « gouvernement de concertation », réservant en particulier le poste du ministère de l’Economie et des Finances à Miguel Castilla, tenant de l’orthodoxie libérale et membre du gouvernement sortant...

Agrandissement : Illustration 61

Le PCP-SL, aujourd'hui
En 1993, le PCP-SL éclate en multiples factions, certaines perdurent d'autres sont écrasées, d'autres encore agissent pour des motifs d'enrichissement tandis que de nombreux militants abandonnent la lutte armée. Aujourd'hui deux factions se réclamant du PCP-SL s'affrontent : la guérilla de la région VRAE – productrice de la coca -, la plus puissante du pays qui est dirigée par Víctor Quispe Palomino, "camarade José" ; et celle du "camarade Artemio", dans la région de Huallaga, qui les traite de mercenaires et de narco-trafiquants.

Agrandissement : Illustration 62

Les deux nouvelles directions se réclamant du PCP-SL, assumant la défaite, conscientes de leurs faiblesses et des erreurs jadis commises, s'appuient sur une nouvelle stratégie militaire et politique dont l'objectif est la libération des camarades emprisonnés, et de s’assurer le contrôle de zones rurales marginales : la prise du pouvoir par la lutte armée est définitivement abandonnée. Dans ce cadre, la tactique du PCP-SL est un travail social et politique auprès des populations locales : assistance médicale, distributions d’aliments, formation des femmes aux travaux manuels. La responsable locale, « Olga » ex-professeur, incarne cette nouvelle stratégie du PCP-SL qui ne cherche plus à imposer ses convictions idéologiques aux paysans, mais gagne leur sympathie en les aidant au quotidien. Mais après la victoire présidentielle d'Ollanta Humala, homme de gauche et indien, le sentier de la lutte armée semble, pour certains, se terminer.
Le Secours Rouge indiquait dans un article, que José “Pepe” Flores Hala, le "camarade Artemio", principal dirigeant du PCP-SL a donné une interview dans une vallée forestière du Huallaga dans lequel il déclare que la guerre populaire initiée en 1980 contre l’État péruvien a fini dans un échec. Le PCP-SL "garde ses objectifs politiques", a-t-il déclaré, mais "en pratique de nos jours cela n’est pas possible", et que "nous voulons sincèrement une solution politique ; nous voulons qu’elle aboutisse, à travers une table de négociations". Le "camarade Artemio" a proposé une "trêve militaire" pour permettre le début des négociations. Il a évoqué des tentatives précédentes qui ont échouées parce que les autorités exigeait la reddition inconditionnelle de la guérilla maoïste.
En décembre 2011, dans une entrevue télévisée, le ministre péruvien de la Défense a repoussé toute négociation avec le PCP-SL, exigeant la capitulation pure et simple ; de même le ministre de la Justice s’est aussi opposé à toute négociation, toute trêve ou toute amnistie.



