Je voudrais revenir ici sur des exemples d’ouverture et de valorisation de la « diversité culturelle » et « diversité » des enfants dans les écoles maternelles et primaires en France, en proposant, humblement, des axes de réflexion critique et des idées. Dans le cadre de mon travail, j’ai été amenée à travailler avec des enseignant·es, mais aussi des bénévoles d’associations ou encore des bibliothécaires, qui souhaitaient sortir un peu des contenus « classiques » proposés aux enfants, parfois très éloignés de la réalité des enfants des classes ou des groupes.
Pour « faire en sorte que tous les enfants (notamment de parents immigrés ou d’origine immigrée) se sentent inclus » et « faire un pas vers les familles », les enseignant·es proposaient souvent des albums « du monde », des comptines « du monde », des journées « cuisines du monde », des ateliers thématiques de « découverte » sur certains pays. Mais souvent, ces tentatives d’ « inclusion » échouaient, et contribuaient de fait à véhiculer certains stéréotypes, loin des réalités des enfants en question.
Paul et Aminata
Je me souviens notamment d’un album qui était utilisé, qui s’intitulait quelque chose comme « Enfants du monde », étiqueté « diversité ethnique » et « vivre-ensemble » et dans lequel on peut découvrir des enfants de « différents pays » à chaque page, de manière très caricaturale, une fille noire présentée comme sénégalaise, qui s’appelle Aminata, qui mange du mafé, en sorte de vêtements traditionnels et vit dans une case (!), puis un enfant blanc et brun s’appelant Paul présenté comme français, qui mange de la baguette dans un décor ressemblant aux quartiers riches de Paris… Je vous passe les détails des autres représentations d’enfants, qui restent dans la même lignée.
Non seulement ce genre de contenu ne joue que sur d’horribles clichés datés, mais en plus, ce contenu n’est absolument pas adapté aux enfants de France d’origine immigrée, qui vivent et tissent au quotidien plusieurs identités. Quelle place ici pour la reconnaissance de la pluralité d’identités ? Le message que les enfants peuvent recevoir derrière ces images n’est-il pas, on ne peut pas s’appeler Aminata et être française ? Toutes les Aminata ne mangent-elles que du mafé ? Faut-il être blanc et manger de la baguette pour être Français ? Qu’il faut choisir entre deux représentations dont aucune ne leur correspond ? Derrière ce qui peut sembler « anodin », ce sont en réalité des représentations problématiques, voire insultantes, pour les enfants, et le gage d’une grande fermeture d’esprit. Comme souvent, ce qui est pensé comme « valorisé » ici est une « culture étrangère à l’étranger » et non une « culture étrangère en France ». En plus, c’est une « culture » figée et réductrice, souvent fantasmée. Je pense que cela peut faire ressentir aux enfants un sentiment d’aliénation ou de dissociation, bien loin de l’objectif de départ de ces activités.
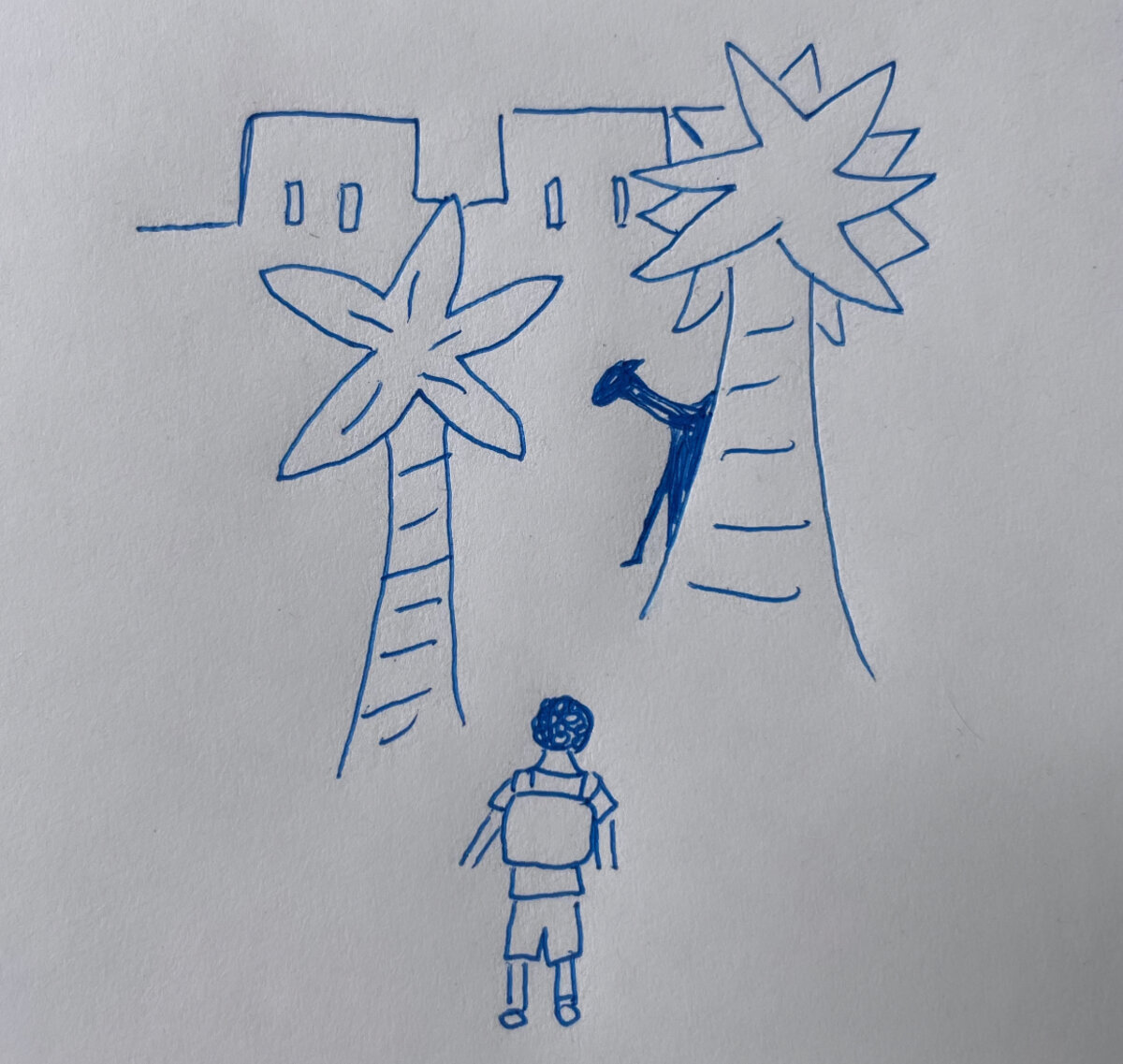
Agrandissement : Illustration 1
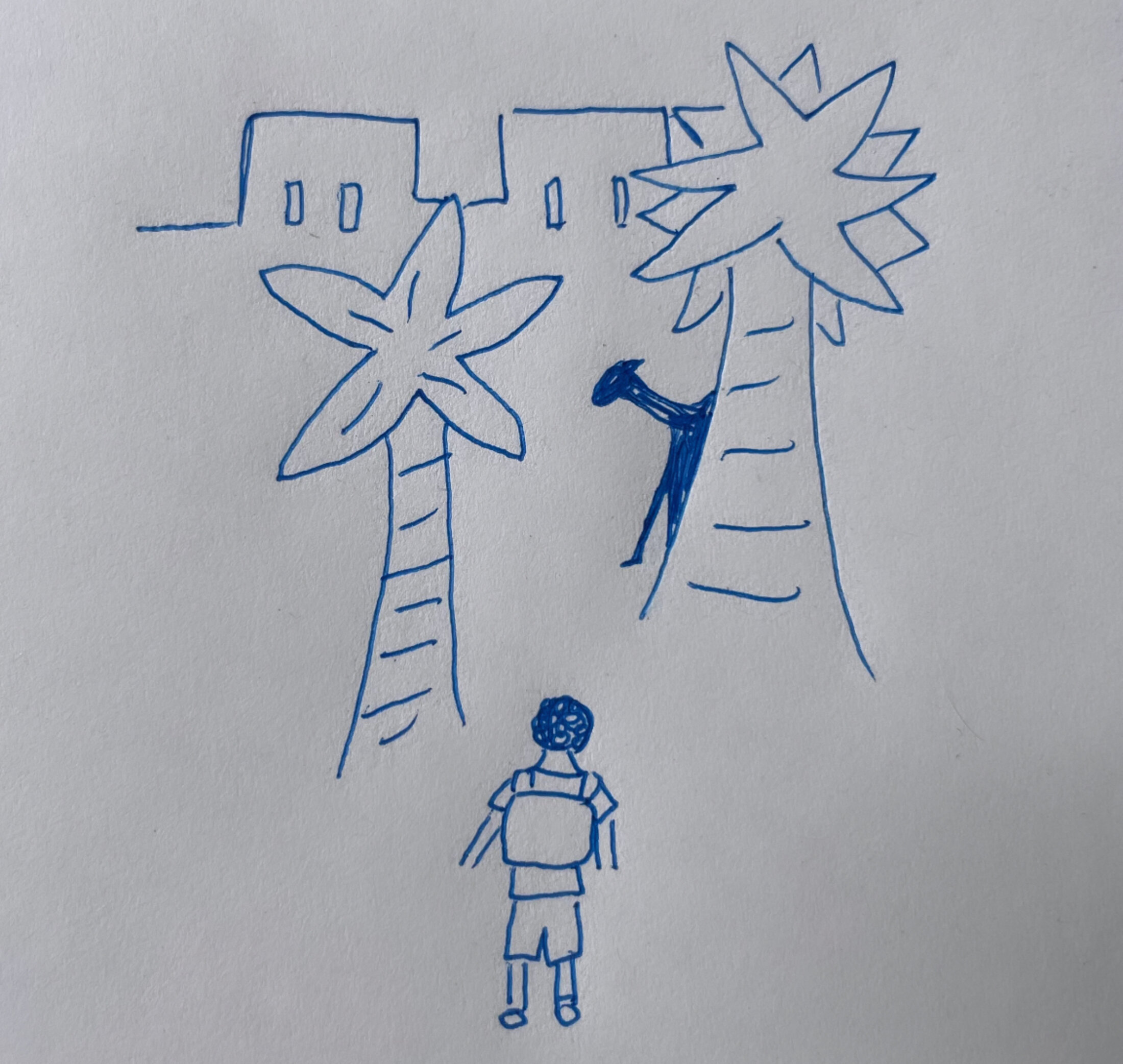
Ali Baba et les palmiers
De même, les albums qui représentent des enfants « arabes », présentent souvent un pays non-identifié (si ce n’est le fantasme construit d’un pays « arabe » lointain d’un temps non-identifié mais qui semble lointain aussi) dans lequel il y a des palmiers, Ali Baba avec un turban sur un dromadaire ou un âne, et j’en passe. Des contes exotiques. Bref, rien à voir ni avec la réalité et les aspirations des enfants arabes de France, ni même d’ailleurs avec la réalité des enfants arabes de pays dits « arabes ». Pourquoi n'aurait-on pas droit, enfin, à des albums dans lequels des enfants comme Farid et Aminata pourraient vivre des aventures en France, ou simplement vivre des histoires avec leurs amis, leurs parents, manger ce qu’ils veulent en fin de compte, que ce soit des céréales au lait, de la pizza, de la mloukhia. Ouvrir un champ des possibles dans la représentation. Ne pas assigner.
La comptine yaourt
Autre contenu souvent proposé dans le cadre des activités d’éveil à la « diversité » ou d’inclusion multiculturelle, les comptines ou chansons « du monde ». Souvent les enseignant·es puisent dans des albums dédiés, des CD. Récemment, une enseignante faisait chanter chaque matin plusieurs chansons aux enfants, dans une langue autre que le français. Lorsque je lui ai demandé dans quelle langue étaient ces chansons, elle m’a dit (tout en se rendant compte au même moment du caractère problématique de la phrase): « je ne sais pas, une langue africaine sûrement ». Elle faisait de fait chanter du yaourt, sans savoir dans quelle langue, sans savoir de quoi parlait cette chanson, avec des percussions qui renforçaient une sorte d’imaginaire « africain ». Il est apparu que c’était en lingala, et que dans la classe, justement, à partir de discussions avec les enfants, deux enfants d’origine congolaise comprenaient le lingala. Mais ils n’avaient pas du tout imaginé que la chanson qu’ils chantaient tous les jours était en lingala… On peut imaginer que leurs parents, comme c'est souvent le cas avec des comptines d’albums de ce type, ne connaissaient pas ces comptines, et qu'elles ne correspondent pas aux comptines réellement chantées dans les familles. Ce qui aurait pu être familier pour les enfants, était devenu une sorte d’invention (exotique), devenu « diversité ». Derrière cette volonté de « diversité », on peut voir une sorte de fermeture d’esprit, ou en tout cas de timidité à vraiment faire un pas vers les familles, un côté aussi ornemental sans sens profond (chanter sans savoir ce que l'on chante). Je pense que peu importe les bonnes volontés, tout le monde peut être pris dans des imaginaires coloniaux, parce que c’est l’héritage historique et encore pour beaucoup le récit majoritaire de notre pays.
Le droit à être multiculturel
Le message multiculturel fondamental, à mon sens, à transmettre aux enfants de France, quels qu’ils soient, n’est pas de réciter des stéréotypes sur des pays, mais de reconnaître leur droit à être multiculturels, leur droit à être pluriels. Et au lieu de leur proposer des contenus, pourquoi ne pas lancer une conversation et une recherche, avec les enfants et les familles ? Pourquoi, au lieu de chercher une comptine inconnue sur internet, ne pas se tourner vers les ressources immédiates que l'on a, les parents ?
J’aimerais proposer d’autres idées d’activités que je mets en œuvre avec des groupes d’enfants ou dans des classes. J’ai proposé à un groupe de plusieurs mamans – de langues maternelles arabe, lingala et turc - de passer avec moi pour faire des ateliers en classes de GS et CP. Dans le cadre de cet atelier, on a proposé une partie « comptines », dans laquelle on a répété les mots importants des comptines à partir de cartes-images (pour que les enfants puissent repérer les mots, les répéter, en identifier le sens), puis à chanter la comptine ensemble. Les parents ont choisi des comptines célèbres en Algérie, au Congo et en Turquie, de sorte que, de fait, les enfants dont les parents étaient originaires de ces pays, connaissaient déjà en grande partie ces chansons. Les compétences travaillées étaient diverses : une activité de traduction et de vocabulaire, un travail de conscience phonologique, une valorisation des compétences des parents et des enfants, un passage du monde de la maison à celui de l’école, des mots qui ont un sens et prennent sens. Il y avait notamment cette chanson en arabe sur un petit chat, que de nombreux enfants connaissaient par cœur et chantaient, ce qui représentait un moment de passage d'une langue à l'autre, d'autorisation de mobilisation de référentiels plurilingues dans le cadre scolaire. Un temps d'"éveil aux langues", bénéfiques à tous les enfants, allophones, plurilingues, ou monolingues. L’enseignante nous a dit qu’elle ne pensait pas que les enfants de sa classe connaissaient autant de vocabulaire, et de chansons, dans d’autres langues que le français. L'objectif était de créer un moment de connaissance, de partage de savoir, de travail de compétences. Ce qui est peut aussi être fait autour de la géographie, de l’histoire, de la langue. Ce qui servira aux enfants dans leurs compétences scolaires, leur culture générale, leur réflexion. Cela doit être l'objectif des activités dites "plurilingues" ou "multiculturelles" : avoir dans ces activités le même niveau d'exigence et le même travail de compétences que dans les autres activités scolaires ou éducatives.
Pour proposer ces activités, il faut bien sûr bien présenter le cadre et les objectifs aux parents qui interviennent, ainsi qu'aux parents d'élèves au sens large, à la direction, aux collègues, pour que tout se déroule au mieux. Je pourrais partager des idées de ressources dans de prochains articles.
Un pas vers les familles… Avec les familles
Je pourrais faire les mêmes développements sur les ateliers « cuisines du monde », ou « découverte de pays », qui souvent ne font qu’asseoir les origines dans une série de clichés culturels et, je dirais même « culturalisants » et bien souvent exotisants. Les fameux « gâteaux » des mamans maghrébines. Toujours ramenées à leur savoir-faire culinaire, là où, en tant que parents, elles ont de nombreuses connaissances à partager et d’apprentissages à transmettre. Nous avons tout intérêt à pousser des contenus qui ne sont pas « ornementaux » mais profondément inscrits dans le sens, la réflexion, l’apprentissage, car c'est dans l'intérêt des enfants.
Je sais bien que ce n’est pas toujours simple (surcharge de travail, nombre d'enfants par classe, etc), et que beaucoup d’enseignant·es font de leur mieux pour « faire un pas vers les familles », mais j'ai voulu proposer ici un point de départ d’une réflexion collective à mener : exotiser n’est pas inclure, culturaliser n’est pas accueillir.
Ce qu’on appelle la diversité ou le multiculturalisme ne devrait pas être une « fresque » des cultures du monde, mais une invitation à construire des identités culturelles multiples, cumulées, complémentaires, asseoir la place des parents dans cette transmission, et permettre aux enfants de naviguer d’un monde à l’autre, d’une langue à l’autre, d’une référence à l’autre.
Je pense aussi que le pas vers les familles ne peut se faire sans les parents. Faire un « pas vers les familles », c’est inviter les familles, non pas à faire du couscous ou des gâteaux, mais à transmettre des contenus (histoires, comptines, jeux, vocabulaire en langues étrangères). Accepter de travailler avec les familles, c’est aussi accepter qu’en tant qu’enseignant·e, on ne sait pas, et accepter d’écouter, et d’apprendre.



