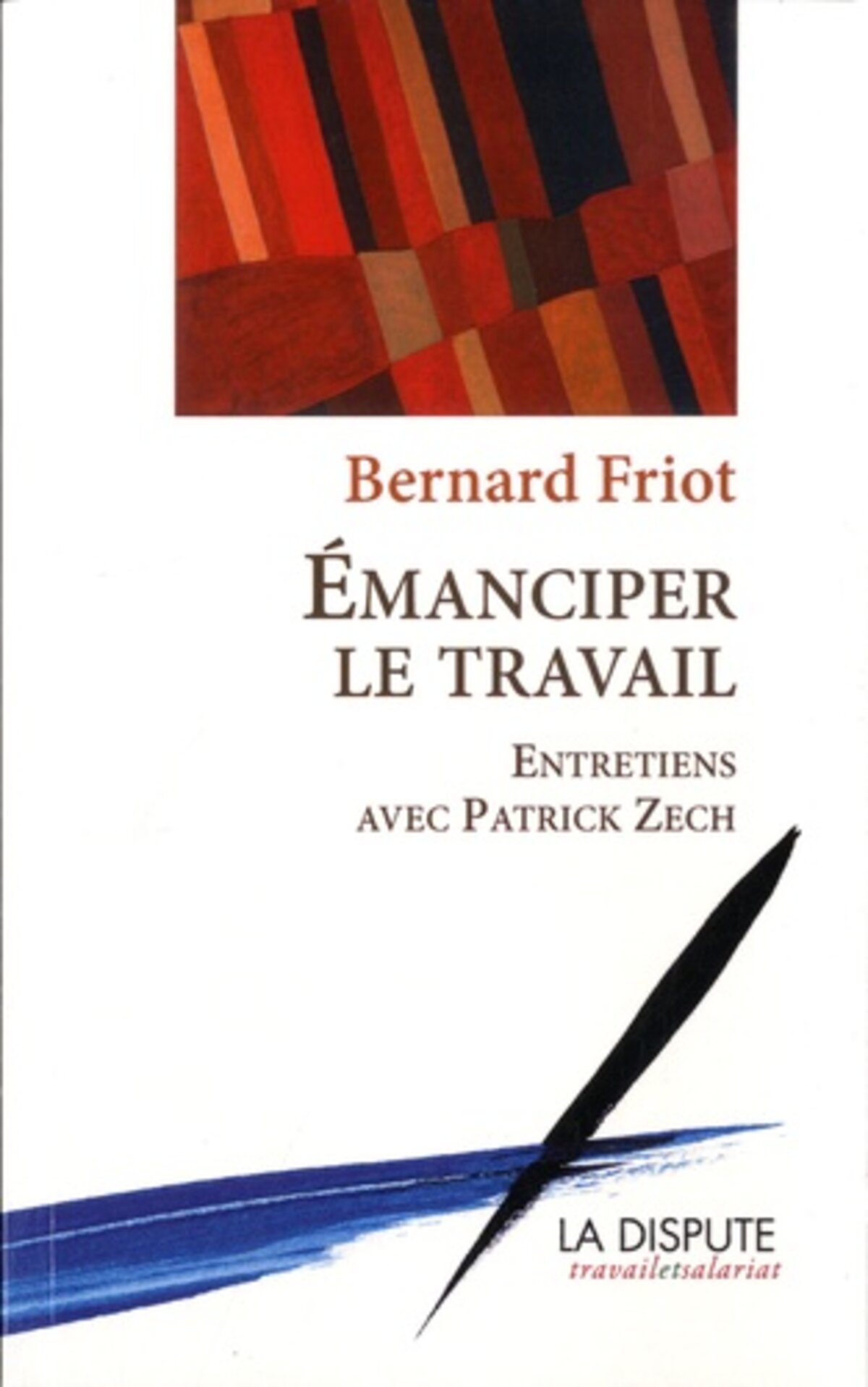
Imaginez : un monde où vous recevez votre premier salaire de 1500€ à 18 ans, un monde où vous pouvez gagner 6000€ par mois sans payer d'impôts jusqu'à votre mort, un monde avec des services publics développés pour tous sans taxation, un monde où les dividendes aux actionnaires n'existent plus, un monde où le marché et la monnaie ne sont pas incompatibles avec les enjeux écologiques quotidiens. N'est-ce pas ambitieux ? Serait-ce une douce utopie détachée du réel, détachée du déjà-là dans nos vies ? En 150 pages, Bernard Friot et Patrick Zech démontrent qu'une alternative est possible dans notre vision du monde du travail, pour l'émancipation de chacun. Encore faut-il la connaître, la mettre à l'épreuve puis éventuellement la défendre pour la rendre possible. Je vais brièvement essayer de vous donner envie d'aller voir ce livre, pour vous faire votre propre avis. C'est parti !
Entrons dans le vif du sujet : en quoi Bernard Friot propose-t-il une alternative, au minimum intéressante, dans notre manière d'appréhender le travail, l'emploi, le salaire, la carrière entre autres ?
D'abord, parce qu'il remet en question des faits tellement intégrés dans notre esprit, qu'on les questionne plus. Petit exemple : si vous faîtes le ménage chez vous, vous êtes dans "l'activité", si vous faîtes le ménage chez d'autres personnes pour une grande entreprise de service à la personne vous "travaillez". Cela vous semble normal. Pourtant l'activité est-elle fondamentalement différente ? Deuxième exemple : si vous prenez de votre temps pour "entraîner" des enfants dans votre club sportif, vous êtes dans l' "activité", le "hobby", si vous vous occupez de ces mêmes enfants à temps égal dans un club sportif semi-professionnel ou pleinement professionnel vous "travaillez". Troisième exemple : vous cultivez vos fruits et légumes et revendez ou donnez le surplus à vos voisins vous êtes dans " l'activité" , vous faites la même chose dans une ferme ou une coopérative et l'on va désormais dire que vous "travaillez". Analysez vos activités et vous trouverez surement beaucoup d'autres exemples.
Qu'est ce qui fait que, dans un cas nous parlons d' " activité", de "hobby", de "loisir" et dans l'autre de "travail" ou d' "emploi" ? Bernard Friot et Patrick Zech présentent un intérêt fondamental car ils nous rappellent que ce qui "vaut" au niveau économique, ce qui est "légitime" comme travail dans notre société n'est pas une donnée "naturelle", c'est un construit. Par conséquent, comme tout ce qui est construit, on peut le démonter, faire bouger les lignes, par les luttes et les revendications et ainsi changer ce qui pour nous devrait avoir une valeur économique et ce qui devrait ne pas en avoir. Et si nous décidions que les travailleurs de la publicité ne sont plus dans le travail, donc illégitimes et uniquement restreints dans la sphère du "hobby" ?
D'ailleurs, comme vous l'avez peut-être constaté j'ai employé dans le paragraphe précédent le mot "emploi" et le mot "travail" comme s'ils étaient synonymes. Faites-vous la différence entre ces deux mots dans votre conversation quotidienne ? Pour la majorité d'entre nous ce n'est pas le cas. Pourtant, l'auteur nous rappelle à quel point il est important de ne pas associer ces mots comme si ils voulaient dire la même chose. Dans le cas de l'emploi, ceux qui décident au niveau économique vous reconnaissent comme un acteur légitime, vous occupez un emploi. Dans le cas du travail, les frontières sont plus floues : où s'arrête le travail ? Où commence-t-il ? Qui décide de cela ?
Analysons ensemble une tendance récente aux années 2010 et très éclairante pour comprendre les enjeux autour de la décision de ce qui "est" ou "n'est pas" travail : certaines personnes sponsorisées par de grandes marques jouent aux jeux-vidéos toute la journée, participent à des compétitions suivies sur les réseaux sociaux par des milliers d'individus, et ils s'entraînent avec leurs coéquipiers presque tous les jours. Si vous aimez le jeu-vidéo, il vous est peut-être arrivé de jouer 5 jours sur 7, de vous entraîner sur votre jeu préféré puis d'organiser une compétition ou d'y participer. Qui décide que vous êtes dans le "hobby" et que l'autre est un "joueur professionnel dans le domaine de l'esport" ? Bernard Friot nous rappelle que nous ne décidons pas de qui est légitime comme "travail" ou non. Nous nous adaptons au "marché du travail" mais nous ne décidons pas de ce qui "est" travail. Ceux qui décident sont ceux qui possèdent les outils de travail (le matériel par exemple), les locaux, les organes de publicité, ceux qui peuvent vous verser un salaire, en bref ceux qui détiennent un capital économique (et/ou symbolique) et qui font de vous l'agent chargé de mettre en valeur ce capital contre salaire.
Mais, il était une fois, des exceptions de grande ampleur. Effectivement, là où Bernard Friot est porteur d'une émancipation c'est qu'il démontre que nous pouvons décider de ce qui vaut à place de nos "maîtres", cela existe déjà en partie dans notre univers social à travers plusieurs institutions spécifiques : les intermittents du spectacle, certains professionnels de la sidérurgie, de l'électricité ou du gaz et surtout les membres de la fonction publique.
D'un coup, Bernard Friot nous interpelle sur ce qui se joue dans les combats politiques et médiatiques d'aujourd'hui : en effet, pourquoi les politiciens cherchent-ils à transformer les statuts et à supprimer toujours plus de fonctionnaires ? Pourquoi ont-ils attaqué par le passé, les intermittents du spectacle ? La réponse classique venue des grands acteurs du système : ces derniers sont un "coût", matérialisés par nos prélèvements obligatoires, ils coûtent trop chers, nous n'avons plus d'argent pour eux et ils seraient plus efficaces sous l'égide d'un organisme privé. La démonstration que réalise Bernard Friot dans son livre va dans une toute autre direction : selon lui l'argument financier ne tient pas la route, la rhétorique de l'efficacité s'appuie sur une propagande médiatique qui n'analyse pas avec la même honnêteté le fonctionnement du privé. Non, ce qui se joue politiquement, c'est la volonté idéologique porté par des prestataires de service politique de supprimer tant que possible tous les agents qui ne mettent pas en avant le capital d'un propriétaire lucratif. Ce qui est en jeu c'est la privatisation du monde au profit d'une oligarchie.
Cependant, qui a pu disposer de son salaire intégral en plein Covid-19 alors que les activités associées à leurs postes ont diminuées ? Les enseignants, les agents territoriaux, les fonctionnaires du domaine socio-culturel, les cheminots, le personnel des ressources humaines. Les intermittents du spectacle disposent d'un salaire garantie en échange d'un certain nombre d'heures de travail étalées et effectuées dans l'année. Dans ces intervalles, malgré tous les obstacles bureaucratiques visant à démoraliser l'intermittent, Pôle Emploi est chargé de verser une somme d'argent, entendue comme un droit au salaire continué. Ce n'est donc pas parce qu'il ne "travaille" pas 5 jours sur 7 dans un bureau que l'intermittent ne produit pas de valeur économique. Il n'est pas un coût assumée par le collectif, il produit lui-même ce qui sera son salaire, même si ce n'est pas un bien marchand. C'est le sens idéologique qui se cache derrière ce fonctionnement administratif.
Selon l'auteur, ce qui est révolutionnaire (et donc dangereux pour les dominants) c'est que pour l'intermittent comme pour l'enseignant fonctionnaire, le salaire de la personne ne dépend ni de l'intensité de son activité, ni du capital qu'il met en avant et ni de son son aspect marchand, il est attaché à sa personne comme un droit économique.
Mais là encore Bernard Friot surprend : mais pourquoi beaucoup de ces individus se replient sur eux-mêmes face aux attaques perpétuelles qu'ils reçoivent dans les réformes politiques et économiques mises en avant dans les médias à forte audience ? Le cœur de sa pensée se trouve ici : la meilleure défense c'est l'attaque, tous ces agents qui reçoivent un salaire à vie incarnent des victoires politiques passées et tombées dans l'oubli, il s'agit dorénavant de reprendre les devants et d'instituer un nouveau droit économique pour TOUTE la population de 18 ans à la mort : un droit au salaire à la qualification personnelle, c'est à dire un salaire attachée à la personne, communément appelé "salaire à vie". Plutôt que de défendre ses droits comme une chasse gardée, le titulaire d'un salaire à vie doit être le premier activiste pour l'extension de ce droit à l'ensemble des travailleurs surtout ceux qui sont dans le domaine privé ou indépendants.
Tout le cœur de sa démonstration vise à montrer que cette revendication est réalisable pour tous et qu'il y a déjà des outils "clés en main" pour la développer. En voici quelques petits extraits :
- La "cotisation-salaire" (à différencier de la "cotisation-prévoyance") est un levier majeur, qui existe, qui a fait ses preuves malgré les campagnes de dénigrement qu'elle subit. Qui a bien conscience de ce qu'est une cotisation, couramment appelée une "charge" dans l'espace médiatique ? L'auteur s'attache ainsi à montrer, chiffres à l'appui, que son élargissement, appuyée sur une suppression des dividendes et dont le fruit serait géré par des caisses de travailleurs peut permettre le versement d'un salaire à vie.
- Non, il n'existe pas de "bon impôt" et de "mauvais impôts". Effectivement, il explique que l'impôt est d'abord la reconnaissance d'une violence sociale qui pourrait être renversée et remplacée par une cotisation à taux fixe et interprofessionnelle. En prélevant à certains pour distribuer à d'autres, on construit un groupe de "productifs" face à un groupe "d'improductifs" économiques. Pour lui, c'est une atteinte au droit à la citoyenneté économique de chacun. En outre, il n'est pas difficile de faire observer que ceux qui devraient "contribuer" le plus par l'impôt, sont ceux qui ont les moyens de s'en écarter le plus facilement par un ensemble de dispositifs plus ou moins légaux (optimisation, évasion fiscale etc...). L'impôt, permet alors de diviser toujours plus ceux qui le paient, pour mieux maintenir le statu quo derrière. Enfin, selon Friot, ce prélèvement donne de la légitimité à ceux qui disposent des outils de travail, des locaux, bref des moyens de production alors que l'existence historique de ces propriétaires lucratifs est fondée sur l'expropriation illégitime du travail d'autrui. Ainsi, l'impératif de "solidarité" et de "justice" est profondément hypocrite dans une telle matrice. Se battre pour son extension lui apparaît profondément vain.
- Il s'appuie sur le processus de "qualification" qui existe déjà en France et qui permet de déconnecter le salaire d'un individu de son poste de travail pour le relier à sa personne, affirmant qu'il est possible de le généraliser, de l'étendre à condition de ne pas l'imaginer comme une certification scolaire (les diplômes à l'école). Cette idée révolutionnaire est cœur de l'institution d'un nouveau droit économique pour tous : être reconnu producteur de valeur à 18 ans quel que soit sa réussite scolaire par la qualification. Être capable d'explorer (sous conditions) des horizons variés de métiers sans s'enfermer. Ce processus de qualification appliqué à tous les français à partir de 18 ans, permettrait de recevoir un salaire de 1500€ au niveau 1 (il prend comme base de calcul et développe autour des 2 000 milliards de PIB que nous produisons ces dernières années). Cette idée présente deux avantages colossaux : il n'y a plus de "marché" du travail, et il n'y a plus de "chômage" dans le cadre du salaire à vie.
- "C'est bien connu, les soignants, les enseignants, le personnel socio-culturel, ils sont utiles à la société, mais ils ne sont ils sont producteurs de valeur économique". Bernard Friot défend la cotisation comme la reconnaissance que les individus tels que les soignants ou les retraités sont des producteurs de valeur économique et non des êtres de besoin à qui l'on doit donner du "pouvoir d'achat". Il s'oppose fermement aux idées de revenu universel, puisque celui-ci ne marginalise pas , ni ne supprime les détenteurs historiques de capital. Il s'appuie sur des arguments que je vous laisse découvrir pour montrer qu'il s'agit d'une nouvelle servitude déguisée (le problème de l'impôt pour la financer par exemple).
- Il cherche à démontrer que nous pouvons nous passer du crédit, public ou privé pour financer nos investissements futurs comme la reconstruction écologique de notre pays. Face au modèle dominant du crédit-dette-intérêt-remboursement, il met en valeur le potentiel que représente la création d'une "cotisation-investissement" pour subventionner des programmes de développement. En effet, en lieu et place de la redistribution actuelle du profit d'une minorité de propriétaires agissant très souvent dans une optique de rentabilité court-termisme, il s'agirait de transformer cette somme en cotisation gérée par des travailleurs élus sous mandat impératifs et révocables pour gérer cette manne financière. Selon Bernard Friot, le modèle "cotisation-subvention" peut se substituer à la domination du crédit et de la dette.
- De plus, Bernard Friot se positionne à rebours de ceux défendant l'idée que toute propriété est un vol. Il souhaite la suppression de toute propriété lucrative qu'elle soit dans le domaine personnel (mettre en location son appartement pour en retirer une rente), ou dans le domaine professionnel (obtenir une rente sur l'utilisation de locaux professionnels). La réponse à cette question complexe ne se situe pas dans un collectivisme idéalisée et niant une violence sociale qui pourtant ne disparaitra jamais. Il souhaite que ceux partageant ses idées se battent pour l'extension d'une propriété d'usage pour chacun dans sa sphère professionnelle et personnelle. Concrètement, cela signifie que les outils de travail sont la propriété du collectif de salariés qui les utilisent, et que les enjeux liés à leur gestion ou entretien doivent se décider à plusieurs. Pour la sphère privée, il s'agit par exemple de faire en sorte que chacun puisse être propriétaire d'un bien sans devoir donner un loyer à un propriétaire rentier. C'est une révolution du marché immobilier qui est proposée.
Cette liste non-exhaustive et partielle des points clés de sa théorie ne peuvent rendre compte de la profondeur des arguments qui y sont tenus. Dans ce livre qui prend la forme d'entretiens très agréables à lire, Patrick Zech n'oublie pas de le questionner sur le "comment" du passage de la théorie à la pratique, ainsi que des nombreuses limites et critiques que présentent son travail. Bernard Friot ne se cache pas, il n'apporte pas une vérité révélée, il cherche à s'appuyer sur un "déjà-là révolutionnaire" pour analyser ce que porterait une extension de mesures, de statuts, de lois à une échelle plus importante sous couvert d'une mobilisation populaire sur des mots d'ordre ambitieux.
Parmi les limites et les critiques fréquemment posées citons, pêle-mêle :
- Comment peut-on défendre une alternative qui vise à rebattre les cartes au niveau économique alors que la France n'est plus capable de créer elle-même sa monnaie ?
- Bernard Friot propose une méthode de formulation des prix dans sa théorie où le profit disparaît mais celle-ci comporte de nombreux inconvénients.
- L'auteur peut avoir tendance à "évacuer" la question internationale trop facilement au regard des enjeux. La France pourrait-elle survivre avec un embargo sur le pétrole lancé par les alliés des détenteurs de capitaux ? Pourrait-on trouver des appuis dans l'Europe ? Comment se procurer de nombreux biens indispensables mais importés si des pays refusent de faire du commerce pour des raison idéologiques ?
- L'auteur reçoit souvent des critiques sur les réserves qu'il émet lui-même quant aux revendications des militants dits "de gauche" qui mèneraient selon Friot à l'échec car les revendications seraient toujours placées sur le terrain et l'agenda des dominants.
- Le modèle de société qu'il défend ne peut-il pas conduire à une gérontocratie dangereuse ?
Pour conclure, rappelons que ce papier est bien trop imparfait pour appréhender les idées de Bernard Friot, leurs imbrications, leur teneur historique et les profondeurs argumentatives de celles-ci. Je préfère regretter mes discours, plutôt que regretter mes silences, ainsi cette courte synthèse est d'abord un vœu pieux pour vous pousser à explorer cette alternative imparfaite mais porteuse d'émancipation.
Précisons : contrairement à la majorité des articles dans ce style, je préfère présenter l'auteur à la fin du papier plutôt qu'au début, surtout si vous ne le connaissez pas. Pourquoi ? Car présenter une biographie de l'auteur avant d'exposer ses idées peut déjà vous conditionner, altérer la réception d'un message sous couverts de préjugés plus ou moins conscients. Pour vous protéger efficacement de ces techniques d'influence que sont "l'empoisonnement du puits" ou "le procès en compromission", entre autres, je vous renvoie une nouvelle fois à mon accompagnement ici : http://autodéfenseintellectuelle.fr/ !
Bernard Friot est professeur émérite à l'université de Paris-Nanterre, spécialisé en sociologie et en économie. Né à Neufchâteau en 1946, Il débute sa carrière en Lorraine. Il est un spécialiste de l'histoire du travail et du fonctionnement de la sécurité sociale en France et en Europe. Il a été amené à analyser en profondeur les fondements idéologiques et les implications pratiques de la socialisation du salaire dans l'économie contemporaine. Par ailleurs chrétien et militant communiste, il est influencé très jeune par la pensée de Karl Marx et Lucien Sève. Il a fondé l'Institution Européen du Salariat (IES), puis l'association d'éducation populaire Réseau Salariat. Collaborateur au journal "Le Monde Diplomatique" il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels : "Puissances du salariat" en 1998, "L'enjeu des retraites" en 2010, "Emanciper le travail" en 2014 ou "Un désir de communisme" en 2020 avec Judith Bernard.



