L'actualité quotidienne et les mouvements sociaux sont presque toujours marqués par des syndicalistes ou des professionnels de la politique réclamant la création "d'emplois". Si vous avez vécu au moins une fois une élection présidentielle en France, vous avez sûrement constaté que tous les programmes visent in fine le "plein-emploi" ? Et si cet horizon était un mirage ? De quels emplois parlons-nous précisément ? Mieux, et si une grande partie des emplois ne servait tout simplement à rien, voire pire étaient nuisibles pour la société ? Vous l'aurez compris, ce livre ne propose pas un éternel recyclage des idées reçues. Ce livre peut vous faire sortir du cadre, penser différemment, jusqu'à proposer des arguments décisifs dans vos batailles citoyennes. C'est une pépite !

Agrandissement : Illustration 1
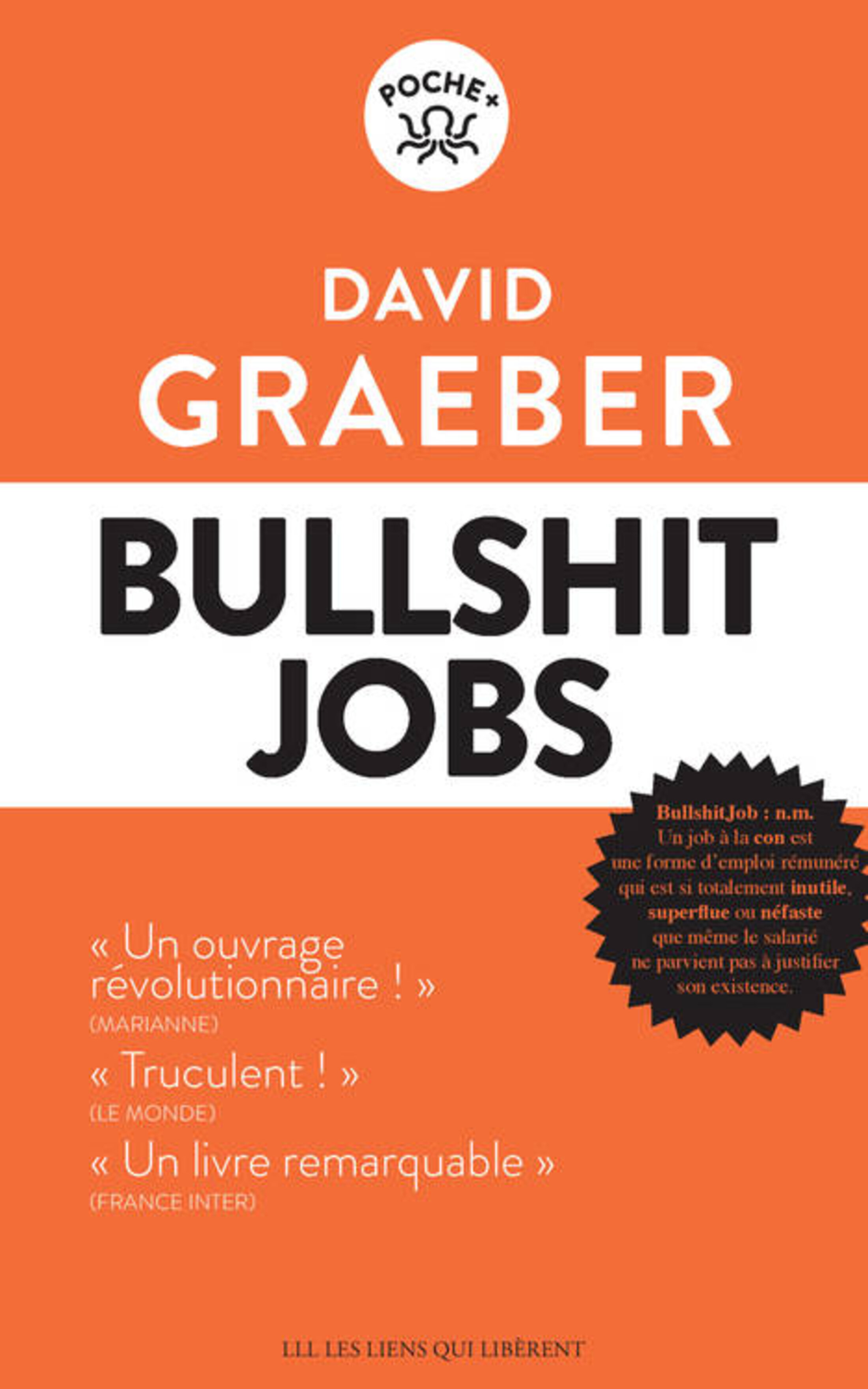
Pour rappel : même si cet article ne se veut pas être une fiche de lecture, car l'exercice est fastidieux à lire et à écrire, il présente le même inconvénient d'appauvrir la pensée de l'auteur et de diminuer le plaisir de la découverte. Ainsi, lire ce papier peut vous servir si vous êtes : soit partagé quant à la lecture ou non de l’œuvre, soit si vous souhaitez découvrir quelques éléments en préambule de votre lecture.
Maintenant, comment l'auteur ose-t-il prétendre que des emplois ne servent à rien, pire qu'ils sont nuisibles ? Comment ose-t-il prétendre que réclamer un emploi pour tous n'est pas une bonne technique ?
Son premier rappel est presque le plus important du livre : le mot "emploi" tel qu'il est exprimé sans complément est un mot "fourre-tout", "valise" qui nous empêche de penser. En effet, cette expression laisse penser que toute activité, tant qu'elle est définie comme étant un "emploi" serait légitime. Or, selon lui, il n'en n'est rien. Le mot "emploi" doit donc être défini précisément avant d'en faire une quelconque revendication.
Pour autant, l'auteur réalise un premier contre-pied intéressant : plutôt que définir ce qui serait un emploi de valeur, qui compte réellement, il commence par définir et répertorier par grande famille tous les emplois "bullshit". Littéralement traduit comme un "Job à la con" cela correspond à une activité rémunérée qui est "si totalement inutile, superflue ou néfaste, que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé de le faire, afin d'honorer les termes de son contrat". Ceci, même s'il pense le contraire dans les tréfonds de son âme. En bref, si l'on supprimait ce type d'emploi demain, le monde ne verrait absolument pas la différence, voire mieux, il s'améliorerait ! Pour lui, cela concerne jusqu'à 40% des emplois aux USA. Essayez de vous poser la question sur le vôtre et vous verrez, les résultats peuvent être surprenants...
Mais avant, de soutenir une telle démonstration, il doit d'abord lever une première critique : qui donc est apte à juger de ce qui serait un emploi utile ou nuisible ? Peut-il se placer au-dessus de tous à juger la pertinence d'un métier ? Peut-être que les jobs à la con sont justes des emplois dont l'auteur ne comprend pas l'utilité ? David Graeber utilise une méthode particulièrement intéressante pour donner de la consistance à son livre et aussi pour nous faire rire durant la lecture : il s'appuie sur les déclarations des employés eux-mêmes, recueillies en masse durant de longs mois. Si cette technique est critiquable, l'auteur précise néanmoins qu'on ne peut définir l'utilité d'un job si l'on reste uniquement dans la perspective du marché. La valeur de marché d'un emploi n'est pas sa valeur sociale. En bref, ce n'est pas parce qu'un patron, ou l'Etat crée un emploi, que celui-ci est nécessaire, utile, ou disposant d'une quelconque valeur en lui-même.
Concrètement, si un métier, même bien payé, apparait pour celui qui l'exerce dépourvue d'une valeur "sociale", c'est à dire d'une capacité à répondre à un besoin largement partagé dans la société, alors c'est peut-être un "bullshit job". Le premier exemple qui vient pour illustrer cette idée c'est l'univers de la communication publicitaire. Les employeurs proposent de l'activité dans ce domaine, pour mettre en avant les produits crées. Pour eux, c'est un emploi nécessaire et avec une grande valeur de marché. Pourtant, une réflexion collective à l'échelle d'un pays pourrait probablement relever l'inutilité d'un tel afflux de publicités crées par ces individus. Par conséquent, si ces emplois impliquent plus de nuisance matérielle et morale pour la population que s'il n'avait pas existé, alors cet emploi ne vaut peut-être pas le coup d'être crée. Enfin, dans un "idéal fantasmé" de l'auteur, la discussion sur l'utilité sociale d'un métier, c'est à dire répondre à un besoin important reconnu par la population, pourrait être discuté démocratiquement. C'est d'ailleurs une nouvelle critique que l'on pourrait faire à l'auteur : au-delà de ce souhait démocratique, il ne se risque pas à aller sur la route périlleuse de la définition des besoins "utiles" et "inutiles". Il sait probablement que ce chemin est si complexe et miné qu'il mériterait un livre à lui tout seul.
Avant de préciser les grandes familles de "Job à la con", David Graeber bouscule des affirmations tellement établies qu'elles paraissent naturelles : non, ce ne sont pas les emplois publics les plus nuisibles. Oui, le secteur privé est un immense pourvoyeur de "jobs à la con". Par ailleurs, un "job à la con" n'est pas du tout la même chose qu'un "boulot de merde". Ces derniers sont fondamentaux et indiscutablement bénéfiques pour la société mais ceux qui les pratiquent sont mal payés et mal traités. Quelques illustrations viennent tout de suite : les éboueurs, les employés dans les usines de traitement de l'eau potable, les ouvriers du bâtiment, les emplois de nettoyage etc. David Graeber met ensuite en avant un paradoxe bien connu et pourtant toujours aussi dominant : ce sont ceux qui ont les "jobs à la con" qui sont auréolés de prestige, d'argent, qui sont respectés. Ce sont ceux qui ont des "jobs à la con" qui peuvent mépriser ceux qui occupent des "jobs de merde" alors que leur activité est fondamentalement inutile voire nuisible...
Le temps des définitions passé quels sont les points centraux de sa démonstration qui pourraient vous intéresser, si vous vous questionnez sur l'univers de l'emploi ? En vrac, voici quelques sujets balayés par l'auteur et quelques extraits d'affirmations argumentés et expliqués dans le livre. Là encore, nous n'irons pas trop loin dans l'explication afin de ne pas diminuer le plaisir de lecture et surtout d'appauvrir la pensée de l'auteur par une retranscription brouillonne.
- Premièrement, il donne beaucoup d'arguments pour contrer l'idée très répandue que toute administration contiendrait en elle-même des niveaux hiérarchiques, des procédures beaucoup plus lourdes que dans le monde du privé qui serait lui "léger" et "efficace". Il explique que la mécanique des "jobs à la con", n'épargne ni le privé, ni le public. C'est donc un premier piège de la pensée, un piège idéologique porté par les entrepreneurs les plus puissants souhaitant une "privatisation du monde".
- Deuxièmement, il y a un phénomène très important qu'il souligne : les emplois dont l'utilité sociale paraît claire sont en voie de "bullshitisation". En bref, dans beaucoup de métiers, les dominants ponctionnent le temps d'activité le plus important et le plus valorisant pour l'employé pour remplacer ce temps par des tâches vaines et superficielles. Par exemple, le cas des enseignants en France (de la primaire à l'université) est criant à cet égard, puisque ces derniers affirment année après année, que le temps disponible pour se consacrer à la transmission du savoir se dégrade au profit d'activité administratives, de réunions, de rapports etc. Quand ce n'est pas tous les cours en présentiel qui sont supprimés...
- La "bullshitisation" des métiers s'accompagne par l'introduction d'un vocabulaire précis et technique totalement hors du cadre initial du métier. C'est un vocabulaire d'évaluation et très proche de la compétition sportive. On y trouve, pêle-mêle, des indicateurs chiffrés pour mesurer la performance, des rapports d'évaluation, des fiches d'objectifs de résultats, ou plus simplement la redondance de mots tels que "qualité", "collaboration", "efficience", "compétitivité". Qui peut se battre contre la "qualité" ? Ces techniques d'influence par le langage servent à "décorer l'enfumage" en laissant penser que cette "bullshitisation" qui fait perdre à l'agent du temps et de l'énergie est nécessaire et bienveillante...
- Pour l'auteur, on pourrait supprimer diverses professions qui existent essentiellement parce que justement la population est trop occupée à s'aliéner dans des "jobs à la con" et qu'elle n'a donc pas le temps de faire les choses elle-même (toiletteurs pour chiens, livreur de pizzas, monteur de meubles, esthéticiennes, barbiers etc...). Dans ce cadre, il va plus loin et prétend qu' on pourrait ramener la semaine "d'emploi" à 15h que la population n'y perdrait pas selon l'auteur. Cette idée mériterait un retour critique : en effet, est-ce qu'une profession est réellement inutile parce que l'individu disposant de temps libre pourrait la faire chez lui ? A quel point est-ce contradictoire ?
- David Graeber démontre que ce qui pourrait être vu comme un faux-problème recèle en vérité de graves implications. En effet, pourquoi ne pas s'estimer heureux, au final, d'être payé (souvent grassement), dans des "bullshit jobs" à ne rien faire d'utile ? Sa réponse est claire : cela crée une grande violence spirituelle pour un être humain qui cherche par essence, inconsciemment ou non, aujourd'hui ou demain, à s'épanouir, à trouver la voie pour être heureux.
- Cette violence spirituelle ne peut se comprendre que si l'on essaie de contrecarrer la théorie économique qui explique que l'humain cherche "systématiquement"à maximiser son avantage à moindre coût. Si cette théorie était toujours vraie, ce livre n'aurait jamais pu exister, puisque il n'aurait jamais pu recueillir autant de témoignages de personnes payées vainement et cherchant à s'échapper à leur sort alors qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins et consommer si nécessaire. Ces personnes, souvent mieux payés que ceux occupant des "jobs de merde" resteraient dans le coin sans qu'on en entende parler. Par conséquent, l'existence même de ce livre montre que, si cette idée d'un humain constamment dans le calcul "coût-bénéfices" est vraie dans certains contextes, elle ne s'applique pas dans l'absolu. Un escroc, lorsqu'il est libre d'escroquer peut prendre plaisir à tromper quelqu'un. Mais un individu commun, qui se voit forcer par sa condition de salarié, de dominé, à se mentir à soi-même et aux autres quant à l'utilité de son boulot, c'est une source de violence spirituelle immense. Ainsi, la pensée communément établie que tout individu se voyant la possibilité de vivre en "parasite", à ne "rien faire" la saisira à coup sûr, est totalement contrecarrée par l'auteur.
- La "joie d'être cause" (en clair, je fais X il se passe Y), le sentiment d'exister dans l'action, le désir d'appartenance et de reconnaissance émotionnelle sont des facteurs inhérents à l'homme qui ne peuvent le limiter à un individu rationnel et calculateur. Il affirme "un être humain privé de la faculté d'avoir un impact significatif sur le monde cesse d'exister !" (P144.)
- "Tu bosses pour moi, et je ne te paie pas pour que tu te reposes". Cette idée, qu'un travailleur n'est pas propriétaire de son temps, que ce temps appartient à la personne ou à la puissance publique qui l'a "acheté" (en échange d'un salaire), est une anomalie historique selon l'auteur. Il montre que ce paradigme jamais remis en question aujourd'hui, qui implique que l'oisiveté n'est pas vu comme dangereuse mais comme véritablement criminelle (vol du temps acheté par l'employeur) est une construction pure et simple. Mieux, il démontre que dans la plupart des sociétés humaines à toutes les époques, cette idée était inconcevable. Cette démonstration de David Graeber passe par un fabuleux résumé de l'histoire de la construction du temps moderne, telle qu'on le voit sur nos montres et horloges aujourd'hui. Par exemple, les écoles occidentales, dans lesquelles les enfants sont obligés de changer d'activité et de rythme au son d'une cloche rituelle, qu'ils le veuillent ou non, constituent l'apprentissage et l'intégration progressive d'une idéologie, c'est à dire se préparer à ce que sera le temps dans le monde du "travail" contemporain.
- L'auteur critique fortement l'argument classique du "estimes-toi heureux" ou dit autrement du "pire ailleurs pour justifier le médiocre ici". Cet argument, s'il avait un véritable impact n'aurait jamais permis à des ouvriers d'enlever leurs enfants des usines, puisque avant, c'était pire, ils étaient "serfs" voire esclaves. Ils auraient pu se contenter de laisser leurs enfants travailler dans les usines. Cet argument, s'il avait un véritable impact, n'aurait pas permis aux travailleurs français de s'être battus, pour aujourd'hui diviser par deux le nombre d'heures passées dans "l'emploi": 3041 heures par an en moyenne en 1841, contre 1505 heures en moyenne en 2019... Mais cet argument est encore si fort aujourd'hui qu'il empêche notamment la jeunesse de revendiquer le droit d'exercer un emploi qui ait du sens ! Pour David Graeber, pour être un "Robin des bois moderne" aujourd'hui, "il suffit de faire quelque chose d'utile !" (p223).
- L'idée extrêmement dominante dans le monde de l'emploi aujourd'hui que tout est censé être "efficace" et "rentable" est contredite par la prolifération des "bullshit jobs" particulièrement importants dans le secteur des "services, de la finance et de la gestion". Et si la blague commune "on fait semblant de travailler, ils font semblant de nous payer" pour se moquer de l'URSS durant la guerre froide était aussi réelle chez nous ?
- Notre "culture politique" occidentale dont le mot d'ordre est la "création d'emplois" sans se poser la question de leur utilité réelle, la croyance en la pertinence intrinsèque du "marché" pour régir l'emploi et attribuer les tâches, ainsi que ce qu'il appelle la "féodalité managériale" (p268) sont quelques-unes des grandes causes expliquant la prolifération des "jobs à la con" selon Graeber.
- L'auteur s'intéresse aussi aux raisons qui font que la prolifération de ces jobs inutiles ne soit pas devenu un problème majeur discuté par les médias et la société civile. Pour lui, cela s'explique par les liens entre l'économie et la philosophie morale, et à la question jamais posée mais toujours décidée par les dominants : qu'est ce qui vaut et qui le décide ?" En effet, toute personne discutant de l'utilité de son boulot raisonne consciemment ou non autour de la théorie de la valeur, cruciale dans le champ économique. Lorsqu'il s'agit d'un bien "marchand", d'un produit comme une orange ou une pomme, il est aisé de définir sa valeur. Une comparaison avec un autre bien marchand que l'on peut extraire, produire et distribuer dans un environnement suffit souvent à définir sa valeur : c'est schématiquement sa valeur d'échange. Mais sur quoi s'appuyer pour affirmer qu'un tableau de Monet a deux fois plus valeur qu'un tableau de Cézanne ? Comment définir la valeur d'un bien non-marchand comme le soin d'un médecin ? Le problème reste entier pour une immense partie de nos activités contemporaines car comme beaucoup de phénomènes humains, la valeur est en grande partie subjective. C'est là que s'insère le politique, la morale et l'idéologie. Or, on ne peut pas réfléchir à l'utilité d'un emploi, si l'on ne se détache pas de la "valeur travail" aujourd'hui hégémonique dans nos esprits, affirmant que toute personne qui "se tue à la tâche" est admirable quel que soit son activité réelle. C'est l'apologie de la "France qui se lève tôt" chère à Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui, mais pour quoi faire au juste Nico ? David Graeber, rejoint ici Bernard Friot sur la nécessité de s'interroger politiquement sur ce qui vaut dans le monde "non-marchand" et sur comment lui attribuer une valeur...
- Pourquoi donc, plus un emploi semble bénéfique à la société moins la rémunération associée à de chances d'être élevée ? David Graeber met magnifiquement en avant la logique perverse qui traverse nos sociétés aujourd'hui : "ceux qui décident d'être bénéfiques à la société - à fortiori s'ils ont conscience de l'être effectivement, ce qui est gratifiant en soi - ne sont aucunement légitimes à réclamer, en sus, des salaires de bourgeois, des congés payés et des retraites confortables. Symétriquement, ceux qui savent parfaitement qu'ils font boulot absurde, voire nuisible, juste pour l'argent, et qui en souffrent, devraient être récompensés par un plus gros magot justement pour ce motif. (...) Que conclure de ces réflexions ? Si le travail tire une partie de sa valeur du fait qu'il est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire alors symétriquement, ce que l'on a envie de faire doit relever davantage du jeu ou du hobby. En d'autres termes, toute activité à laquelle on est susceptible d'avoir envie de consacrer son temps libre ne mérité aucune récompense matérielle y compris pécuniaire." (p328-329). Le CQFD de la perversité. D'où le "bénévolat", le "militantisme", "l'engagement", tous ces mots qui permettent de cacher la réalité de ces activités : du travail gratuit qui pourrait mériter rémunération, si les discussions et les décisions sur la valeur étaient prises autrement.
- De plus, pour l'auteur la prolifération des "jobs à la con" en silence s'explique par l'absence de recul et l'absence de critique quant à la définition de ce qui est "travail". Sa définition de ce mot l'illustre bien : "En règle générale on en fait l'opposé du jeu, ce dernier étant décrit comme ce à quoi l'on s'adonne sans autre raison, juste pour le plaisir. Le travail lui est une activité (généralement pénible et répétitive) à laquelle on ne se livre pas pour elle-même mais afin d'atteindre un autre objectif (se procurer à manger, édifier un mausolée...)" (p334) Cette définition du travail comme punitive et visant à "créer" quelque chose est totalement contestable et mensongère selon lui. Contestable, sur le plan de la contrainte, et sur ce point il rejoint Bernard Friot. L'humain s'accomplit, se réalise et s'épanouit dans le travail, c'est une activité qu'il n'a jamais cessé d'exercer en tant qu'espèce. Encore faut-il le définir, s'intéresser à son organisation, ses difficultés, sa répartition avec honnêteté pour réellement tenter de le sortir de l'aliénation... Mensongère sur le plan de la "création", et là dessus il apporte un éclairage fondamental. Il démontre que ce paradigme d'une souffrance nécessaire pour "créer", "produire" ne fait plus sens dans nos sociétés contemporaines régies par les machines. Qu'on le déplore ou qu'on s'en accommode, l'essentiel de l'activité des travailleurs occidentaux aujourd'hui consiste à entretenir, inventer, réparer, réorganiser des choses avec les machines ou sur elles. Alors que le parc de machines n'a jamais été aussi important aujourd'hui, la "religion du travail" fantasme sur "la production" de l'homme comme s'il était encore dans le jardin d'Eden, nu et sans outils... David Graeber met parfaitement en avant cette contradiction faisant comme si les machines n'existaient pas. Pour le moment, c'est toujours le cas (cela risque de s'arrêter un jour), alors pourquoi ne pas l'assumer et accompagner au mieux les derniers qui n'ont pas ou peu les machines pour travailler ? Pourquoi rester dans l'hypocrisie ?
- David Graeber termine son écriture sur les conséquences concrètes de ses logiques perverses du travail pleinement intégrées par le citoyen. Les conséquences sont terribles sur l'atmosphère politique dans nos sociétés, c'est ce qu'il appelle la "jalousie morale" et là encore, une citation vaut plus que toutes les explications : " ces situations professionnelles (...) génèrent une atmosphère politique lourde de haine et de ressentiment. Les personnes qui galèrent au chômage envient celles qui travaillent. Celles-ci sont encouragées à s'en prendre aux pauvres et aux chômeurs qu'on leur dépeint constamment comme des parasites et des profiteurs. Les travailleurs qui ont la chance d'avoir un "vrai" boulot productif ou bénéfique sont en butte au ressentiment de leurs semblables végétant dans des jobs à la con, tandis qu'eux-mêmes sous payés, humiliés et peu valorisés vouent une animosité croissante aux "élites", celles qui, selon eux, monopolisent les rares emplois permettent de gagner décemment sa vie tout en faisant quelque chose d'utile, de noble, de glamour. Tout ce petit monde partage un même dégoût pour la classe politique, considérée comme corrompue (à juste titre). Cette dernière, quant à elle, s'accommode fort bien de ces diverses formes de haines stupides, très utiles pour détourner l'attention de ses propres agissements." (p378).
A la suite de réflexions aussi profondes, de remises en questions aussi fondamentales, qui n'a pas envie de demander à David Graeber : et toi que proposes-tu comme alternatives ? Comment remédier à tous ces problèmes soulevés ? J'ai déjà beaucoup (trop?) développé le cœur de son ouvrage alors je vous laisse le plaisir total de la découverte de sa conclusion. Peut-être que nous pourrons discuter des idées transformatrices proposées en commentaires ?
Une précision : contrairement à la majorité des articles dans ce style, je préfère présenter l'auteur à la fin du papier plutôt qu'au début, surtout si vous ne le connaissez pas. Pourquoi ? Car présenter une biographie de l'auteur avant d'exposer ses idées peut déjà vous conditionner, altérer la réception d'un message sous couverts de préjugés plus ou moins conscients. Pour vous protéger efficacement de ces techniques d'influence que sont "l'empoisonnement du puits" ou "le procès en compromission" entres autres. Je vous renvoie à mon accompagnement pour en savoir plus ici : http://autodéfenseintellectuelle.fr/
David Graeber est un anthropologue et économiste malheureusement décédé le 02 septembre 2020 à 59 ans. Professeur à la London School of Economics il était aussi une figure importante du mouvement "Occupy Wall Street" en 2011. Activiste et engagé politiquement, notamment pour la défense du mouvement anarchiste il est l'auteur de nombreux livres exceptionnels parmi lesquels : "Dette : 5000 ans d'histoire" en 2013, "Bureaucratie, l'utopie des règles" en 2015.



