
Agrandissement : Illustration 1


Agrandissement : Illustration 2

L’horreur de cette histoire provient autant du drame d’une vie de 22 ans violemment interrompue dans des circonstances terribles, que de la familiarité glaçante qu’elle procure en nous — une familiarité que le cousin d’Aboubakar, rencontré vendredi dernier au Breil, est le premier à faire observer, malgré son deuil. Cette familiarité, c’est déjà celle qui consiste pour les médias à la fois à décrire la scène en se basant uniquement sur le récit policier ainsi qu'à contribuer à une caractérisation de dénigrement du passé et de la personnalité de la victime suggérant une certaine légitimité à sa mort. De même, c’est aussi celle d’une scène de crime désertée rapidement par les enquêteurs faisant que tout élément soumis au dossier par la suite ne puisse servir de preuve. De manière similaire, le récit des témoins du quartier — j’en ai rencontré l’un d’entre eux ayant fait une déposition à l'IGPN — n'apparaît pas dans le dossier; certaines personnes ayant filmé une partie de la scène ont même été intimidées pour qu’elle supprime les vidéos. C’est également le récit du meurtrier invoquant la légitime défense quelques jours avant d’admettre — chose plus rare — avoir menti et parlant désormais “d’accident”. Le suivant dans cet version, le parquet de Nantes l’a mis en examen (puis remis en liberté sous contrôle judiciaire) pour “violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner” plutôt que pour “homicide volontaire”. Enfin, c’est la familiarité de la dignité de la famille de la victime qui, malgré tout, a appelé au calme au cours des affrontements évoqués plus bas; une responsabilité supplémentaire qu’on impose à celles et ceux qui n’ont pas le luxe de ne représenter qu’eux-mêmes. Le discours de son cousin se veut également conciliant: “ca aurait pu arriver à n’importe qui,” “on ne dit rien d’autre que c’est un flic qui l’a tué.”

Agrandissement : Illustration 3

Des paroles dignes, là encore; néanmoins, il est impossible de ne pas constater que la relation à la police est un rapport a la fois racial et géographique: les personnes racisées des quartiers populaires se trouvent dans une situation immensément plus précaire dans le rapport que leur impose la police, que celle que vivent les personnes blanches des centres-villes. C’est ce qui, au delà des solidarités locales avec la famille d’Aboubakar, rend ce meurtre inséparable de la condition des jeunes (en particulier des jeunes hommes racisés) des quartiers populaires et ainsi que certain d’entre eux, rejoints par des zadistes — jugé.e.s très respectueux et solidaires par les personnes à qui j’ai parlé — aient affronté une police revenue en force durant les jours qui ont suivi ce drame: des cailloux et des poubelles et voitures incendiées contre les grenades de gaz lacrymogènes, les flashball et les innombrables fourgons.

Agrandissement : Illustration 4

Dans le petit centre commercial dont une partie a été brûlée durant ces affrontements, une chose frappe: sur deux panneaux de bois aggloméré posés de manière temporaire là où des portes fenêtres se tenaient, une photo d’un parc urbain à San Francisco qui a été manifestement recollée après l’incendie. Il est peut-être dérisoire de s’y arrêter ici, mais il me semble que le contraste saisissant qu’elle présente dit quelque chose des politiques subies par le quartier du Breil.

Agrandissement : Illustration 5

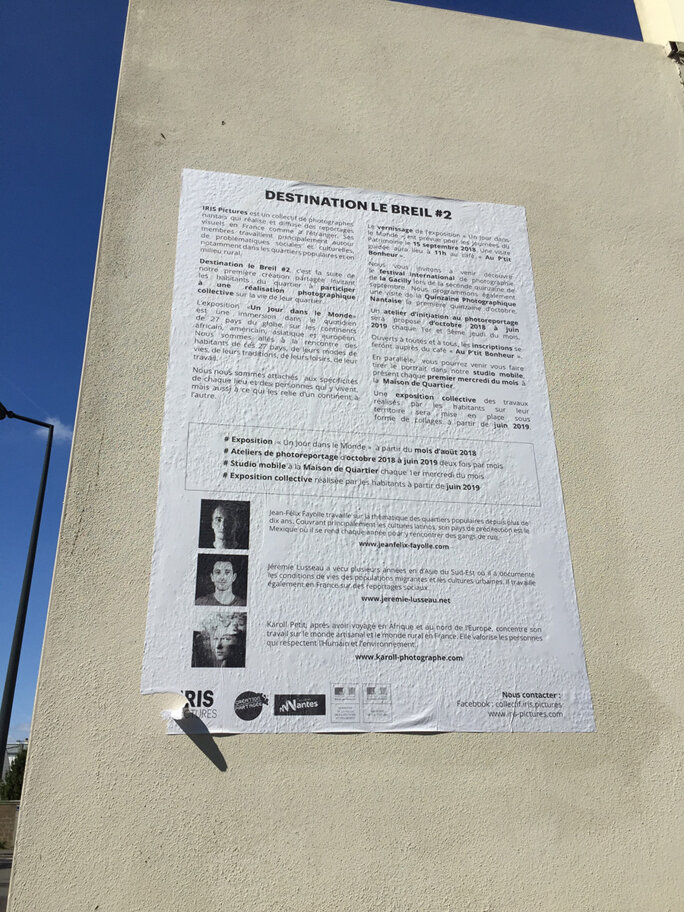
Agrandissement : Illustration 6
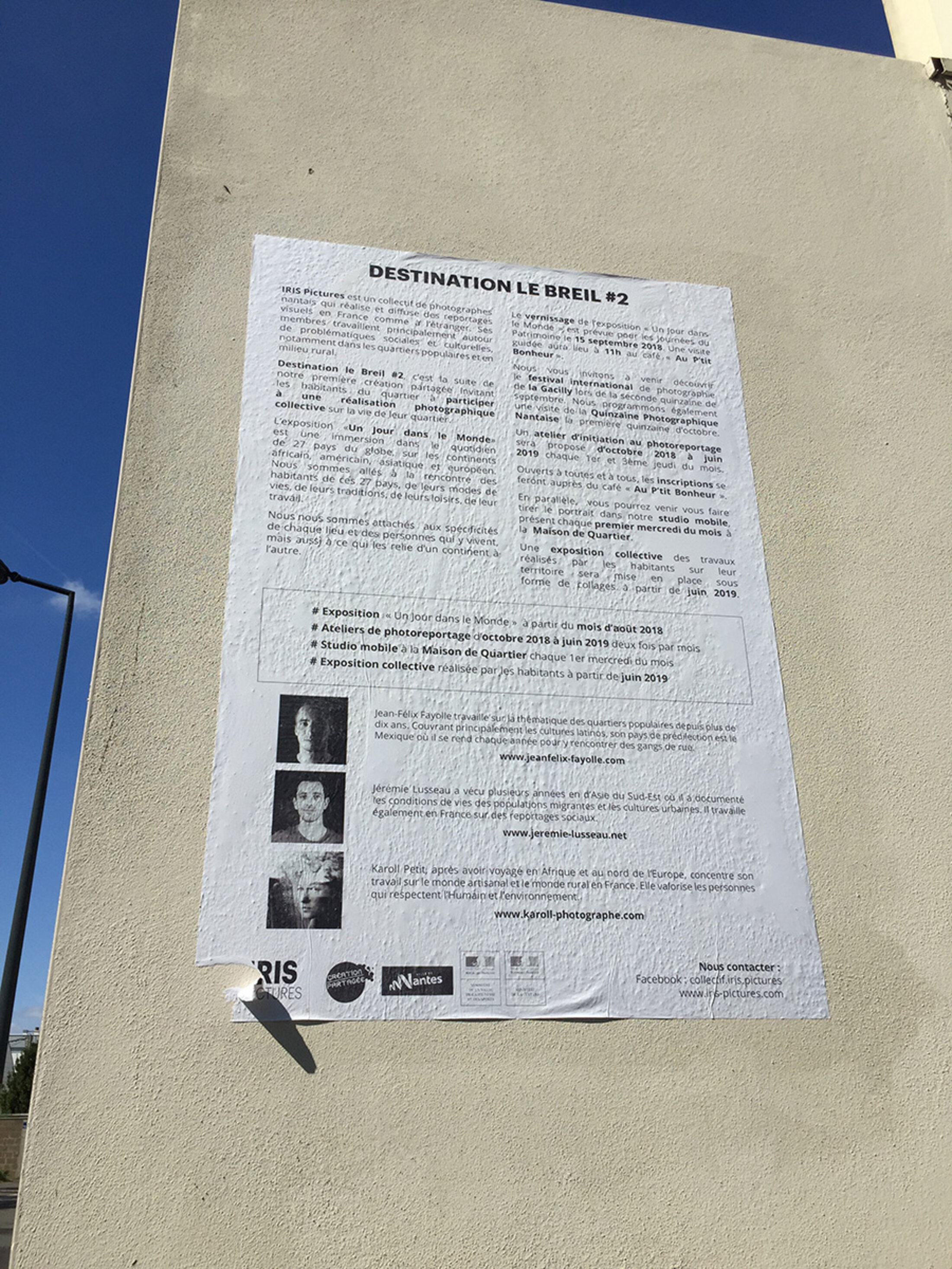
Cette photo fait partie d’une série qu’on retrouve sur de très nombreux murs d’immeubles du quartier dans des formats plus ou moins grands, présentant des scènes de vie dans un certain nombre de pays du monde. Quelques affiches nous informent de leur provenance et confirment le devinable: il s’agit d’un collectif de jeunes photographes nantais blancs n’habitant pas le quartier. Une visite de leur site nous informent que ceux-ci sont de grands voyageurs dont les intérêts se portent sur “l’humain” et “les populations marginalisées”, et que certains d’entre eux travaillent avec des ONG. Les photos affichées apparaissent alors à la fois comme des marqueurs d’un privilège économique et d’une liberté de circulation à l'échelle mondiale qui ne peuvent apparaître que comme des provocations dans un quartier ou le chômage atteint 40% et au sein duquel très peu de personnes ont le luxe de voyager. De même, les photos des dites “populations marginalisées” de divers endroits du monde semble suggérer aux résident.e.s que leur situation est à relativiser. “La misère, on la connait; c’est pas à nous qu’il faut montrer ça, mais plutôt aux gens du centre ville”, commente l’un des deux résidents qui m’accueillent. Mais bien-sur, il est inutile de s’acharner sur ces jeunes photographes; ceux-ci ne sont finalement que quelques uns des très nombreux/ses artistes en France à qui on a confié des missions “d’animation culturelle” sans jamais remettre en cause le fait que ces mêmes quartiers qui ne reçoivent que très peu de moyens pour développer leur propres projets. La plus grande responsabilité revient aux autorités qui organisent de telles expositions dont le caractère endogène au quartier révèle le paternalisme des relations qu’entretient la municipalité avec lui.

Agrandissement : Illustration 7


Agrandissement : Illustration 8

Une chose qui frappe également à la lecture du texte présentant l’exposition est le concept (non cité directement mais suggéré) de participation avec les habitant.e.s du quartier. Celui-ci se retrouve en grosses lettres sur un panneau publicitaire de la Coopérative du logement abordable dans le cadre de l’initiative “Habitat participatif” de la ville de Nantes. “Ici, concevez avec nous et vos voisins votre futur appartement sur mesure!” nous dit le panneau. Ici, c’est sur l’unique place du quartier. Celle-ci a été laissée à l’abandon (sans doute en prévision de ce chantier), mais les murets qui y demeurent servent à quelques jeunes hommes du quartier pour s’y rassembler. Le simulacre de démocratie que ces opérations immobilières dites “participatives” permettent d’auto-proclamer une légitimité aux transformations que subit le quartier.

Agrandissement : Illustration 9


Agrandissement : Illustration 10

Dans les années 1990, c'était un groupe de logements construits dans les années 1960 pour y loger des familles de harki a l’issue de la Revolution algérienne qui avaient été détruits pour laisser place à des pavillons dont les résident.e.s sont majoritairement des personnes de la classe moyenne blanche. Au moment de la “rénovation” du quartier — “un coup de peinture sur les façades” me dit un des résidents — ce sont même des terrains de football et de basket qui devront laisser la place à de nouveaux immeubles, renforçant la densité jugée déjà très dense par ses habitants, et retirant encore des espaces de socialité. Ne demeurent que quelques restes de pelouse mal entretenues entre les places de parking et les immeubles, un mini terrain de foot “pour les petits” et un mail de verdure devant l'école maternelle. Un accès au complexe sportif voisin eût pu être imaginé mais le mur qui le sépare du quartier (récemment entamé à coup de marteau par les jeunes du quartier) a été rénové et y a été ajouté, une lame de dents métalliques empêchant son escalade.

Agrandissement : Illustration 11

Dans les quartiers populaires, les espaces de potentiels rassemblement sont pensés comme autant de menaces au soi-disant “ordre public”. Pas étonnant des lors que les autorités cherchent à s’en débarrasser même si, bien-sûr, d’autres raisons que celle dite “sécuritaire” rentrent en jeu. Le prix de l’immobilier à Nantes par exemple connaît en ce moment une augmentation spectaculaire. La partie de la ville où se situe le Breil n’est pas proche du centre-ville; néanmoins, elle en subit également les conséquences et des diverses opérations de promotion immobilière sont à redouter dans le quartier également. Le fétiche de ladite “participation” en est souvent une incarnation permettant également aux architectes impliqués de se déresponsabiliser de leurs rôles au sein de cette violence capitaliste, puisque ceux/celles-ci se convainquent du caractère démocratique de ces opérations.

Agrandissement : Illustration 12

Bien-sûr, un certain nombre des considérations développées dans cet article semblent ne pas atteindre la même gravité que celle du meurtre d’Aboubakar Fofana qui en motivait pourtant l'écriture. Cependant, il est crucial de considérer ce qu’on a pris l’habitude sordide d'appeler “bavure” — bien que ce terme soit finalement approprié dans la dimension coloniale qu’il suggère à travers sa référence historique aux Brigades Agression Violence (BAV) de la police — dans un contexte politique a la fois local et national, historique et contemporain. Les conditions politiques qui font qu’un tel meurtre puisse avoir lieu sont aussi celles qui permettent que l'enquête soit bâclée et que personne au Breil n’ait eu de nouvelles du dossier depuis juillet malgré les promesses de seconde autopsie, d'expertise du pistolet et de reconstitution. Il est également à noter — c'est pourtant délicat, mais je trahirais une partie de ce que j’ai entendu au Breil si je le taisais — que la centralité politique, économique, culturelle et sociale française sur Paris se retrouve dans une certaine mesure dans le militantisme dont le langage, la perspective politique et la représentativité sont fortement accaparés par les mouvements parisiens — cet article ne fait pas exception. Ce qui se passe au Breil, c’est-à-dire le meurtre “du loup” et ses suites, mais aussi les conditions politiques d’existence de ce quartier populaire, devrait donc nous mobiliser tou.te.s au sein des divers forces qui s'associent aux luttes contre les violences policières. Comme toujours, cette mobilisation se doit d'être à la fois spécifique car seules les pressions semblent pouvoir faire avancer un dossier judiciaire autrement jugé d’avance, et générale car ce meurtre fait système et que nous ne pourrions mitiger l'urgence de son démantèlement.
Pour consulter des vidéos et comptes rendus de ces deux derniers moi au Breil, ainsi que pour suivre la vie politique du quartier, rendez vous sur Breil Jeunesse Solidarité.

Agrandissement : Illustration 13




