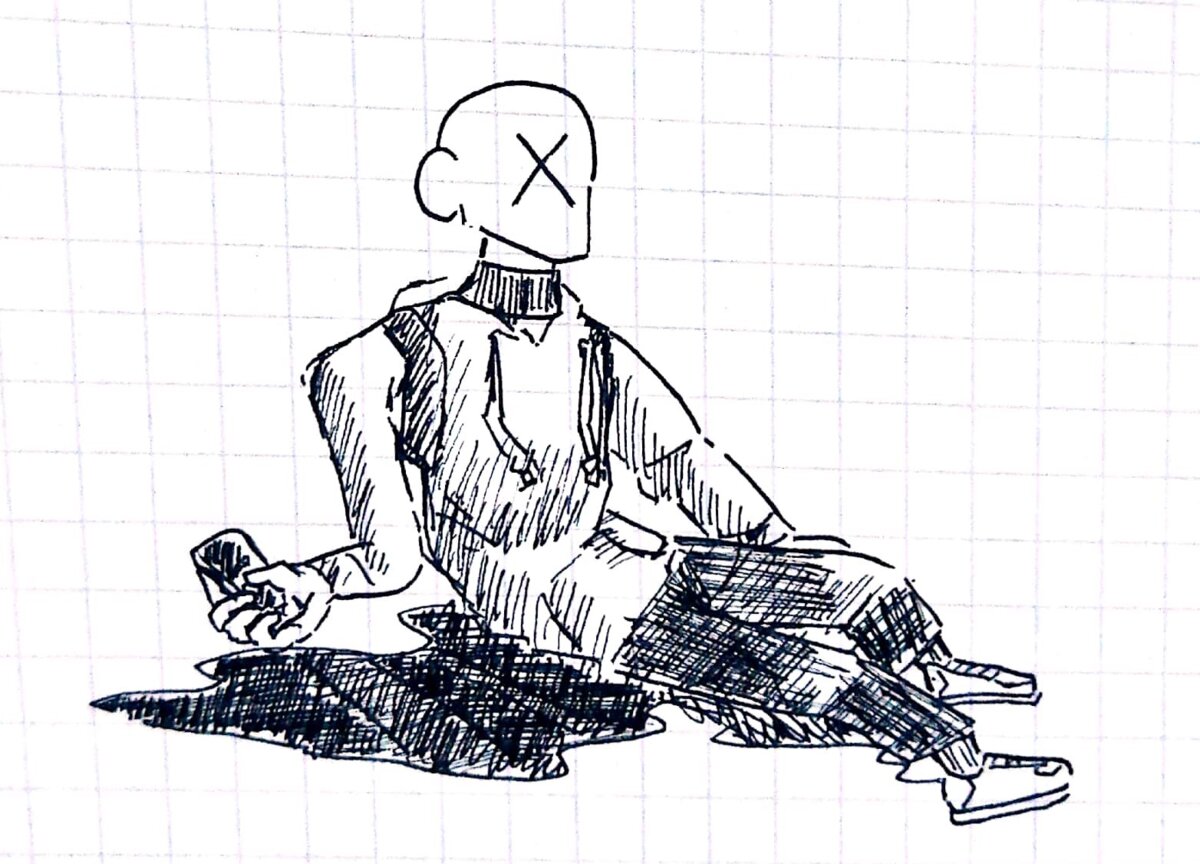
Agrandissement : Illustration 1
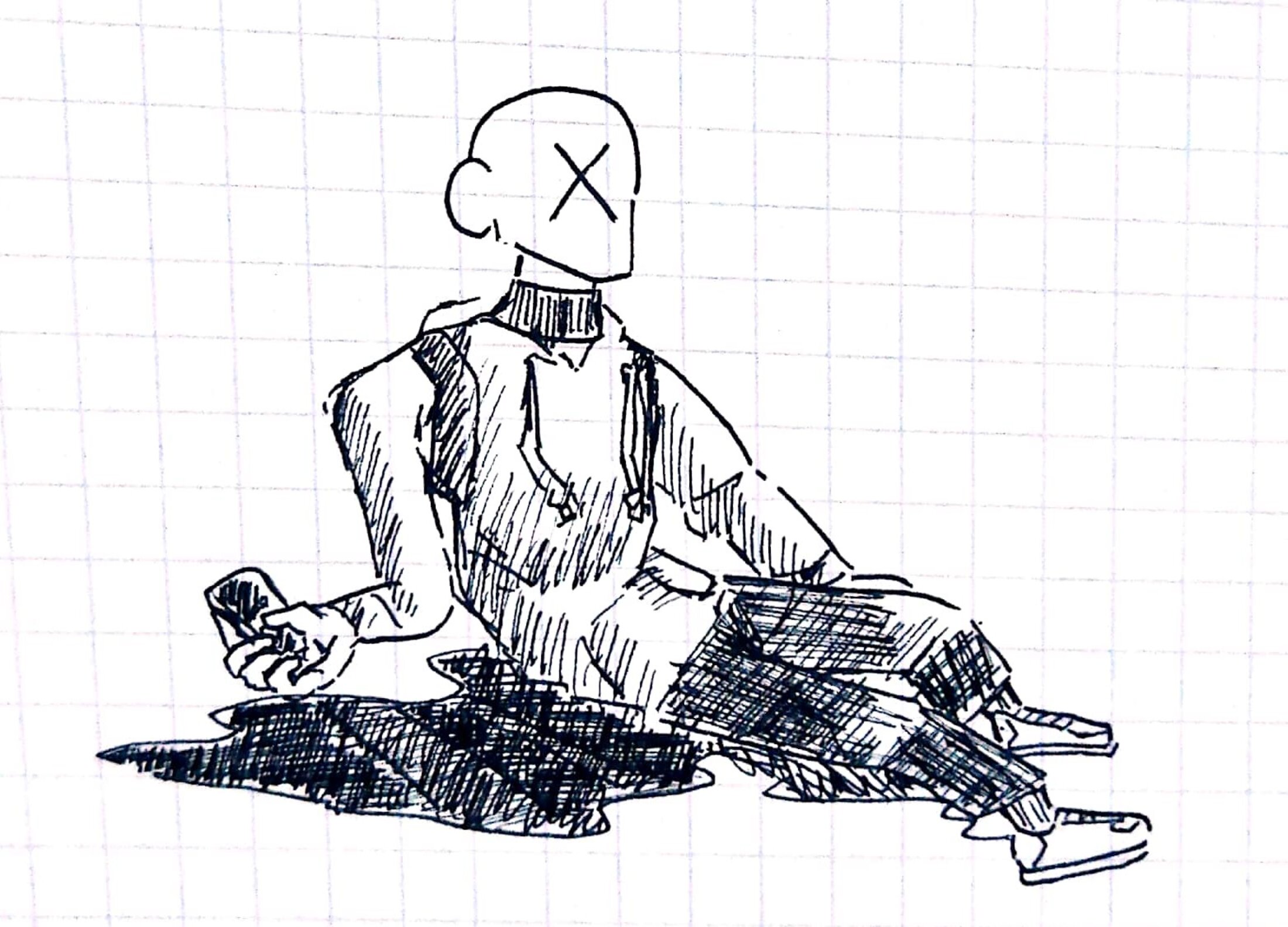
Il est sûr qu'il serait préférable de rouvrir tout de suite, dès demain, les universités dans une recherche à court-terme d'un bien-être étudiant. Le fait est, que nous sommes dans une situation de pandémie mondiale, incertaine, qui ne permet PAS, la réouverture complète des universités, du moins, pas comme avant.
Cet article souhaite faire l'état de l'enseignement supérieur, après la publication d'une lettre ouverte d'enseignant.es-chercheur.euses, ainsi qu'une lettre ouverte d'étudiant.es. De réussir à comprendre afin d'établir les solutions, les réflexions collectives et individuelles sur cette crise. De faire marcher les moteurs de l'enseignement dans la recherche d'une réelle continuité pédagogique.
2020-2021, une année universitaire (encore) sacrifiée ? Entre le bilan officiel et le bilan étudiant la colère gronde
Nous ne pouvons pas, rouvrir les universités. Il est matériellement impossible aujourd'hui de faire comme avant. Nous connaissons depuis peu un regain de contagion, ainsi qu'une perspective encore plus incertaine -la propagation du variant britannique bien plus contagieux ainsi que la découverte d'un nouveau variant inconnu qui a émergé au Japon. Nous devons réfléchir sur ces bases et ne pas bêtement demander à nos universités une réouverture de nos écoles, faire une rentrée tout ce qu'il y'a de plus normale, reprendre notre train-train quotidien école-fête. Il est vrai que nous n'avons éclipser réellement aucun des deux facteurs de contagion estudiantin à savoir : la réunion de nos camarades en salle de classe bondées et les fêtes alcoolisées sans masques ni protections. Quand bien même leurs tailles et leurs intensités ont diminué.
Il nous est nécessaire d'établir une base de réflexion : nous tournons aujourd'hui en moyenne à 17 000 nouveaux cas par jours, les nouveaux cas sont en constante augmentation, nos chiffres sont bien en deçà de la réalité et un nouveau confinement est à prévoir. Pourquoi ? Tout d'abord, si la mise en place fin-octobre d'un confinement précoce a eu un impact positif sur la courbe des contaminations, le déconfinement progressif lui a été un désastre en annihilant tous ses bénéfices. Ensuite, comme nous le disions plus tôt la nécessaire interaction entre nos camarades de classes n'a pas toujours permis de créer un effet de confinement idéal. Enfin, parce que certains de nos camarades de classes et d'université ont été obligé.es de revenir dans nos universités pour passer des partiels en présentiel.
Ainsi, on va évaluer ces prochains jours l'effet "fêtes de fin d'année". Alors que l'effet "couvre-feu" nous dessinait une certaine inefficacité, nous sommes aujourd'hui face à notre propre tort d'avoir maintenu des fêtes comme à la normale -oui, d'un point de vue psychologique, la population est à bout, mais nous développerons les moyens d'adoucir cela plus tard. L'enjeu en tant qu'étudiant.e est surtout de comprendre l'impact sur nos camarades précaires et proches du burn-out, ne trouvant plus sens à leurs études. Comment pouvons-nous remédier à cela ? Certainement pas en réouvrant les universités, à part pour risquer leurs vies.
L'Enseignement Supérieur inadapté : désastre d'un système vieillissant en fin de parcours
Entre le désastre des partiels en ligne à l'Université de Strasbourg et le stress occasionné aux étudiant.es, nous, étudiant.es, nous retrouvons, d'une part acculé.es, isolé.es les un.es des autres. D'autre part, des sphères de décisions et de changements de nos conditions de travail. Qu'est-ce qui pèche dans ces partiels et cours à distance ? Tournons-nous vers les sciences de la pédagogie, si un étudiant.e est désintéressé.e, démotivé.e par des cours, c'est à cause du format, de la manière d'enseigner. Avec tout le bon vouloir, chaque étudiant.e à fait l'expérience pendant ces confinements d'un éloignement et surtout d'un isolement, dû au fait que les étudiant.es ne se retrouvent plus dans ces cours monstrueusement longs et sans suivi pédagogique. Loin de moi de jeter la pierre aux enseignant.es, qui se retrouvent ell.eux aussi dans une situation d'inconnu. Mais cette situation révèle plusieurs symptômes des méthodes d'enseignements vieillissantes.
D'abord, n'oublions pas notre impréparation à tous.tes, que cela soit du côté technique (cf. la défaillance matérielle du serveur de l'université de Strasbourg, comme l'incapacité à proposer aux étudiant.es des solutions pour pouvoir suivre à distance des cours autre qu'en les invitant à venir au sein de l'établissement), que du côté méthode. Autrement dit, adapter un cours en distanciel ne signifie pas plaquer des méthodes pédagogiques en présentiel sur une situation de distanciel. Nous ne pouvons, que cela soit du côté des enseignant.es, ou des étudiant.es, suivre une dizaine de conférences, en amphi, de chez nous. Pour cause, sinon, nous le ferions depuis toujours. Non, l'enseignement n'est pas le même, les conditions d'études ne sont pas les mêmes et il est impossible pour nous de fournir le même travail d'écoute comme de réflexion, dans un amphithéâtre, que chez nous.
Ensuite, il est nécessaire de discuter dans la même idée de l'organisation des partiels. Je suis étudiant à Sciences Po Strasbourg, (et je suis conscient des privilèges que cela peut me conférer), mais en ayant discuté avec les étudiant.es des autres Sciences Po, des autres départements de mon université et des autres universités, on a pu constater une chose : les partiels en synchrone sont un désastre. En reprenant la réflexion plus haut, comment est-il possible que cela ne pose aucun problème ? Et quand bien même les notes prendraient en compte cela, l'étudiant.e face à un devoir qu'il sait mauvais, ou à un rendu qu'il sait qu'il aurait pu faire mieux augmente son mal-être, participe à son isolement, participe à son mécontentement. Et bien-sûr, les soucis techniques sont à prendre en compte, entre les connexions lentes et le matériel vieillissant, ce sont les plus précaires d'entre nous, mais pas seulement, qui en pâtissent le plus. Alors, il est nécessaire de repenser cela, et nous y venons, aux solutions.
La nécessité d'un renouveau pédagogique : une réflexion collective
Comment ces partiels synchrones aurait-pu être mieux organisés ? Tout d'abord, analysons le problème de ces partiels synchrones. Est-ce faire preuve de malhonnêteté que de dire que la préparation à ces partiels était moindre ? Que tous les étudiant.es avaient devant leurs yeux, leurs cours ? Encore une fois, les étudiant.es s'adaptent à la contrainte pour espérer le mieux. Mais cela signifie surtout, que ces partiels étaient vidés de leur substance n'étant plus qu'un "recrachage" de cours. Car si cette pratique d'évaluation peut être critiquable, car nous sommes en études supérieures, ne devrions-nous pas être amenés à penser ? Mais surtout, nous en sommes à un niveau où l'étudiant.e, tel.le un.e dactylographe effectue des bêtes copié-collés afin de reprendre la même réflexion dument développée par son enseignant.e. Nous en sommes à cela, ce n'est plus recracher mais repasser un cours pour le lisser et y ajouter quelques paillettes pour faire croire à de "l'honnêteté intellectuelle".
Nous devons être écoutés, sur les formes les plus à même de construire des évaluations épanouissantes et qui créeraient de la réflexion. L'année passée, pendant le premier confinement, l'examen de sociologie demandait de réaliser une réflexion sur deux questions, de manière synthétique en une semaine. D'une part, l'étudiant.e une fois son cours digéré, était amené.e à construire soi-même une pensée. D'autre part, l'enseignant.e, en charge de la correction, était assuré.e de ne pas avoir son propre cours sous les yeux, et surtout de ne pas avoir une charge de travail trop intense. J'invite tous les enseignant.es à prendre exemple sur cela. Mais les partiels ne sont pas tout, discutons maintenant des cours.
Comme dit plutôt, un cours, ça n'est pas seulement plaquer des méthodes pédagogiques de dictée sur un logiciel de rediffusion. Malheureusement, il aurait été nécessaire pour certain.nes enseignant.es de ell.eux aussi s'adapter. Le numérique peut créer du rapprochement, pourquoi ne pas l'avoir utilisé afin de créer plus d'interaction ? Pourquoi les promotions, comptant de trop nombreuses personnes, n'ont pas été divisées afin de réduire les effectifs, créer des cours réduits, qui auraient permis à nombre d'élèves de ne pas s'éparpiller, ne rien comprendre, et fermer son ordinateur en se disant : "mais de quoi cette matière parlait en réalité ?". Oui, les enseignant.es sont trop peu nombreux.ses, mal payé.es, et ce qu'iels demandent c'est de l'interaction, du vivant, il me semble que c'est aussi à ell.eux de créer cette stimulation sociale et intellectuelle. Enfin, on sait dès à présent que le virus circule surtout dans des lieux fermés, et certain.es enseignant.es ont proposé de faire des cours en plein air. À vrai dire, en plein mois de janvier, et étant plutôt frileux, je ne sais pas si cela me motiverait, mais le printemps arrive, et à ce moment-là je pense que la question devrait revenir sur la table. Dans l'immédiat, il pourrait être possible de réaliser des cours en groupes réduits, mais là encore, la légère expérience que certain.nes étudiant.es ont eu de ces cours, se présente de la sorte : dans des classes supposées ne de devoir compter plus de 20 personnes (ce qui est déjà trop), on en comptait 30, voir 40 !
Alors, il est certain que la pandémie n'est pas finie, il est certain que rouvrir les universités ne sera qu'un placebo, pire, un moteur de la formation de nouveaux clusters. Il est certain que mes réflexions sont peut-être trop pauvres et ne prennent pas en compte un certain nombre de facteurs. Mais, sur l'autel du financement des universités, les enseignant.es ET les étudiant.es sont sacrifié.es et il est nécessaire que l'on se révolte, il est nécessaire que nous prenions tous.tes le temps de discuter, de réfléchir collectivement, d'arrêter de penser notre petite vie, de s'accrocher à tout prix à notre routine passée. Il est nécessaire que nous nous organisions, créons des fils de solidarités, assurons-nous qu'ils ne soient pas coupés, assurons-nous que, nous, étudiant.es, nous soyons écouté.es.
(- Merci Alice pour la correction)



